[page i]
LE
RÈGNE ANIMAL
DISTRIBUÉ
D'APRÈS SON ORGANISATION.
[page ii]
IMPRIMERIE D'HIPPOLYTE TILLIARD,
RUE DE LA HARPE, N° 78.
[page iii]
LE
RÈGNE ANIMAL
DISTRIBUÉ D'APRES SON ORGANISATION,
POUR SERVIR DE BASE
A L'HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX
ET D'INTRODUCTION A L'ANATOMIE COMPARÉE.
PAR M. LE BARON CUVIER,
GRAND OFFICER DE LA LÉGION-D'HONNEUR, CONSEILLER-D'ÉTAT ET AU CONSEIL ROYAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, L'UN DES QUARANTE DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE, SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES, MEMBRE DES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS ROYALES DES SCIENCES DE LONDRES, DE BERLIN, DE PÉTERSBOURG, DE STOCKHOLM, D'ÉDIMBOURG, DE COPENHAGUE, DE GŒTTINGUE, DE TURIN, DE BAVIÈRE, DE MODÈNE, DES PAYS-BAS, DE CALCUTTA, DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LONDBES, etc.
AVEC FIGURES DESSINÉES D'APRÈS NATURE.
NOUVELLE ÉDITION, REVUE ET AUGMENTÉE.
TOME III.
Paris,
CHEZ DÉTERVILLE, LIBRAIRE,
RUE HAUTEFEUILLE, N° 8;
ET CHEZ CROCHARD, LIBRAIRE,
CLOÎTRE SAINT-BENOÎT, N° 16.
1830.
[page iv]
[page v]
AVERTISSEMENT.
Pour laisser ensemble toute la portion de cet ouvrage dont M. Latreille a bien voulu se charger, j'ai réuni dans ce volume, immédiatement après l'embranchement des mollusques et la classe des vers articulés, tout l'embranchement des zoophytes qui, dans l'ordre de ma méthode, n'aurait dû venir qu'après la classe des insectes; en sorte que le volume actuel rassemble précisément les animaux dont Linnæus formaitsa classe des vers. Sa publication retardée par diverses circonstances, a obligé aussi d'y placer la table alphabétique de tout l'ouvrage, mais le lecteur prévenu, ne sera point embarrassé par cette interversion.
Les animaux dont j'y traite sont ceux qui, dans ces derniers temps, ont donné lieu à plus de recherches et de découvertes, et qui de ma part ont exigé plus de travail et plus de chan-
b
[page] vi
gements dans les genres et dans la distribution des espèces. J'ai cité religieusement comme à mon ordinaire, les observateurs dont les ouvrages m'ont fourni des données; on verra que j'ai surtout profité des travaux de M. de Lamarck, que les sciences viennent de perdre, et de MM. de Blainville, Savigny, de Ferussac, des Hayes, d'Orbigny, Rudolphi, Bremser, Otto, Leuckart, Chamisso, Eisenhardt, Rang, Sowerby, Charles Desmoulins, Quoy et Gaymard, delle Chiaje, Defrance, Deslonchamp, Audouin, Milne Edwards, Dugès, Moquin Tandon, Ranzani, Morren, et nombre d'autres savants observateurs, que j'ai eu soin de nommer.
Quelque lenteur que j'aie mise à publier ce volume, j'ai encore le regret de n'avoir point reçu à temps quelques ouvrages récents qui m'auraient encore procuré de bons matériaux, particulièrement le Système des Acalèphes de M. Eschholtz (Berlin, 1829, in-4°), que je reçois au moment ùu je livre cette feuille à l'impression, et l'article ZOOPHYTES du Dictionnaire des Sciences naturelles de M. de Blainville, qui n'est point encore imprimé.
Au Jardin du Roi, mars 1830.
[page vii]
TABLE MÉTHODIQUE
DU TROISIÈME VOLUME.
| Pag. | |
| DEUXIÈME GRANDE DIVISION DU RÈGNE ANIMAL. | |
| MOLLUSQUES | 1 |
| Leur division en six classes | 6 |
| CÉPHALOPODES | 8 |
| Seiches | 11 |
| Poulpes | ib. |
| Polipes d'Aristote | 12 |
| Elédons d'Aristote | ib. |
| Argonautes | ib. |
| Bellérophes | 14 |
| Calmars | ib. |
| Loligopsis | ib. |
| Calmars proprement dits | ib. |
| Onychotheuthis | 15 |
| Sépioles | ib. |
| Sépiotheutes | 16 |
| Seiches proprement dites | ib. |
| Nautiles | 17 |
| Spirules | ib. |
| Nautiles proprement dits | ib. |
| Lituus | 18 |
| Orholes | ib. |
| Orthocératites | ib. |
| Bélemnites | 19 |
| Actinocamax | 20 |
| Ammonites | ib. |
| Ammonites propres | ib. |
| Ammonites | 21 |
| Cératites | ib. |
| Orbulites | ib. |
| Scaphites | ib. |
| Baculites | ib. |
| Hamites | ib. |
| Turrilites | ib. |
| Camérines | 22 |
| Sidérolithes | ib. |
| Hélicostégues | 23 |
| Hélicostégues ammonoïdes | 24 |
| Hélicostégues turbinoïdes | ib. |
| Stycostégues | ib. |
| Enallostégues | 25 |
| PTÉROPODES | 26 |
| Clio | ib. |
| Cymbulies | 27 |
| Pneumodermes | ib. |
| Limacine | 28 |
| Hyales | ib. |
| Cléodores | 29 |
| Cléodores propres | ib. |
| Creséis | ib. |
| Cuviéries | ib. |
| Psychées | ib. |
| Eurybies | ib. |
| Pyrgo | 30 |
| GASTÉROPODES | ib. |
| Leur division en ordres | 34 |
| PULMONÉS | 37 |
| Pulmonés terrestres | ib. |
| Limaces | ib. |
[page] viii
| Limaces proprement dites | ib. |
| Arions | 38 |
| Limas | ib. |
| Vaginules | 39 |
| Testacelles | ib. |
| Parmacelles | 40 |
| Escargots | ib. |
| Escargots proprement dits | ib. |
| Vitrines | 42 |
| Bulimes terrestres. | |
| Bulimes proprement dits | ib. |
| Maillots | 43 |
| Grenailles | 44 |
| Ambrettes | ib. |
| Nompareilles | ib. |
| Agathines | 45 |
| Pulmonés aquatiques | 46 |
| Onchidies | ib. |
| Planorbes | 47 |
| Limnées | 48 |
| Physes | ib. |
| Scarabes | 49 |
| Auricules | ib. |
| Mélampes | 50 |
| NUDIBRANCHES | ib. |
| Doris | 51 |
| Onchidores | 52 |
| Plocamocères | ib. |
| Polycères | ib. |
| Tritonies | ib. |
| Théthys | 53 |
| Scyllées | 54 |
| Glaucus | ib. |
| Laniogères | 55 |
| Eolides | ib. |
| Cavolines | ib. |
| Flabellines | ib. |
| Tergipes | 56 |
| Busiris | ib. |
| Placobranches | ib. |
| INFÉROBRANCHES | 57 |
| Phyllidies | ib. |
| Diphyllides | ib. |
| TECTIBRANCHES | 58 |
| Pleurobranches | ib. |
| Pleurobranchæa | 59 |
| Aplysies | 60 |
| Dolabelles | 61 |
| Notarchus | 62 |
| Bursatelles | ib. |
| Acères | ib. |
| Bullées | 63 |
| Bulles | ib. |
| Acères propres | 64 |
| Gastroptères | 65 |
| Ombrelles | ib. |
| HÉTÉROPODES | 66 |
| Ptérotrachea | 67 |
| Carinaires | 68 |
| Atlantes | ib. |
| Firoles | 69 |
| Timoriennes | ib. |
| Monophores | 70 |
| Phylliroés | ib. |
| PECTINIBRANCHES | ib. |
| Trochoïdes | 72 |
| Toupies | 73 |
| Tectaires | ib. |
| Epérons | ib. |
| Roulettes | ib. |
| Cantharides | 74 |
| Entonnoirs | ib. |
| Télescopes | ib. |
| Trochus | ib. |
| Cadrans | 75 |
| Evomphales | ib. |
| Sabots | ib. |
| Sabots proprement dits | ib. |
| Dauphinules | 76 |
| Pleurotomaires | ib. |
[page] ix
| Turritelles | 77 |
| Scalaires | ib. |
| Cyclostomes | 78 |
| Valnées | ib. |
| Paludines | 79 |
| Littorines | 80 |
| Monodontes | ib. |
| Phasianelles | 81 |
| Ampullaires | ib. |
| Lanistes | 82 |
| Hélicines | ib. |
| Ampulines | ib. |
| Olygires | ib. |
| Mélanies | 82 |
| Rissoaires | 83 |
| Mélanopsides | ib. |
| Pirènes | ib. |
| Actéons | 84 |
| Pyramidelles | ib. |
| Janthines | ib. |
| Nérites | 85 |
| Natice | ib. |
| Nérites propres | ib. |
| Vélates | 86 |
| Néritines | ib. |
| Clithons | ib. |
| Capuloïdes | ib. |
| Cabochons | 87 |
| Hipponyces | ib. |
| Crépidules | ib. |
| Piléoles | 88 |
| Septaires (Navicelles Lam.) | ib. |
| Calyptrées | ib. |
| Siphonaires | 89 |
| Sigarets | 90 |
| Coriocelles | ib. |
| Cryptostomes | ib. |
| Buccinoides | 91 |
| Cones | ib. |
| Porcelaines | 92 |
| Ovules | 93 |
| Ovules propres | ib. |
| Navettes | ib. |
| Tarières | 94 |
| Volutes | ib. |
| Olives | ib. |
| Volvaires | 95 |
| Volutes propres | ib. |
| Cymbium | ib. |
| Voluta | 96 |
| Marginelles | ib. |
| Colombelles | ib. |
| Mitres | ib. |
| Cancellaires | 97 |
| Buccins | ib. |
| Buccins propres | ib. |
| Nasses | 98 |
| Eburnes | ib. |
| Ancillaires | ib. |
| Tonnes | 99 |
| Tonnes propres | ib. |
| Perdrix | ib. |
| Harpes | ib. |
| Pourpres | ib. |
| Licornes | 100 |
| Sistres. (Ricinules lam.) | ib. |
| Choncholepas | ib. |
| Casques | ib. |
| Heaumes | 101 |
| Vis | ib. |
| Cérithes | ib. |
| Potamides | 102 |
| Rochers | ib. |
| Murex | 103 |
| Murex proprement dits | ib. |
| Brontes | ib. |
| Typhis | ib. |
| Chicoracées | ib. |
| Aquilles | 104 |
| Lotoriums | ib. |
| Tritoniums | ib. |
| Trophones | ib. |
| Ranelles | ib. |
[page] x
| Apolles | 104 |
| Fuseaux | 105 |
| Fuseaux proprement dits | ib. |
| Lathires | ib. |
| Struthiolaires | ib. |
| Pleurotomes | ib. |
| Clavatules | ib. |
| Pyrules | 106 |
| Carreaux | ib. |
| Fasciolaires | ib. |
| Turbinelles | ib. |
| Strombes | 107 |
| Strombes propres | ib. |
| Ptérocéres | ib. |
| Rostellaires | ib. |
| Hippocrènes | 108 |
| TUBULIBRANCHES | ib. |
| Vermets | ib. |
| Magiles | 109 |
| Siliquaires | ib. |
| SCUTIBRANCHES | 110 |
| Ormiers | 111 |
| Haliotides propres | ib. |
| Padolles | ib. |
| Stomates | ib. |
| Fissurelles | 112 |
| Emarginules | ib. |
| Pavois | 113 |
| CYCLOBRANCHES | ib. |
| Patelles | 114 |
| Oscabrions | ib. |
| ACÉPHALES | 115 |
| ACÉPHALES TESTACÉS | 117 |
| Ostracés | 119 |
| Acarde | ib. |
| Radiolites | ib. |
| Sphérulites | 120 |
| Calcéoles | ib. |
| Hippurites | ib. |
| Batolithes | ib. |
| Huîtres | 120 |
| Huîtres propres | 121 |
| Gryphées | 122 |
| Peignes | ib. |
| Limes | 123 |
| Houlettes | 124 |
| Hinnites | ib. |
| Plagiostomes | ib. |
| Pachytes | 125 |
| Dianchores | ib. |
| Podopsides | ib. |
| Anomies | 126 |
| Placunes | ib. |
| Spondyles | 127 |
| Plicatules | ib. |
| Marteaux | 128 |
| Vulselles | ib. |
| Pernes | ib. |
| Crénatules | 129 |
| Gervilles | ib. |
| Inocérames | ib. |
| Catilles | 130 |
| Pulvinites | ib. |
| Ethéries | ib. |
| Arondes | 131 |
| Pentadines | ib. |
| Avicules | ib. |
| Jambonneaux | ib. |
| Arches | 132 |
| Arches propres | 133 |
| Cucullées | ib. |
| Pétoncles | ib. |
| Nucules | 134 |
| Trigonies | ib. |
| Mytilacés | 135 |
| Moules | ib. |
| Moules propres | 136 |
| Modioles | ib. |
| Lithodomes | ib. |
| Anodontes | 137 |
| Iridine | 138 |
| Dipsade | ib. |
[page] xi
| Mulètes | 138 |
| Hyries | 139 |
| Castalies | ib. |
| Cardites | ib. |
| Cypricardes | 140 |
| Coralliophages | ib. |
| Vénéricardes | ib. |
| Crassatelles | ib. |
| Camacécs | 141 |
| Chama | ib. |
| Tridacnes | ib. |
| Tridacnes propres | 142 |
| Hippopes | ib. |
| Cames proprement dites | 143 |
| Dicérates | ib. |
| Isocardes | ib. |
| Cardiacés | 144 |
| Bucardes | ib. |
| Hémicardes | 145 |
| Donaces | ib. |
| Cyclades | 146 |
| Cyrèues | ib. |
| Cyprines | ib. |
| Galathées | 147 |
| Corbeilles | ib. |
| Tellines | ib. |
| Loripèdes | 148 |
| Lucines | 149 |
| Ongulines | ib. |
| Vénus | |
| Vénus propres | 150 |
| Astartés ou Cressines | ib. |
| Cythérées | ib. |
| Capses | 151 |
| Pétricoles | 152 |
| Corbules | ib. |
| Mactres | ib. |
| Mactres propres | 153 |
| Lavignons | ib. |
| Enfermés | 153 |
| Myes | 154 |
| Lustraires | ib. |
| Myes propres | 155 |
| Anatines | ib. |
| Solémyes | ib. |
| Glycymères | ib. |
| Panopes | 156 |
| Pandores | ib. |
| Byssomies | ib. |
| Hyatelles | 157 |
| Solens | ib. |
| Solens propres | ib. |
| Sanguinolaires | 158 |
| Psammobies | ib. |
| Psammothées | ib. |
| Pholades | ib. |
| Tarets | 159 |
| Fistulanes | 160 |
| Gastrochènes | ib. |
| Térédines | 161 |
| Clavagelles | ib. |
| Arrosoirs | ib. |
| ACÉPHALES SANS COQUILLES | 162 |
| Simples | 163 |
| Biphores | ib. |
| Thalia | 164 |
| Salpa propres | 165 |
| Ascidies | ib. |
| Agrégés | 167 |
| Botrylles | 168 |
| Pyrosomes | ib. |
| Polyclinum | 169 |
| BRACHIOPODES | 170 |
| Lingale | ib. |
| Térébratules | 171 |
| Spirifères | 172 |
| Thécidées | 173 |
| Orbicules | ib. |
| Discines | ib. |
[page] xii
| Cranies | ib. |
| CIRRHOPODES | 174 |
| Anatifes | 175 |
| Pentalasmis | ib. |
| Pouce-Pieds | 176 |
| Cineras | 177 |
| Otions | ib. |
| Tetralasmis | ib. |
| Glands de mer | ib. |
| Balanes | 178 |
| Acastes | ib. |
| Conies | ib. |
| Asemes | ib. |
| Pyrgomes | ib. |
| Ochthosies | 179 |
| Creusies | ib. |
| Coronules | ib. |
| Tubicinelles | ib. |
| Diadémes | ib. |
| TROISIÈME GRANDE DIVISION DU RÈGNE ANIMAL. | |
| ANIMAUX ARTICULÉS | 180 |
| Leur distribution en quatre classes | 182 |
| LES ANNELIDES | 186 |
| Leur division | 187 |
| ANNELIDES TUBICOLES | 189 |
| Serpules | 190 |
| Spirorbes | 191 |
| Sabelles | ib. |
| Térébelles | 193 |
| Amphitrites | 194 |
| Syphostoma | 196 |
| Dentales | ib. |
| DORSIBRANCHES | 197 |
| Arénicoles | ib. |
| Amphinomes | 198 |
| Chloés | ib. |
| Fléiones | 199 |
| Euphrosines | ib. |
| Hipponoés | ib. |
| Eunices | ib. |
| Lysidices | 200 |
| Aglaures | 201 |
| Néréides | ib. |
| Phyllodoces | 202 |
| Alciopes | ib. |
| Spio | 203 |
| Syllis | ib. |
| Glycères | ib. |
| Nephthys | ib. |
| Lombrinères | 204 |
| Aricies | ib. |
| Hesiones | ib. |
| Ophélies | 205 |
| Cirrhatules | ib. |
| Palmyres | ib. |
| Aphrodites | 206 |
| Halithées | ib. |
| Polynoé | 207 |
| Sigalions | ib. |
| Acoétes | ib. |
| Chætoptères | 208 |
| ABRANCHES | 209 |
| Abranches sétigères | ib. |
| Lombrics | ib. |
| Lombrics propres | ib. |
| Enterions | 210 |
| Hypogæons | 211 |
| Trophonies | ib. |
| Naïades | ib. |
| Climènes | 212 |
| Abranches sans soies | ib. |
| Sangsues | ib. |
| Sangsues propres | 213 |
| Hæmopis | 214 |
| Bdelles | ib. |
| Nephelis | ib. |
| Trochéties | 215 |
| Aulastome | ib. |
| Branchiobdelles | ib. |
| Hæmocharis | ib. |
[page] xiii
| Albiones | 216 |
| Branchellion | ib. |
| Clepsines | ib. |
| Phyllines | 217 |
| Malacobdelles | ib. |
| Dragoneaux | ib. |
| QUATRIÈME EMBRANCHEMENT ou GRANDE DIVISION DES ANIMAUX. | |
| LES ZOOPHYTES ou ANIMAUX RAYONNÉS | 218 |
| Leur division | 220 |
| ECHINODERMES | 223 |
| PÉDICELLÉS | 224 |
| Astéries | 225 |
| Astéries propres | ib. |
| Ophiures | 228 |
| Euryales (Gorgonocéphales, Leach.) | ib. |
| Comatules (Alecto, Leach.) | ib. |
| Encrines | 229 |
| Apiocrinites | 230 |
| Encrinites | ib. |
| Pentacrinites | ib. |
| Platycrinites | ib. |
| Cyathocrinites | ib. |
| Actinocrinites | ib. |
| Rhodocrinites | ib. |
| Eugeniacrinites | ib. |
| Oursins | ib. |
| Oursins proprement dits | 232 |
| Echinonés | 234 |
| Nucléobites | ib. |
| Galérites | ib. |
| Scutelles | 235 |
| Rotulæ | ib. |
| Cassidules | ib. |
| Ananchites | 236 |
| Clypéastres | ib. |
| Fibulaires | 237 |
| Spatangues | ib. |
| Brissoides | ib. |
| Brifrus | ib. |
| Holothuries | 238 |
| ECHINODERMES SANS PIEDS | 241 |
| Molpadies | ib. |
| Myniades | ib. |
| Priapules | 242 |
| Lithodermes | ib. |
| Siponcles | ib. |
| Bonellies | 243 |
| Thalassémes | 244 |
| Thalassémes propres | ib. |
| Echiures | ib. |
| Sternapsis | 245 |
| INTESTINAUX | ib. |
| Leur division | 246 |
| CAVITAIRES | 247 |
| Filaires | 248 |
| Tricocéphales | 249 |
| Trichostomes | ib. |
| Oxyures | 250 |
| Cucullans | ib. |
| Ophiostomes | ib. |
| Ascarides | ib. |
| Strongles | 252 |
| Spiroptères | 253 |
| Physaloptères | ib. |
| Sclérostomes | 254 |
| Liorhynques | ib. |
| Linguatules | ib. |
| Prionodermes | 255 |
| Lernées | ib. |
| Lernées propres | 256 |
| Pennelles | ib. |
| Sphyrions | 257 |
| Anchorelles | ib. |
[page] xiv
| Brachielles | 257 |
| Clavelles | 258 |
| Condracanthes | ib. |
| Nemerte | 259 |
| Tubulaires | ib. |
| Ophiocéphales | ib. |
| Cérébratules | 260 |
| PARENCHYMATEUX | ib. |
| Acanthocéphales | ib. |
| Echinorinques | 261 |
| Hæruca | 262 |
| Trématodes | ib. |
| Douves | ib. |
| Festucaires | ib. |
| Strigées | 263 |
| Géroflés | ib. |
| Douves propres | ib. |
| Holostomes | 264 |
| Polystomes | ib. |
| Cyclocotyles | 265 |
| Tristomes | ib. |
| Hectocotyles | ib. |
| Aspidogaster | 266 |
| Planaires | ib. |
| Prostomes | 267 |
| Derostomes | 268 |
| Phænicures ou Vertumnus | ib. |
| Tenïoides | ib. |
| Tænia | ib. |
| Tricuspidaires | 270 |
| Botriocéphales | ib. |
| Dibothryorhynques | ib. |
| Floriceps | ib. |
| Tétrarinques | 271 |
| Tentaculaires | ib. |
| Cysticerques | ib. |
| Cœnures | 272 |
| Scolex | 273 |
| Cestoïdes | ib. |
| Ligules | ib. |
| ACALÉPHES, vulgairement ORTIES DE MER | 274 |
| ACALÉPHES SIMPLES | 275 |
| Méduses | ib. |
| Méduses propres | 276 |
| Equorées | ib. |
| Phorcynies | ib. |
| Fovéolies | ib. |
| Pélagie | ib. |
| Cyanées | 277 |
| Rhyzostomes | 278 |
| Céphées | 279 |
| Cassiopées | ib. |
| Astomes | ib. |
| Bérénices | 280 |
| Eudores | ib. |
| Carybdées | ib. |
| Beroés | ib. |
| Idya | 281 |
| Doliolum | 282 |
| Callianires | ib. |
| Janires | ib. |
| Alcinoés | ib. |
| Ocyroés | ib. |
| Ceste | ib. |
| Porpites | 283 |
| Vélelles | 284 |
| ACALÉPHES HYDROSTATIQUES | ib. |
| Physalies | 285 |
| Physsophores | 286 |
| Physsophores propres | ib. |
| Hippopodes | 287 |
| Cupulites | ib. |
| Racemides | ib. |
| Rhizophyzes | ib. |
| Stéphanomies | 288 |
| Diphyes | ib. |
| Diphyes propres | ib. |
| Calpes | 289 |
[page] xv
| Abyles | 289 |
| Cuboïdes | ib. |
| Navicules | ib. |
| POLYPES | ib. |
| POLYPES CHARNUS, VULGAIREMENT ORTIES DE MER FIXES | 290 |
| Actinies | 291 |
| Actinies propres | ib. |
| Thalassianthes | 293 |
| Discosomes | ib. |
| Zoanthes | ib. |
| Lucernaires | ib. |
| POLYPES GÉLATINEUX | 294 |
| Polypes à bras | ib. |
| Corines | 295 |
| Cristatelles | 296 |
| Vorticelles | ib. |
| Pédicellaires | 297 |
| POLYPES A POLYPIERS | ib. |
| Polypes à tuyaux | 298 |
| Tubipores | ib. |
| Tubulaires | 299 |
| Tubulaires marines | ib. |
| Tibianes | ib. |
| Cornulaires | 300 |
| Anguinaires | ib. |
| Campanulaires | ib. |
| Clyties | ib. |
| Laomédies | ib. |
| Sertulaires | ib. |
| Aglaophénies | 301 |
| Amatia | ib. |
| Antennulaires | ib. |
| Sertulaires propres | ib. |
| Polypes à cellules | 302 |
| Cellulaires | ib. |
| Crisies | ib. |
| Acamarchis | ib. |
| Loricules | 303 |
| Eucratées | 303 |
| Electres | ib. |
| Flustres | ib. |
| Cellépores | 304 |
| Tubulipores | 305 |
| Corallines | ib. |
| Corallines propres | ib. |
| Amphiroés | 306 |
| Janies | ib. |
| Cymopolies | ib. |
| Pénicilles | ib. |
| Halimèdes | 307 |
| Flabellaires | ib. |
| Galaxaures | ib. |
| Liagores | ib. |
| Anadiomènes | 308 |
| Acétabules | ib. |
| Polyphyres | ib. |
| Polypes corticaux | 309 |
| Cératophytes | ib. |
| Antipathes | ib. |
| Gorgones | 310 |
| Plexaures | ib. |
| Eunicées | ib. |
| Muricées | 311 |
| Primnoa | ib. |
| Litophytes | ib. |
| Isis | ib. |
| Corail | ib. |
| Mélités | 312 |
| Isis propres | ib. |
| Mopsées | ib. |
| Madrépores | ib. |
| Turbinoles | 313 |
| Caryophyllies | ib. |
| Oculines | ib. |
| Madrépores propres | 314 |
| Pocillopores | ib. |
| Sérialopores | ib. |
| Astrées | ib. |
| Explanaires | ib. |
| Porites | ib. |
| Méandrines | ib. |
[page] xvi
| Pavonies | 315 |
| Hydnophores | ib. |
| Agaricines | ib. |
| Sarcinules | ib. |
| Stylines | ib. |
| Millépores | 316 |
| Distichopores | ib. |
| Millépores propres | ib. |
| Eschares | ib. |
| Rétépores | ib. |
| Adéones | 317 |
| Polypiers nageurs | ib. |
| Pennatules | ib. |
| Pennatules propres | 318 |
| Virgulaires | ib. |
| Scirpéaires | 319 |
| Pavonaires | ib. |
| Rénilles | ib. |
| Vérélilles | ib. |
| Ombellulaires | ib. |
| Ovulites | 320 |
| Lunulites | ib. |
| Orbiculites | ib. |
| Dactylopores | ib. |
| Alcyons | ib. |
| Alcyons | ib. |
| Théthyes | 321 |
| Ep onges | ib. |
| INFUSOIRES | 322 |
| ROTIFÉRES | 323 |
| Furculaires | 324 |
| Trichocerques | ib. |
| Vaginicoles | ib. |
| Tubicolaires | ib. |
| Brachions | 325 |
| INFU SOIRES HOMOGÈNES | ib. |
| Urcéolaires | ib. |
| Trichodes | ib. |
| Leucophres | ib. |
| Kérones | ib. |
| Himantopes | ib. |
| Cercaires | 326 |
| Vibrions | ib. |
| Enchelides | ib. |
| Ciclides | ib. |
| Paramèces | ib. |
| Kolpodes | ib. |
| Gones | ib. |
| Bursaires | ib. |
| Protées | ib. |
| Monades | 327 |
| Volvox | ib. |
[page 1]
LE
RÈGNE ANIMAL
DISTRIBUÉ D'APRÈS SON ORGANISATION.
DEUXIÈME GRANDE DIVISION
DU RÈGNE ANIMAL.
LES MOLLUSQUES (1).
Les mollusques n'ont point de squelette articulé ni de canal vertébral. Leur système nerveux ne se
(1) N. B. Linnæus réunissait en une seule classe, sous le nom de VERS, tous les animaux non vertébrés, sans membres articulés; il la divisait en cinq ordres: les INTESTINS, embrassant quelques-uns de mes annelides et de mes intestinaux; les MOLLUSQUES, comprenant mes mollusques nus, mes échinodermes et une partie de mes intestinaux, et de mes zoophytes; les TESTAGÉS, comprenant mes mollusques et annelldes a coquilles; les LYTHOPHYTES ou coraux pierreux, et les ZOOPHYTES, embrassant le reste des polypes, quelques intestinaux et les infusoires.
La nature n'était point du tout consultée dans cet arrangement; Bruguières, dans l'Encycl. méthod., chercha à le rectifier. Il établit six ordres de vers, savoir: les INFUSOIRES; les INTESTINS, qui comprenaient aussi les annelides; les MOLLUSQUES, réunissant à mes vrais mollusques nus plusieurs de mes zoophytes; les ÉCHINODERMES, comprenant seulement les oursins et les astéries; les TESTAGÉS, à peu près les mêmes que ceux de Linnæus; et les ZOOPHYTES, nom sous lequel il n'entendait que les coraux. Cette distribution n'était préférable à celle de Linnæus que par un rapprochement plus complet des annelides, et par la distinction d'une partie des échinodermes.
Je proposai un arrangement nouveau de tous les animaux sans vertèbres, fondé sur leur structure interne, dans un mémoire lu à la Société d'histoire naturelle, le 21 floréal an III, ou le 10 mai 1795, dont tous mes travaux postérieurs, sur cette partie de l'histoire naturelle, ont été des développements.
TOME III. 1
[page] 2
réunit point en une moelle épinière, mais seulement en un certain nombre de masses médullaires dispersées en différents points du corps, et dont la principale, que l'on peut appeler cerveau, est située en travers sur l'œsophage, qu'elle enveloppe d'un collier nerveux. Leurs organes du mouvement et des sensations n'ont pas la même uniformité de nombre et de position que dans les animaux vertébrés, et la variété est plus frappante encore pour les viscères, et surtout pour la position du cœur et des organes respiratoires, et pour la structure et la nature même de ces derniers; car les uns respirent l'air élastique, et les autres l'eau douce ou salée. Cependant leurs organes extérieurs et de locomotion sont généralement symétriques des deux côtés d'un axe.
La circulation des mollusques est toujours double, c'est-à-dire que leur circulation pulmonaire fait toujours un circuit à part et complet. Cette fonction est aussi toujours aidée au moins par un ventricule charnu, placé non pas comme dans les poissons, entre les veines du corps et les artères du poumon, mais au contraire entre les veines du poumon et les artères du corps. C'est done un ventricule aortique. La famille des céphalopodes seule est pourvue en outre d'un ventricule pulmonaire, qui même est divisé en deux. Le ventricule aortique se divise aussi dans quelques genres, comme les arches et les lingules; d'autres fois, comme dans
[page] 3
les autres bivalves, son oreillette seulement est divisée.
Quand il y a plus d'un ventricule, ils ne sont pas accolés en une seule masse, comme dans les animaux à sang chaud, mais souvent assez éloignés l'un de l'autre, et l'on peut dire alors qu'il y a plusieurs cœurs.
Le sang des mollusques est blanc ou bleuâtre, et la fibrine y paraît moins abondante en proportion que dans celui des animaux vertébrés. Il y a lieu de croire que leurs veines font les fonctions de vaisseaux absorbants.
Leurs muscles s'attachent aux divers points de leur peau, et y forment des tissus plus ou moins compliqués et plus ou moins serrés. Leurs mouvements consistent en contractions dans divers sens, qui produisent des inflexions et des prolongements ou relâchements de leurs diverses parties, au moyen desquels ils rampent, nagent et saisissent différents objets, selon que les formes des parties le permettent; mais comme les membres ne sont point soutenus par des leviers articulés et solides, ils ne peuvent avoir d'élancements rapides.
L'irritabilité est extrême dans la plupart, et se conserve long-temps après qu'on les a divisés. Leur peau est nue, très sensible, ordinairement enduite d'une humeur qui suinte de ses pores; on n'a reconnu à aucun d'organe particulier pour l'odorat, quoiqu'ils jouissent de ce sens; il se pourrait que
1*
[page] 4
toute la peau en fût le siége, car elle ressemble beaucoup à une membrane pituitaire. Tous les acéphales, les brachiopodes, les cirrhopodes, et une partie des gastéropodes et des ptéropodes sont privés d'yeux; mais les céphalopodes en ont d'au moins aussi compliqués que ceux des animaux à sang chaud. Ils sont les seuls où l'on ait découvert des organes de l'ouïe, et dont le cerveau soit entouré d'une boîte cartilagineuse particulière.
Les mollusques ont presque tous un développement de la peau qui recouvre leur corps et ressemble plus ou moins à un manteau, mais qui souvent aussi se rétrécit en simple disque, ou se rejoint en tuyau, ou se creuse en sac, ou s'étend et se divise enfin en forme de nageoires.
On nomme mollusques nus ceux dont le manteau est simplement membraneux ou charnu; mais il se forme le plus souvent dans son épaisseur une ou plusieurs lames de substance plus ou moins dure, qui s'y déposent par couches, et qui s'accroissent en étendue aussi bien qu'en épaisseur, parce que les couches récentes débordent toujours les anciennes.
Lorsque cette substance reste cachée dans l'épaisseur du manteau, l'usage laisse encore aux animaux qui l'ont, le titre de mollusques nus. Mais le plus souvent elle prend une grosseur et un développement tels que l'animal peut se contracter sous son abri; on lui donne alors le nom de coquille, et à
[page] 5
l'animal celui de testacé; l'épiderme qui la recouvre est mince et quelquefois lesséché; il s'appelle communément drap marin (1).
Les variétés de formes, de couleur, de surface, de substance et d'éclat des coquilles sont infinies; la plupart sont calcaires; il y en a de simplement cornées; mais ce sont toujours des matières déposées par couches, ou transsudées par la peau sous l'épiderme, comme l'enduit muqueux, les ongles, les poils, les cornes, les écailles et même les dents. Le tissu des coquilles diffère selon que cette transsudation se fait par lames parallèles ou par filets verticaux serrés les uns contre les autres.
Les mollusques offrent toutes les sortes de mastication et de déglutition; leurs estomacs sont tantôt simples, tantôt multiples, souvent munis d'armures particulières, et leurs intestins diversement prolongés. Ils ont le plus souvent des glandes salivaires et toujours un foie considérable, mais point de pancréas ni de mésentère; plusieurs ont des sécrétions qui leur sont propres.
Ils offrent aussi toutes les variétés de génération. Plusieurs se fécondent eux-mêmes; d'autres, quoiqu'hermaphrodites, ont besoin d'un accouplement réciproque; beaucoup ont les sexes séparés. Les
(1) Jusqu'à moi l'on avait fait des testacés un ordre particulier; mais il y a des passages si insensibles des mollusques nus aux testacés, les divisions naturelles groupent tellement les uns avec les autres, que cette distinction ne peut plus subsister. Il y a d'ailleurs plusieurs testacés qui ne sont pas des mollusques.
[page] 6
uns sont vivipares, les autres ovipares, et les œufs de ceux-ci sont tantôt enveloppés d'une coquille plus ou moins dure, tantôt d'une simple viscosité.
Ces variétés relatives à la digestion et à la génération se trouvent dans un même ordre, quelquefois dans une même famille.
Les mollusques en général paraissent des animaux peu développés, peu susceptibles d'industrie, qui ne se soutiennent que par leur fécondité et la ténacité de leur vie (1).
DIVISION
DES MOLLUSQUES EN SIX CLASSES (2).
La forme générale du corps des mollusques étant assez proportionnée à la complication de leur organisation intérieure, indique leur division naturelle.
Les uns ont le corps en forme de sac ouvert par devant, renfermant les branchies d'où sort une tête bien développée, couronnée par des produc-
(1) M. de Blainville a substitué au nom de mollusques celui de malacozoaires, et il en sépare les oscabrions et les cirrhopodes, qu'il appelle malentozoaires.
(2) Cette distribution des mollusques m'appartient entièrement, ainsi que la plupart de ses subdivisions du second degré.
[page] 7
tions charnues fortes et alongées, au moyen desquelles ils marchent et saisissent les objets. Nous les appelons CÉPHALOPODES.
En d'autres le corps n'est point ouvert; la tête manque d'appendices ou n'en a que de petits; les principaux organes du mouvement sont deux ailes ou nageoires membraneuses, situées aux côtés du col, et sur lesquelles est souvent le tissu branchial. Ce sont les PTÉROPODES.
D'autres encore rampent sur un disque charnu de leur ventre, quelquefois mais rarement comprimé en nageoire, et ont presque toujours en avant une tête distincte. Nous les appelons GASTÉROPODES.
Une quatrième classe se compose de ceux où la bouche reste cachée dans le fond du manteau, qui renferme aussi les branchies et les viscères, et s'ouvre ou sur toute sa longueur, ou à ses deux bouts, ou à une seule extrémité. Ce sont nos ACÉPHALES.
Une cinquième comprend ceux qui, renfermés aussi dans un manteau, et sans tête apparente, ont des bras charnus ou membraneux et garnis de cils de même nature. Nous les nommons BRACHIOPODES.
Enfin il en est qui, semblables aux autres mollusques par le manteau, les branchies, etc., en diffèrent par des membres nombreux, cornés, articulés, et par un système nerveux plus voisin de
[page] 8
celui des animaux articulés. Nous en ferons notre dernière classe, celle des CIRRHOPODES.
PREMIÈRE CLASSE DES MOLLUSQUES,
LES CÉPHALOPODES (1).
Leur manteau se réunit sous le corps, et forme un sac musculeux qui enveloppe tous les viscères. Ses côtés s'étendent dans plusieurs en nageoires charnues. La tête sort de l'ouverture du sac; elle est ronde, pourvue de deux grands yeux, et couronnée par des bras ou pieds charnus, coniques, plus ou moins longs, susceptibles de se fléchir en tout sens, et très vigoureux, dont la surface est armée de suçoirs ou ventouses par lesquels ils se fixent avec beaucoup de force aux corps qu'ils embrassent. Ces pieds servent à l'animal à saisir, à marcher et à nager. Il nage la tête en arrière, et marche dans toutes les directions, ayant la tête en bas et le corps en haut.
Un entonnoir charnu, placé à l'ouverture du sac, devant le col, donne passage aux excrétions.
Les céphalopodes ont deux branchies placées dans leur sac, une à chaque côté, en forme de
(1) M. de Blainville a changé ce nom en Céphalophores.
M. de Lamarck avait d'abord réuni mes Céphalopodes et mes Gastéropodes, sous le nom de Céphalés; mais ayant ensuite multiplié les classes, il a repris celui de céphalopodes.
[page] 9
feuille de fougère très compliquée; la grande veine cave, arrivée entre elles, se partage en deux, et donne dans deux ventricules charnus situés chacun à la base de la branchie de son côté, et qui y poussent le sang.
Les deux veines branchiales se rendent dans un troisième ventricule placé vers le fond du sac, et qui porte le sang dans tout le corps par diverses artères.
La respiration se fait par l'eau qui entre dans le sac, et qui en sort au travers de l'entonnoir. Il paraît qu'elle peut même pénétrer dans deux cavités du péritoine que les veines caves traversent en se rendant aux branchies, et qu'elle peut agir sur le sang veineux par le moyen d'appareils glanduleux attachés à ces veines.
Entre les bases des pieds est percée la bouche, dans laquelle sont deux fortes mâchoires de corne, semblables au bec d'un perroquet.
Entre les deux mâchoires est une langue hérissée de pointes cornées; l'œsophage se renfle en jabot, et donne ensuite dans un gézier aussi charnu que celui d'un oiseau, auquel succède un troisième estomac membraneux et en spirale, où le foie, qui est très grand, verse la bile par deux conduits. L'intestin est simple et peu prolongé. Le rectum donne dans l'entonnoir.
Ces animaux ont une excrétion particulière, d'un noir très foncé, qu'ils emploient à teindre l'eau de
[page] 10
la mer pour se cacher. Elle est produite par une glande et réservée dans un sac diversement situé selon les espèces.
Leur cerveau renfermé dans une cavité cartilagineuse de la tête, donne, de chaque côté, un cordon qui produit dans chaque orbite un gros ganglion, d'où sortent des filets optiques innombrables; l'œil est formé de nombreuses membranes, et recouvert par la peau, qui devient transparente en passant sur lui, et forme quelquefois des replis qui tiennent lieu de paupières. L'oreille n'est qu'une petite cavité creusée de chaque côté près du cerveau, sans canaux semi-circulaires et sans conduit extérieur, où est suspendu un sac membraneux qui contient une petite pierre.
La peau de ces animaux, surtout des poulpes, change de couleur par places, par taches, avec une rapidité bien supérieure à celle du caméléon (1).
Les sexes sont séparés. L'ovaire de la femelle est dans le fond du sac; deux oviductus en prennent les œufs et les conduisent au dehors au travers de deux grosses glandes qui les enveloppent d'une matière visqueuse et les rassemblent en espèces de grappes. Le testicule du mâle, placé comme l'ovaire, donne dans un canal déférent qui se termine à une verge charnue située à gauche de l'anus. Une vessie et une prostate y aboutissent également. Il y
(1) Voyez Carus, Nov. act. nat. cur., XII, part. 1, p. 320, et Sangiovanni, Ann. des Se. nat., XVI, p. 308.
[page] 11
a lieu de croire que la fécondation se fait par arrosement comme dans le plus grand nombre des poissons. Dans le temps du frai, la vessie renferme une multitude de petits corps filiformes qui, au moyen d'un mécanisme spécial, crèvent en s'agitant avec rapidité sitôt qu'ils tombent dans l'eau, et répandent une humeur dont ils sont remplis.
Ces animaux sont voraces et cruels; et comme ils ont de l'agilité et de nombreux moyens de se saisir de leur proie, ils détruisent beaucoup de poissons et de crustacés.
Leur chair se mange; leur encre s'emploie en peinture; on croit que la bonne encre de la Chine en est une espèce (1).
Les céphalopodes ne comprennent qu'un ordre, que l'on divise en genres, d'après la nature de leur coquille.
Ceux qui n'en ont pas d'extérieure ne faisaient même dans Linnæus qu'un seul genre,
LES SEICHES. (SEPIA. L.) (2)
Que l'on divise aujourd'hui comme il suit:
LES POULPES. (OCTOPUS. Lam.) Polypus des anciens.
N'ont que deux petits grains coniques de substance cornée, aux deux côtés de l'épaisseur de leur dos, et leur sac n'ayant point de nageoires, représente une bourse ovale. Leurs pieds sont au nombre de huit, tous à peu près égaux,
(1) Cependant M. Ab. Rémusat n'a rien trouvé dans les auteurs chinois qui confirme cette opinion.
(2) M. de Blainville en fait un ordre qu'il nomme Cryptodibranches.
[page] 12
très grands à proportion du corps, et réunis à leur base par une membrane. L'animal s'en sert également pour nager, pour ramper, et pour saisir sa proie. Leur longueur et leur force en font pour lui des armes redoutables, au moyeu desquelles il enlace les animaux, et a souvent fait périr des nageurs. Les yeux sont petits à proportion, et la peau se resserre sur eux de manière à les couvrir entièrement quand l'animal le veut. Le réservoir de l'encre est enchâssé dans le foie; les glandes des oviductus sont petites.
Les uns
LES POLYPES d'Aristote.
Ont leurs ventouses alternant sur deux rangées le long de chaque pied.
L'espèce vulgaire (Sepia octopodia, Linn.) à peau légèrement grenue, à bras six fois aussi longs que le corps, garnis de cent vingt paires de ventouses, infeste nos côtes en été, et y détruit une quantité immense de crustacés.
Les mers des pays chauds produisent
Le Poulpe granuleux. Lam. (Sepia rugosa. Bosc.) Séb. III. 11. 2. 3.
A corps plus grenu; à bras de peu plus longs que le corps, garnis de quatre-vingt-dix paires de ventouses. Quelques-uns croient que c'est l'espèce qui fournit la bonne encre de la Chine.
D'autres
LES ÉLÉDONS d'Aristote.
N'ont qu'une rangée de ventouses le long de chaque pied.
La Méditerranée en produit un remarquable par son odeur musquée,
Le Poulpe musqué. Lam. Mém. de la Soc. d'Hist. Nat. in-4°. pl. II. Rondelet. 516 (1).
LES ARGONAUTES. (ARGONAUTA. Linn.)
Sont des poulpes à deux rangs de suçoirs, dont la paire
(1) Ajoutez le poulpe cirrheux, Lam., loc. cit., pl. I, fig. 2, et, en général, plusieurs espèces nouvelles de tout le genre des seiches, que M. de Férussac se propose de publier bientôt.
[page] 13
de pieds la plus voisine du dos, se dilate à son extrémité en une large membrane. Ils n'ont point dans le dos les deux petits grains cartilagineux des poulpes ordinaires; mais on trouve toujours ces mollusques dans unecoquille très mince, cannelée symétriquement et roulée en spirale, dont le dernier tour est si grand, proportionnellement, qu'elle a l'air d'une chaloupe dont la spire serait la poupe: aussi l'animal s'en sert-il comme d'un bateau, et quand la mer est calme on en voit des troupes naviguer à la surface, employant six de leurs tentacules au lieu de rames, et relevant, dit-on, les deux qui sont élargis pour en faire des voiles. Si les vagues s'agitent, ou qu'il paraisse quelque danger, l'argonaute retire tous ses bras dans sa coquille, s'y concentre et redescend au fond de l'eau. Son corps ne pénètre pas jusqu'au fond des spires de sa coquille, et il paraît qu'il n'y adhère point, du moins n'y a-t-il aucune attache musculaire, ce qui a fait penser à quelques auteurs qu'il ne l'habite qu'en qualité de parasite (1), comme le bernard-l'hermite, par exemple; cependant, comme on le trouve toujours dans la même coquille, comme on n'y trouve jamais d'autre animal (2), bien qu'elle soit très commune, et de nature à se montrer souvent à la surface, comme enfin il paraît que l'on aperçoit le germe de cette coquille jusque dans l'œuf de l'argonaute (3) on doit croire cette opinion encore très problématique, pour ne rien dire de plus.
Les anciens connaissaient déjà ce singulier céphalopode et sa manœuvre. C'est leur nautilus et leur pompilus, Plin. IX, c. 29.
On en connaît quelques espèces fort semblables entre elles par les animaux et par les coquilles, que Linnæus réu-
(1) C'est dans cette hypothèse que M. Rafinesque et d'autres après lui ont fait de l'animal le genre OCYTHOÉ.
(2) Ce que l'on a dit de contraire, même tout récemment, ne repose que sur des ouï-dire ou des conjectures.
(3) Poli, testac., neap., III, p. 10. Voyez aussi Férussac, Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris, II, p. 160, et Ranzani, Mem. di Stor. nat. dec., I, p. 85.
[page] 14
nissait sous le nom d'argonauta argo, vulgairement Nautile papyracé (1).
On croit pouvoir attribuer à un animal analogue aux argonautes
Les BELLEROPHES.
Coquilles fossiles enroulées spiralement et symétriquement, sans cloisons, mais épaisses, non cannelées, et dont le dernier tour est moins long à proportion (2).
LES CALMARS. (LOLIGO. Lam.) (3)
Ont dans le dos, au lieu de coquille, une lame de corne en forme d'épée ou de lancette; leur sac a deux nageoires, et outre leurs huit pieds, chargés sans ordre de petits suçoirs portés sur de courts pédicules, leur tête porte encore deux bras beaucoup plus longs, armés de suçoirs seulement vers le bout, qui est élargi. Ils s'en servent pour se tenir comme à l'ancre. Leur bourse à noir est enchâssée dans le foie, et les glandes de leurs oviductus sont très grandes. Ils déposent leurs œufs attachés les uns aux autres en guirlandes étroites et sur deux rangs.
On les subdivise aujourd'hui d'après le nombre et l'armure de leurs pieds, et la forme de leurs nageoires.
Les LOLIGOPSIS ou CALMARETS n'auraient que huit pieds comme les poulpes, mais ou ne les connaît que par des dessins peu authentiques (4).
Dans les CALMARS proprement dits, les longs bras ont
(1) Arg. argo., Favanne, VII, A, 2, A, 3;—Arg. haustrum, Delw., ib., A, 5;—A. tuberculata, Shaw., Nat. misc., 995;—A. navicula, Solander, Fav., VII, A, 7;—A. hians, Sol., Fav., VII, A, 6;—A. cranchii, Leach., Trans. phil., 1817.
(2) Bellorophon vasulites, Montf., Couch. syst., I, p. 51. Voyez aussi Defrance, Ann. des Se. nat., I, p. 264.
(3) Calmar, de Theca calamaria (écriloire), parce qu'il y a de l'encre, et que sa coquille cornée représente la plume.
(4) Voyez cependant Leachia cyclura, Lesueur, Se. nat. Philad., II, p. 89, et Krusenstern, atl., pl. LXXXVIII.
[page] 15
des ventouses comme les autres tentacules, et les nageoires sont placées vers la pointe du sac.
Nous en avons trois dans nos mers,
Le Calmar commun. (Sepia loligo. Linn.) Rondel. 506. Salv. 169.
A nageoires formant ensemble un rhombe au bas du sac.
Le grand Calmar. (Loligo sagittata. Lam.) Séb. III. IV.
A nageoires formant ensemble un triangle au bas du sac, à bras plus courts que le corps, chargés de suçoirs, sur près de moitié de leur longueur.
Le petit Calmar. (Sepia media. Linn.) Rondel. 508.
A nageoires formant ensemble une ellipse au bas du sac, qui se termine en pointe aiguë (1).
LES ONYCHOTHEUTHIS. Lichtenst. (ONYKIA. Lesueur.)
Ont à leurs longs bras des ventouses terminées en crochets. Du reste leurs formes sont les mêmes (2).
LES SÉPIOLES
Ont les nageoires arrondies, attachées aux côtés du sac et non à sa pointe.
Nous en avons une dans nos mers,
La Sépiole commune. (Sepia sepiola. Linn.) Rondel. 519.
A sac court et obtus, à nageoires petites et circulaires.
(1) Aj. Lol. Bartramii, Lesueur, Ac. sc. nat. Phil., II, VII, 1, 2;—L. Bartlingii, id., XCV;—L. illccebrosa, id., pl. f., n° 6;—L. pelagica, Bosc, Vers., I, 1, 2;—L. Pealii, Lesueur, I, G, VIII, 1, 2;—L. pavo, id., XCVI;—L. brevipinna, id., ib., III, X.
(2) On. caribœa, Lesueur, Ac. sc. nat. Phil., II, IX, 1, 2;—On. angulata, id., ib., 1, 3;—On. uncinata, Quoy et Gaym., Voyage de Freyc., Zool., pl. VII, f. 66;—On. Bergii, Lichtenst., Isis, 1818, pl. XIX;—On. Fabricii, ib., id.;—On. Banksii, Leach., ap. Tuckey, voy. an Zaïre, pl. XVIII, f. 2, copié Journ. de phys., tome LXXXVI, juin, f. 4;—On. Smithii, Leach., ib., f. 3, Journ. phys., ib., 5.
[page] 16
Elle ne passe guères trois pouces de longueur, et sa lame de corne est grêle et aiguë comme un stilet.
Les SÉPIOTHEUTES. Blainv. (CHONDROSEPIA. Leukard).
Ont le sac bordé tout du long, de chaque côté par les nageoires, comme dans les seiches; mais leur coquille est cornée, comme dans les calmars (1).
LES SEICHES proprement dites. (SEPIA. Lam.)
Ont les deux longs bras des calmars, et une nageoire charnue régnant tout le long de chaque côté de leur sac. Leur coquille est ovale, épaisse, bombée, et composée d'une infinité de lames calcaires très minces, parallèles, jointes ensemble par des milliers de petites colonnes creuses, qui vont perpendiculairement de l'une à l'autre. Cette structure la rendant friable, on l'emploie, sous le nom d'os de seiche, pour polir divers ouvrages, et on la donne aux petits oiseaux pour s'aiguiser le bec.
Les seiches ont la bourse à l'encre détachée du foie, et située plus profondément dans l'abdomen. Les glandes des oviductus sont énormes. Elles déposent leurs œufs attachés les uns aux autres en grappes rameuses, assez semblables à celles des raisins, et qu'on nomme vulgairement raisins de mer.
L'espèce répandue dans toutes nos mers (Sepia officinalis, L.), Rondel., 498, Séb., III, 111, atteint un pied et plus de longueur. Sa peau est lisse, blanchâtre, pointillée de roux.
La mer des Indes en produit une à peau hérissée de tubercules (Sepia tuberculata, Lam.), Soc. d'hist. nat., in-4°, pl. I, fig. 1 (2).
(1) Chondrosepia loligiformis, Leukard., ap. Ruppel., voyage, An. sans vert., pl. 6, f. 1.
(2) On trouve parmi les fossiles de petits corps armés d'une épine, qui sont des bouts d'os de seiches. C'est le genre BÉLOPTÈRE, Deshayes, Voyez ma note à ce sujet, Ann. des sc. nat., II, XX, 1, 2.
D'autres fossiles, mais pétrifiés, paraissent avoir de grands rapports avec des becs de seiches. Ce sont les RYNCHOLITHES de M. Faure Biguet. Voyez Gaillardot, Ann. sc. nat., II, 485, et pl. XXII, et d'Orbigny, ib., pl. VI.
[page] 17
Linnæus réunissait dans son genre
DES NAUTILES. (NAUTILUS. L.)
Toutes les coquilles contournées en spirale, symétriques et chambrées, c'est-à-dire divisées par des cloisons en plusieurs cavités, et les supposait habitées par des céphalopodes. Une d'elles appartient en effet à un céphalopode très semblable à une seiche, mais à bras plus courts; c'est le genre
DES SPIRULES. (SPIRULA. Lam.)
Dans l'arrière de leur corps de seiche, est une coquille intérieure qui, toute différente qu'elle est de l'os de seiche, pour la figure, n'en diffère pas beaucoup pour la formation. Qu'on se représente que les lames successives, au lieu de rester parallèles et rapprochées, sont concaves vers le corps, plus distantes, croissant peu en largeur, et faisant un angle entre elles, on aura un cône très alongé, roulé sur luimême en spirale dans un seul plan, et divisé transversalement en chambres. Telle est la coquille de la spirule, qui a de plus ces caractères, que les tours de spire ne se touchent point, et qu'une seule colonne creuse, occupant le côté intérieur de chaque chambre, continue son tuyau avec ceux des autres colonnes, jusqu'à l'extrémité de la coquille. C'est ce qu'on nomme le syphon.
On ne connaît qu'une espèce, dite vulgairement, à cause de sa forme, Cornet de postillon (Nautilus spirula, L.), List., 550, 2.
LES NAUTILES proprement dits.
Ont une coquille qui diffère des spirules, en ce que les lames croissent très rapidement, et que les derniers tours de spire, non-seulement touchent, mais enveloppent les précédents. Le syphon est au milieu de chaque cloison.
L'espèce la plus commune (N'autilus pompilius, L.), List., 551, est très grande, d'un beau nacre en dedans, couverte en dehors d'une croûte blanche, variée de bandes ou de flammes fauves.
TOME III. 2
[page] 18
Suivant Rumphe, son animal serait en partie logé dans la dernière cellule, aurait le sac, les yeux, le bec de perroquet et l'entonnoir des autres céphalopodes; mais sa bouche, au lieu de leurs grands pieds et de leurs bras, serait entourée de plusieurs cercles de nombreux petits tentacules, sans suçoirs. Un ligament partant du dos parcourrait tout le syphon et l'y fixerait(1). Il est probable aussi que l'épiderme se prolonge sur l'extérieur de la coquille; mais on peut croire qu'il est mince sur les parties vivement colorées.
On en voit des individus (Naut. pompilius, β, Gm.), List., 552; AMMONIE, Montf., 74, dont le dernier tour n'enveloppe et ne cache pas les autres, mais où tous les tours, quoique se touchant, sont à découvert, ce qui les rapproche des ammonites; néanmoins, ils ressemblent tellement à l'espèce commune pour tout le reste, qu'on a peine à croire qu'ils n'en soient pas une variété.
Les fossiles nous offrent des nautiles de taille grande ou médiocre, et de formes plus variées que ceux que produit la mer actuelle (2).
On trouve aussi parmi les fossiles, des coquilles chambrées, à cloisons simples et à siphon, dont le corps d'abord arqué ou même contourné en spirale, demeure droit dans ses parties les plus nouvelles; ce sont les LITUUS de Breyn, dont les tours sont tantôt contigus (3); tantôt distincts (les HORTOLES, Montf.).
D'autres, où il est droit dans sa totalité, sont les ORTHOCERATITES (4).
(1) La figure qu'en donne Rumphius est indéchiffrable, et ce qui étonne, c'est que les nombreux naturalistes qui ont visité la mer des Indes, n'aient point examiné ou recueilli un animal qui doit être si curieux, et qui appartient à une coquille si commune.
(2) Grandes espèces à un seul syphon: l'ANGULITE, Montf., I, 6;—l'AGANIDE, id., 50;—le CANTROPE, id., 46.
(3) Nautilus lituus, Gmel.;—N. semilituus, Planc. I, X.
(4) Breyn. de Polythal., pl. III, IV, V et VI; et Walch, Pétrif. de Knorr., supl., IV, b, IV, d, IV. Voyez aussi Sage, Journal dephys., brum, an IX, pl. 1, sous le nom de belemnite.
[page] 19
Il n'est pas improbable que leurs animaux aient ressemblé à celui du nautile ou à celui de la spirule.
LES BÉLEMNITES.
Appartiennent probablement encore à cette famille, mais il est impossible de s'en assurer, puisqu'on ne les trouve plus que parmi les fossiles; tout annonce cependant que ce devaient être des coquilles intérieures. Elles ont un test mince et double, c'est-à-dire composé de deux cônes réunis par leur base, et dont l'intérieur beaucoup plus court que l'autre, est divisé lui-même intérieurement en chambres par des cloisons parallèles, concaves du côté qui regarde la base. Un syphon s'étend du sommet du cône externe à celui du cône interne, et se continue de là, tantôt le long du bord des cloisons, tantôt au travers de leur centre. L'intervalle des deux cônes testacés est rempli de substance solide, tantôt à fibres rayonnantes, tantôt à couches coniques qui s'enveloppent, et dont chacune a sa base au bord d'une des cloisons du cône intérieur. Quelquefois on ne trouve que cette partie solide; d'autres fois on trouve aussi les noyaux des chambres du cône intérieur ou ce qu'on appelle les alvéoles. Plus souvent ces noyaux et les chambres mêmes n'ont laissé d'autres traces que quelques cercles saillants au dedans du cône interne. En d'autres cas on trouve les alvéoles en plus ou moins grand nombre, et encore empilés, mais détachés du double étui conique qui les enveloppait.
Les bélemnites sont au nombre des fossiles les plus abondants, surtout dans les couches de craie et de calcaire compacte (1).
(1) Les ouvrages les plus complets sur ce genre singulier de fossiles, sont le Mémoire sur les Bélemnites considérées zoologiquement et géologiquement par M. de Blainville, Paris, in-4°, 1827; et celui de M. J. S. Miller, sur le même sujet, dans le 2e tome, 1re part., des Trans. geologiques, seconde série, Londres 1826. Voyez aussi Sage, Journal de phys., brum. an IX; mais surtout fructidor an IX, et Raspail, Journ. des Sc. d'observ., deuxième cabier, A ce genre se rapportent le Paclite, Montf., I, 318;—le Thalamule, 322;—l'Achéloïte, 358;—le Cétocine, 370;—l'Acame, 374;—la Bélemnite, 382;—l'Hibolite, 386;—le Porodrague, 390;—le Pirgopole, 394, qui sont oes étuis des différentes especes; quant à l'Amunone, id., 326;—le Cailirhoé, 362;—le Chrisaore, 378. ils paraissent des noyaux ou piles d'alvéoles détachés de leurs étuis.
2*
[page] 20
M. de Blainville les répartit selon que le cône intérieur ou la partie chambrée pénètre plus ou moins profondément; que les bords du cône extérieur ont ou n'ont pas une petite fente, et enfin selon qu'il y a à la surface extérieure une gouttière longitudinale d'un côté, ou bien deux ou plusienrs gouttières vers le sommet, ou bien enfin que cette surface est lisse et sans gouttières.
Des corps fort semblables aux bélemnites, mais sans cavité, et même à base plutôt proéminente, forment le genre ACTINOCAMAX de Miller.
C'est sur des conjectures de même sorte que repose le classement des
AMMONITES. Brug. Vulg. Cornes d'Ammon (1).
Car on ne les trouve non plus que parmi les fossiles. Elles se distinguent en général des nautiles, par leurs cloisons qui, au lieu d'être planes ou simplement concaves, sont anguleuses, quelquefois ondulées, mais le plus souvent déchiquetées sur leurs bords, comme des feuilles d'acanthes. La petitesse de leur dernière loge peut faire croire que, comme la spirule, elles étaient des coquilles intérieures. Les couches des montagnes secondaires en fourmillent, et l'on en voit depuis la grandeur d'une lentille jusqu'à celle d'une roue de carrosse. Les variations de leurs enroulements et de leurs sypbons donnent les motifs de leurs subdivisions.
On réserve particulièrement le nom d'AMMONITES, Lam.
(1) Ce nom vient de la ressemblance de leurs volutes avec celles de la corne d'un bélier.
[page] 21
(SIMPLEGADES, Montf., 82), aux espèces qui montrent tous leurs tours. Leur syphon est placé près du bord (1).
On les a distinguées dernièrement en celles qui ont le bord des cloisons foliacé (les AMMONITES, les PLANITES, de Haan), et en celles qui l'ont simplement anguleux et onduleux (les CÉRATITES, de Haan).
Celles où le dernier tour enveloppe tous les autres, sont les ORBULITES, Lam., ou GLOBITES et GONIATITES, de Haan, ou PÉLAGUSES, Montf., 62. Le syphon y est comme dans les précédentes.
On a donné le nom de SCAPHITES, Sowerb., à celles dont les tours sont contigus et dans le même plan, excepté le dernier, qui est détaché et se reploye sur lui-même (2).
On en voit de toutes droites, sans aucune partie en spirale (les BACULITES, Lam.).
Les unes sont rondes (3); d'autres sont comprimées (4). Quelquefois on voit à ces dernières un syphon latéral.
Il y en a d'arquées à leurs premières loges (les HAMITES, Sowerb.).
Enfin, celles de toutes qui sortent le plus des formes ordinaires à cette familie, ce sont les TURRILITES, Montf., 118, où les tours, loin de rester dans le même plan, descendent avec rapidité, et donnent à la coquille cette forme d'obélis que qu'on nomme turriculée (5).
(1) Les espèces d'AMMONITES ont été long-temps recueillies et décrites avec moins de soin que celles des coquilles ordinaires. On peut commencer leur étude par l'article Ammonite de l'Enc. mét., vers, I, 28, et par celui de M. de Roissy, dans le Buffon de Sonnini, mollusques, V, 16. Il faut aussi consulter la Monographie qu'en a donnée M. de Haan, sous le titre de Monographiœ ammoniteorun et goniateorum specimen, Leid., 1325.
(2) Sc. obliquus, Sowerb.; Cuv., Os. foss., II, 2e part., pl. 11, f. 13.
(3) Baculites vertebralis, Montf., 342; Fauj, mout. de Saint-Pierre, pl. XXI.
(4) Le Tiranite, Montf., 346; Walch., Pétrif., Suppl., pl. XIII. M. de Haan en fait son genre RHABDITES, et il y rapporte les ICHTHYOSARCOLITES de M. Desmarest.
(5) Montf., Journal de phys., therm. an VII, pl. 1, f. 1. Il y a des doutes sur la position du syphon. Peut-être, selon M. Audouin, ce qu'on a pris pour tel, est l'enroulement columellaire.
[page] 22
On croit encore, toujours d'après des motifs semblables, devoir rapporter à la famille des céphalopodes, et considérer comme des coquilles intérieures
LES CAMÉRINES. Brug. (NUMMULPTES. Lam.) Vulg. Pierres nummulaires, numismales, lenticulaires.
Qui ne se trouvent également que parmi les fossiles, et présentent à l'extérieur une forme lenticulaire, sans aucune ouverture apparente, et à l'intérieur une cavité spirale divisée par des cloisons en une infinité de petites chambres, mais sans syphon. C'est un des fossiles les plus répandus, et qui forme presque à lui seul des chaînes entières de collines calcaires, et des bancs immenses de pierre à bâtir (1).
Les plus communes, et celles qui deviennent les plus grandes, sont tout-à-fait discoïdes, et n'ont qu'un seul rang de chambres par tour de spire (2).
On en trouve aussi quelques espèces très petites de cette sorte dans certaines mers (3).
D'autres petites espèces, soit fossiles, soit vivantes, out leur bord hérissé de pointes qui leur donnent la forme d'étoiles (les SIDÉROLITHES, Lam.) (4).
Des travaux et des recherches d'une patience infinie, exécutés successivement par Bianchi (ou Janus Plancus),
(1) Ce qu'on nomme pierre de Laon, n'est formé que de camérines. C'est sur de tels rochers que les pyramides d'Egypte sont fondées, et avec des pierres semblables qu'elles sont construites. Voyez le Mémoire de FORTIS sur les discolithes dans ses Mémoires sur l'Italie, et celui de M. Héricart de Thury, ainsi que les énumérations données par M. de Lamark, Anim. sans vert., VII, et par M. d'Orbigny, Tab. méth. des céphalopodes.
(2) Nautilus mammilla, Ficht. et Moll., VI, a, b, c, d;—Naut. lenticularis, VI, e, f, g, h, VII, a-h. A ce genre se rapportent aussi le LICOPHRE et l'ÉGÉONE, Montf., 158, 166, et son ROTALITE, 162, très différent des ROTALIES de Lamarck.
(3) Nautilus radiatus, Ficht, et Moll., VI, a, b, c, d;—Naut. veresus, ib., e, f, g, h.
(4) Siderol. calcitrapoïde, Lam., Faujas, mont. de St.-Pierre, pl. xxxiv.
[page] 23
Soldani, Fichtel et Moll, et Alc. d'Orbigny, ont fait connaître un nombre étonnant de ces coquilles chambrées et sans syphon comme les nummulaires, extrêmement petites, souvent même tout-à-fait microscopiques, soit dans la mer, parmi le sable, les fucus, etc., soit à l'état fossile, dans les couches sableuses de divers pays; et ces coquilles varient à un degré remarquable pour la forme générale, le nombre et la position relative des chambres, etc.; une ou deux espèces, les seules dont on ait observé les animaux, ont paru montrer un petit corps oblong, couronné par des tentacules nombreux et rouges, ce qui, joint aux cloisons de leur coquille, les a fait ranger, comme les genres dont nous venons de parler, à la suite des céphalopodes, classement qui aurait besoin d'être confimé par des observations plus nombreuses, pour être regardé comme définitif.
Linnæus et Gmel in placent parmi les nautiles celles de ces espèces qui étaient connues de leur temps.
M. d'Orbigny, qui les a étudiées avec plus de soin que personne, en fait un ordre qu'il nomme FORAMINIFÈRES, parce que les cellules n'y communiquent que par des trous, et les divise en familles d'après la manière dont les cellules sont rangées.
Lorsque les cellules sont simples et disposées en spirale, ce sont ses HÉLICOSTÈGUES, et elles se subdivisent encore. Si les tours de la spirale s'enveloppent, comme il arrive nommément dans les camérines, ce sont ses Hélicostègues nautiloïdes(1).
(1) Ces êtres infiniment petits intéressant peu notre plan, nous nous bornerons à citer les noms des genres avec quelques exemples. Dans cette première division, sont comprises les Camerines elles-même sous le nom de NUMMULINES, et en outre les NONIONINES (Nautilus pompiloïdes, Fichtel et Moll., N. incrassatus, iid.).
Les SYDEROLINES, les mêmes que les syderolites, Lam.
Les CRISTELLAIRES (Nautilus cassis, Naut. galea, iid., etc.),
Les ROBULINES (Nautilus calcar, N. vortex, iid.),
Les SPIROLINES (Spirotinites cylindracea, Lam., Anim. sans vert.),
Les PÉNÉROPLES (Nautilus planatus, Fichtel et Moll., etc.),
Les DENDRITINES,
Les POLYSTOMELLES,
Les ANOMALINES,
Les VERTÉBRALINES,
Les CASSIDULINES.
[page] 24
Si les tours ue se recouvrent pas, ce sont les Hélicostègues ammonoïdes (1).
Si les tours s'élèvent comme dans la plupart des univalves, ce sont les Hélicostègues turbinoïdes (2).
Des cellules simples peuvent aussi être enfilées sur un seul axe droit ou peu courbé, c'est la famille des STYCOSTÈGUES (3).
(1) M. d'Orbigny n'en fait que quatre genres,
Les SOLDANIES,
Les OPERCULINES,
Les PLANORBULINES,
Et les PLANULINES,
(2) Celles-ci comprennent dix genres,
Les TRONCATULINES,
Les GYROÏDINES,
Les GLOBIGÉRINES,
Les CALCARINES, où l'on place entre autres le Nautilus Spengleri, Fichtel et Moll., XIV, d, i, et XV,
Les ROTALIES,
Les ROSALINES,
Les VALVULINES,
Les BULIMINES,
Les UVIGÉRINES,
Et les CLAVULINES.
(3) Les Stycostègues sont divisées par M. d'Orbigny en huit genres,
Les NODOSAIRES, qu'il subdivise en NODOSAIRES propres, comme Nautilus radiculus, Lin.;—Naut. jugosus, Montag., Test. brit., XIV, f. 4; en DENTALINES, tels que Nautilus rectus, Montag., 1. cit., XIX, f. 4, 7 (le genre REOPHAGE, Montf., l. 330); en ORTHOCÈRINES, comme Nodosaria clavulus, Lam., Encycl., pl. 466, f. 3, et en MUCRONINES,
Les FRONDICULAIRES, où vient Renulina complanata, Blainv., Malac.,
Les LINGULINES,
Les RIMULINES,
Les VAGINULINES, où appartient Nautilus legumen, Gm., Planc. I, f. 7; Encycl., pl. 465, f. 3,
Les MARGINULINES, où est Nautilus raphanus, Gm., Soldan., II, XCIV,
LES PLANULAIRES, comme Nautilus crepidulus, Ficht. et Moll., XIX, g, h, i.
Et les PAVONINES.
[page] 25
Ou bien elles peuvent être disposées en deux séries alternatives; ce sont alors les ENALLOSTÈGUES (1).
Ou bien elles peuvent être rassemblées en petit nombre et ramassées commeen peloton; ce sont les AGATHISTÈGUES (2).
Enfin dans les ENTOMOSTÈGUES (3), les cellules ne sont pas simples comme dans les autres famille, mais elles se subdivisent par des cloisons transverses, de manière que la coupe de la coquille présente une sorte de treillis.
(1) M. d'Orbigny a cinq genres d'Enallostègues,
Les BIGENERINES,
Les TEXTULAIRES,
Les VULVULINES,
Les DIMORPHINES,
Les POLYMORPHINES,
Les VIRGULINES,
Et les SPHÉROÏDINES.
(2) Les AGATHISTÈGUES ou MILLIOLES des auteurs, qui composent à elles seules des bancs immenses de pierres calcaires, ne forment dans M. d'Orbigny que six genres,
Les BILOCULINES,
Les SPIROLOCULINES,
Les TRILOCULINES,
Les ARTICULINES,
Les QUINQUELOCULINES,
Et les ADELOSINES.
M. de Blainville assure avoir observé que leur animal n'a point de tentacules; en ce cas il s'éloignerait beaucoup des céphalopodes.
(3) Les Entomostègues ressembleut extérieurement à plusieurs des HÉLICOSTÈGUES. M. d'Orbigny en fait cinq genres,
Les AMPHISTÉGINES,
Les HÉTÉROSTÉGYNES,
Les ORBICULINES,
Les ALVÉOLINES,
Et les FABULAIRES
Les personnes qui voudront approfondir cette partie curieuse de la Conchyliologie, sur laquelle notre plan ne nous permet pas de nous étendre; mais qui peut être fort utile dans l'étude des couches fossiles, trouveront un bon guide dans le tableau méthodique des céphalopodes inséré par M. d'Orbigny, dans les Ann. des sc. nat, 1826, tome VII, p. 95 et 245, et profiteront aussi avec avantage des modèles en grand que cet habile observateur a fait exécuter.
[page] 26
DEUXIÈME CLASSE DES MOLLUSQUES,
LES PTÉROPODES (1).
Nagent, comme les céphalopodes, dans les eaux de la mer, mais ne peuvent s'y fixer ni y ramper faute de pieds. Leurs organes du mouvement ne consistent qu'en nageoires placées, comme des ailes, aux deux côtés de la bouche. On n'en connaît que de petites espèces et en petit nombre, toutes hermaphrodites.
LES CLIO. (CLIO. Lin. CLIONE. Pall.)
Ont le corps oblong, membraneux, sans manteau, la tête formée de deux lobes arrondis, d'où sortent de petits tentacules; deux petites lèvres charnues et une languette sur le devant de la bouche, et les nageoires chargées d'un réseau vasculaire qui tient lieu de branchies; l'anus et l'orifice de la génération sont sous la branchiedroite. Quelques-uns leur attribuent des yeux.
La masse des viscères ne remplit pas à beaucoup près l'enveloppe extérieure: l'estomac est large, l'intestin court, le foie volumineux.
L'espèce la plus célèbre (Clio borealis, L.), fourmille dans les mers du nord, et fait, par son abondance, une pâture
(1) M. de Blainville réunit mes Ptéropodes et mes gastéropodes, en une seule classe qu'il nomme PARACÉPHALOPHORES, et il y place mes Ptéropodes comme un ordre particulier, sous le nom d'APOROBRANCHES. Cet ordre est divisé en deux familles; les Thécosomes, qui ont une coquille, et les Gymnosomes, qui n'en ont pas.
[page] 27
pour les baleines, quoique chaque individu ait à peine un pouce de long (1).
Bruguière en a observé une plus grande, et non moins abondante, dans la mer des Indes; elle se distingue par sa couleur rose, sa queue échancrée, et son corps partagé en six lobes par des rainures. Encycl. Méth., pl. des Mollusques, pl. LXXV, f. 1, 2.
Il paraît qu'il faut également placer ici
LES CYMBULIES de Péron,
Qui ont une enveloppe cartilagineuse ou gélatineuse en forme de chaloupe ou plutôt de sabot, hérissée de petites pointes en séries longitudinales; l'animal a deux grandes ailes à tissu vasculaire, qui sont ses branchies et ses nageoires, et entre elles, du côté ouvert, un troisième lobe plus petit à trois pointes; la bouche avec deux petits tentacules est entre les ailes, vers le côté fermé de la coquille, et au-dessus deux petits yeux et l'orifice de la génération, d'où sort une verge en forme de petite trompe. La transparence permet de distinguer le cœur, le cerveau et les viscères au travers des enveloppes (2).
LES PNEUMODERMES. (PNEUMODERMON. Cuv.)
Commencent à s'écarter un peu plus des clio. Ils ont le corps ovale, sans manteau et sans coquilles, les branchies attachées à la surface, et formées de petits feuillets rangés sur deux ou trois lignes disposées en H à la partie opposée à la tête; les nageoires petites; la bouche garnie
(1) Le Clio borealis, de Pallas (Spicil., X, pl. 1, f. 18, 19), le Clio retusa de Fabricius (Faun. groen., L., 334), et le Clio limacina de Phips (Ellis, Zooph., pl. 15, f. 9, 10.), dont Gmelin fait autant d'espèces différentes, ne paraissent que ce seul et même animal.
(2) Voyez Péron, Ann. Mus., XV, pl. 111, f. 10–11. N. B. Dans la fig. de Cymbulie donnée par M. de Blainv., Malac., XLVI, 3, l'animal est mis dans la coquille en sens contraire du véritable. Notre description repose sur des observations récentes et répétées de M. Laurillard.
[page] 28
de deux petites lèvres et deux faisceaux de nombreux tentacules, terminés chacun par un suçoir, a en dessous un petit lobe ou tentacule charnu (1).
L'espèce connue (Pneumodermon Peronii, Cuv., Ann. du Mus., IV, pl. 59, et Péron, ib., XV, pl. 2) a été prise dans l'Océan par Péron. Elle n'a guères qu'un pouce de long.
LES LIMACINES. Cuv.
Doivent, d'après la description de Fabricius, avoir de grands rapports avec les pneumodermes; mais leur corps se termine par une queue contournée en spirale, et se loge dans une coquille très mince, d'un tour et demi, ombiliquée d'un côté et aplatie de l'autre. L'animal se sert de sa coquille comme d'un bateau, et de ses ailes comme de rames quand il veut nager à la surface de la mer.
L'espèce connue (Clio helicina de Phips et de Gmel. Argonauta arctica; Fabric., Faun. Groenl., 387, n'est guères moins abondante que le Clio boréal dans la mer Glaciale, et passe aussi pour un des principaux aliments de la baleine (2).
LES HYALES. (HYALEA. Lam. CAVOLINA. Abildg.)
Ont deux très grandes ailes, point de tentacules, un manteau fendu par les côtés, logeant les branchies dans le fond de ses fissures, et revêtu d'une coquille également fendue par les côtés, dont la face ventrale est très bombée, la dorsale plate, plus longue que
(1) M. de Blainville avait pensé que les nageoires portent le tissu branchial, et que ce que j'ai regardé comme des branchies est une autre sorte de nageoire. En ce cas l'analogie avec les clio aurait été encore plus grande, mais il est revenu depuis à ma manière de voir (Malacol., p. 483).
(2) Je ne sais si l'animal dessiné par M. Scoresby, dont M. de Blainville (Malac., pl. XLVIII bis, f. 5), fait son genre SPIRATELLE, est bien, comme il le croit, le même que ceux de Phips et de Fabricius.
[page] 29
l'autre, et la ligne transverse qui les unit en arrière, munie de trois dentelures aiguës. Dans l'état de vie, l'animal fait sortir par les fentes latérales de sa coquille des lanières plus ou moins longnes, qui sont des productions du manteau.
L'espèce la plus connue (Anomia tridentata, Forskahl; Cavolina natans, Abildgaard, Hyalea cornea, Lam.) Cuv., Ann. du Mus., IV, pl. 59, et Péron, ib. XV, pl. 3, fig. 13, a une petite coquille jaunâtre, demi-transparente, que l'on trouve dans la Méditerrannée et dans l'Océan (1).
LES CLÉODORES. (CLEODORA. Péron.)
Pour lesquelles Brown avait originairement créé le genre Clio, paraissent analogues aux hyales, par la simplicité de leurs ailes, et l'absence de tentacules entre elles; il est probable que leurs ouïes sont aussi cachées dans le manteau; cependant leur coquille conique ou pyramidale n'est pas fendue sur les côtés.
M. Rang distingue les CLÉODORES propres, à coquille pyramidale,
Les CRESÉIS, à coquille conique, alongée (2),
Les CUVIÈRIES, à coquille cylindrique,
Les PSYCHÉS, à coquille globuleuse,
Les EURYBIES, à coquille hémisphérique (3).
(1) Aj. Hyal lanceolata, Lesueur, Bull. des sc., juin 1813, pl. V, f. 3;—Hyal. inflexa, ib., f. 4.
N. B. Le Glaucus, la Carinaire et la Firole, que M. Péron rapporte aussi à la famille des Ptéropodes, appartiennent à célle des Gasteropodes; le Philliroé, du même auteur, y appartient très probablement aussi, et son Callianire est un zoophyte.
(2) C'est probablement auprès des creséis, et peut-être dans le même sous-genre qu'il faut placer, selon MM. Rang et Audouin, le genre TRIPTÈRE, de MM. Quoy et Caymard, que M. de Blainville rapporte à la famille des acères.
(3) Voyez les Mém. de M. Rang, Ann. Sc. nat., novembre 1827, et mars 1828.
N. B. Plusieurs ptéropodes ont été découverts à l'état fossile. M. Rang a trouvé dans les terrains de Bordeaux des hyales, des cléodores, la Cuvierie. Voyez Ann. des Sc. nat., août 1826. La vaginelle de Daudin est une creséis pour M. Rang; elle en a en effet tous les caractères.
[page] 30
On a cru pouvoir rapprocher des hyales
LE PYRGO.
Très petite coquille fossile, découverte par M. Defrance, globuleuse, très mince, divisée par une fente transversale très étroite, si ce n'est par le devant, où elle s'élargit un peu.
TROISIÈME CLASSE DES MOLLUSQUES,
LES GASTEROPODES,
Constituent une classe très nombreuse de mollusques, dont on peut se faire une idée par la limace et le colimaçon.
Ils rampent généralement sur un disque charnu placé sous le ventre, mais qui prend quelquefois la forme d'un sillon ou celle d'une lame verticale; le dos est garni d'un manteau, qui s'étend plus ou moins, prend diverses figures, et produit une coquille dans le plus grand nombre des genres. Leur tête, placée en avant, se montre plus ou moins, selon qu'elle est plus ou moins engagée sous le manteau. Elle n'a que de petits tentacules qui sont au-dessus de la bouche et ne l'entourent pas. Leur nombre va de deux à six, et ils manquent quelque-
[page] 31
fois; leur usage n'est que pour le tact, et au plus pour l'odorat. Les yeux sont très petits, tantôt adhérents à la tête, tantôt à la base, ou au côté, ou à la pointe du tentacule; ils manquent aussi quelquefois. La position, la structure et la nature de leurs organes respiratoires varient et donnent lieu de les diviser en plusieurs familles; mais ils n'ont jamais qu'un cœur aortique, c'est-à-dire placé entre la veine pulmonaire et l'aorte.
La position des ouvertures par lesquelles sortent les organes de la génération et celle de l'anus varient; cependant elles sont presque toujours sur le côté droit du corps.
Plusieurs sont absolument nus; d'autres n'ont qu'une coquille cachée; mais le plus grand nombre en porte qui peuvent les recevoir et les abriter.
Ces coquilles se produisent dans l'épaisseur du manteau. Il y en a de symétriques de plusieurs pièces, de symétriques d'une seule pièce, et de non symétriques qui, dans les espèces où elles sont très concaves et où elles croissent long-temps, donnent nécessairement une spirale oblique.
Que l'on se représente en effet un cône oblique, dans lequel se placent successivement d'autres cônes, toujours plus larges dans un certain sens que dans les autres, il faudra que l'ensemble se roule sur le côté qui grandit le moins.
Cette partie, sur laquelle est roulé le cône, se nomme la columelle, et elle est tantôt pleine, tan-
[page] 32
tôt creuse. Lorsqu'elle est creuse, son ouverture se nomme ombilic.
Les tours de la coquille peuvent rester à peu près dans le même plan, ou tendre toujours vers la base de la columelle.
Dans ce dernier cas, les tours précédents s'élèvent au-dessus les uns des autres, et forment ce que l'on nomme la spire, qui est d'autant plus aiguë que les tours descendent plus rapidement et qu'ils s'élargissent moins. Ces coquilles à spire saillante se nomment turbinées.
Quand, au contraire, les tours restent à peu près dans le même plan, et qu'ils ne s'enveloppent pas, la spire est plate ou même concave. Ces coquilles s'appellent discoïdes.
Quand le haut de chaque tour enveloppe les précédents, la spire est cachée.
La partie de laquelle l'animal semble sortir, se nomme l'ouverture.
Quand les tours restent à peu près dans le même plan, lorsque l'animal rampe, il a sa coquille posée verticalement, la columelle en travers sur le derrière de son dos, et sa tête passe sous le bord de l'ouverture opposée à la columelle.
Quand la spire est saillante, c'est obliquement du côté droit qu'elle se dirige, dans presque toutes les espèces; un petit nombre seulement ont leur spire saillante à gauche, lorsqu'elles marchent, et se nomment perverses.
[page] 33
On remarque que le cœur est toujours du côté opposé à celui où se dirige la spire. Ainsi il est ordinairement à gauche, et dansles perverses il est à droite. Le contraire a lieu pour les organes de la génération.
Les organes de la respiration, quisont toujoursdans le dernier tour de la coquille, reçoivent l'élément ambiant par dessous son bord, tantôt parce que le manteau est entièrement détaché du corps le long de ce bord, tantôt parce qu'il y est percé d'un trou.
Quelquefois le bord du manteau se prolonge en canal pour que l'animal puisse aller chercher l'élément ambiant sans faire sortir sa tête et son pied de la coquille. Alors la coquille a aussi dans son bord, près du bout de la columelle opposé à celui vers lequel tend la spire, une échancrure ou un canal pour loger celui du manteau. Par conséquent le canal est à gauche dans les espèces ordinaires, à droite dans les perverses.
Au reste, l'animal étant très flexible, fait varier la direction de la coquille, et le plus souvent lorsqu'il y a une échancrure ou un canal, il dirige le canal en avant, ce qui fait que la spire est en arrière, la columelle vers la gauche, et le bord opposé vers la droite. Le contraire a lieu dans les perverses. Voilà pourquoi on dit que leur coquille tourne à gauche.
L'ouverture de la coquille, et par conséquent aussi le dernier tour sont plus ou moins grands, par rapport aux autres tours, selon que la tête ou le pied de
TOME III. 3
[page] 34
l'animal qui doivent sans cesse en sortir et y rentrer, sont plus ou moins volumineux par rapport à la masse des viscères qui restent fixés dans la coquille.
Cette ouverture est d'autant plus large ou plus étroite, que ces mêmes parties sont plus au moins épaisses. Il y a des coquilles dont l'ouverture est étroite et longue; c'est que le pied est mince et se replie en deux pour rentrer.
La plupart des gastéropodes aquatiques à coquille spirale, ont un opercule, ou pièce tantôt cornée, tantôt calcaire, attachée sur la partie postérieure du pied, et qui ferme la coquille quand l'animal y est rentré et replié.
Il y a des gastéropodes à sexes séparés, et d'autres qui sont hermaphrodites, et dont les uns peuvent se suffire à eux-mêmes, tandis que les autres ont besoin d'un accouplement réciproque.
Leurs organes de la digestion ne diffèrent pas moins que ceux de la respiration.
Cette classe est trop nombreuse pour que nous n'ayons pas dû la diviser en un certain nombre d'ordres que nous avons tirés de la position et de la forme de leurs branchies.
LES PULMONÉS.
Respirent l'air en nature dans une cavité dont ils ouvrent et ferment à volonté l'étroit orifice; ils sont hermaphrodites avec accouplement réciproque; les uns n'ont point de coquille, les autres
[page] 35
en portent, et même souvent de complétement turbinées, mais ils n'ont jamais d'opercule.
LES NUDIBRANCHES.
N'ont aucune coquille, et portent des branchies de diverses formes à nu sur quelque partie de leur dos.
LES INFÉROBRANCHES.
Semblables d'ailleurs aux précédents, portent leurs branchies sous les rebords de leur manteau.
LES TECTIBRANCHES.
Ont des branchies sur le dos ou sur le côté, couvertes par une lame du manteau, qui contient presque toujours une coquille plus ou moins développée, ou quelquefois seulement enveloppées dans un rebord redressé du pied.
Ces quatre ordres sont hermaphrodites, avec accouplement réciproque.
LES HÉTÉROPODES.
Portent les branchies sur le dos, où elles forment une rangée transversale de petits panaches et sont dans quelques-uns protégées, ainsi qu'une partie des viscères, par une coquille symétrique. Ce qui les distingue le mieux, c'est un pied comprimé en nageoire mince et verticale, au bord de laquelle se montre souvent une petite ventouse, seul vestige du pied horizontal du reste de la classe.
3*
[page] 36
LES PECTINIBRANCHES.
Ont les sexes séparés; leurs organes respiratoires consistent presque toujours en branchies, composées de lamelles réunies en forme de peignes, et sont cachés dans une cavité dorsale, largement ouverte au-dessus de la tête.
Ils ont à peu près tous des coquilles turbinées, à bouche tantôt entière, tantôt échancrée, tantôt munie d'un syphon, et le plus souvent susceptible d'être plus ou moins bien fermée par un opercule attaché au pied de l'animal en arrière (1).
LES SCUTIBRANCHES.
Ont des branchies analogues à celles des pectinibranches; mais leurs sexes sont réunis de manière qu'ils se fécondent eux-mêmes sans accouplement, comme la classe des acéphales; leurs coquilles sont très ouvertes, et dans plusieurs en bouclier non turbiné: ils n'ont jamais d'opercule.
LES CYCLOBRANCHES.
Hermaphrodites à la manière des scutibranches, ont une coquille d'une ou de plusieurs pièces, mais jamais turbinée ni operculée; leurs branchies sont attachées sous les rebords de leur manteau comme dans les inférobranches.
(1) N. B. Quelquefois, comme dans les vermets et les siliquaires, le pied est recourbé de manière qu'il semble que l'opercule soit en avant.
[page] 37
LE PREMIER ORDRE DES GASTÉROPODES,
LES PULMONÉS (1),
Se distinguent des autres mollusques en ce qu'ils respirent l'air élastique par un trou ouvert sous le rebord de leur manteau, et qu'ils dilatent ou contractent à leur gré; aussi n'ont-ils point de branchies, mais seulement un réseau de vaisseaux pulmonaires, qui rampent sur les parois et principalement sur le plafond de leur cavité respiratoire.
Les uns sont terrestres, d'autres vivent dans l'eau, mais sont obligés de venir de temps en temps à la surface ouvrir l'orifice de leur cavité pectorale pour respirer.
Tous ces animaux sont hermaphrodites.
LES PULMONÉS TERRESTRES,
Ont presque tous quatre tentacules; deux ou trois seulement de fort petite taille n'ont pas laissé voir la paire inférieure.
Ceux d'entre eux qui n'ont point de coquille apparente, formaient dans Linnæus le genre
DES LIMACES. (LIMAX. L.)
Que nous divisons comme il suit:
LES LIMACES proprement dites. (LIMAX. Lam.)
Ont le corps alongé, et pour manteau un disque charnu,
(1) M. de Blainville a préféré à ce nom celui de PULMOBRANCHES
[page] 38
serré, qui occupe seulement le devant du dos, et ne recouvre que la cavité pulmonaire. Il contient, dans plusieurs espèces, une petite coquille oblongue et plate, ou au moins une concrétion calcaire qui en tient lieu. L'orifice de la respiration est au côté droit de cette espèce de bouclier, et l'anus est percé au bord de cet orifice. Les quatre tentacules sortent et rentrent en se déroulant comme des doigts de gants, et la tête elle-même peut rentrer en partie sous le disque du manteau. Les organes de la génération s'ouvrent sous le tentacule droit supérieur. Il n'y a à la bouche qu'une mâchoire supérieure en forme de croissant dentelé, qui leur sert à ronger avec beaucoup de voracité les herbes et les fruits, auxquels elles causent beaucoup de dégâts. Leur estomac est alongé, simple et membraneux.
M. de Ferussac distingue
Les ARIONS, où l'orifice de la respiration est vers la partie antérieure du bouclier; il n'y a dans le bouclier que des grains calcaires. Telle est
La Limace rouge. (Limax rufus. L.) Férussac. Moll. terr. et fluv. pl. I et III.
Que l'on rencontre à chaque pas dans les temps humides, et qui est quelquefois presque entièrement noire, ib., II, 1, 2; c'est celle dont on emploie le bouillon dans les maladies de poitrine (1).
Et les LIMAS, où cet orifice est vers la partie posté lieure leur coquille est souvent mieux prononcée.
Telle est
La grande Limace grise. (L. maximus. L.) Lim. antiquorum. Féruss. pl. IV et pl. VIII. A. f. 1. L. Sylvaticus. Drap. Moll. IX. 10.
Souvent tachetée ou rayée de noir; dans les caves, les forêts sombres.
(1) Aj. la Limace blanche (L. albus, Müll.), Ferussac., pl. 1, f. 3;—la L. de jardin (L. hortensis, id.), pl. II, f. 4–6.
[page] 39
La petite Limace grise. (L. agrestis. L.) Féuss. pl. V. f. 5–10.
Petite, sans taches; l'une des plus abondantes et des plus nuisibles (1).
LES VAGINULES. (VAGINULUS. Féruss.)
Ont le manteau serré sans coquille, et tendu sur toute la longueur du corps, quatre tentacules, dont les inférieurs un peu fourchus; l'anus tout-à-fait à l'extrémité postérieure, entre la pointe du manteau et celle du pied; et le même orifice conduisant à la cavité pulmonaire, située le long du flanc droit; l'orifice de l'organe mâle de la génération est sous le tentacule inférieur droit, et celui de l'organe femelle sous le milieu du côté droit. Ces organes, ainsi que ceux de la digestion, sont fort semblables à ceux du colimaçon.
Ce sont des mollusques des deux Indes, très semblables à nos limaces (2).
LES TESTACELLES (TESTACELLA. Lam.)
Ont l'orifice de la respiration et l'anus à l'extrémité pos-
(1) Aj. Limax alpinus, Féruss., pl. v, a;—L. gagates, Drap., pl. IX, f. 1 et 2, etc.
N. B. Les PLECTROPHORES, Féruss., seraient des limaces qui porteraient sur le bout de leur queue et loin du bouclier, une espèce de petite coquille conique; mais on ne les connaît que par des dessins peu authentiques, Favanne, Zoomorphose, pl. LXXVI, copié Féruss., pl. VI, f. 5, 6, 7.
M. de Blainville doute aujourd'hui (Malac., p. 464) de la réalité de son genre LIMACELLE, et rejette son genre VÉRONICELLE (Dict. des Sc. nat.). Les PHILOMYQUES et les EUMELES de Rafin., sont trop imparfaitement indiqués pour être admis dans un ouvrage tel que celui-ci.
(2) Vaginulus Taunaisii, Féruss., pl. VIII, A, f. 7; et VIII, B, 2, 3;—V. altus, id, pl. VIII, A, f. 8, et VIII, B, f. 6;—V. Langsdorfii, id., pl. VIII, B, f. 3 et 4;—V. lœvigatus, id., pl. VIII, B, f. 5, 7;—Onchidium occidentale, Guilding, Trans. linn., XIV, IX.
Le genre Meghimatium de Van Hasselt, Bullet. univ., 1824, Zool., tom. III, p. 82 paraît aussi devoir s'y joindre.
N. B. Le genre Vaginule est différent de l'Onchidium, avec lequel M. de Blainville l'a réuni (Malac., p. 465), en même temps qu'il en détachait de vrais Onchidiums pour en faire son genre PERONIA. Il a d'ailleurs donné une bonne anatomie du Vaginule dans les Moll. terr. et fluv. de M. de Férussac, pl. VIII, C.
[page] 40
térieure; leur manteau est fort petit, et placé sur cette même extrémité. Il contient une petite coquille ovale, à très large ouverture, à très petite spire, qui n'égale pas le dixième de la longueur du corps. Pour le reste, ces animaux ressemblent aux limaces.
On en trouve une espèce assez abondante dans nos départements méridionaux (Testacella haliotoidea, Draparn.), Cuv., Ann. Mus., V, XXVI, 6–11, qui vit sous terre, et se nourrit principalement de lombrics. M. de Férussac a observé que son manteau se développe extraordinairement lorsqu'elle se trouve dans un lieu trop sec, et qu'il lui donne alors une sorte d'abri.
LES PARMACELLES. (PARMACELLA. Cuv.)
Ont un manteau membraneux à bords lâches, placé sur le milieu du dos, et contenant dans sa partie postérieure une coquille oblongue, plate, qui montre en arrière un léger commencement de spire. L'orifice de la respiration et l'anus sont sous le côté droit du milieu du manteau.
La première espèce connue est de Mésopotamie. (Parmacella Olivieri.) Cuv., Ann. Mus., V, XXIX, 12–15.
Il y en a une du Brésil (P. palliolum, Féruss., pl. VII, A), et quelques autres des Indes.
Dans les pulmonés terrestres à coquille complète et apparente, les bords de l'ouverture sont le plus souvent relevés en bourrelet dans l'adulte.
Linnæus rapportait à son genre
DES ESCARGOTS. (HELIX. L.)
Toutes les espèces où l'ouverture de la coquille un peu entamée par la saillie de l'avant-dernier tour, prend ainsi une circonscription en forme de croissant.
Quand ce croissant de l'ouverture est autant ou plus large qu'il n'est haut, ce sont
LES ESCARGOTS proprement dits. (HELIX. Brug. et Lam.)
[page] 41
Les uns ont la coquille globuleuse. Tout le monde connaît dans ce nombre le grand Escargot (Hel. pomatia, L.), commun dans les jardins, les vignes, à coquille roussâtre, marquée de bandes plus pâles; nourriture assez recherchée dans quelques cantons, et la Livrée ou petit Escargot des arbres (Hel. nemoralis, L.) à coquille diversement et vivement colorée, qui nuit beaucoup aux espaliers dans les temps humides (1).
Il n'est personne qui n'ait entendu parler des curieuses expériences sur la reproduction de leurs parties coupées (2).
D'autres ont la coquille déprimée, c'est-à-dire à spire aplatie (3).
On doit en remarquer parmi elles quelques-unes, qui ont intérieurement des côtes saillantes (4).
Et surtout celles où le dernier tour se recourbe subitement dans l'adulte, et y prend une forme irrégulière et plissée (5).
(1) Ajoutez les Helix glauca;—Citrina;—Rapa;—Castanea;—Globulus,—Lactea;—Arbustorum;—Fulva;—Epistylium;—Cincta;—Ligata;—Aspersa;—Extensa;—Nemorensis;—Fruticum;—Lucena;—Vittata;—Rosacea;—Itala;—Lusitanica;—Aculeata;—Turturum;—Cretacea;—Fuscescens;—Terrestris;—Nivea;—Hortensis;—Lucorum;—Grisea;—Hœmastoma;—Pulla;—Venusta;—Picta, Gm., etc.
(2) Voyez Spallanzani, Schœffer, Bonnet, etc.
(3) Hel. lapicida;—H. cicatricosa;—H. œgophtalmos;—H. oculus capri;—H. albella;—H. maculata;—H. algira;—H. lœvipes;—H. vermiculata;—H. exilis;—H. carocolla;—H. cornu militare;—H. pellis serpentis;—H. gualteriana;—H. oculus communis;—H. marginella;—H. maculosa;—H. nœvia;—H. corrugata;—H. ericetorum;—H. nitens;—H. costata;—H. pulchella;—H. cellaria;—H. obvoluta;—H. strigosula;—H. radiata;—H. crystallina.;—H. ungulina;—H. volvulus,—H. tnvolvulus;—H. badia;—H. cornu venatorium, etc.
(4) Hel. sinuata;—H lucerna,—H. tychnuchus;—H. cepa;—H. isognomostoma;—H. sinuosa;—H. punctata, etc.
(5) Hel. ringens, Chemn., IX, CIX, 919, 920, ce sont les ANOSTOMES, Lam., ou TOMOGÈRES, Montf. Une coquille fossile assez analogue est le genre STROPHOSTOME, Deshayes.
On doit encore étudier sur les escargots, les planches V, VI, VII, et VIII de Draparn., et les descriptions y relatives; les ouvrages de Sturm et de Pfeiffer sur les espèces d'Allemagne; mais surtout le grand et bel ouvrage in-fol. de M. de Férussac, sur les mollusques terrestres et fluviatiles.
[page] 42
LES VITRINES. (VITRINA. Draparn. HELICO-LIMAX. Féruss.)
Sont des escargots à coquille très mince, aplatie, sans ombilic, et à grande ouverture sans bourrelet; dont le corps est trop grand pour rentrer entièrement dans la coquille; le manteau a un double rebord (1); le rebord supérieur, qui est divisé en plusieurs lobes, peut beaucoup dépasser la coquille, et se replier sur elle pour la frotter et la polir.
Celles qu'on connaît en Europe vivent dans les lieux humides, et sont fort petites (2).
Il y en a de plus grandes dans les pays chauds.
On doit en rapprocher quelques escargots qui, sans avoir de double rebord, ont néanmoins aussi peine à rentrer dans leur coquille (3).
Quand le croissant de l'ouverture est plus haut qu'il n'est large, ce qui arrive toujours, dans des coquilles à spire oblongue ou alongée, ce sont:
LES BULIMES TERRESTRES de Brug.
Qu'il a fallu encore subdiviser comme il suit:
LES BULIMES proprement dits. (BULIMUS. Lam.)
Ont l'ouverture garnie d'un bourrelet dans l'adulte, mais sans dentelures.
On en trouve dans les pays chauds de grandes et belles espèces; quelques-unes sont remarquables par le volume de leurs œufs, dont la coque est pierreuse; d'autres, par leur coquille gauche.
Nous en avons ici plusieurs, médiocres ou petites, dont une (Helix decollata, Gm.), Chemn., CXXXVI, 1254–1257, a l'habitude singulière de casser successivement les
(1) C'est ce que M. de Férussac nomme une cuirasse et un collier.
(2) Helix pellucida, Müll. et Geoff.; Vitrina pellucida, Drap., VIII, 34–37;—l'Helicarion, Quoy et Gaym., Zool. de Freyc., pl. LXVII, I; Féruss., pl. IX, f. 1–4?
(3) Hel. rufa et brevipes, Féruss., Drap., VIII, 26–33.
[page] 43
tours du sommet de sa spire. On emploie cet exemple pour prouver que les muscles de l'animal peuvent se détacher de la coquille; car il vient un moment où ce bulime ne conserve plus un seul des tours de spire qu'il avait au commencement (1).
LES MAILLOTS. (PUPA. Lam.) Autrement BARILLETS, etc.
Ont une coquille à sommet très obtus, et dont le dernier tour redevient plus étroit que les autres dans l'adulte, ce qui lui donne la forme d'un ellipsoïde, ou quelquefois presque d'un cylindre. L'ouverture est entourée d'un bourrelet, et entamée du côté de la spire par le tour précédent. Ce sont de petites espèces qui vivent dans les lieux humides, parmi les mousses, etc.
Quelquefois il n'y a aucune dentelure (2).
Plus souvent, il y en a une dans la partie de l'ouverture fermée par l'avant-dernier tour (3).
Souvent aussi, il y en a en dedans du bord extérieur (4).
(1) Aj. Helix ovalis, Gm., Chemn., IX, CXIX, 1020, 1021;—Hel. oblonga, ib., 1022, 1023;—H. trifasciata, id., CXXXIV, 1215;—H. dextra, ib., 1210–1212;—Interrupta, ib., 1213, 1214;—H., ib., 1215;—H., ib., 224, 1225;—H. perversa, id., CX et CXI, 928–937;—H. inversa, ib., 925, 926;—H. contraria, id., CXI, 938, 939;—H. lœva, ib, 940 et 949;—H. labiosa, id., CXXXIV, 1234;—H. ib., 1232;—H. ib., 1231;—H. cretacea, id., CXXXVI, 1263;—H. pudica, id., CXXI, 1042;—H. calcarea, id., CXXXV, 1226.
Bulla auris malchi, L., Gm., ib., 1037, 1038. V, ib., 1041.
Bulimus columba, Brug., Séb., III, LXXI, 61;—Bulimus fasciolatus, Oliv., Voyage, pl. XVII, f. 5. Pour les petites espèces de ce pays-ci, voyez Draparnaud, Moll. terr. et fluviat., pl. IV, f. 21–32.
(2) Bulimus labrosus, Oliv., Voyage, pl. XXXI, f. 10, A. B.;—Pupa. edentula, Drap., III, 28 et 29;—Pupa obtusa, ib, 43, 44;—Bul. fusus, Brug.
(3) Turbo uva, L. Martini, IV, CLIII, 1439;—Turbo muscorum, L. (Pupa marginata, Drap., III, 36, 37, 38);—Pupa muscorum, Drap. III, 26, 27 (Vertigo cylindrica, Féruss.);—Pupa umbilicata, Drap., III, 39, 40;—P. doliolum, ib., 41, 42.
(4) Hel. vertigo, Gm. (Pupa vertigo, Drap., III, 34, 35);—Pupa antivertigo, ib., 32, 33;—Pupa pygmœa, ib., 30, 31;—Bulimus ovularis, Oliv., Voyage, XVII, 12, a, b.
[page] 44
LES GRENAILLES. (CHONDRUS. Cuv.)
Ont, comme les derniers maillots, l'ouverture entamée du côté de la spire par le tour précédent, et bordée de lames ou de dents saillantes; mais leur forme est plus ovoïde, et comme aux bulimes ordinaires.
Les uns ont des dents au bord de l'ouverture (1).
D'autres, des lames placées plus profondément (2).
Ici se terminent les espèces terrestres d'helix, à coquille munie d'un bourrelet dans l'adulte.
LES AMBRETTES. (SUCCINEA. Drap.)
Ont la coquille ovale, l'ouverture plus haute que large, comme les bulimes, mais plus grande à proportion, sans bourrelet, et le côté de la columelle presque concave. L'animal ne peut y rentrer en entier, et on pourrait presque le regarder comme une testacelle à grande coquille. Il a les tentacules inférieurs fort petits, et vit sur les herbes et les arbustes des bords des ruisseaux, ce qui a fait regarder ce genre comme amphibie (3).
On a dû démembrer du genre TURBO de Linn., et rapprocher des hélices terrestres,
LES NOMPAREILLES. (CLAUSILIA. Drap.)
Qui ont la coquille grêle, longue et pointue, le dernier tour dans l'adulte rétréci, comprimé et un peu
(1) Bulimus zebra, Ol., XVII, 10;—Pupa tridens, Drap., III, 57;—Pupa variabilis, ib., 55, 56.
(2) Bulimus avenaceus, Brug. (Pupa avena), Drap., III, 47, 48;—P. secale, ib., 49, 50;—P. frumentum, ib., 51, 52;—Bulimus similis, Brug.;—P. cinerea, Drap., ib., 53, 54;—P. polyodon., IV, 1, 2;—Helix quadridens (Pupa quadr., Drap.), ib., 3.
(3) Suceinea amphibia, Drap., IV, 22, 23 (Helix putris, L.);—S. oblonga, ib., 24.—Les genres COCHLOHYDRE, Féruss., LUCÈNE, Oken, TASSADE, Huder, correspondent aux Ambrettes. M. Delamark les nommait d'abord AMPHIBULIMES. L'Amphibulime encapuchonné, Lam., Ann. du Mus., VI, LV, 1, pourrait aussi bien être une testacelle.
[page] 45
détaché, terminé par une ouverture complète, et bordée d'un bourrelet, souvent dentelée ou garnie de lames.
Le plus souvent on trouve dans le rétrécissement du dernier tour une petite lame légèrement courbée en S, dont on ignore l'usage dans l'animal vivant.
Ce sont de petites espèces qui vivent dans les mousses, au pied des arbres, etc. Un grand nombre sont tournées à gauche (1).
On a dû également séparer des BULLES de Linnaœus, et ramener ici
LES AGATINES. (ACHATINA. Lam.)
Dont la coquille ovale ou oblongue, a l'ouverture plus haute que large des bulimes, mais manque de bourrelet, et a l'extrémité de la columelle tronquée, ce qui est le premier indice des échancrures que nous verrons aux coquilles de tant de gastéropodes marins. Ces agatines sont de grands escargots, qui dévorent les arbres et les arbustes dans les pays chauds (2).
Montfort en distingue celles où le dernier tour a en dedans un cal ou épaississement particulier (les LIGUUS, Montf. (3)); ce tour y est moins haut, à proportion, que dans les autres.
(1) Turbo perversus, L. List., 41, 39;—Turbo bidens, Gm., Drap., IV, 5–7;—Turbo papillaris, Gm., Drap., ib., 13; et les autres clausilies de Drap., représ. sur la même plauche;—Bulimus retusus, Oliv., Voyage, XVII, 2;—Bul. inflatus, ib., 3;—Bul. teres, ib., 6;—Bul. torticollis, ib., 4, a, b.;—Turbo tridens, L. Chemn., IX, XII, 957;—Clausilia collaris, Féruss., List., 20, 16.
(2) Bulla zebra, L. Chemn., IX, CIII, 875, 876; CXVIII, 1014–1016;Bulla achatina, ib., 1012, 1013;—Bulla purpurea, ib., 1018;—Bulla dominicensis, id., CXVII, 1011;—Bulla stercus pulicum, CXX, 1026, 1027;—Bulla flammea, id., CXIX, 1021–1025;—Helix tenera, Gm., ib., 1028, 1030;—Bulimus bicarinatus, Brug., List., 37;—Mélanie buccinoïde, Oliv, Voyage, XVII, 8.
(3) Bulla virginea, L., Chemn., IX, CXVII, 1000–1003; X, CLXXIII, 1682, 3.
[page] 46
Et celles où l'extrémité de la columelle se recourbe vers le dedans de l'ouverture (les POLYPHÊMES, Montf. (1)); le dernier tour y est plus haut.
LES PULMONÉS AQUATIQUES,
N'ont que deux tentacules, comme nous l'avons dit; ils viennent toujours à la surface pour respirer, en sorte qu'ils ne peuvent habiter des eaux bien profondes, aussi vivent-ils la plupart dans les eaux douces ou les étangs salés, ou du moins près des côtes et des embouchures des rivières.
Il y en a sans coquilles, tels que
LES ONCHIDIES. (ONCHIDIUM. Buchanan.)(2).
Un large manteau charnu, en forme de bouclier, déborde leur pied de toutes parts, et recouvre même leur tête quand elle se contracte. Elle a deux longs tentacules rétractiles, et sur la bouche un voile échancré ou formé de deux lobes triangulaires et déprimés.
L'anus et l'orifice de la respiration sont sous le bord postérieur du manteau, où est un peu plus profondément la cavité pulmonaire. Près d'eux, à droite, s'ouvre l'or-
(1) Bulimus glans, Brug., Chemn., IX, CXVII, 1009, 1010.
(2) ONCHIDIUM, nom donné à ce genre, parce que la première espèce (Onchid. typhœ, Buchan., Soc. Linn., Lond., V, 132) était tuberculeuse; j'en connais maintenant une lisse, Onchid. lœvigatum, Cuv., et quatre ou cinq tuberculeuses: Onch. Peronii, Cuv., Ann. Mus., V, 6;—Onchid. Sloanii, Cuv., Sloane, Jam., pl. 273, 1 et 2;—Onch. verruculatum, Descr. de l'Eg., moll. gaster., pl. 11, f. 3;—Onch. celticum, Cuv., petite espèce des côtes de Bretagne, etc.
N. B. M. de Blainville a changé le nom d'Onchidium en PERONIA, et transporté le premier aux Vaginules. Il place ses peronia parmi ses Cyclobranches; mais je ne puis apercevoir de différence réelle entre leur organe respiratoire et celui des autres pulmonés.
[page] 47
gane femelle de la génération; l'organe mâle est au contraire sous le grand tentacule droit, et ces deux ouvertures sont réunies par un sillon qui règne sous tout le bord droit du manteau.
Ces mollusques, dépourvus de mâchoires, ont un gésier musculeux suivi de deux estomacs membraneux. Plusieurs se tiennent sur les bords de la mer, mais dans les lieux où le reflux découvre alternativement le fond; ensorte qu'ils peuvent très bien respirer l'air en nature (1).
Les pulmonés aquatiques à coquilles complètes ont aussi été placés par Linnæus dans ses genres HELIX, BULLA et VOLUTA, dont on a dû les retirer.
Dans celui des HELIX étaient les deux genres suivants, dont l'ouverture a, comme dans les helix, le bord interne en arc rentrant.
LES PLANORBES. (PLANORBIS. Brug.) (2).
Avaient déjà été distingués des helix par Bruguières, et même auparavant par Guettard, parce que leur coquille roulée presque dans un même plan, a les tours peu croissants, et l'ouverture plus large que haute; elle renferme un animal à longs tentacules minces et filiformes, dont les yeux sont placés à la base intérieure de ces tentacules; il exprime des bords de son manteau une liqueur abondante et rouge, mais qui n'est pas son sang. Son estomac est musculeux, et sa
(1) Voyez Chamisso., Nov. act. nat. cur., XI, part. 1, p. 348, et Van Hasselt, Bullet. univ., 1824, sept., Zool., 83.
(2) Hel. vortex;—H. cornea;—H. spirorbis;—H. polygyra;—H. contorta;—H. nitida;—H. alba;—H. simitis.
Voyez les citations de Gmel. et ajoutez y Draparnaud, pl. I, f. 39–51, et pl. II, f. 1–22.
[page] 48
nourriture végétale, comme celle des limnées, dont les planorbes sont les compagnons fidèles dans toutes nos eaux dormantes.
LES LIMNÉES. (LIMNÆUS. Lam.) (1).
Séparés des bulimes de Bruguière par M. Delamark, ont, comme les bulimes, la spire oblongue et l'ouverture plus haute que large; mais leur bord, comme celui de ambrettes, ne se réfléchit point, et leur columelle a un pli longitudinal qui rentre obliquement dans la cavité. La coquille est mince; l'animal a deux tentacules comprimés, larges, triangulaires, portant les yeux près de la base de leur bord interne. Ils vivent d'herbes et de graines; et leur estomac est un gésier très musculeux, précédé d'un jabot. Hermaphrodites comme tous les pulmonés, ils ont l'organe femelle assez éloigné de l'autre, ce qui les oblige à s'accoupler de manière que celui qui sert de mâle à l'un, sert de femelle à un troisième, et l'on en voit quelquefois de longs chapelets ainsi disposés
Ils vivent en grand nombre dans les eaux dormantes, et on en trouve abondamment, ainsi que des planorbes, dans certaines couches marneuses ou calcaires, que l'on reconnaît par là avoir été déposées dans de l'eau douce (2).
LES PHYSES. (PHYSA. Drap.)
Qui étaient rangées (mais sans motif) parmi les bulles, ont à peu près la coquille des limnées, mais sans pli à la columelle comme sans rebord, et très mince. L'ani-
(1) Hel. stagnalis, L., dont H. fragilis, est une variété;—H. palustris;—H. peregra;—H. limosa;—H. auricularia. Voyez Draparn., pl. II, f. 28–42, et pl. III, f. 1–7.
(2) Le Limn. glutinosus, a, comme les physes, le manteau assez ample pour envelopper sa coquille. C'est le genre AMPHIPEPLEA, Nilson, Moll. suce.
[page] 49
mal, lorsqu'il nage ou qu'il rampe, recouvre sa coquille de deux lobes dentelés de son manteau, et a deux longs tentacules grêles et pointus qui portent les yeux sur leur base interne fortement renflée. Ce sont de petits mollusques de nos fontaines.
Nous en possédons une, tournée à gauche (Bulla fontinalis, L.) (1).
D'après les observations de Van Hasselt, c'est ici qu'il faudrait placer
LES SCARABES. Montf.
Qui ont une coquille ovale et l'ouverture rétrécie par de grosses dentelures saillantes, tant du côté de la columelle que versle bord extérieur; ce bord est plus renflé, et comme l'animal le refait après chaque demi-tour, la coquille est plus saillante sur deux lignes opposées, et a l'air comprimée.
Ils vivent sur les herbes aquatiques dans l'archipel des Indes (2).
Les deux genres suivants étaient parmi les VOLUTES.
LES AURICULES. (AURICULA. Lam.)
Diffèrent de tous les pulmonés aquatiques qui precedent, par une columelle marquée de grosses cannelures obliques; leur coquille est ovale ou oblongue, l'ouverture haute comme aux bulimes et aux limnées; le bord est garni d'un bourrelet. Plusieurs sont assez grandes; on n'est pas bien certain si elles vivent dans les marais comme les limnées, ou simplement sur leurs bords comme les ambrettes.
Nous n'en avons qu'une en France, des bords de la Mé-
(1) Les espèces voisines, Bull. hypnorum, L., et Physa acuta, et Scaturiginum, Drap., auront besoin d'un nouvel examen pour leurs animaux. Vid. Draparn., p. 54 et suivantes.
(2) Helix scarabœus. L.
TOME III. 4
[page] 50
diterranée. L'animal n'a que deux tentacules, et les yeux sont à leur base (Auricula myosotis, Drap., III, 16, 17; Carychium myosotis, Féruss.) (1).
LES MELAMPES. Montf. (CONOVULUS. Lam.)
Ont, comme les auricules, des plis saillants à la columelle, mais leur ouverture n'a point de bourrelet, et leur lèvre interne est finement striée; leur coquille a la figure générale d'un cône dont la spire ferait la base. Ils habitent les rivières des Antilles (2).
DEUXIÈME ORDRE DES CASTÉROPODES,
LES NUDIBRANCHES (3).
Ils n'ont aucune coquille ni cavité pulmonaire; mais leurs branchies sont à nu sur quelque partie du dos: ils sont tous hermaphrodites et marins; souvent ils nagent renversés, le pied à la surface concave comme un bateau, et s'aidant des bords de
(1) Aj. Voluta auris Midœ, L., Martini, II, XLIII, 436–38; Chemn., X, CXLIX, 1395, 1396;—Vol. auris Judœ, L., Martini, II, XLIV, 449–51;—Vol. auris Sileni, Born., IX, 3–4;—Vol. glabra, Mart., II, XLIII, 447, 448—Vol. coffea, Chemn., IX, CXXI, 1044.
(2) Voluta minuta, L., Martin., II, XLIII, f. 445, ou Bulimus coniformis, Brug.;—Bul. monile, Brug., Maritni, ib., f. 444;—Bul. ovulus, Br., Mart., ib., 446.
(3) Mes quatre premiers ordres sont réunis par M. de Blainville, en ce qu'il nomme une sous-classe, et il les désigne par le titre de PARACÉPHALOPHORES MONGÏQUES. De mon ordre des Nudibranches, il en fait deux dans le premier (ses CYCLOBRANCHES), il place les Doris et genres analogues; dans le second (ses POLYBRANCHES), sont les Tritonies et les genres quiles suivent, qu'il divise en deux familles selon qu'ils ont deux ou quatre tentacules.
[page] 51
leur manteau et de leurs tentacules comme de rames.
LES DORIS (1). (DORIS. Cuv.)
Ont l'anus percé sur la partie postérieure du dos, et les branchies rangées en cercle autour de cet anus, sous forme de petits arbuscules, composant tous ensemble une espèce de fleur. La bouche est une petite trompe située sous le bord antérieur du manteau, et garnie de deux petits tentacules coniques. Deux autres tentacules en forme de massue, sortent de la partie supérieure et antérieure du manteau. Les organes de la génération ont leurs ouvertures rapprochées sous son bord droit. L'estomac est membraneux. Une glande entrelacée avec le foie, verse une liqueur particulière, par un trou percé près de l'anus. Les espèces sont nombreuses, et quelques-unes deviennent assez grandes. On en trouve dans toutes les mers. Leur frai est en forme de bandes gélatineuses répandues sur les pierres, les varecs (2).
(1) Nom employé d'abord par Linnœus pour un animal de ce genre, mais qu'il caractérisait mal, étendu ensuite à presque tous les nudibranches par Müller et Gmelin; restreint par moi à sa première signification.
(2) Espèces à manteau ovale, débordant le pied: Doris verrucosa, L., Cuv., Ann. Mas., IV, LXXIII, 4, 5; — Doris argo, L., Bohatsch, Anim., Mar., V, 4, 5; — Doris obvelata, Müll., Zool. dan., XLVII, 1, 2; — Doris fusca, id., ib., LXVII, 6–9; — Doris stellata, Bommé, Act. Fless., I, III, 4; — Doris pilosa, Müll., Zool. d., LXXXV, 5–8; — D. lævis, id., ib., XLVII, 3–5; — D. muricata; id., LXXXV, 2–4; — D. tuberculata, Cuv., Ann. Mus., IV, LXXIV, 5; — D. Limbata, ib., id., 3; — D. solea, id., ib., 1, 2; — D. scabra, id., ib., p. 466; — D. maculosa, id., ib.; D. tomentosa, id., ib.; — D. nodosa, Montag., Trans. Lin., IX, VII, 2; — D. marginata, Linn. Trans., VII, VII, p. 84; — D. nigricans, Otto., Nov. act. nat. cur., XI, XXXVIII, 1; — D. setigera, Rapp., Nov. act. nat. cur., XIII, part. II, pl. XXVI, f. 1; — D. grandiflora, id., ib., XXVII, f. 3; — D. tigrina, Sav., gr. ouv. d'Eg., gasterop., pl. 1, p. 3; — D. concentrica, ib., f. 5; — D. marmorata, ib., f. 6, etc.
Espèces prismatiques, à manteau presqu'aussi étroit que le pied: Doris lacera, Cuv., Ann. Mus., IV, LXXIII, f. 1 et 2; — D. atromarginata, id., ib., LXXIV, 6; — D. pustulosa, id., ib., p. 473 — D. gracilis, Rapp., Nov. act. nat. cur., XIII, part. 2, pl. XXVII, f. 10.
Voyez aussi Van Hasselt, Bullet. univ., 1824, oct., Zool., p. 235.
4*
[page] 52
LES ONCHIDORES. Blainv.
Ne diffèrent des doris que par l'écartement de leurs organes des deux sexes, dont les orifices sont mis en communication par un sillon creusé le long du côté droit, comme dans les onchidies (1).
LES PLOCAMOCÈRES. Leuckard.
Ont tous les caractères des onchidores, et de plus le bord antérieur de leur manteau est orné de nombreux tentacules branchus (2).
LES POLYCÈRES. (POLYCERA. Cuv.)
Ont les branchies comme les doris, sur l'arrière du corps, mais plus simples, et suivies de deux lames membraneuses qui les recouvrent dans les moments de danger; en avant de deux tentacules en massues, pareils à ceux des doris, elles en portent quatre et quelquefois six autres, simplement pointus (3).
LES TRITONIES. (TRITONIA. Cuv.)
Ont le corps, les tentacules supérieurs et les organes de la génération comme les doris, mais l'anus et l'orifice de la liqueur particulière sont percés à droite, derrière les organes de la génération: les branchies, en forme de petits arbres, sont rangées tout le long des deux côtés
(1) Onchidora Leachii, Blainv., Malac., pl. XLVI, f. 8.
(2) Plocamoceros ocellatus, Leuckard, ap. Ruppel, invert., pl. 5, f. 3.
(3) Doris quadrilineata, Müll., Zool. dan., I, XVII, 4–6, et mieux ib., CXXXVIII, 5–6; — Doris cornuta, ib., CXLV, 1, 2, 3; — Doris flava, Trans. Soc. Linn., VII, VII, p. 84; — Polycera lineata, Risso., Hist. nat. mér., IV, pl. 1, f. 5.
[page] 53
du dos, et la bouche, garnie de larges lèvres membraneuses, est armée en dedans de deux mâchoires latérales, cornées et tranchantes, semblables à des ciseaux de tondeur.
Nous en avons une grande, couleur de cuivre, le long de nos côtes (Tritonia Hombergii, Cuv.), Ann. Mus., 1, XXXI, 1, 2, et Journ. de Phys., 1785, octob., pl. 11.
Il y en a aussi beaucoup d'espèces très variées pour la taille et les formes de leurs branchies (1); plusieurs sont fort petites (2).
LES THÉTHYS. (THETHYS. Lin.) (3)
Ont tout le long du dos deux rangées de branchies en forme de panaches, et sur la tête un très grand voile membraneux et frangé, qui se recourbe en se raccourcissant sous la bouche. Celle-ci est une trompe membraneuse sans mâchoires: il y a sur la base du voile deux tentacules comprimés, du bord desquels sort une petite pointe conique. Les orifices de la génération, de l'anus et de la liqueur particulière, sont comme dans la tritonie. L'estomac est membraneux et l'intestin très court.
Nous en avons, dans la Méditerranée, une belle es-
(1) Telles sont Trit. elegans, Descr. de I'Eg., Zool., gastér., pl. 2, f. 1; — Trit. rubra, Leuckard, ap. Ruppel, invert., pl. 4, f. 1; — Tr. glauca, ib., f. 2; — T. cyanobranchiata, ib., f. 3; — Tritonia arborescens, Cuv., Ann. Mus, VI, LXI, et trois autres au moins très voisines; — Doris arborescens, Strœm., Act. Hafn., X, V, 5, — Doris frondosa, Ascan., Act. Tronth., V. V. 2, et Doris cervina, Bommé, Act. Fless., I, III, 1.
(2) Doris coronata, Bommé, ib., et Doris pinnatifida, Trans. Linn., VII, VII, qui en est très voisin; — Doris fimbriata, Müll., Zool. dan., CXXXVIII, 2, et probablement Doris clavigera, Müll., ib., XVII, 1–3. Peut-être faut-il encore rapporter à ce genre le Doris lacera, Zool. dan., CXXXVIII, 3, 4.
(3) De ευων, nom employé par les anciens pour désigner les ascidies; Linnæus l'a détourné pour ce genre.
[page] 54
pèce grise, tachetée de blanc (Thetis fimbria, L.), Cuv., Ann. Mus., XII, XXIV (1).
LES SCYLLÉES. (SCYLLÆA. Lin.)
Ont le corps comprimé, le pied étroit et creusé d'un sillon pour embrasser les tiges des fucus; point de voile; la bouche comme une petite trompe; les orifices comme dans les théthys; les tentacules comprimés, terminés par un creux d'où sort une petite pointe à surface inégale, et sur le dos deux paires de crêtes membraneuses, portant à leur face interne des pinceaux de filaments qui sont les branchies. Le milieu de l'estomac est revêtu d'un anneau charnu, armé en dedans de lames cornées et tranchantes comme des couteaux.
Il y en a une espèce (Scillœa pelagica, L.), Cuv., Ann. Mus., VI, LXI, 1, 3, 4, commune dans le fucus natans de presque toutes les mers.
LES GLAUCUS. (GLAUCUS. Forster.)
Ont le corps long, les orifices de l'anus et de la génération comme dans les précédentes, quatre très pepetits tentacules coniques, et de chaque côté trois branchies, formées chacune de longues lanières disposées en éventail, qui leur servent aussi à nager; ce sont de charmants petits animaux de la Méditerranée et de l'Océan, agréablement peints d'azur et de nacre, qui nagent sur le dos avec une grande vitesse. Leur anatomie ressemble beaucoup à celle de la tritonie. Les espèces n'en sont pas encore bien distinguées (2).
(1) Je pense que les différences aperçues entre le Thethys fimbria, Bohatsch., Anim. mar., pl. V, et le Thethys leporina, Fab. Column. aq.; pl, XXVI, ne tiennent qu'au plus ou moins de conservation des individus.
(2) Doris radiata, Gm., Dup., Trans. Phil., LIII, pl. III: — Scyllée nacrée, Bosc, Hist. des vers; — Glaucus atlanticus, Blumenb., fig. d'Histoire naturelle, pl. 48, et Manuel, trad. fr., II, p. 22; Cuv., Ann. Mus., VI, LXI, II; Péron, Ann. Mus., XV, III, 9.
[page] 55
LES LANIOGÈRES. (LANIOGERUS. Blainv.)
Ont de chaque côté deux séries de petites lames finement divisées en peignes, et qui sont leurs branchies. Leur corps est plus court et plus gros que celui des glaucus; mais ils ont de même quatre petits tentacules (1).
LES EOLIDES. (EOLIDIA. Cuv.)
Ont la forme de petites limaces, avec quatre tentacules en dessus et deux aux côtés de la bouche. Leurs branchies sont des lames ou des feuilles disposées comme des écailles plus ou moins serrées des deux côtés de leur dos.
Il y en a dans toutes les mers (2).
LES CAVOLINES. (CAVOLINA. Bruguière.)
Ont, avec les tentacules des éolides, les branchies en forme de filets, disposées sur des rangées transversales sur le dos (3).
LES FLABELLINES. Cuv.
Toujours avec les tentacules des précédentes, ont les branchies composées de filets rayonnants portés par cinq ou six pédicules de chaque côté; elles tiennent de près
(1) Laniogerus Elfortii, Blainv., Malac., pl. XLVI, f. 4.
(2) Doris papillosa, Zool. dan., CXLIX, 1–4; — Doris bodoensis, Gunner., Act. Hafn., X, 170; — Doris minima, Forsk., Ic., XXVI, H; — Doris fasciculata, id., ib., G.; — Doris branchialis, Zool. dan., CXLIX, 5–7; — Doris cærulea, Linn. Trans., VII, VII, 84; — Eolidia histrix, Otto., Nov. act. nat. cur., XI, XXXVIII, 2, etc.
(3) Doris peregrina, Gm., Cavolini, polyp. mar., VII, 3;—Eolidea annulicornis, Chamisso, Nov. act. nat. cur., XI, part. 2, pl. XXIV, f. 1; — Doris longicornis, Trans. Linn., IX, VII, 114?
N. B. Il ne faut pas confondre ce genre avec la Cavoline d'Abildgard, qui est l'Hyale.
[page] 56
aux glaucus, et, en général, tous les nudibranches à branchies situées sur les côtés du dos sont fort voisins (1).
LES TERGIPES. Cuv.
Avec la forme des éolides et deux tentacules seulement, portent le long de chaque côté du dos, une rangée de branchies cylindriques, terminées chacune par un petit suçoir, et pouvant leur servir comme de pieds pour marcher sur le dos.
Ceux qu'on connaît sont fort petits (2).
LES BUSIRIS. Risso.
Ont, avec un corps oblong, à dos convexe, deux tentacules filiformes, et derrière eux, sur la nuque, deux branchies en forme de plumes (3).
LES PLACOBRANCHES. (PLACOBRANCHUS. Van Hasselt.)
Ont deux tentacules et deux lobes labiaux, et tout le dos, élargi par ses bords, recouvert de stries nombreuses et rayonnantes, qui sont ses branchies. Dans l'état ordinaire, les bords élargis du manteau se relèvent et se croisent l'un sur l'autre pour former une enveloppe aux branchies, qui se trouvent ainsi comme dans un étui cylindrique.
Ce sont de petits mollusques de la mer des Indes (4).
(1) Doris affinis., Gm., Cavol., polyp. mar.; VII, 4.
(2) Limax tergipes, Forsk., XXVI, E., ou Doris lacinulata, Gm.; — Doris maculata, Lina. Trans., VII, VII, 34; — Doris pennata, Bommé, Act. Fless., I, III, 3?
(3) Busiris griseus, Risso, Hist. nat. mar., IV, pl. 1, f. 6.
(4) L'espèce connue (Placobranchus Hasselti, Nob.) a les stries branchiales vertes, et le corps gris-brun, semé de petits ocelles, Van Hasselt, Bullet. univ., 1824, oct., p. 240. MM. Quoy et Gaymard l'out trouvée aux îles des Amis.
[page] 57
TROISIÈME ORDRE DES GASTÉROPODES,
LES INFÉROBRANCHES.
Ont à peu près la forme et l'organisation des doris et des tritonies, mais leurs branchies, au lieu d'être placées sur le dos, le sont, comme deux longues suites de feuillets, des deux côtés du corps sous le rebord avancé du manteau.
LES PHYLLIDIES. (PHYLLIDIA. Cuv.)
Leur manteau nu, et le plus souvent coriace, n'est garni d'aucune coquille. Leur bouche est une petite trompe et porte un tentacule de chaque côté; deux autres tentacules sortent en dessus de deux petites cavités du manteau. L'anus est sur l'arrière du manteau, et les orifices de la génération sous le côté droit en avant. Le cœur est vers le milieu du dos; l'estomac est simple, membraneux, et l'intestin court.
On en trouve plusieurs espèces dans la mer des Indes (1).
LES DIPHYLLIDES. Cuv.
Ont à peu près les branchies des phyllidies, mais le manteau plus pointu en arrière; la tête, en demi-cercle, a de chaque côté un tentacule pointu et un léger tubercule: l'anus est sur le côté droit (2).
(1) Phyllidia trilineata, Séb., III, 1, 16; Cuv., Ann. Mus., V, XVIII, 1; et Zool. du Voyage de Freycin., pl. 87, f. 7–10; — Ph. ocellata, Cuv., ib., 7; — Ph. pustulosa, id., ib., 8, et quelques espèces nouvelles.
(2) Diphyllidia Brugmansii, Cuv.; — Diphyll. Lineata, Otto., Nov. act. nat. cur., X, VII, ou Pleuro-phyllidia, Meckel, Arch. allem., VIII, p. 190, pl. II, delle Chiaie, Mém., X, 12.
N. B. La Linguelle d'Elfort, Blainv., Malac., pl. XLVII, f. 2, ne nous parait point différente de notre première espèce.
[page] 58
QUATRIÈME ORDRE DES GASTÉROPODES,
LES TECTIBRANCHES (1).
Ont les branchies attachées le long du côté droit ou sur le dos, en forme de feuillets plus ou moins divisés, mais non symétriques; le manteau les recouvre plus ou moins, et contient presque toujours dans son épaisseur une petite coquille. Ils se rapprochent des Pectinibranches par la forme des organes de la respiration, et vivent, comme eux, dans les eaux de la mer; mais ils sont tous hermaphrodites, comme les NUDIBRANCHES et les PULMONÉS.
LES PLEUROBRANCHES. (PLEUROBRANCHUS. Cuv.)
Ont le corps également débordé par le manteau et par le pied, comme s'il était entre deux boucliers. Le manteau contient, dans quelques espèces, une petite lame calcaire ovale, dans d'autres, une lame cornée; il est échancré au-dessus de la tête. Les branchies sont attachées le long du côté droit dans le sillon entre le manteau et le pied, et représentent une série de pyramides divisées en feuillets triangulaires. La bouche, en forme de petite trompe, est surmontée d'une lèvre échancrée et de deux tentacules tubuleux et fendus; les orifices de la génération sont en avant, et l'anus en arrière des branchies. Il y a quatre estomacs, dont le second est charnu, quelquefois armé de pièces
(1) M. de Blainville a donné à cet ordre le nom de MONOPLEUROBRANCHES.
[page] 59
osseuses, et le troisième garni à l'intérieur de lames saillantes longitudinales; l'intestin est court.
Il y en a diverses espèces dans la Méditerranée aussi bien que dans l'Océan, dont quelques-unes grandes et de belles couleurs (1).
LES PLEUROBRANCHÆA. Meckel. (PLEUROBRANCHIDIUM. Bl.)
Ont les branchies et les orifices de la génération placés comme dans les pleurobranches; mais l'anus est au-dessus des branchies; les rebords du manteau et du pied ne font que peu de saillie, et sur le devant du manteau sont quatre tentacules courts, distants, et faisant un carré qui rappelle le disque antérieur des acères. Je ne leur trouve qu'un estomac, qui n'est qu'une dilatation du canal, et à parois minces. Un organe glanduleux très divisé s'ouvre derrière les orifices génitaux; ils n'ont point de vestige de coquille.
On n'en connaît qu'un de la Méditerranée (Pleurobranchœa Meckelii), Leve, Diss. de pleur., 1813 (2).
(1) Pleurobranchus Peronii, Cuv., Ann. Mus., V, XVIII, 1, 2; — Pl. tuberculatus, Meckel, morceaux d'anat. comp., I, V, 33–40; et quelques espèces nouvelles telles que Pleur. oblongus, Descr. de l'Eg., Moll. gaster., pl. 3, f. 1; — Pl. aurantiacus, id., Risso, Hist. nat. mer., IV, pl. 1, f. 8; — Pl. luniceps, Cuv.; — Pl. Forskalii, Forsk., pl. XXVIII, et Leuckard, ap. Ruppel., An. invert., pl. V; — Pl. citrinus, ib., f. 1.
Le genre LAMELLARIA, Montag., Trans. linn., XI, pl. XII, f. 3 et 4, ne me paraît différer des pleurobranches par rien d'essentiel, non plus que celui des BERTHELLES, Blainv., Malac., pl. XLIII, f. 1. On distingue seulement ce dernier, parce que le manteau n'est pas échancré au-dessus de la tête, comme dans beaucoup de pleurobranches. Le Pl. oblongus y appartiendrait et même le Pl. luniceps.
(2) C'est le genre pleurobranchidie de Blainv., Malacol., pl. XLIII, f. 3; mais non pas, comme il le croit, le Pleurobranchus tuberculatus de Meckel.
[page] 60
LES APLYSIES (1). (APLYSIA. Lin.)
Ont les bords du pied redressés en crêtes flexibles, et entourant le dos de toutes parts, pouvant même se réfléchir sur lui; la tête portée sur un cou plus ou moins long, deux tentacules supérieurs et creusés comme des oreilles de quadrupède, deux autres aplatis au bord de la lèvre inférieure; les yeux au-dessous des premiers. Sur le dos sont les branchies, en forme de feuillets très compliqués, attachées à un large pédicule membraneux, et recouvertes par un petit manteau également membraneux, qui contient dans son épaisseur une coquille cornée et plate. L'anus est percé en arrière des branchies, et est souvent caché sous les crêtes latérales; la vulve est en avant à droite, et la verge sort sous le tentacule droit. Un sillon qui s'étend depuis la vulve jusqu'à l'extrémité de la verge, conduit la semence lors de l'accouplement. Un énorme jabot membraneux mène dans un gésier musculeux, armé en dedans de corpuscules cartilagineux et pyramidaux, que suivent un troisième estomac semé de crochets aigus, et un quatrième en forme de cœcum. L'intestin est volumineux. Ces animaux se nourrissent de fucus. Une glande particulière verse, par un orifice situé près de la vulve, une humeur limpide que l'on dit fort âcre dans certaines espèces; et des bords du manteau il suinte en abondance une liqueur pourpre foncée, dont l'animal colore au loin l'eau de la mer quand il aperçoit quelque danger. Leurs œufs sont déposés en longs filets glaireux entrelacés, minces comme des ficelles.
(1) Aπλυσια, qui ne peut se nettoyer; nom donné par Aristote à quelques zoophytes. Linnæus en a fait cette fausse application. Les anciens connaissaient très bien nos animaux sous le nom de lièvre-marin, et leur attribuaient plusieurs propriétés fabuleuses.
[page] 61
On trouve dans nos mers:
L'Aplysie bordée. (Apl. fasciata. Poiret.) Rang. Apl. pl. VI et VII.
Noire, à bord des crêtes latérales rouges: c'est une des grandes espèces.
L'Aplysie ponctuée (Apl. punctata. Cuv.) Ann. Mus. t. II. p. 287. pl. 1. fig. 2–4. Ranc. Apl. pl. XVIII. fig. 2.
Lilas, semé de points verdâtres.
L'Aplysie dépilante. (Apl. depilans. Lin.) Bohatch. anim. mar. pl. 1 et 11 Rang. pl. XVI.
Noirâtre, avec de grandes taches nuageuses, grisâtres.
Il y en a aussi plusieurs espèces dans les mers éloignées (1).
LES DOLABELLES. (DOLABELLA. Lam.)
Ne diffèrent des aplysies que parce que les branchies et ce qui les entoure sont à l'extrémité postérieure du corps, qui ressemble à un cône tronqué. Leur crête latérale se serre sur l'appareil branchial, ne laissant qu'un sillon étroit; leur coquille est calcaire.
On en trouve dans la Méditerranée et dans la mer des Indes (2).
(1) Aplysia brasiliana, Rang., pl. VIII, 1, 2, 3; — A. dactylomela, id., IX; — A. protea, id., X, 1; — A. sorex, id., X, 4, 5, 6; — A. tigrina, id., XI; — A. maculata, id., XII, 1–5; — A. marmorata, Blainv., Journ. de phys., janvier 1823, Rang., XII, 6, 7; — A. Keraudrenii, id., XIII; — A. Lessonii, id., XIV; — A. Camelus, Cuv., Ann. Mus., et Rang., XV, 1; — A. alba, Cuv., ib., et Rang., XV, 2, 3; — A. napolitana, id., XV bis; — A. virescens, Risso., Hist. nat. mer., IV, pl. 1, et 7. Il est bon de remarquer cependant, que la plupart de ces aplysies ayant été représentées sur des individus conservés dans la liqueur, il peut rester des doutes sur les caractères spécifiques de quelques-unes.
(2) Dolabella Rumphii, Cuv., Ann. Mus., V, XXIX, 1; et Rumph., Thes. amb., pl. x, 6, des Moluques, ou Aplysia Rumphii, Rang., pl. 1, — Apl. ecaudata, Rang., pl. 11; — A. truncata, id.; — A. teremidi, d., III, 1; — A. gigas, id., III, 4; — A. Hasseltii, id., XXIV, 1.
[page] 62
LES NOTARCHES. (NOTARCHUS. Cuv.)
Ont leurs crêtes latérales réunies et recouvrant le dos, sauf une échancrure longitudinale, pour conduire aux branchies, qui n'ont point de manteau pour les couvrir, mais ressemblent d'ailleurs à celles des aplysies, ainsi que tout le reste de l'organisation (1).
Dans
LES BURSATELLES. Blainv.
Les crêtes latérales se réunissent en avant, de manière à ne laisser qu'une ouverture ovale pour l'arrivée de l'eau aux branchies, qui n'ont pas non plus de manteau pour les couvrir (2).
Mais ces deux genres rentrent probablement dans un seul.
LES ACÈRES. (AKERA. Müller.)
Ont les branchies couvertes comme les genres précédens; mais leurs tentacules sont tellement raccourcis, élargis et écartés, qu'ils paraissent n'en avoir point du tout, ou plutôt qu'ils ne forment ensemble qu'un grand bouclier charnu et à peu près rectangulaire sous lequel sont les yeux. Du reste, leur hermaphroditisme, la position de leurs deux sexes, la complication et l'armure de leur estomac, la liqueur pourpre que répandent plusieurs de leurs espèces, les rappro-
(1) Notarchus gelatinosus, Cuv., auquel M. Rang associe le Bursatella Savigniana, Deser. de l'Eg., Zool. gastér., pl. 11, f. 1, 2, et Rang., Apl., pl. XX. et son Apl. Pleii, pl. XXI, et quelques petites espèces.
(2) Bursatella Leachii, Blainv., Malac., pl. XLIII, f. 6.
N. B. On a aussi rapproché des aplysies, l'Apl. viridis, Montag., Trans. Lin., VII, pl. VII, dont M. Oken fait son genre AGTÆON, et qui est au moins très voisin de l'Élysie timide, Risso, Hist. nat. mérid., IV, pl. 1, f. 3, 4; mais n'en connaissant pas les branchies, je ne puis classer ni l'un ni l'autre.
[page] 63
chent des aplysies. Leur coquille, dans celles qui en ont une, est plus ou moins roulée sur elle-même, avec peu d'obliquité, sans spire saillante, sans échancrure ni canal; et la columelle faisant une saillie convexe, donne à l'ouverture la figure d'un croissant, dont la partie opposée à la spire est toujours plus large et arrondie.
M. de Lamarck nomme BULLÉES celles où la coquille est cachée dans l'épaisseur du manteau. Elle fait très peu de tours, et l'animal est beaucoup trop gros pour y rentrer.
L'Amande de mer. (Bullæa aperta. Lam. Bulla aperta et Lobaria quadriloba. Gm. Phyline quadripartita. Ascan.) Mull. Zool. dan. III. pl. CI. Planc. Conch. min. not. pl. XI. Cuv. Ann. du Mus. t. I. pl. XII. 1. 6. (1).
Animal blanchâtre, d'un pouce de long, que le bouclier charnu formé par les vestiges de ses tentacules, les bourrelets latéraux de son pied, et son manteau occupé par sa coquille, semblent diviser en quatre lobes à sa face supérieure. Sa coquille mince, blanche, demi-transparente, est presque toute en ouverture; son gésier est armé de trois pièces osseuses rhomboïdales très épaisses. On le trouve dans presque toutes les mers, où il vit sur les fonds vaseux.
M. de Lamarck laisse le nom de BULLES (BULLA) (2), aux espèces dont la coquille, recouverte seulement d'un léger épiderme, est assez considérable pour donner retraite à l'animal. Elle se contourne un peu plus que dans les bullées.
(1) Le Sormet, Adans., Sénég., pl. I, f. 1, est une espèce très voisine de nos bullées; mais je ne trouve pas de sûreté à établir un genre ni même une espèce sur un document aussi imparfait.
(2) Le genre Bulla comprenait, dans Linn., non-seulement toutes les Acères, mais encore les Auricules, les Agatines, les Physes, les Ovules, les Térébelles, animaux très différents entre eux. Bruguières a commencé à le débrouiller, en séparant les Agatines et les Auricules, qu'il réunissait avec les Limnées au genre Bulime. M. de Lamarck a achevé ce travail en créant tous les genres que nous venons de nommer.
[page] 64
L'Oublie. (Bulla lignaria. L.) Martini. I. XXI. 194. 95. Cuv. Ann. Mus. XVI. 1. Pol. test. Neap. III. pl. XLVI.
Sa coquille oblongue, à spire cachée, à ouverture ample, très large en avant, représente une lame lâchement roulée, et rayée selon la direction des tours. L'estomac de l'animal est armé de deux grandes pièces osseuses en demi-ovale, et d'une petite comprimée (1).
La Muscade. (Bulla ampulla. L.) Martini I. XXII. 20. 204. Cuv. Ann. Mus. XVI. 1.
A coquille ovale, épaisse, nuancée de gris et de brun. L'estomac a trois pièces rhomboïdales noires très convexes.
La Goutte d'eau. (Bulla hydatis. L.) Chemn. IX. CXVIII. 1019. Cuv. Ann. Mus. XVI. 1.
A coquille ronde, mince, demi-transparente; le dernier tour, et par conséquent l'ouverture, s'élevant plus que la spire; le gésier a trois petites pièces en forme d'écusson (2).
Nous réserverons le nom d'ACÈRES proprement dites (DORIDIUM, Meck., LOBARIA, Blainv.) aux espèces qui n'ont point de coquilles du tout, ou n'en ont qu'un vestige en arrière, quoique leur manteau en ait la forme extérieure.
Il y en a une petite espèce dans la Méditerranée (Bulla carnosa, Cuv., Ann. Mus., XVI, 1; Meckel, Morc. d'anat. comp., II, VII, 1, 3; Blainv., Malacol., pl. XLV, f. 3). Son estomac n'est pas plus armé que son manteau; elle a un œsophage charnu d'une grande épaisseur.
On y trouve aussi une espèce tuberculeuse (Doridium Meckelii, Delle chiaie, Memor., pl. X, f. 1–5.
(1) Gioëni ayant observé cet estomac isolé, le prit pour une coquille et en fit un genre auquel il donna son nom (la Tricla de Retzius, le Char de Bruguières). Gioëni alla même jusqu'à décrire les prétendues habitudes de ce coquillage. Draparnaud a le premier reconnu cette erreur mêlée de supercherie.
(2) Aj. Bull. naucum; — Bulla physis. Müller en a fait connaître des espèces plus petites, comme Akera bullata, Zool. dan., LXXI, ou Bulla okera, Gm.
[page] 65
LES GASTROPTÈRES. (GASTROPTERON. Meckel.)
Ne paraissent que des acères dont le pied développe ses bords en larges ailes qui servent à la natation, laquelle se fait le dos en bas. Ils n'ont pas non plus de coquille ni d'armure pierreuse à l'estomac; un très léger repli de la peau, est le seul vestige d'opercule bran chial qu'on leur observe.
- L'espèce connue est aussi de la Méditerranée (Gastropteron Meckelii), Kosse, Diss. de Pteropodum ordine; Halæ, 1813, f. 11–13, et Blainv., Malacol., pl. XLV, f. 5, ou Clio amati, Delle chiaie, Memor., pl. II, fig. 1–8. C'est un petit mollusque d'un pouce de long sur deux de large, quand ses ailes sont étendues.
Jusqu'à de plus amples études anatomiques, c'est dans l'ordre des tectibranches, et même auprès des pleurobranches, que nous croyons pouvoir placer le genre singulier
Des OMBRELLES. Lam. ou GASTROPLAX. Blainv.
L'animal est un grand mollusque circulaire, dont le pied déborde beaucoup le manteau, et a sa face supérieure hérissée de tubercules. Les viscères sont dans une partie supérieure et centrale arrondie. Le manteau ne s'y montre que par des bords un peu saillants et tranchants, tout le long du devant et du côté droit. Sous ce léger rebord du manteau sont les branchies en pyramides lamelleuses comme celles du pleurobranche, et à leur arrière un anus tubuleux. Sous ce même rebord sont, en avant, deux tentacules fendus longitudinalement encore comme dans le pleurobranche, et à leur base interne les yeux; entre eux une espèce de trompe qui est peut-être un organe de la génération; le bord antérieur du pied a un grand espace concave dont les
TOME III. 5
[page] 66
bords peuvent se resserrer comme une bourse, et au fond duquel est un tubercule percé d'un orifice qui est peutêtre la bouche, et surmonté d'une membrane frangée. La face inférieure du pied est lisse et sert à ramper comme dans les autres gastéropodes.
Cet animal porte une coquille pierreuse, plate, irrégulièrement arrondie, plus épaisse dans le milieu, à bords tranchants, marquée de stries légèrement concentriques.
On l'avait crue d'abord attachée au pied, mais des observations plus récentes établissent qu'elle est sur le manteau, et à la place ordinaire (1).
CINQUIÈME ORDRE DES GASTÉROPODES,
LES HÉTÉROPODES, Lam. (2)
Se distinguent de tous les autres parce que leur pied, au lieu de former un disque horizontal, est comprimé en une lame verticale musculeuse, dont ils se servent comme d'une nageoire, et au bord de laquelle, dans plusieurs espèces, une dilatation en forme de cône creux, représente le disque des autres
(1) L'échantillon du Muséum britannique décrit par M. de Blainville (Bullet. phil., 1819, p. 178), sous le nom de GASTROPLAX, a en effet la coquille attachée sous le pied, et il est difficile de deviner par quel artifice; cependant le manteau est si mince qu'il a bien l'air d'avoir été protégé par la coquille. M. Reynaud vient d'en rapporter un individu qui a perdu sa coquille; mais où il semble que l'on aperçoit des traces des membranes qui l'attachaient au manteau, et néanmoins il n'y a point de restes de muscles qui s'y soient fixés. On trouve aussi une coquille semblable dans la Méditerranée, mais on n'en a point encore observé l'animal.
(2) M. de Blainville fait des Hétéropodes une famille qu'il nomme NECTOPODES, et les réunit dans son ordre des NUCLÉOBRANCHES, avec une autre famille qu'il nomme PTÈROPODES, et qui ne comprend de mes ptéropodes que la Limacine. Il y joint, sur je ne sais quelle conjecture, l'ARGONAUTE.
[page] 67
ordres. Leurs branchies formées de lobes en forme de plumes, sont situées sur l'arrière du dos, dirigées en avant, et immédiatement derrière elles, sont le cœur et un foie peu volumineux, avec une partie des viscères et les crganes internes de la génération. Leur corps, de substance gélatineuse et transparente doublée d'une couche musculaire, est alongé, terminé le plus souvent par une queue comprimée. Leur bouche a une masse musculaire, et une langue garnie de petits crochets; leur œsophage est très long; leur estomac mince; deux tubes proéminents au côté droit du paquet des viscères, donnent issue aux excréments et aux œufs ou au sperme. Leur natation se fait d'ordinaire le dos en bas et lepied en haut (1). Ils peuvent gonfler leur corps en le remplissant d'eau d'une manière qui n'est pas encore bien éclaircie.
Forskal les comprenait tous sous son genre
PTEROTRACHEA,
Mais on a dû les subdiviser.
(1) Cette manière de nager ayant fait croire à Peron, que la lame natatoire est sur le dos, et le cœur et les branchies sous le ventre, a donné lieu à beaucoup d'erreurs sur la place qui appartient à ces animaux. La seule inspection de leur système nerveux m'avait fait juger, dans mes Mémoires sur les mollusques, qu'ils sont analogues aux Gastéropodes. Une anatomie plus complète, faite depuis, et celle que M. Poli en donne dans son troisième volume, ont parfaitement confirmé cette conjecture. Le fait est que les Hétéropodes diffèrent peu des Testibranches. et toutefois M. Laurillard croit leurs sexes séparés.
5*
[page] 68
LES CARINAIRES. Lam. (1)
Ont le noyau, formé du cœur, du foie et des organes de la génération, recouvert par une coquille menue symétrique, conique, à pointe recourbée en arrière, souvent relevée d'une crête, sous le bord antérieur de laquelle flottent les plumes des branchies. Leur tête porte deux tentacules, et les yeux en arrière de leur base.
Il y en a une espèce dans la Méditerranée (Carinaria cymbium, Lam.), Péron, Ann. Mus., XV, III, 15; Poli, III, XLIV; Ann. des Sc. nat., tom. XVI, pl. 1.
Et une dans la mer des Indes (Carinaria fragilis, Bory Saint-Vincent, Voyage aux quatre îles d'Afr., I, VI, 4 (2).
L'argonaute vitré des auteurs, Favanne, VII, c, 2; Martini, I, XIII, 163, doit être la coquille d'une grande carinaire; mais on ne connaît pas encore son animal.
LES ATLANTES. (ATLANTA. Lesueur.) (3)
Seraient, d'après les nouvelles observations de M. Rang, des animaux de cet ordre, dont la coquille au lieu d'être évasée comme celle des carinaires, a sa cavité étroite et roulée en spirale sur le même plan; le contour en est relevé d'une crête mince.
Ce sont de très petites coquilles de la mer des Indes, dans l'une desquelles Lamanon avait cru retrouver l'original des cornes d'Ammon (4) (Atlanta Peronii et Atlanta
(1) Forskal comprenait tous ces animaux sous son genre Ptérotrachea, nom auquel Bruguière substitua celui de FIROLE. Péron ayant divisé le genre, a affecté le nom de Carinaire à celles qui ont une coquille, et celui de Firole aux autres. Rondelet donne déjà la Carinaire, mais sans sa coquille; De insect. zooph., cap. XX.
(2) Aj. Car. depressà, Rang., Ann. des Sc. nat., fév. 1829, p. 136.
(3) Il ne faut pas confondre les Atlantes de Lesueur avec l'Atlas qu'il décrit au même endroit, et que je ne sais où classer, tant sa description me paraît confuse.
(4) Voyage de Lapeyrouse, IV, p. 134, et pl. 63, f. 1–4.
[page] 69
Keraudrenii, Lesueur), Journ. de phys., LXXXV, nov. 1817, et Rang., Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris, tome III, p. 373 et pl. IX.
LES FIROLES. (FIROLA. Peron.)
Ont le corps, la queue, le pied, les branchies, le paquet des viscères à peu près comme les carinaires; mais on ne leur a point observé de coquille; leur museau s'alonge en trompe recourbée, et leur yeux ne sont point précédés par des tentacules. On voit souvent pendre du bout de leur queue, un long filet articulé, que Forskal avait pris pour un tænia, et dont la nature n'est pas encore bien certaine.
Il y en a aussi une espèce très commune dans la Méditerranée (Pterotrachea coronata, Forsk.), Peron., Ann. Mus., XV, II, 8, et M. Lesueur en décrit plusieurs de la même mer qu'il regarde comme différentes, mais qui auraient besoin d'une nouvelle comparaison, Acad. Sc. nat. Philad., tom. 1, p. 3 (1).
M. Lesueur distingue les FIROLOÏDES, où le corps au lieu de se terminer en une queue comprimée, est tronqué brusquement derrière le paquet des viscères, ib., p. 37 (2).
A ces deux genres maintenant bien connus, je suppose qu'il faudra ajouter, quand on les conuaîtra mieux:
LES TIMORIENNES. Quoy et Gaym. Zool. de Freyc. pl. LXXXVII. f. 1.
Qui sembleraient des firoles dépouillées de leur pied et de leur paquet de viscères.
(1) Firola Mutica; — F. Gibbosa; — F. Forskalea; — F. Cuviera. C'est celle-ci qui est le Pterotrachea coronata de Forsk.; — F. Frederica, copié Malacol. de Blainv., pl. XLVII, f. 4;—F. Peronii.—Aj. Pterotrachea Rufa, Quoy et Gaym., Voyage de Freyciu., zool., pl. 87, f. 2 et 3.
(2) Firoloïda Demarestia;—Fir. Blainvilliana;—F. Aculeata, Les.
[page] 70
ET LES MONOPHORES. id. ib. f. 4 et 5 (1).
A peu près de la forme d'une carinaire, mais aussi sans pieds et sans paquet de viscères distinct, ni coquille.
Il n'est pas aussi certain que l'on doive y placer
LES PHYLLIROÉS. Péron. Ann. Mus. XV. pl. II. f. 1.
Dont le corps, transparent et très comprimé, a en avant un museau surmonté de deux longs tentacules sans yeux; en arrière, une queue tronquée, et laisse voir au travers de ses téguments son cœur, son système nerveux, son estomac et des organes génitaux des deux sexes. Il a aussi les orifices de l'anus et de la génération sur le côté droit, et laisse même quelquefois sortir une verge assez longue; mais je ne puis lui apercevoir d'autre organe respiratoire que sa peau mince et vasculaire (2).
LE SIXIÈME ORDRE DES GASTÉROPODES,
LES PECTINIBRANCHES (3).
Forment sans comparaison la division la plus nombreuse, puisqu'ils comprennent presque toutes les coquilles univalves en spirale, et plusieurs coquilles simplement coniques. Leurs branchies, composées de nombreux feuillets ou lanières, rangées parallèlement comme les dents d'un peigne, sont attachées sur
(1) Il ne faut pas les confondre avec les Monophores de M. Bory Saint-Vincent (Voyage aux quatre îles d'Afrique), qui sont des pyrosomes.
(2) Ces observations sont faites sur des individus que M. Quoy a bien voulu me communiquer. M. de Blainville fait du Phylliroé, une famille qu'il nomme Psillosomes, et qui est la troisième de ses Aporobranches, les autres sont les Hyales, les Clio, etc.
(3) C'est ce que M. de Blainville nomme sa sous-classe des PARACÉPHALOPHORES DIOÏQUES.
[page] 71
une, deux ou trois lignes, suivant les genres, au plafond de la cavité pulmonaire qui occupe le dernier tour de la coquille, et qui s'ouvre par une grande solution de continuité, entre le bord du manteau et le corps.
Deux genres seulement, les cyclostomes et les hélicines ont au lieu de branchies, un réseau vasculaire, tapissant le plafond d'une cavité d'ailleurs toute semblable; ils sont les seuls quirespirent l'air en nature, tous les autres respirent l'eau.
Tous les pectinibranches ont deux tentacules et deux yeux portés quelquefois sur des pédicules particuliers, une bouche en forme de trompe plus ou moins alongée, et des sexes séparés. La verge du mâle, attachée au côté droit du cou, ne peut d'ordinaire rentrer dans le corps, mais se réfléchit dans la cavité des branchies; elle est quelquefois très grosse. La seule paludine la fait rentrer par un orifice percé à son tentacule droit. Le rectum, et l'oviductus de la femelle rampent aussi le long du côté droit de cette cavité, et entre eux et les branchies, est un organe particulier composé de cellules recélant une humeur très visqueuse, servant à former une enveloppe commune, qui renferme les œufs et que l'animal dépose avec eux Les formes de cette enveloppe sont souvent très compliquées et très singulières (1).
(1) Voyez pour les murex, Lister., 881, Baster, op. subs., I, VI, 1, 2; pour les buccins, Bast., ib., V, 2, 3.
[page] 72
Leur langue est armée de petits crochets, et entame les corps les plus durs par des frottements lents et répétés.
La plus grande différence entre ces animaux consiste dans la présence ou l'absence de ce canal formé par un prolongement du bord de la cavité pulmonaire du côté gauche, et qui passe par un canal semblable ou par une échancrure de la coquille, pour faire respirer l'animal sans qu'il sorte de son abri. Il y a encore entre les genres cette distinction, que quelques-uns manquent d'opercule, et les espèces diffèrent entre elles par les filets, franges et autres ornements que portent leur tête, leur pied ou leur manteau.
On range ces mollusques sous plusieurs familles d'après les formes de leurs coquilles, qui paraissent être dans un rapport assez constant avec celle des animaux.
La première famille des gastéropodes pectinibranches, ou
LES TROCHOIDES,
Se reconnaît à sa coquille, dont l'ouverture est entière, sans échancrure ni canal pour un syphon du manteau, l'animal n'en ayant point; et garnie d'un opercule ou de quelque organe qui le remplace (1).
(1) Ce sont les PARACÉPHALOPHORES DIOÏQUES ASIPHONOBRANCHES de M. de Blainville.
[page] 73
LES TOUPIES. (TROCHUS. Lin.) (1)
Ont des coquilles dont l'ouverture anguleuse à son bord externe approche plus ou moins au total de la figure quadrangulaire, et se trouve dans un plan oblique par rapport à l'axe de la coquille, parce que la partie du bord, voisine de la spire, avance plus que le reste. La plupart de leurs animaux ont, trois filaments à chaque bord du manteau, ou au moins quelques appendices aux côtés du pied.
Parmi ceux qui n'ont pas d'ombilic, il y en a dont la columelle, en forme d'arc concave, se continue sans aucun ressaut avec le bord extérieur. C'est l'angle et l'avancement de ce bord qui les distigue des turbo. Ce sont les TECTAIRES, Montf. (2).
Plusieurs sont aplatis, à bord tranchant, ce qui les a fait comparer à des molettes d'éperon. Ce sont les ÉPERONS (CALCAB, Montfort) (3).
On en voit quelques-uns qui sont un peu déprimés, orbiculaires, luisants, à ouverture demi-ronde, et dont la columelle est convexe et calleuse. Ce sont les ROULETTES (ROTELLA, Lam.) (4).
D'autres ont la columelle distinguée vers le bas par une petite proéminence, ou vestige de dent pareille à celle des monodontes, dont ces trochus ne diffèrent que par l'angle
(1) M. de Blainville fait de ce grand genre, sa famille des GONIOSTOMES.
(2) Troch. inermis, Chemn., V, CLXXIII, 1712–13; — Tr. Cookii, id., CLXIV, 1551; — Tr. cœlatus, id., CLXII, 1536–37; — Tr. imbricatus, ib., 1532–33; — Tr. tuber, id., CLXV, 1573–74; — Tr. sinensis, ib., 1564–65; — Turbo pagodus, id., CLXIII, 1541–42; — Turbo tectumpersicum, ib., 1543–44.
(3) Turbo calcar, L., Chemn., V, CLXIV, 1552; — T. stellaris, id.; 1553; — T. aculeatus, id., 1554–57; — T. imperialis, id., 1714.
(4) Tr. vesticrius, L.; Chemn., V, CLXVI, 1601.
[page] 74
de leur ouverture et l'avancement de leur bord. L'ouverture y est d'ordinaire à peu près aussi haute que large. Ce sont les CANTHARIDES, Montf. (1).
Quelques-uns l'ont, au contraire, beaucoup plus large que haute, et leur base concave les rapproche des calyptrées. Ce sont les ENTONNOIRS, Montf. (2).
D'autres, où l'ouverture est aussi bien plus large que haute, ont la columelle en forme de canal spiral (3).
Ceux d'entre eux qui ont la coquille turriculée, se rappro chent des cérites, les TÉLESCOPES, Montf. (4).
Parmi les trochus ombiliqués, les uns n'ont pas non plus de ressaut à la columelle; la plupart sont aplatis, et ont l'angle extérieur tranchant.
De ce nombre est
La Frippière. (Trochus agglutinans. L.) Chemn. V. CLXXII. 1688. 9.
Remarquable par son habitude de coller et d'incorporer même à sa coquille, à mesure qu'elle s'accroît, divers corps étrangers, tels que petits cailloux, fragments d'autres coquilles, etc.; elle recouvre souvent son ombilie d'une lame testacée (5).
Il y en a cependant aussi à bords arrondis.
Tel en est un petit, le plus commun sur nos côtes (Tr. einerarius, L.), Chemn., V, CLXXI, 1686, verdâtre, rayé obliquement de violet.
(1) Tr. iris, Chemn., 1522–23; — Tr. granatùm, ib., 1654–55; — Tr. zyzyphinus, CLXVI. 1592–98; — Tr. conus, CLXVII, 1610; — Tr. maculatus, CLXVIII, 1617–18, — Tr. americanus, CLXII, 1534–35; — Tr. conulus, Gualt., LXX, M.
(2) Trochus concavus, Chemn., V, CLXXVIII, 1620–21.
(3) Trochus foveolatus, Chemn., V, CLXI, 1516–19; — Tr. mauritianus, id., CLXIII, 1547–48 — Tr. fenestratus, ib., 1549–50; — Tr. obeliscus, CLX, 1510–12.
(4) Trochus telescopium, Chemn., V, CLX, 1507–9.
(5) Ajoutez Trochus indicus, Chemn., V, CLXXII, 1697–98;—Troch. im perialis, CLXXIII, 1714, et CLXXIV, 1715; — Tr. solaris, ib., 1701–1702, et 1716–1717; — Tr. planus, ib., 1721, 1722.
[page] 75
D'autres trochus ombiliqués ont à la columelle une proéminence vers le bas (1).
En d'autres enfin, elle est crénelée sur sa longueur (2).
LES CADRANS. (SOLARIUM. Lam.)
Se distinguent des autres toupies par une spire en cône très évasé, dont la base est creusée d'un ombilic extrêmement large, où l'on suit de l'œil les bords intérieurs de tous les tours marqués par un cordon crénelé (3).
LES ÉVOMPHALES. (EVOMPHALUS. Sowerby.)
Sont des coquilles fossiles semblables aux cadrans, mais qui n'ont pas de crénelures aux tours internes de l'ombilic (4).
LES SABOTS. (TURBO. Lin.) (5).
Comprennent toutes les espèces à coquille complétement et régulièrement turbinée et à bouche tout-à-fait ronde. Un examen plus détaíllé les a fait beaucoup subdiviser.
LES SABOTS proprement dits. (TURBO. Lam.)
Ont la coquille ronde ou ovale, épaisse, et la bouche complétée du côté de la spire par l'avant-dernier tour. L'animal a deux longs tentacules, les yeux portés sur des pédicules à leur base extérieure, et sur les côtés du pied des ailes membraneuses, tantôt simples, tantôt frangées,
(1) Tr. virgatus, Chemn., V, CLX, 1514–15; — Tr. niloticus, Chemn., V, CLXVII, 1605–7, CLXVIII, 1614; — Tr. vernus, id., CLXIX, 1625–26; — Tr. inœqualis, CLXX, 1636–37; — Tr. magus, CLXXI, 1656–57; — Tr. conspersus, Gualt., LXX, B.; — Tr. jujubinus, CLXVII, 1612–1613.
(2) Tr. maculatus, CLXVIII, 1615–1616; — Tr. costatus, CLXIX, 1634; — Tr. viridis, CLXX, 1644; — Tr. radiatus, ib., 1640–42.
(3) Trochus pérspectivus, L., Chemn., V, CLXXII, 1691–96; — Tr. stramineus, ib., 1699; — Tr. variegatus ib., 1708–1709; — Tr. infundibuliformis, ib., 1706–1707.
(4) Evomph. pentangulatus, Sowerb., Min. conch., I, pl. XLV, f. 2; — Ev. nodosus, id., XLVI, etc.
(5) M. de Blainville a fait de ce grand genre sa famille des CRICOSTOMES.
[page] 76
tantôt munies d'un ou deux filaments. C'est à quelques-uns d'eux qu'appartiennent ces opercules pierreux et épais qui se font remarquer dans les collections, et qu'on employait autrefois en médecine sous le nom d'Unguis odoratus.
Il y en a d'ombiliqués (les MÉLÉAGRES, Montf.) (1), et de non ombiliqués (les TURBO, Montf.) (2).
LES DAUPHINULES. Lam.
Ont la coquille épaisse comme les turbo, mais enroulée presque dans le même plan; son ouverture est complétement formée par le dernier tour, et sans bourrelet. Leur animal est semblable à celui des turbo.
L'espèce la plus commune (Turbo delphinus, L.), List. 608, 45, prend son nom d'épines rameuses et contournées qui l'ont fait comparer à un poisson desséché (3).
LES PLEUROTOMAIRES. Defrance.
Sont des coquilles fossiles à bouche ronde, dont le bord externe a une incision étroite et remontant assez haut. Il est
(1) Turbo pica, L., List., 640, 30; — T. argyrostomus, Chemn., V, CLXXVII, 1758–61; — T. margaritaceus, ib., 1762; — T. versicolor, List., 576, 29; — T. mespilus, Chemn., V, CLXXVI, 1742–43; — T. granulatus, ib., 44–46; — T. ludus, ib., 48, 49; — T. diadema, id., p. 145; — T. cinereus, Born., XII, 25–26; — T. torquatus, Chemn., X, p. 295; — T. undulatus, id., CLXIX, 1640–41.
(2) Turbo petholatus, List, 584, 39; — T. cochlus, ib., 40; — T. Chrysostomus, Chemn., V, CLXVIII, 1766; — T. rugosus, List., 647, 41; — T. marmoratus, id., 587, 46; — T. sarmaticus, Chemn., V, CLXXIX, 1777–18–1781; — T. cornutus, ib., 1779–80; — T. olearius, id., CLXXVIII, 1771–72; — T. radiatus, id., CLXXX, 1788–89; — T. imperialis, ib., 1790; — T. coronatus, ib., 1791–93; — T. canaliculatus, id., CLXXXI, 1794; — T. setosus, ib., 95–96; — T. Spinosus, ib., 1797; — T. sparverius, ib., 1798; — T. moltkianus; ib., 99–1800; — T. spenglerianas, ib., 1801–2; — T. castanea, id., CLXXXII, 1807–1814; — T. crenulatus, ib., 1811–12; — T. smaragdulus, ib., 1815–1816; — T. cidaris, Chemn., V. CLXXXIV; — T. helicinus, Born., XII, 23–24.
(3) Ajoutez Turbo nodulosus, Chemn., V, CLXXIV, 1723–24; — T. carinatus, Born., XIII, 3–4; — Argonauta cornu, Fichtel et Moll., test, microsc., I, a, e, on LIPPISTE de Montfort.
[page] 77
probable qu'elle répondait, comme celle des siliquaires, à quelque fente de la partie branchiale du manteau.
M. Deshayes en compte déjà plus de vingt espèces fossiles. Les SCISSURELLES de M. d'Orbigny en sont des espèces vivantes.
LES TURRITELLES (TURRITELLA. Lam.)
Ont la même ouverture ronde que les turbo proprement dits et complétée aussi par l'avant-dernier tour, mais leur coquille est mince, et, loin d'être enroulée dans le même plan, sa spire s'alonge en obélisque (turriculée). Leur animal a les yeux attachés à la base extérieure de ses tentacules. Son pied est petit (1).
On en trouve un très grand nombre parmi les fossiles, et l'on doit en rapprocher les PROTO, Defr.
LES SCALAIRES. (SCALARIA. Lam.)
Ont, comme les turritelles, la spire alongée en pointe; et, comme les dauphinules, la bouche complétement formée par le dernier tour; cette bouche est de plus entourée d'un bourrelet que l'animal répète d'espace en espace, à mesure que sa coquille croît, de manière à y former comme des échelons. L'animal a les tentacules et la verge longs et grêles.
Il y en a une espèce célèbre par son prix, le Turbo scalaris, L., Chemn., IV, CLII, 1426, etc., vulgairement Scalata, qui se distingue parce que ses tours ne se touchant qu'aux points où sont les bourrelets, laissent du jour dans leurs intervalles.
Une autre espèce plus grêle, et qui n'a point cette particularité, est le Turbo clathrus L., commun dans la Méditerranée, List., 588, 50, 51.
On peut placer ici quelques sous-genres de terre
(1) Turbo imbricatus, Martini, IV, CLII, 1422; — T. replicatus, ib., CLI, 1412; List., 590, 55; — T. acutangulus, List., 591, 59; — T. duplicatus, Martini, IV, CLI, 1414; — T. exoletus, List., 591, 58; — T. terebra, id., 590, 54; — T. variegatus, Martini, IV, CLII, 1423; — T. obsoletus, Born., XIII, 7.
[page] 78
ou d'eau douce, à ouverture entière, ronde ou à peu près, et operculée. Dans ce nombre,
LES CYCLOSTOMES. (CYCLOSTOMA. Lam.) (1)
Doivent être distingués de tous les autres, parce qu'ils sont terrestres, attendu qu'au lieu de branchies, leur animal a seulement un réseau vasculaire sur les parois de sa cavité pectorale. Il ressemble d'ailleurs, en tout le reste, aux animaux de cette famille, sa cavité respiratoire s'ouvre de même au-dessus de sa tête par une grande solution de continuité; les sexes sont séparés; la verge du mâle est grande, charnue, et se replie dans la cavité pectorale; les tentacules, au nombre de deux, sont terminés par des tubercules mousses, et deux autres tubercules placés sur leur base extérieure portent les yeux.
Leur coquille, en spire ovale, a ses tours complets, finement striés eu travers, et sa bouche, dans l'adulte, entièrement bordée d'un petit bourrelet. Elle est fermée d'un opercule rond et mince.
On trouve ces coquilles dans les bois, sous les mousses, les pierres.
La plus commune est le Turbo elegans, List., 27, 25, à peu près de six lignes de longueur, grisâtre, que l'on trouve presque sous toutes les mousses (1).
LES VALVÉES (VALVATA. Müll.)
Vivent dans les eaux douces; leur coquille est presque enroulée dans un même plan, comme celle des planorbes, mais son ouverture est ronde, munie d'un opercule, et l'animal, qui porte deux tentacules grêles, et les yeux à leur base antérieure, respire par des branchies.
(1) M. de Férussac fait des cyclostomes et des hélicines son ordre des PULMONÉS OPERCULÉS.
(2) Ajoutez Turbo lincina, List., 26, 24; — T. labeo, List., 25, 23; — T. dubius, Born., XIII, 5, 6; — T. limbatus, Chemn., IX, CXXIII, 1075.
On doit remarquer parmi les fossiles, le Cyclostoma mumia de Lam, Brongn., Ann. Mus., XV, XXII, 1
[page] 79
Dans une espèce de ce pays-ci:
Le Porte-Plumet. (Valvata cristata. Müll.) Drap. I. 32–33.
Gruet-Huysen. Nov. act. nat. cur. t. X, pl. XXXVIII.
La branchie, faite comme une plume, sort de dessous le manteau, et flotte au dehors avec des mouvements de vibration, quand l'animal veut respirer. Au côté droit du corps, est un filament qui ressemble à un troisième tentacule. Le pied est divisé, en avant, en deux lobes crochus. La verge du mâle est grêle, et se retire seulement dans la cavité respiratoire. La coquille, qui a à peine trois lignes de large, est grisâtre, plate et ombiliquée. On la trouve dans les eaux dormantes (1).
C'est ici qu'il faut placer les coquilles complétement aquatiques ou respirant par des branchies, qui appartenaient à l'ancien genre Hélix, c'est-à-dire dans lesquelles l'avant-dernier tour forme, comme dans les hélix, les limnées, etc., un arc rentrant, qui donne plus ou moins à l'ouverture la figure d'un croissant (2).
Les trois premiers genres tiennent encore d'assez près aux turbo. Ainsi
LES PALUDINES. (PALUDINA. Lam.)
Ont été nouvellement séparées des cyclostomes, parce qu'elles n'ont point de bourrelet à leur ouverture; que celle-ci, aussi bien que leur opercule, a un petit angle vers le haut, et que leur animal, ayant des branchies, vit dans l'eau comme tous les autres genres de cette famille. Il porte une trompe très courte, deux tentacules
(1) Ajoutez Valvata planorbis, Drap., I, 34, 35; — V. minuta, id., 36–38.
(2) C'est ce dont M. de Blainville fait sa famille des ELLIPSOSTOMES.
[page] 80
pointus; les yeux à leur base externe sans pédicule particulier; une petite aile membraneuse de chaque côté du corps en avant; le bord antérieur de son pied est double; l'aile du côté droit se recourbe en un petit canal, qui introduit l'eau dans la cavité respiratoire, ce qui commence à indiquer le syphon de la famille suivante.
Dans l'espèce commune,
La Vivipare à bandes de Geoffr. (Helix vivipara. Lin.) Drap. I. 16.
Dont la coquille, lisse et verdâtre, a deux ou trois bandes longitudinales pourpres, et qui habite en abondance toutes nos eaux dormantes; la femelle produit des petits vivants: on les trouve, au printemps, dans son oviductus, dans tous les états de développement. Spallanzani assure que les petits, pris au moment de leur naissance et nourris séparés, reproduisent sans fécondation, comme ceux des pucerons. Cependant les mâles sont presque aussi communs que les femelles; ils ont une grande verge qui sort et rentre comme celle des hélix, mais par un trou percé dans le tentacule droit, ce qui fait toujours paraître ce tentacule plus grand que l'autre. C'est un moyen de reconnaître le mâle (1).
La mer produit quelques coquillages qui ne diffèrent des paludines que par une coquille épaisse. Ce sont
LES LITTORINES. Féruss.
Dont l'espèce commune
Le Vigneau (turbo littoreus. L.) Chemn. V CLXXXV, 1852,
Fourmille sur nos côtes. Sa coquille est ronde, brune, rayée longitudinalement de noirâtre. On le mange.
LES MONODONTES. (MONODON. Lam.)
Ne diffèrent des littorines que par une dent mousse
(1) Ajoutez Cyclost. achatinum, Drap., I, 18; — C. impurum, id., 19, 20, ou Helix tentaculata, L., etc.; et les petites espèces des étangs d'eau salée, décrites par M. Beudant, Ann. Mus., XV, p. 199.
[page] 81
et légèrement saillante au bas de leur columelle, qui a quelquefois encore une fine dentelure. Plusieurs ont aussi le bord extérieur de l'ouverture crénelé. L'animal est plus orné; il porte généralement de chaque côté trois ou quatre filets aussi longs que ses tentacules. Ses yeux sont portés sur des pédicules particuliers à la base externe des tentacules. L'opercule est rond et corné.
On en trouve une petite espèce très abondante sur nos côtes (Trochus tessellatus, L.), Adans., Sénég., XII, 1, List., 642, 33, 34, à coquille brune, tachetée de blanchâtre (1).
LES PHASIANELLES. (PHASIANELLA. Lam.)
Ont la coquille oblongue ou pointue, comme celle de plusieurs lymnées et bulimes; son ouverture, de même plus haute que large, est de plus munie d'un opercule pierreux, et a le bas de la columelle sensiblement aplati et sans ombilic.
Ce sont des espèces des mers des Indes, que leurs couleurs douces et agréablement nuancées font rechercher des amateurs. Leur animal a deux longs tentacules, les yeux portés sur deux tubercules de leur base extérieure, de doubles lèvres échancrées et frangées, ainsi que les ailes, qui portent chacune trois filaments (2).
LES AMPULLAIRES. (AMPULLARIA. Lam.)
Ont la coquille ronde et ventrue, à spire courte
(1) Ajoutez Trochus labeo, Adans., Sénég., XII, List., 68, 442; — Troch. Pharaonius, List., 637, 25; — Tr. rusticus, Chemn., V, CLXX, 1645, 46; — Tr. nigerrimus, ib., 47; — Tr. œgyptius, id., CLXXI, 1663, 4; — Tr. viridulus, ib., 1677; — Tr. carneus, ib., 1682; — Tr. albidus, Born., XI, 19, 20; — Tr. asper, Chemn., ib., CLXVI, 1582; — Tr. citrinus, Knorr., Del., I, X, 7; — Tr. granatum, Chemn., V, CLXX, 1654, 55; — Tr. crocatus, Born., XII, 11, 12; — Turbo atratus, Chemn., V, CLXXVI, 1754–55; — Turbo dentatus, id., CLXXVIII, 1767, 8, etc.
(2) Buccinum tritonis, Chemn., IX, CXX, 1035, 1036; — Helix solida, Born., XIII, 18, 19.
TOME III. 6
[page] 82
comme celle de la plupart des hélices; son ouverture est plus haute que large, munie d'un opercule, et sa columelle ombiliquée. Elles vivent dans les eaux douces ou saumâtres des pays chauds. Leur animal a de longs tentacules et des yeux portés sur des pédicules de leur base. Au plafond de sa cavité respiratoire, à côté d'un peigne branchial, long et unique, est, d'après les observations de MM. Quoy et Gaymard, une grande poche sans issue remplie d'air, qui pourrait passer pour une vessie natatoire (1).
Les LANISTES, Montf., sont des ampullaires à grand ombilic contourné en spirale (2).
LES HÉLICINES. (HELICINA. Lam.) (3)
Seraient par la coquille, des ampullaires à bord de l'ouverture renversé (4).
Quand ce bord renversé est tranchant, ce sont les AMPULLINES, Blainv., et quand il est en bourrelet mousse, les OLYGIRES de Say.
Il y en a une espèce remarquable par un rebord et une traverse pierreuse à la face interne de son opercule (5).
Il paraît que, dans cesanimaux, les organes de la respiration sont disposés comme dans les cyclostomes, et qu'ils peuvent vivre de même à l'air (6).
LES MÉLANIES. (MELANIA. Lam.)
Ont une coquille plus épaisse, à ouverture plus haute
(1) Helix ampullacea, L., List., 130, 30; — Bulimus urceus, Brug, List., 125, 25.
(2) Ampull. carinata, Oliv., Voyage en Turq., pl. XXXI, f. 7, copié Blainv., Malac., XXXIV, 3.
(3) Montfort a changé le nom d'hélicine en celui de Pitonnille; mais il n'a pas été adopté, et on ne peut le citer que pour la synonymie.
(4) L'Helicine striée, Blainv., Malac., XXXV, 4.
(5) L'Helicine neritelle, List., LXI, 59, cop. Blainv., Malac., XXXIX, 2.
(6) C'est d'après cette circonstance que M. de Férussac range ce sousgenre avec celui des Cyclostomes dans un ordre qu'il nomme Pulmonès operculés. Voyez la Monographie de ce genre par M. Gray, Zool. journ., nos 1 et 2.
[page] 83
que large, qui s'évase à la partie opposée à sa spire. La columelle n'a ni repli ni ombilic; la spire varie beaucoup pour l'alongement.
Les mélanies vivent dans les rivières, mais il n'y en a point en France; leur animal a de longs tentacules et les yeux sur leur côté extérieur, vers le tiers de la longueur (1).
LES RISSOAIRES. (RISSOA. Freminv. ACMEA. Hartm.)
Diffèrent des mélanies parce que les deux bords de leur ouverture s'unissent dans le haut (2).
LES MÉLANOPSIDES. (MELANOPSIS. Ferussac.)
A peu près de la forme des mélanies, en diffèrent par une callosité à la columelle et un vestige d'échancrure vers le bas de l'ouverture, qui semble indiquer un rapport avec les vis (3).
LES PIRÈNES. Lam.
Ont non-seulement ce petit sinus vers le bas, mais on leur en voit un second à la partie opposée (4).
Ces deux sous-genres vivent, comme les mélanies, dans les rivières du midi de l'Europe et des pays chauds.
(1) Mèlanie thiare (Melania amarula, Lam.), Chemn., Tab. 134, fig. 1218 et 1219; de l'île de France, de Madagascar.
Aj. Mel. truncata, Lam., Encycl., pl. 458, fig. 3, a-b; — Mel. coarctata, id., Encycl., pl. 458, fig. 5, a-b, et un grand nombre d'espèces fossiles, parmi lesquelles Mél. semi-placata, Defr.; — Mél. Cuvieri, Desh., Coq. foss. des env. de Paris, tom. II, pl. XII, fig. 1–2, — Mél. costellata, Lam.
(2) M. de Freminville en décrit sept espèces dans le nouv. Bullet. des Sc. nat. de la Soc. phil., année 1814, p. 7, et M. Audouin trois dans l'ouvrage d'Égypte: Riss. Freminvillii, Coq., pl. III, fig. 20; — Riss. Desmarestü, ibid, 21; — Riss. d'Orbignii, ibid, fig. 22.
(3) Mélanopside buccinoïde (Melan. buccinoülea), Feruss., Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris, tom. I, pl. VII, fig. 1–11, etc. Voyez Sowerby; 22e livraison.
(4) Pirène térebrate (Pir. terebralis), Lam.; Lister, Tab. 115, fig. 10.; — Pir. Madagascariensis, Encycl., pl. 458, fig. 2, a, b, etc.
6*
[page] 84
Nous croyons pouvoir placer ici deux genres détachés des volutes, et qui ressembleraient assez aux auricules, mais qui sont operculés et ne portent que deux tentacules:
LES ACTÉONS. Montf. (1). (TORNATELLES. Lam.)
Qui ont la coquille elliptique, à spire peu saillante, l'ouverture alongée en croissant, élargie par en bas, et le bas de la columelle marqué d'un ou deux gros plis ou callosités obliques (2), et
LES PYRAMIDELLES. Lam.
Qui ont la spire turriculée, l'ouverture large, en croissant, le bas de la columelle contourné obliquement, et marqué de plis aigus en spirale (3).
LES JANTHINES. (JANTHINA. Lam.) (4)
S'écartent beaucoup de tous les précédents par les formes de l'animal. Leur coquille cependant est assez semblable à celle de nos colimaçons terrestres, et a de même son bord columellaire en arc rentrant, mais est un peu anguleuse au bord externe, et sa columelle un peu prolongée au delà du demi-ovale que formerait, sans ce prolongement, le bord extérieur. L'animal n'a point d'opercule, mais il porte sous son pied un organe vésiculaire semblable à une bulle d'écume, et toutefois de
(1) Qu'il faut hien distinguer des Actéons d'Oken, lesquels paraissent voisins des Aplysies.
(2) Voluta tornatilis et bifasciata, L., Martini, II, XLIII, 442, 443; — V. sulcata et V. solilula, ib., 440, 441; — V. flammea, ib., 439; — V. flava, ib., 444; — V. pusilla, ib., 446.
(3) Trochus dolabratus, L. Chemn., V, CLXVII, 1603, 1604; — Bulintus terebellum, Brug., List., 844, 72.
(4) M. de Blainville fait de ce genre sa famille des OXYSTOMES.
[page] 85
substance solide, ce qui l'empêche de ramper, mais lui permet de flotter à la surface de l'eau. Sa tête, en forme de trompe cylindrique, terminée par une bouche fendue verticalement et armée de petits crochets, porte de chaque côté un tentacule fourchu.
L'espèce commune (Helix Janthina, L.), List. 572, 24, est une jolie coquille violette, très abondante dans la Méditerranée. Quand on touche l'animal, il répand une liqueur épaisse d'un violet foncé, qui teint autour de lui l'eau de la mer.
LES NÉRITES. (NERITA. Lin.) (1)
Sont les coquilles qui ont leur columelle en ligne droite, ce qui rend leur ouverture demi - circulaire ou demi - elliptique. Cette ouverture est généralement grande par rapport à la coquille, mais toujours munie d'un opercule qui la ferme complétement. La spire est presque effacée et la coquille demi-globuleuse.
LES NATICES. (NATICA. Lam.)
Sont des nérites à coquilles ombiliquées; celles dont on connaît l'animal ont un grand pied, des tentacules simples, portant les yeux à leur base et un opercule corné (2).
LES NÉRITES propres. (NERITA. Lam. PELORONTA. Oken.)
N'ont point d'ombilic. Leur coquille est épaisse, leur columelle dentée, leur opercule pierreux; leur animal porte les yeux sur des pédicules à côté des tentacules, et n'a qu'un pied médiocre (3).
(1) M. de Blainville fait de ce grand genre sa famille des HÉMICYCLOSTOMES.
(2) Voyez pour les espèces la première div. de Gm. et Chemn., V, pl. CLXXXVI-CLXXXIX.
(3) Voyez pour les espèces la troisième div. de Gm. et Chemn., V, pl, CLXXXX-CLXXXXIII, et Sowerby, Gen. of Sh., quinzième livraison.
[page] 86
On en distingue peut-être assez légèrement
LES VÉLATES. Montf.
Où le côté de la columelle est recouvert d'une couche calcaire, épaisse et bombée (1), et
LES NÉRITINES. Lam.
Qui ont la coquille sans ombilic, mince, l'opercule corné; elles vivent dans les eaux douces. L'animal est comme dans les nérites propres. Le plus souvent leur columelle n'est pas dentée.
No us en avons une petite agréablement variée en couleur, très abondante dans nos rivières (Nerita fluviatilis, L.), Chemn., IX, CXXIV, 188 (2).
Quelques-unes y ont cependant de fines dentelures (3), et dans ce nombre il en est dont la spire est armée de longues épines (les CLITHONS, Montf.) (4).
C'est des trochoïdes que, d'après nos nouvelles observations, nous croyons devoir rapprocher une famille que nous appellerons
CAPULOIDES (5),
Et qui comprend cinq genres, dont quatre démembrés des patelles. Ils ont tous une coquille largement ouverte, à peine turbinée, sans opercule, sans échancrure ni syphon; du reste, leur
(1) Nerita perversa, Gmel., grande espèce fossile; Chemn., IX, CXIV, 975, 976.
(2) Ajoutez Nerita turrita, Chemn., IX, CXXIV, 1085.
(3) Nerita pulligera, Chemn., loc. cit., 1878–1879; — N. virginea, Lister, 604, 606.
(4) Nerita corona, Chemn., 1083–84.
(5) M de Blainville en met la plupart dans ses Paracéphalophores hermaphrodites non symétriques ou calyptraciens; mais ils me paraissent tous dioïques.
[page] 87
animal ressemble aux autres pectinibranches, et a de même les sexes séparés. Leur peigne branchial est unique, disposé en travers à la voûte de la cavité, et ses filets sont souvent très longs.
LES CABOCHONS. (CAPULUS. Montf. PILEOPSIS. Lam.)
Ont une coquille conique, à sommet se recourbant un peu en commencement de spirale, qui les a longtemps fait placer parmi les patelles; leurs branchies sont sur une rangée sous le bord antérieur de la cavité branchiale; leur trompe est assez longue; sous leur cou est un voile membraneux très plissé; ils ont deux tentacules coniques portant les yeux à leur base extérieure (1).
LES HIPPONYCES. (HIPPONYX. Defr.)
Paraîtraient, d'après leur coquille, des cabochons fossiles, mais très remarquables par un support formé de couches calcaires sur lequel ils reposent, et qui avait été probablement transsudé par le pied de leur animal (2).
LES CRÉPIDULES. (CREPIDULA. Lam.)
Ont une coquille ovale, à pointe obtuse couchée, dirigée obliquement en arrière et de côté, à ouverture faisant la base de la coquille, à moitié fermée en dessous et en arrière par une lame horizontale. Le sac abdominal contenant les viscères est sur cette lame, le pied dessous, la tête et les branchies en avant. Les branchies consistent en une rangée de longs filaments attachés sous
(1) Patella hungarica, List., 544–32; — Pat. calyptra, Chemn., X, CLXIX, 1643–44; — Pat mitrala, Gm., Lister, DXLIV, 31.
(2) Patella cornucopiœ, Lam, Knorr., Petrif., II, part. II, pl. 131 f. 3, et Blainv., Malac., pl.
[page] 88
le bord antérieur de la cavité branchiale. Deux tentacules coniques portent les yeux à leur base extérieure (1).
LES PILÉOLES. (PILEOLUS. Sowerby.)
Paraissent des crépidules dont la lame transverse prend moitié de l'ouverture; cependant leur coquille est plus semblable à celles des patelles (2). On ne les a que fossiles.
LES SEPTAIRES. Féruss. NAVICELLES. Lam. (CIMBER. Montf. 82.)
Ressemblent aux crépidules, excepté que leur sommet est symétrique, couché sur le bord postérieur, et leur lame horizontale moins saillante; l'animal a de plus une plaque testacée de forme irrégulière, attachée horizontalement sur la face supérieure du disque musculaire de son pied, et recouverte par le sac abdominal, qui repose en partie dessus. C'est probablement l'analogue d'un opercule, mais qui n'en remplit pas les fonctions, étant en quelque sorte à l'intérieur; leur animal a de longs tentacules, et à leur base extérieure, des pédicules qui portent les yeux. Elles vivent dans les rivières des pays chauds (3).
LES CALYPTRÉES. (CALYPTRÆA. Lam.)
Ont une coquille en cône, dans le creux de laquelle est une petite lame saillante en dedans, qui fait comme
(1) Patella fornicata, List., 545, 33, 35; — P. aculeata, Chemn., X, CLXVIII, 1624–25; — P. goreensis, Martini, I, XIII, 131, 132; — P. solea, Naturf., XVIII, 11, 15; — P. crepulula, Adans. Sénég., I, 11, 9; — Pat. porcellana, List., 545, 34.
(2) Pileolus plicatus, Sowerb.; — Pil. lævis, id., Gen. of Shells., n° 19; — Pil. neritoides, Desh., Ann. des Sc. nat., I, XIII, 3, a, b, c.
(3) Patella neritoïdea, List., 545–36, et Naturf., XIII, V, 1, 2; — Pat. borbonica, Bory. Saint-Vincent, Voyage, I, XXXVII, 2; et pour l'animal, Quoy et Gaim., Voyage de Freycinet, pl. 71, f. 3–6.
[page] 89
un commencement de columelle et s'interpose dans un repli du sac abdominal. Les branchies se composent d'une rangée de nombreux filets longs et minces comme des cheveux.
Les unes ont cette lame adhérente au fond du cône, ployée elle-même en portion de cône ou de tube, et descendant verticalement (1).
D'autres l'ont placée presque horizontalement, adhérente aux côtés du cône, qui est marqué en dessus d'une ligne spirale, ce qui donne à leur coquille quelque rapport avec celle des trochus (2).
LES SIPHONAIRES. (SIPHONARIA. Sowerby.)
Démembrées tout nouvellement des patelles, ont une coquille au premier coup d'œil très semblable à une patelle aplatie et sillonnée en rayons, mais son bord est un peu plus saillant du côté droit, et elle est creusée en dessous d'un léger sillon qui aboutit à cette proéminence du bord, et auquel répond un trou latéral du manteau par où l'eau s'introduit dans la cavité branchiale placée sur le dos, et d'ailleurs close de toute part. L'organe respiratoire consiste en petits feuillets peu nombreux, attachés sur une ligne transversale au plafond de cette cavité; l'animal ne paraît point avoir de tentacules, mais seulement un voile étroit sur la tête (3).
Il y a des espèces où la coquille n'a pas même cette appa-
(1) Patella equestris, L., List., 546–38; — Pat. sinensis, ib., 39; — Pat. trochiformis, Martini, I, XIII, 135; — Pat. auricula, Chemn., X, CLXVIII, 1628–29; — Pat. plicata, Nat. forsch., XVIII, 11, 12; — Pat. striata, ib., 13.
(2) Patella contorta, Nat. Forsch., IX, III, 34, VIII, 11–14; — Pat. depressa, ib., XVIII, II, 11.
(3) Patella sipho; — Siphonaria concinna, Sowerb., Gen. of Shelss, ° XXI; — S. exigua, id., ib. Voyez aussi Savigny, Descr. de l'Eg., Zool., Gaster., pl. III, f. 3, et Coq., pl 1, f. 1. M. Gray a proposé, il y a quelques années, un genre GADINIA, qui ne diffère en rien de celui des siphonaires. (Philos. Magaz., avril 1824.)
[page] 90
rence légère de canal, et ressemble tout-à-fait à celle d'une patelle, si ce n'est que son sommet est sur l'arrière (1).
LES SIGARETS. (SIGARETUS. Adans.)
Ont la coquille aplatie, à ouverture ample et ronde, à spire peu considérable, dont les tours s'élargissent très vite et se voient par dedans, et cachée pendant la vie dans l'épaisseur d'un bouclier fongueux qui la déborde de beaucoup, ainsi que le pied, et qui est le véritable manteau. On remarque en avant de ce manteau, une échancrure et un demi-canal qui servent à conduire l'eau dans la cavité branchiale, et qui forment un passage à la famille suivante; mais dont la coquille ne porte aucune empreinte. Les tentacules sont coniques et portent les yeux à leur base extérieure; la verge du mâle est très grande.
Nous en avons quelques espèces sur nos côtes.
LES CORIOCELLES. (CORIOCELLA. Blainv.)
Ne sont que des sigarets dont la coquille est cornée et presque membraneuse, comme celle des aplysies (2).
LES CRYPTOSTOMES. (CRYPTOSTOMA. Blainv.)
Ont une coquille assez semblable à celle des sigarets, portée avec la tête et l'abdomen qu'elle recouvre sur un pied quatre fois plus grand, coupé carrément en arrière, et qui produit en avant une partie charnue et oblongue, qui fait près de moitié de sa masse. L'animal même a la tête plate, deux tentacules, un large peigne branchial au plafond de sa cavité dorsale;
(1) Siphonaria tristensis, Sow., loc. cit.
(2) La Coriocelle noire, Blainv. Malac., XLII, f. 1. Ce mollusque n'est pas dépourvu de coquille, comme l'a cru l'auteur du genre; mais elle est mince et flexible.
[page] 91
la verge sous le tentacule droit; mais je ne lui vois pas d'échancrure au manteau (1).
La troisième famille des gastéropodes pectinibranches, ou
LES BUCCINOIDES,
A une coquille spirale, dont l'ouverture a, près de l'extrémité de la columelle, une échancrure ou un canal pour le passage du syphon, ou tuyau qui lui-même n'est qu'un repli prolongé du manteau. Le plus ou moins de longueur du canal, quand il existe, le plus ou moins d'ampleur de l'ouverture et les formes de la columelle, donnent leur division en genres, que l'on peut grouper diversement (2).
LES CONES. vulg. Cornets. (CONUS. L.) (3)
Ainsi nommés de la forme conique de leur coquille; la spire, ou tout-à-fait plate ou peu saillante, forme la base du cône; sa pointe est à l'extrémité opposée; l'ouverture est étroite, rectiligne ou à peu près, étendue d'un bout à l'autre, sans renflement ni plis, soit au bord, soit à la columelle. L'animal est d'une minceur proportionnée à l'ouverture qui lui donne passage; ses
(1) Outre l'espèce du Muséum britannique (Cr. leachii, Blainv.), Malac., XLII, 3, nous en avons une (Cr. carolinum, Nob.) envoyée de la Caroline par M. L'Herminier.
(2) Ce sont les Paracéphalophores dioïques syphonobranches de M. de Blainville.
(3) M. de Blainville réunit les Cornets, les Porcelaines, les Ovules, les Tarières et les Volutes, en une famille qu'il nomme ANGYOSTOMES.
En plaçant ici ces genres à ouverture étroite, nous n'entendons point précisément les rapprocher de la famille précédente; mais seulement les présenter les premiers, comme ayant les caractères les plus saillants parmi ceux à syphon.
[page] 92
tentacules et sa trompe s'alongent beaucoup; les premiers portent les yeux en dehors près de la pointe; l'opercule placé obliquement sur l'arrière de son pied, est étroit et trop court pour fermer toute l'ouverture de la coquille.
Les coquilles de ce genre ont généralement de très belles couleurs, ce qui les a fait recueillir en grande abondance dans les cabinets. Nos mers n'en produisent que très peu (1).
On les distingue selon que leur spire est plate ou peu saillante, et que les tours en sont ou non tuberculeux, ou qu'elle est plus saillante et même pointue, ayant aussi, ou non, des tubercules.
Il y en a même dont la spire est assez saillante pour les faire paraître cylindriques, et alors elle peut aussi être lisse ou tuberculeuse (2).
On appelle spire couronnée celle qui a des tubercules.
LES PORCELAINES. (CYPRÆA. L.)
Ont aussi la spire très peu saillante, et l'ouverture étroite et s'étendant d'un bout à l'autre; mais leur coquille bombée au milieu et presque également rétrécie aux deux bouts, offre une forme ovale, et leur ouverture, dans l'animal adulte, est ridée transversalement à ses deux côtés. Le manteau est assez ample pour se recourber sur la coquille et l'envelopper; il la
(1) On peut voir, sur les espèces de ce beau genre, l'article et les planches de Bruguières dans l'Encycl. méthod., où il est parfaitement décrit et représenté, et l'énumération encore plus complète qu'en a faite M. de Lamarck, Ann. Mus., tome XV.
(2) Espèces à spire couronnée, Con. cedonulli, L. Coq., recherchée et qui admet un grand nombre de variétés, Encycl. méth., pl. 316, fig. 1; Con. marmoreus, L., Enc., pl. 317, fig. 5; Con. arenatus, Brug. Enc., pl. 320, fig. 6., etc.
Espèces à spire non couronnée. Con. litteratus, L., Encycl., pl. 323, fig. 1; — Con. tessellatus, Brug., Enc., pl. 326, fig. 7; — Con. virgo, Brug., Encycl., pl. 326. fig. 5, etc.
[page] 93
couvre à un certain âge d'une couche d'une autre couleur, en sorte que cette différence, jointe à la forme que prend l'ouverture, ferait prendre l'adulte pour une autre espèce. L'animal a des tentacules médiocres, portant les yeux à leur base externe, et un pied mince sans opercule.
Ce sont aussi des coquilles très belles en couleurs, et dont on a beaucoup rassemblé dans les cabinets, quoiqu'elles viennent presque toutes des mers des pays chauds (1).
LES OVULES. (OVULA. Brug.)
Ont la coquille ovale et l'ouverture étroite et longue comme les porcelaines; mais sans rides du côté de la columelle; la spire est cachée, et les deux bouts de l'ouverture à peu près également échancrés ou également prolongés l'un et l'autre en canal. Linnæus les confondait avec les bulles, dont Bruguières les a séparées avec raison. Leur animal a un pied large, un manteau étendu, qui peut en partie se retrousser sur la coquille; un museau médiocre et obtus, et deux longs tentacules, qui portent les yeux sur le côté, vers le tiers de leur longueur.
Montfort appelle en particulier OVULES, celles où le bord extérieur est ridé en travers (2).
Il nomme NAVETTES (VOLVA) celles où les deux bouts de l'ouverture se prolongent en canal, et où le bord extérieur lui même n'est pas ridé (3).
(1) Voyez, pour les espèces, le genre cypræa de Gmel., et les figures recueillies par Bruguières pour l'Encyclopédie, le Gen. of Shells de M. Sowerby, XVIIe livr., et surtout une Monographie de M. Gray, publiée dans le Zool. Journal, nos 2, 3 et 4.
(2) Bulla ovum, L., List., 711, 65, Encycl., 358, 1.
(3) Bulla volva, L., List., 711, 63, Encycl., 357, 3; — B. birostris, Enc., 357, 1; Sow., ibid.
[page] 94
Quand ce bord extérieur n'est pas ridé, ni les extrémités de l'ouverture prolongées, il les appelle CALPURNES (1).
LES TARIÈRES. (TEREBELLUM. Lam.)
Ont la coquille oblongue, l'ouverture étroite, sans plis ni rides, et s'élargissant uniformément jusqu'au bout opposé à la spire, laquelle est plus ou moins saillante selon les espèces (2). On ne connaît pas leurs animaux
LES VOLUTES. (VOLUTA. Lin.)
Varient pour la forme de la coquille et pour celle de l'ouverture; mais se reconnaissent à l'échancrure sans canal qui la termine et à des plis saillants et obliques de leur columelle.
Bruguières en avait d'abord séparé.
LES OLIVES. (OLIVA. Brug.)
Ainsi nommées à cause de la forme oblongue ou ellipsoïde de leur coquille, dont l'ouverture est étroite, longue, échancrée à l'opposite de la spire, qui est courte, et a les plis de la columelle nombreux et semblables à des stries. Les tours sont creusés en sillon. Ces coquilles ne le cèdent point en beauté aux porcelaines (3).
Leur animal a un grand pied, dont la partie antérieure (en avant de la tête) est séparée par une incision de chaque côté; ses tentacules sont grêles et portent les yeux sur le côté au milieu de leur longueur. Sa trompe, son syphon,
(1) Bulla verrucosa, L., List., 712, 67, Enc., 357, 5, dont nous ne séparons pas les ULTIMES, Montf.; ou Bulla gibbosa, L., List., 711, 64, Encycl., 357, 4.
(2) Terebellum subulatum, Lam., Bulla terebeilum, L., Lister, 736, f. 30, Encycl., 360, 1; — Tereb. convolutum, Lam. Sowerb., Gen. of Shells, 6e liv.
(3) Oliv. subulata, Lam., Enc., pl. 368, fig. 6, a b; — Vol. hiatula, L.;—Voluta porphyria, Vol. oliva, et en général toutes les volutes cylindroïdes de Gm., p. 3438 et suivantes.
[page] 95
sa verge sont assez longs; il n'a pas d'opercule. MM. Quoy et Gaymard ont observé à sa partie postérieure un appendice qui s'introduit dans lé sillon des tours.
Le reste du genre volute a été ensuite subdivisé en cinq par M. de Lamark. (1)
LES VOLVAIRES. (VOLVARIA. Lam.)
Ressemblent beaucoup aux olives par leur forme oblongue ou cylindrique; mais leur ouverture est étroite, et son bord antérieur remonte jusqu'au-dessus de la spire, qui est excessivement courte. Il y a un ou plusieurs plis au bas de leur columelle; leur poli, leur blancheur les font employer sur quelques côtes en colliers (2). Il y en a une petite espèce fossile de nos environs (3).
LES VOLUTES propres. (VOLUTA. Lam.)
Ont l'ouverture ample, et la columelle marquée de quelques gros plis, dont le plus éloigné de la spire est le plus fort. Leur spire varie beaucoup en saillie.
Les unes (CYMBIUM, Montf.; CYMBA, Sowerb.) ont le dernier tour ventru; leur animal a un pied charnu, grand et épais, sans opercule, et sur la tête un voile, aux côtés duquel sortent les tentacules. Les yeux sont sur ce même voile en dehors des tentacules. Sa trompe est assez longue et son syphon a un appendice de chaque côté de sa base. Ces coquilles deviennent très grandes, et plusieurs sont fort belles (4).
D'autres (VOLUTA, Montf.) ont le dernier tour en cône,
(1) Sans compter les Tornatelles et les Pyramidelles déjà mentionnées page 84 ci-dessus.
(2) Volv. monilis, L.; Volv. triticea, Lam., etc.
(3) Volvaria bulloïdes, Lam., Encycl. méth., pl. 384, f. 4.
(4) Vol. æthiopica, List., 797, 4; — V. cymbium, 796, 3, 800, 7; — V. olla, 794, 1; — V. Neptuni, 802, 8; — V. navicula, 795, 2; — V. papillaris, Séb., III, LXIV, 9; — V. indica, Martini, III, LXXII, 772, 773; genre MELO, Sowerb., Gen. of Shells, 28e liv.—V. cymbiola, Chemn, X, CXLVIII, 1385, 1386; — V. præputium, List., 798, 1; — V. spectbilis, Davila, I, VIII, S.
[page] 96
se rétrécissant au bout opposé à la spire (1). Leur animal a le pied moins gros que dans les précédentes; leurs coquilles sont souvent aussi très remarquables par la beauté de leurs couleurs ou des dessins qui y sont tracés.
LES MARGINELLES. (MARGINELLA. Lam.)
Avec les formes des volutes propres, ont le bord extérieur de l'ouverture garni d'un bourrelet. Leur échancrure est peu marquée. Selon Adanson, leur animal a aussi le pied très grand et manque d'opercule. Il recouvre en partie la coquille en relevant les lobes de son manteau. Ses tentacules portent les yeux sur le côté externe de leur base (2).
M. de Lamarck en distingue encore les COLOMBELLES (COLOMBELLA) dont les plis sont nombreux et le bourrelet du bord externe renflé dans son milieu (3). Il paraît qu'elles n'ont pas d'opercule.
LES MITRES (MITRA. Lam.)
Ont l'ouverture oblongue avec quelques gros plis à sa columelle, et le plus voisin de la spire le plus gros. Leur spire est généralement pointue et alongée; plusieurs espèces sont brillamment tachetées de rouge sur un fond blanc (4). Leur
(1) Voluta musica, List., 805, 14, 806, 15; — V. scapha, 799, 6; — V. vespertilio, 807, 16, 808, 17; — V. hæbrea, 809, 18; — V. vexillum, Martini, III, CXX, 1098; — V. flavicans, ib., XCV, 922, 923; — V. undulata, Lam., Ann. Mus., etc. Voyez pour d'autres espèces un Mémoire de M. Broderip (Zool. Journ., avril 1825).
(2) Voluta glabella, Adans., IV, genre X, 1; — Voluta faba, ib., 2; — Vol. prunum, ib., 3; — Vol. persicula, ib., 4, et en général toute la pl. XLII, vol. II de Martini; — Vol. marginata, Born., IX, 5, 6.
(3) Voluta mercatoria, List., 824, 43; — Vol. rustica, List., 824, 44; — Vol. mendicaria, et presque toute la pl. XLIV de Martini, vol. II; — Col. strombiformis; Vol. labiosa; Vol. punctata, etc., Sow., Gen. of Shells, 9e livr.
(4) Telles sont Vol. episcopalis, List., 839, 66; — Vol. papalis, ib., 67; et 840, 68;—Vol. cardinalis, 838, 65. Ajoutez Vol. patriarchalis; — Vol. pertusa, 822, 40;—Vol. vulpecula, Martini, IV, CXLVIII, 1366; — Vol. plicaria, List., 820, 37; — Vol. sanguisuga, List., 821, 8; — Vol. caffra, Martini, IV, CXLVIII, 1369, 1370; — Vol. acus, id., CLVII, 1493, 1494; — Vol. scabricula, id., CXLIX, 1388, 89; — Vol. maculosa, ib., 1377; — Vol. nodulosa, ib., 1385; — Vol. spadicea, id., CL, 1392; — V. aurantia, ib., 1393–94; — V. decussata, 1395; — V. tunicula, 1376.
[page] 97
animal a le pied petit, les tentacules de longueur médiocre portant les yeux de côté vers le tiers inférieur, un siphon aussi de longueur médiocre; mais il avance souvent une trompe plus longue que sa coquille.
LES CANCELLAIRES. (CANCELLARIA. Lam.)
Dont le dernier tour est ventru et l'ouverture ample et ronde, et où le bord interne forme une plaque sur la columelle. Leur spire est saillante, pointue, et leur surface généralement marquée de sillons croisés (1).
LES BUCCINS. (BUCCINUM. L.) (2)
Comprennent toutes les coquilles non plissées à la columelle, munies d'une échancrure, ou d'un canal court infléchi vers la gauche.
Bruguières en a fait les quatre genres des buccins; des pourpres, des casques et des vis, dont MM. de Lamark et Montfort ont encore subdivisé une partie.
LES BUCCINS. (BUCCINUM. Brug.)
Comprennent les coquilles échancrées sans aucun canal, dont la forme générale est ovale, ainsi que celle de l'ouverture. Tous ceux de leurs animaux qu'on connaît manquent de voile à la tête, et ont une trompe, deux tentacules écartés, portant les yeux sur le côté externe et un opercule corné. Leur siphon s'alonge hors de la coquille.
M. de Lamark réserve spécialement ce nom de BUCCIN (BUCCINUM, Lam.) à celles dont la columelle est convexe et nue, et le bord sans rides ni bourrelet. Leur pied est mé-
(1) Voluta cancellata, L., Adans., VIII, 16; — Vol. reticulata, List., 830, 25, etc. — Sow., Gen. of Shells, 5e livr.
(2) M. de Blainville fait de ce grand genre, une famille de ses Paracephalophores dioïques siphonobranches, qu'il nomme ENTOMOSTOMES.
TOME III. 7
[page] 98
diocre, leur trompe longue et grosse, et leur verge souvent excessivement grande (1).
LES NASSES. (NASSA. Lam.)
Ont le côté de la columelle recouvert par une plaque plus ou moins large et épaisse, et l'échancrure profonde, mais sans canal. Leur animal ressemble à celui des buccins proprement dits, et il y a pour les coquilles des passages gradués d'un sous-genre à l'autre (2).
M. Delamark nomme
EBURNES. (EBURNA. Lam.)
Celles qui joignent à une coquille lisse et sans rides au bord, une columelle largement et profondément ombiliquée. Leur coquille a pour la forme générale de grands rapports avec les olives. On ne connaît pas leur animal (3).
LES ANCILLAIRES. (ANCILLARIA. Lam.)
Ont la même coquille lisse, et au bas de la columelle un bourrelet marqué, sans ombilic et sans sillon à la spire.
(1) Buccinum undatum, L., List., 662, 14; — Bucc. glaciale, L.; — Bucc. anglicum, List., 963, 17; — Bucc. porcatum, Martini, IV, CXXVI, 1213, 1214; — Bucc. lævissimum, id., CXXVII, 1215–16; — B. igneum, ib., 1217; — Bucc. carinatum, Phips, Voyage XII, 2; — B. solutum, Naturf., XVI, 11, 3–4; — Bucc. strigosum, Gm., n° 108, Bonan., III, 38; — Bucc. glaberrimum, Martini, IV, CXXV, 1177, 1182; — Bucc. strigosum, ib., 1183, 1188; — Bucc. obtusum, ib., 1193; — Bucc., coronatum, CXXI, 1115, 1116.
(2) Buccinum arcularia, List., 970, 24, 25, — Bucc. pullus, List., 971, 26; — B. gibbosulum, List., 972, 27, et 973, 28; — Bucc. tessulatum, List, 975, 30; — B. fossile, Martini, III, XCIV, 912, 914; — Bucc. marginatum, id., CXX, 1101, 1102; — Bucc. reticulatum, List, 966, 21; — Bucc. vulgatum, Martini, IV, CXXIV, 162–66; — Bucc. stolatum, ib., 1167–69; — Bucc. glans, List., 981, 40; — Bucc. papillosum, List., 969, 23; — Bucc. nitidulum, Mart., IV, CXXV, 1194, 1195.
(3) Buccinum glabratum, List., 974, 29; — B. spiratum, List., 981, 41; — Bucc. zeylanicum, Martini, IV, CXXII, 1119.
[page] 99
L'animal de plusieurs de leurs espèces est pareil à celui des olives, et a même le pied encore plus développé (1).
Le même naturaliste nomme
TONNES. (DOLIUM. Lam.)
Celles où des côtes saillantes qui suivent la direction des tours rendent le bord ondulé; le tour inférieur y est ample et ventru. Montfort divise encore les tonnes,
En TONNES propres, où le bas de la columelle est comme tordu (2).
Et en PERDRIX, où il est tranchant (3).
Leur animal a un très grand pied élargi en avant; une trompe plus longue que sa coquille; des tentacules grêles, portant les yeux au côté externe près de leur base; sa tête n'a point de voile, et son pied ne porte point d'opercule.
LES HARPES. (HARPA. Lam.)
Se reconnaissent à des côtes saillantes transversales sur les tours, et dont la dernière forme un bourrelet au bord.
Ce sont de belles coquilles dont l'animal a un très grand pied pointu en arrière, large à sa partie antérieure, qui est distinguée par deux échancrures profondes. Ses tentacules portent les yeux aux côtés vers leur base. Il n'a point de voile ni d'opercule (4).
LES POURPRES. (PURPURA. Brug.)
Se reconnaissent à une columelle aplatie, tranchante vers
(1) Anc. cinamomea, Lam., Mart., II, pl. 65, f. 731; — Voluta ampla, Gm., Mart., ib., f. 722, et les espèces décrites par M. de Lamarck, et représentées Encycl. méth., pl. 393. Voyez aussi la Monographie des Ancillaires de M. W. Swainson, Journ. of Sc. and Arts, n° 36, p. 272.
(2) Bucc. olearium, List., 985, 44, et Sow., Gen. of Shells, n° 29; — Bucc. galea, List., 898, 18; — Bucc. dolium, List., 899, 19;—Bucc. fasciatum, Brug., Martini, III, CXVIII, 1081; — Bucc. pomum, id., II, XXXVI, 370, 371.
(3) Bucc. perdix, List., 984, 43.
(4) Buccinum harpa, L., et les autres espèces long-temps confondues avec celle-là. List., 992, 993, 994; Martini III, CXIX; Bucc. costatum, ib. MM. Reynaud, et Quoy et Gaymard ont observé que dans certaines circonstances la partie postérieure du pied se détache spontanément.
7*
[page] 100
le bout opposé à la spire, et y formant, avec le bord externe, un canal creusé dans la coquille, mais non saillant. Ils étaient épars parmi les buccins et les murex de Lin. Leur animal ressemble à celui des buccins proprement dits (1).
Des coquilles semblables aux pourpres, mais où l'on voit une épine saillante au bord externe de l'échancrure, forment le genre LICORNE, Montf. (MONOCEROS, Lam.) (2).
D'autres coquilles semblables aux pourpres, où la columelle ou au moins le bord sont garnis, dans l'adulte, de dents qui rétrécissent l'ouverture, forment les SISTRES, Montf. (RICINULES, Lam.) (3).
LES CONCHOLEPAS. Lam.
Ont les caractères généraux des pourpres, mais leur ouverture est si énorme et leur spire si peu considérable, que leur coquille a presque l'air d'un cabochon, ou de l'une des valves d'une arche. Leur échancrure a une petite dent saillante de chaque côté. Leur animal ressemble à celui des buccins proprement dits, si ce n'est que son pied est énorme en largeur et en épaisseur, et qu'il s'attache à la coquille par un muscle en fer à cheval, comme dans les cabochons; il a un opercule corné, mince et étroit.
On n'en connaît qu'une espèce des côtes du Pérou. (Buccinum concholepas, Brug.), Argenv., pl. II, f. F, D, et Sowerb., Gen. of Shells, 6e livr.
LES CASQUES. (CASSIS. Brug.)
Ont la coquille ovale, l'ouverture oblongue ou étroite, la columelle recouverte d'une plaque comme les nasses, et
(1) Buccinum persicum, List., 987, 46–47; — B. patulum, id., 989, 49; — Bucc. hæmastoma, id., 988, 48; — B. trochlea, B. lapillus, id., 965, 18, 19; — Murex fucus, id., 990, 50; — Mur. histrix, Martini, III, CI, 974, 975; — Mur. mancinella, List., 956, 7, 8, 957, 9–10; — Mur. hippocastanum, List., 955, 996, 990, 991.
(2) Buccinum monodon, Gm., Martini, III, LXIX, 761; — Bucc. narval, Brug.; — Bucc. unicorne, id.
(3) Murex ricinus, L., Séb., III, LX, 37, 39, 42; — Mur. neritoïdeus, Gm., n° 43, List., 804, 12–13.
[page] 101
cette plaque ridée transversalement ainsi que le bord externe; leur échancrure finit en un canal court, replié et comme retroussé en arrière et vers la gauche. Il y a souvent des varices. Leur animal ressemble à celui des buccins proprement dits; mais son opercule corné est dentelé pour passer entre les rides du bord externe.
Les uns ont le bourrelet du bord dentelé extérieurement vers l'échancrure (1).
Les autres ont ce bourrelet sans dentelures (2).
LES HEAUMES. (MORIO. Montf. CASSIDAIRES. Lam.)
Séparés des casques par Montfort, ont le canal moins brusquement courbé, et conduisent tout-à-fait à certains murex. L'animal ressemble à celui des buccins, mais son pied se développe davantage (3).
LES VIS. (TEREBRA. Brug.)
Ont l'ouverture, l'échancrure et la columelle des buccins proprement dits; mais leur forme générale est turriculée, c'est-à-dire que leur spire est très alongée en pointe (4).
LES CERITHES. Adans. (CERITHIUM. Brug.)
Démembrés avec raison des MUREX de Linnæus, ont une coquille à spire turriculée, c'est-à-dire très élevée
(1) Buccinum vibex, Martini, II, XXXV, 364, 365; — Bucc. glaucum, List., 996, 60; — Bucc. erinaceus, List., 1015, 73.
(2) Les Buccinum de la deuxième div. de Gmel., exceptés les B. echinophorum, strigosum, n° 26, et tyrrhenum, qui sont des cassidaires. Il faut aussi remarquer que parmi les vrais casques, Gmelin paraît avoir fait plusieurs doubles emplois.
(3) Buccinum caudatum, L., List., 940, 36; — Bucc. echinophorum, List., 1003, 68; — Bucc. strigosum, Gm., n° 26, List., 1011, 71, f., Bucc. tyrrhenum, Bonam, III, 160.
(4) Toute la dernière subdivision des Buccinum de Gmelin, tels que Buccinum maculatum, L., List., 846, 74; — Bucc. crenulatum, L., List., 846, 75;—Bucc. dimidiatum, L., List., 843, 71; — Bucc. subulatum, L., List., 842, 70, etc.
M. de Blainville en sépare le genre ALÈNE (Subula), qu'il fonde sur une différence dans l'animal, et, de plus, sur la présence d'un opercule.
[page] 102
en pointe, l'ouverture ovale et un canal court, mais bien prononcé et recourbé à gauche ou en arrière. Leurs animaux portent un voile sur la tête, deux tentacules écartés ayant les yeux sur le côté, et un opercule rond et corné.
On en trouve beaucoup parmi les fossiles (1).
M. Brongniart a distingué des cérithes,
LES POTAMIDES.
Qui, avec la même forme de coquille, ont un canal très court, à peine échancré, point de gouttière au haut du bord droit, et la lèvre extérieure dilatée. Elles vivent dans les rivières ou au moins à leur embouchure, et l'on en trouve quelques-unes fossiles dans des terrains où il n'y a d'ailleurs que des espèces de terre ou d'eau douce (2).
LES ROCHERS. (MUREX. L.) (3)
Comprennent toutes les coquilles à canal saillant et
(1) Murex vertagus, List., 1020, 83; — M. aluco, List., 1025, 87; — Mur. annularis, Martini, IV, CLVII, 1486; — Mur. cingulatus, ib., 1492; — Mur. terebella, id., CLV, 1458, 9; — Mur. fuscatus, Gualt., 56, H.; — Mur. granulatus, Martini, IV, CLVII, 1483; — Mur. moluccanus, ib., 1484, S., etc., et cette quantité d'espèces fossiles décrites par M. de Lamarck, Ann. Mus. M. Deshayes a séparé des cérithes, sous le nom de TRIPHORE, quelques petites espèces dont le bord se prolonge dans l'ouverture, et la partage en trois orifices distincts.
C'est aussi auprès des cérithes qu'il faut placer plusieurs coquilles fossiles, dont M. Defrance a fait son genre NERINÉE, et qni s'en distinguent par des plis très prononcés sur chaque tour et à la columelle, dont le centre est en outre creux dans toute sa longueur. On en connaît déjà neuf espèces.
(2) Voyez Brong., Ann. Mus., XV, 367. On doit mettre dans ce sous-genre, Cerithium atrum, Brug., List., pl. 115, f. 10; — Cer. palustre, ib., 836, f. 62; — C. muricatum, ib., 121, f. 17, etc., et parmi les fossiles, la Potamide Lamarck., Brongn., loc. cit., pl. XXII, f. 3.
(3) M de Blainville fait de ce grand genre sa famille des SIPHONOSTOMES.
[page] 103
droit (1). J'ai trouvé aux animaux de tous les sous-genres une trompe, des tentacules rapprochés, longs, portant les yeux sur le côté externe; un opercule corné et point de voile à la tête: ils ressemblent d'ailleurs à ceux des buccins, sauf la longueur du siphon. Bruguières les divise en deux genres, subdivisés ensuite par MM. Lamarck et Montfort.
LES MUREX. Brug.
Sont toutes les coquilles à canal saillant et droit, et à varices en travers des tours (2).
M. Lamarck réserve en particulier ce nom à celles où les varices ne sont pas contiguës sur deux rangs opposés.
Si leur canal est long et grêle, et leurs varices armées d'épines, ce sont les MUREX proprement dits, Montf. (3).
Quand avec ce long canal ils ne portent que des varices noueuses, ce sont les BRONTES du même (4).
Quelques-uns à canal médiocre ont entre des varices épineuses, des tubes saillants qui pénètrent dans la coquille. Ce sont les TYPHIS, Montf. (5).
Lorsque, au lieu d'épines, les varices sont garnies de feuilles plissées, déchiquetées ou divisées en branches, ce sont les CHICORACÉS, Montf. (6). Leur canal est long ou médiocre, et leurs productions foliacées varient à l'infini en figure et en complication.
(1) Encore Linnæus y joignait-il plusieurs pourpres dont le canal n'est pas saillant, et toutes les cérithes où il est recourbé.
(2) Les varices sont des bourrelets saillants, dont l'animal borde sa bouche chaque fois qu'il interrompt l'accroissement de sa coquille.
(3) Murex tribulus, Lister., 902, 22; — Mur. brandaris, List., 900, 20; — Mur. cornutus, List., 901, 21; — Mur. Senegalensis, Gm., et le costatus du n° 86, Adans., Sénég., VIII, 19.
(4) Mur. haustellum, List., 903, 23; — Mur. caudatus, Martini, Conch., III, f. 1046, 1049; — Mur. pyrum.
(5) Mur. tubifer, Roissy, Brug., Journ. d'hist. nat, I, XI, 3. Montfort, 614.
(6) Mur. ramosus, List., 946, 41, et toutes ses variétés; Martini, III, CV, CX, CXI; — Mur. scorpio, Martini, CVI; — Mur. saxatilis, Martini, CVII, CVIII; et plusieurs autres non encore assez bien caractérisées.
[page] 104
Quand avec un canal médiocre ou court, les varices sont seulement noueuses, et que la base a un ombilic, ce sont les AQUILLES, Montf. Nous en avons plusieurs sur nos côtes (1).
S'il n'y a pas d'ombilic, ce sont ses LOTORIUMS (2).
Enfin quand le canal est court, la spire élevée et les varices simples, ce sont les TRITONIUM. Leur bouche est généralement ridée en travers sur ses deux bords. Nous en avons de fort grands dans nos mers (3).
Il y a quelquefois des varices nombreuses, comprimées, presque membraneuses. Ce sont les TROPHONES. Montf. (4).
D'autrefois elles sont très comprimées, très saillantes, et en petit nombre (5).
M. de Lamarck sépare de tous les murex de Bruguières,
LES RANELLES. (RANELLA. Lam.)
Dont le caractère est d'avoir les varices opposées, en sorte que la coquille en est comme bordée de deux côtés. Leur canal est court, et leur surface n'est hérissée que de tubercules. Les bords de leur ouverture sont ridés (6).
Les APOLLES, Montf., ne sont que des ranelles ombiliquées (7).
(1) Murex cutaceus, L., Séb., III, XLIX, 63, 64; — Mur. trunculus, Martini, III, CIX, 1018, 20; — Mur. miliaris, id., III, Vign., 36, 15; — Mur. pomum, Adans., IX, 22; Murex decussatus, ib., 21.
(2) Mur. lotorium, L., Martini, IV, CXXX, 1246–9; — Mur. femorale, id., CXI, 1039; — Mur. triqueter, Born., XI, 1, 2.
(3) Mur. tritonis, L, List., 959, 12; — Mur. maculosus, Martini, IV, CXXXII, 1257, 1258; — Mur. australis, Lam., Martini, IV, CXXXVI, 1284; — Mur. pileare, Martini, IV, CXXX, 1243, 48, 49; — Mur. argus, Martini, IV, CXXXI, 1255, 1256; — Mur. rubecula, id., CXXXII, 1259, 1267.
(4) Murex magellanicus, Martini, IV, CXXXIX, 1297.
(5) Mur. tripterus, Born., X, 18, 19; — Mur. obeliscus, Martini, III, CXI, 1033, 1037.
(6) N. B. Ce sont les Mur. bufo, Montf., 574; — Mur. rana, List., 995, 28; — Mur. reticularis, List., 935, 30; — Mur. affinis, et les espèces ou variétés de Martini, 1229, 30, 31, 32, 33, 34; 1269, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.
(7) Murex gyrinus, List., 939, 34.
[page] 105
LES FUSEAUX. (FUSUS. Brug.)
Sont toutes les coquilles à canal saillant et droit, qui n'ont point de varices.
Quand la spire est saillante, la columelle sans plis, et le bord entier, ce sont les FUSEAUX proprement dits, Lam., que Montfort divise encore: lorsqu'ils manquent d'ombilic, il leur réserve le nom de FUSEAUX (1). Les moins alongés et les plus ventrus se rapprochent par degrés de la forme des buccins (2). Lorsqu'ils ont un ombilic, Montfort les appelle LATHIRES (3).
Les STRUTHIOLAIRES se distinguent des fuseaux propres par un rebord qui entoure leur orifice, comme en se retroussant, et qui couvre la columelle. Leur bord est renflé dans l'adulte, par où elles tiennent aux murex (4).
Quand la spire est saillante, la columelle sans plis, et qu'il y a dans le bord vers la spire une petite entaille ou échancrure bien marquée, ce sont les PLEUROTOMES, Lam. (5).
On en sépare encore, mais par trop légèrement, les CLAVATULES, où l'échancrure est large et touche à la spire.
Quand la spire est peu marquée, aplatie ou arrondie, et
(1) Mur. cochlidium, Séb., III, LII, 6; — Mur. morio, List., 928, 22; — Mur. canaliculatus, Martini, III, LXVII, 742–43; — Mur. candidus, Martini, IV, CXLIV, 1339; — Mur. ansatus, id., ib., 1340; — Mur. lœvigatus, Martini, CXLI, 1319, 1320; — Mur. longissimus, ib., 1344; — Mur. undatus, ib., 1343; — Mur. colus, L., List., 917, 10; — Mur. striatulus, ib., 1351–52; — Mur. pusio, List., 914, 7; — Mur. verrucosus, ib., 1349–50, etc., et les nombreuses espèces fossiles décrites par M. de Lamark.
(2) Mur. islandicus, Martini, IV, CXLI, 1312, 1313, etc.; — Mur. antiquus, ib., CXXXVIII, 1294, et List., 962. 15; — Mur., despectus, Mart., 1295.
(3) Mur. vespertilio, id., CXLII, 1323, 24.
(4) Mur. stramineus, Gm., Enc. méth., 431, 1, a, b; — Str. crenulata, Lam.
(5) Murex babilonius, L., List., 917, 11; — Mur. javanus, Mart., IV, 138, et le grand nombre d'espèces fossiles décrites par M. de Lamarck et d'autres conchyliologistes.
[page] 106
la columelle sans plis, ce sont les PYRULES de Lam. Il y en a d'ombiliquées (1) et de non ombiliquées (2).
Montfort sépare encore de ces pyrules les espèces à spire aplatie, et qui ont des stries en dedans, vers la lèvre, et les nomme CARREAUX (FULGUR) (3). Ce sont en quelque sorte des pyrules à columelle plissée, et leurs plis sont même quelquefois à peine sensibles.
Parmi ces démembrements des fuseaux de Bruguières, les FASCIOLAIRES, Lam., se distinguent par quelques plis obliques et marquées à la columelle, vers la naissance du syphon (4).
LES TURBINELLES. (TURBINELLA. Lam.)
Sont encore des coquilles à canal droit, sans varices, reconnaissables à de gros plis transverses à leur columelle, qui se portent sur toute la longueur de l'orifice, et qui les rapprochent beaucoup des volutes coniques; elles n'en diffèrent proprement que par l'alongement de leur ouverture en une espèce de canal (5), et la limite entre les unes et les autres n'est pas aisée à tracer.
(1) Murex rapa, Martini, III, LXVIII, 750, 753; — Buccinum bezoar, Gm., Martini, III, LXVIII, 754, 755.
(2) Bulla ficus, L., List., 750, 46; — Murex ficus, ib., 741.
(3) Murex perversus, L., List., 907, 27; — Mur. aruanus, List., 908, 28; — Mur. canaliculatus, Martini, III, LXVI, 738–740, et LXVII, 742, 3; — Mur. spirillus, Martini, III, CXV, 1069; — Pyrula canaliculata, Lam. Montf, 502, qui me paraît le même que Mur. carica, Martini, III, LXVII, 744.
(4) Murex tulipa, L., List., 910, 911; — Mur. trapezium, List., 931, 26; — Mur. polygonus, List., 922, 15; — Mur. infundibulum, List., 921, 14; — Mur. striatulus, Martini, IV, CXLVI, 1351–52; — Mur. versicolor, ib., 1348; — Mur. pardalis, id., CXLIX, 1384; — Mur. costatus, Knorr., Petrif., C, II, 7; — Mur. lancea, Martini, IV, CXLV, 1347.
(5) Murex scolymus, Martini, IV, CXLII, 1325; — Voluta pyrum, Martini, III, XCV, 916, 917; — Voluta ceramica, List., 829, 51; — Voluta rhinoceros, Chemn., X, 150, f. 1407, 1408. — Vol. turbinellus, List., 811, 20; — Voluta capitellum, List., 810, 19. — Voluta globulus, Chemn., XI, 178 f., 1715, — Vol. turrita Gm.
[page] 107
LES STROMBES. (STROMBUS. L.)
Comprennent les coquilles à canal droit ou infléchi vers la droite, dont le bord externe de l'ouverture se dilate avec l'âge, mais en conservant toujours un sinus vers le canal, sous lequel passe la tête quand l'animal s'étend.
La plupart ont ce sinus à quelque distance du canal.
M. de Lamarck subdivise ces espèces-là en deux sous-genres.
LES STROMBES propres. (STROMBUS. Lam.)
Où le bord se dilate en une aile plus ou moins étendue, mais non divisée en doigts. Leur pied est petit à proportion, et leurs tentacules portent les yeux sur un pédicule latéral plus gros que le tentacule même. L'opercule est corné, long et étroit, porté sur une queue mince (1).
LES PTÉROCÈRES. (PTEROCERA. Lam.)
Ont le bord divisé dans l'adulte, en digitations longues et grêles, variant, pour le nombre, selon les espèces. Leur animal est le même que celui des strombes proprement dits (2).
D'autres strombes ont le sinus du bord externe contigu au canal. Ce sont les ROSTELLAIRES (ROSTELLARIA, Lam.). Elles ont généralement un second canal remontant le long de la spire, et formé par le bord externe et par une continuation de la columelle.
Dans quelques-unes, le bord est encore digité. Leur animal ressemble à celui des murex, mais ne porte qu'un très petit opercule (3).
(1) Presque tous les strombes compris dans la deuxième et la troisième division de Gmel., en observant qu'il y a plusieurs doubles emplois occasionés par les divers degrés de développement du bord externe.
(2) Strombus lambis, Rondel., 79; Martini, III, LXXXVI, 855; — Str. chiragra, List., 870; — Str. millepeda, List., 868, 869; — Str. scorpius, List., 867.
(3) Strombus pes pelecani, L., List., 865, 866.
[page] 108
D'autres n'ont au bord que des dentelures. Leur canal est long et droit (1).
D'autres encore ont ce bord entier. Ce sont les HIPPOCRÈNES (HIPPOCRENES, Montf.) (2).
SEPTIÈME ORDRE DES GASTÉROPODES,
LES TUBULIBRANCHES.
Doivent être détachés des pectinibranches, avec lesquels ils ont cependant de grands rapports, parce que leur coquille en forme de tube plus ou moins irrégulier et dont le commencement seul est en spirale, se fixe sur divers corps; aussi n'ont-ils point d'organes de copulation et se fécondent-ils eux-mêmes.
LES VERMETS (VERMETUS. Adanson.)
Ont une coquille tubuleuse, dont les tours, dans le premier âge, forment encore une espèce de spire, mais se prolongent ensuite en un tube plus ou moins irrégulièrement contourné, ou ployé comme ceux des tubes des serpules. Cette coquille se fixe d'ordinaire par l'entrelacement d'autres de la même espèce, ou parce qu'elle est enveloppée en partie par des lithophytes: l'animal ne marchant point, n'a pas de pied proprement dit; mais ce qui, dans les gastéropodes ordinaires, forme la queue, se reploie en-dessous et se porte jusques en avant de la tête, ou son extrémité se renfle en une masse
(1) Strombus fusus, L., List., 854, 11, 12, 916, 9.
(2) Strombus amplus, Brander, Foss., Hant., VI. 76, ou rostellaria macroptera, Lam. — Str. fissurella, Lam., Encycl. méth., p. 411, 3, a, b, qui n'est pas celui de Martini, IV, CLVIII, 1498–99, etc.
[page] 109
garnie d'un opercule mince; quand l'animal se retire, c'est cette masse qui ferme l'entrée de son tube; elle a quelquefois divers appendices, et son opercule est épineux dans certaines espèces. La tête du mollusque est obtuse, et porte deux tentacules médiocres, qui ont les yeux aux côtés de leur base externe. La bouche est un orifice vertical; sous elle se voit, de chaque côté, un filament qui a toute l'apparence d'un tentacule, mais qui en réalité appartient au pied. Leurs branchies ne forment qu'une rangée le long du côté gauche de la voûte branchiale. Le côté droit est occupé par le rectum et par le canal spermatique qui transmet aussi les œufs. Il n'y a point de verge, et l'animal se féconde lui-même.
Les espèces de vermets sont assez nombreuses, mais peu distinctes. Linnæus les laissait avec les serpules (1).
Les VERMILIES que M. Delamark laisse encore auprès des serpules, ne diffèrent point des vermets (2).
LES MAGILES. (MAGILUS. Monfort.) Vulgairement Campulotes.
Ont un tube carêné sur sa longueur, qui d'abord assez régulièrement en spirale, se continue ensuite en ligne plus ou moins droite; bien que l'on n'en connaisse point l'animal, il est probable que c'est près des vermets qu'il devra se placer (3).
LES SILIQUAIRES. (SILIQUARIA. Brug.)
Ressemblent aux vermets par la tête, par la position
(1) Serpula lumbricalis, Linn., Adans., Seneg., XI, 1, et plusieurs espèces nouvelles.
(2) Serpula Triquetra, GM., Born., Mus., pl. XVIII, t. 14.
(3) Magilus antiquus, Montf., II, pl. 43, et Guettard, Mém., III, pl. LXXI, f. 6.
[page] 110
de l'opercule, par la coquille tubuleuse et irrégulière; mais cette coquille a sur toute sa longueur, une fente qui en suit les contours, et qui correspond à une fente semblable de la partie du manteau qui recouvre la cavité branchiale. D'un côté de cette fente adhère tout du long un peigne branchial composé d'une grande quantité de feuillets déliés et comme tubuleux. Linnæus les laissait aussi avec les serpules, et l'on a cru jusqu'à ce dernier temps qu'elles appartenaient à la classe des annélides (1).
HUITIÈME ORDRE DES GASTÉROPODES,
LES SCUTIBRANCHES (2).
Comprennent un certain nombre de gastéropodes assez semblables aux pectinibranches pour la forme et la position des branchies, ainsi que pour la forme générale du corps, mais où les sexes sont réunis, de manière toutefois qu'ils se fécondent eux-mêmes. Leurs coquilles sont très ouvertes, sans opercule, et le plus grand nombre ne sont même aucunement turbinées, ensorte qu'elles couvrent ces animaux, et surtout leurs branchies, comme ferait un bouclier. Le cœur est traversé par le rectum, et reçoit le sang par les deux oreillettes, comme dans le plus grand nombre des bivalves.
(1) Serpula anguina, Lin.:—Serpula muricata, Born., Mus., XVIII, 16.
N. B. M. Delamarck supposait encore les siliquaires et les vermilies voisines des serpules. M. de Blainville les a rapprochées des vermets, et M. Audouin vient d'en observer et d'en décrire l'animal; c'est à lui que nous devons ce que nous en disons.
(2) M. de Blainville réunit cet ordre et le suivant (les oscabrions exceptés), dans sa sous-classe des PARACÉPHALOPHORES HERMAPHRODITES.
[page] 111
LES ORMIERS. (HALYOTIS. L.) (1)
Sont le seul genre de cet ordre qui ait sa coquille turbinée, et parmi ces sortes de coquilles la leur se reconnaît à l'excessive ampleur de son ouverture, à son aplatissement et à la petitesse de sa spire, qu'on voit par le dedans. Cette forme l'a fait comparer à l'oreille d'un quadrupède.
LES HALIOTIDES propres. (HALYOTIS. Lam.)
Ont en outre une série de trous perçant la coquille le long du côté de la columelle; lorsque le dernier trou n'est pas encore terminé, il donne à la coquille l'air d'être échancrée. L'animal est un des gastéropodes les plus ornés. Tout autour de son pied, et jusque sur sa bouche, règne, du moins dans les espèces les plus communes, une double membrane découpée en feuillages, et garnie d'une double rangée de filets; en dehors de ses longs tentacules, sont deux pédicules cylindriques pour porter les yeux. Le manteau est profondément fendu au côté droit, et l'eau qui passe par les trous de la coquille, peut, au travers de cette fente, pénétrer dans la cavité branchiale; le long de ses bords, sont encore trois ou quatre filets, que l'animal peut aussi faire sortir par ces trous. La bouche est une trompe courte (2).
LES PADOLLES. Montf., ont la coquille presque circulaire, presque tous les trous oblitérés, et un sillon profond qui suit le milieu des tours, et se marque en dehors par une arête saillante, le Padole briqueté, Montf., II, p. 114.
LES STOMATES. (STOMATIA. Lam.)
Ont la coquille plus creuse, à spire plus saillante, et
(1) Les PARACÉPHALOPHORES HERMAPHRODITES OTIDÉES, Blainv.
(2) Toutes les halyotis de Gmel., exceptés imperforata et perversa.
Ce genre a certainement, quoiqu'on l'ait contesté, son analogue parmi les fossiles. M. Marcel de Serres en a décrit une espèce trouvée dans le calcaire de Montpellier (Hal. Philberti), Ann. des Sc. nat., t. XII, p. XLV, f. A.
[page] 112
manquant de trous; mais ressemblant du reste à celle des haliotides, qu'ils lient ainsi avec celle de certains turbo. Eeur animal est beaucoup moins orné que celui des Halyotides (1).
Les genres suivants, démembrés des patelles, ont la coquille tout-à-fait symétrique, ainsi que la position du cœur et des branchies (2).
LES FISSURELLES. (FISSURELLA. L.)
Ont un large disque charnu sous le ventre, comme les patelles, une coquille conique placée sur le milieu du dos, mais ne le recouvrant pas toujours en entier, percée à son sommet d'une petite ouverture, qui sert à la fois de passage aux excréments et à l'eau nécessaire à la respiration: cette ouverture pénètre dans la cavité des branchies située sur le devant du dos, et dans le fond de laquelle donne l'anus; cavité qui est d'ailleurs largement ouverte au-dessus de la tête. Il y a de chaque côté, et symétriquement, un peigne branchial; les tentacules coniques portent les yeux à leur base extérieure; les côtés du pied sont garnis d'une rangée de filets (3).
LES EMARGINULES. (EMARGINULA. Lam.)
Ont exactement la même structure que les fissurelles, si ce n'est qu'au lieu d'un trou à leur sommet, leur manteau et leur coquille ont une petite fente ou échancrure à
(1) Halyotis imperforata, Gm.; Chemn., X, CLXVI, 1600–1601.
(2) Ce sont les PARACÉPHALOPHORES CERVICOBRANCHES BRANCHIFÈRES, Blainv.
(3) Toutes les patelles de la cinquième division de Gmel. excepté pat. fissura; entre autres pat. grœca, List., 527, 1–2; — P. nimbosa, List., 528, 4. Nous en avons une espèce où la coquille, six fois moins large que le manteau, entoure simplement le trou du sommet comme un anneau (Fissurella annulata, Nob.).
[page] 113
leur bord antérieur, qui pénètre de même dans la cavité branchiale; les bords du manteau enveloppent et couvrent en grande partie ceux de la coquillé; les tentacules coniques portent les yeux sur un tubercule de leur base extérieure. Les bords du pied sont garnis d'une rangée de filets (1).
LES PAVOIS. (PARMOPHORUS. Lam.)
Ont, comme les émarginules, leur coquille recouverte en grande partie par les bords retroussés du manteau; cette coquille est oblongue, légèrement conique et sans trou ni échancrure; leurs branchies et leurs autres organes sont les mêmes que dans les deux genres précédents (2).
HUITIÈME ORDRE DES GASTÉROPODES,
LES CYCLOBRANCHES (3)
Ont leurs branchies en forme de petits feuillets ou de petites pyramides attachés en cordon plus ou moins complet sous les rebords du manteau, à peu
(1) Patella fissura, L., List., 543, 28, etc. Le PALMAIRE, Montf., 7, doit peu s'éloigner de ce genre.
(2) Patella ambigua, Chemn., II, CXCII, 1918.
N. B. On trouve aussi parmi les fossiles des fissurelles, des émarginules et des parmophores.
(3) M. de Blainville, qui nomme Cyclobranches l'ordre où il place les doris, fait des trois genres précédents et des patelles, un ordre qu'il nomme Cervicobranches, et qu'il divise en rétifères et branchifères; les rétifères sont les patelles, parce qu'il suppose qu'elles respirent au moyen d'un réseau de la cavité qui est au-dessus de leur tête. Il m'a été impossible de le découvrir ni d'y voir d'autre organe de la respiration que le cordon de feuillets qui règne tout autour sous le rebord du manteau. Voyez l'anat. de la patelle, dans mes Mémoires sur les mollusques.
TOME III. 8
[page] 114
près comme dans les inférobranches, dont ils se distinguent par la nature de leur hermaphroditisme; car, ainsi que les précédents, ils n'ont point d'organes d'accouplements et se suffisent à eux-mêmes. Leur cœur n'embrasse pas le rectum, mais il varie en situation. On n'en connaît que deux genres, dont la coquille n'a jamais rien de turbiné.
LES PATELLES. (PATELLA. L.)
Ont le corps entier recouvert d'une coquille d'une seule pièce en cône évasé; sous les bords de leur manteau règne un cordon de petits feuillets branchiaux; l'anus et l'issue des organes de la génération sont un peu à droite au-dessus de la tête, laquelle a une trompe grosse et courte, et deux tentacules pointus, portant les yeux à leur base extérieure; la bouche est charnue, et contient une langue épineuse, qui se porte en arrière et se replie profondément dans l'intérieur du corps. L'estomac est membraneux et l'intestin long, mince et fort replié; le cœur est en avant au-dessus du col, un peu vers la gauche (1).
Nous en avons quelques espèces en abondance sur nos côtes.
LES OSCABRIONS (CHITON. L.)
Ont une rangée d'écailles testacées et symétriques enchâssées le long du dos de leur manteau, mais n'en
(1) Je sépare des patelles et range parmi les trochoïdes, tous les animaux compris dans les genres crépidule, navicelle, calyptrée de M. de Lamarck, auxquels j'ajoute les cabochons, et je mets dans les scutibranches ses genres fissurelle, émarginule et parmophores ou pavois patella ambigua, Chemn, XI, 197, 1918; enfin l'OMBRELLE; Scutus Montf., (patella umbella, Martini, II, VI, 18), est un tectibranche. Quant à la patella anomala de Müll., elle appartient aux brachiopodes; c'est mon genre ORBICULE. Les autres espèces citées par Gmel., restent dans le genre patelle.
[page] 115
occupant pas toute la largeur. Les bords du manteau même sont très coriaces, garnis ou d'une peau nue ou de petites écailles qui lui donnent l'aspect du chagrin, ou d'épines, ou de poils, ou de faisceaux de soie. Sous ce bord règne de chaque côté une rangée de branchies en pyramides lamelleuses, et en avant un voile membraneux sur la bouche tient lieu de tentacules. L'anus est sous l'extrémité postérieure. Le cœur est situé en arrière sur le rectum. L'estomac est membraneux et l'intestin très long et très contourné. L'ovaire occupe le dessus des autres viscères et paraît s'ouvrir sur les côtés par deux oviductus.
Nous en avons quelques petits sur nos côtes, et il y en a beaucoup et de grands dans les mers des pays chauds (1).
LA QUATRIÈME CLASSE DES MOLLUSQUES.
LES ACÉPHALES,
N'ont point de tête apparente, mais seulement une bouche cachée dans le fond ou entre les replis du manteau. Celui-ci est presque toujours ployé en deux, et renferme le corps, comme un livre est renfermé dans sa couverture; mais souvent aussi les deux lobes se réunissent par devant, et le manteau forme alors un tube; quelquefois encore, entièrement fermé par un bout, il représente un sac. Ce manteau est presque toujours garni d'une coquille calcaire bivalve, quelquefois multivalve, et n'est
(1) Les OSCABRELLES de Lamarck et toutes les espèces de chiton des auteurs doivent rester sous ce genre dont M. de Blainville a cru devoir faire une classe à part, qu'il nomme POLYPLAXIPHORES, supposant qu'elle conduit aux animaux articulés.
8*
[page] 116
réduit que dans deux genres seulement à une nature cartilagineuse ou même membraneuse. Le cerveau est sur la bouche, et il y a un ou deux autres ganglions. Les branchies sont presque toujours de grands feuillets couverts de réseaux vasculaires sur ou entre lesquels passe l'eau; les genres sans coquille les ont cependant d'une structure plus simple. De ces branchies, le sang va au cœur généralement unique, qui le distribue partout, et il revient à l'artère pulmonaire sans être aidé par un autre ventricule.
La bouche n'a jamais de dents, et ne peut prendre que les molécules que l'eau lui apporte: elle conduit dans un premier estomac; il y en a quelquefois un second; l'intestin varie beaucoup en longueur. La bile arrive généralement par plusieurs pores dans l'estomac que la masse du foie entoure. Tous ces animaux se fécondent eux-mêmes, et dans plusieurs testacés, les petits qui sont innombrables, passent quelque temps dans l'épaisseur des branchies avant d'être mis au monde (1). Tous les acéphales sont aquatiques (2).
(1) Quelques naturalistes pensent que les très petits bivalves qui remplissent dans certaines saisons les branchies externes de l'anodonte et de la moule, n'en sont pas la progéniture, mais une espèce différente et parasite. Voyez à ce sujet la Dissert. de M. Jacobsen. Les observations de sir Éverard Home semblent répondre à cette difficulté.
(2) M. de Lamarck avait d'abord changé mon nom d'Acéphales en celui d'Acéphalés. M. de Blainville fait de mes Acéphales et de mes Brachiopodes, une classe qu'il nomme ACÉPHALOPHORÉS.
[page] 117
LE PREMIER ORDRE DES ACÉPHALES,
LES ACÉPHALES TESTACÉS
OU A QUATRE FEUILLETS BRANCHIAUX (1),
Sont sans comparaison les plus nombreux. Toutes les coquilles bivalves, et quelques genres de multivalves leur appartiennent. Leur corps qui renferme le foie et les viscères est placé entre les deux lames du manteau; en avant, toujours entre ces lames, sont les quatre feuillets branchiaux striés régulièrement en travers par les vaisseaux; la bouche est à une extrémité, l'anus à l'autre, le cœur du côté du dos; le pied, lorsqu'il existe, est attaché entre les quatre branchies. Aux côtés de la bouche sont quatre autres feuillets triangulaires, qui sont les extrémités des deux lèvres, et servent de tentacules. Le pied n'est qu'une masse charnue, dont les mouvements se font par un mécanisme analogue à celui de la langue des mammifères. Il a ses muscles attachés dans le fond des valves de la coquille. D'autres muscles qui forment tantôt une, tantôt deux masses,
(1) M. de Lamarck dans son dernier ouvrage, a fait de mes Acéphales testacés, sa classe des Conchifères; et M. de Blainville son ordre des Acéphalophores lamellibranches; mais c'est toujours la même chose.
[page] 118
se rendent transversalement d'une valve à l'autre pour les tenir fermées; mais quand l'animal relâche ces muscles, un ligament élastique placé en arrière de la charnière, ouvre les valves en se contractant.
Un assez grand nombre de bivalves possède ce qu'on appelle un byssus, c'est-à-dire un faisceau de fils plus ou moins déliés, sortant de la base du pied, et par lesquels l'animal se fixe aux différents corps. Il emploie son pied pour diriger ces fils et pour en coller les extrémités; il reproduit même des fils quand on lui en a coupé; néanmoins la nature de cette production n'est pas encore bien constatée. Réaumur les croyait une sécrétion filée et comme tirée dans le sillon du pied; Poli pense que ce n'est qu'un prolongement de fibres tendineuses.
La coquille se compose essentiellement de deux battants, auxquels s'ajoutent dans certains genres, quelques pièces surnuméraires, et dont la charnière est tantôt simple, tantôt composée d'un plus ou moins grand nombre de dents et de lames qui entrent dans des fossettes correspondantes.
Le plus souvent ces coquilles ont vers la charnière une partie saillante que l'on nomme sommets ou nates.
La plupart ferment entièrement quand l'animal les rapproche; mais il en est plusieurs qui ont toujours une ou plusieurs parties bâillantes, soit en avant, soit aux extrémités.
[page] 119
La première famille des Acéphales testacés, ou
LES OSTRACÉS,
A le manteau ouvert et sans tubes ni ouvertures particulières.
Ces mollusques manquent de pied, ou n'en ont qu'un petit, et sont pour la plupart fixés ou par leur coquille ou par leurs fils aux rochers et aux autres corps plongés sous l'eau. Ceux qui sont libres ne se meuvent guère qu'en choquant l'eau par une lermeture subite de leurs valves.
Leur première subdivision n'a qu'une masse museuleuse allant d'une valve à l'autre, ce qui se voit à l'impression unique laissée sur la coquille.
Or croit devoir y placer des coquilles fossiles don't les valves ne paraissent pas même avoir été attachées par un ligament, mais se recouvrent comme un vase et son couvercle, et tenaient l'une à lautre seulement par les muscles. C'est le genre
ACARDE. Brug. ou OSTRACITE. La Peyrouse.
Dont M. Delamarck fait une famille qu'il nomme RUDISTES. Les coquilles en sont épaisses, et d'un tissu solide ou poreux: on y distingue aujourd'hui
LES RADIOLITES. Lamarck.
Dont les valves sont striées du centre à la circonférence. L'une est plate, l'autre épaisse, à peu près conique et fixée(1).
(1) L'espèce de Brug., 173, f. 1, 23, qui forme le genre Acarde. Lam. ne paraît qu'une double épiphyse de vertèbres de cétacés Les DISCINES Lam ne sont que des ORBICULES; on croit que les CRANIES doiveut aussi s'en rapprocher; les JODAMIES de M. de France, on BIROSTRITES, Lam. ne sont que des moules de Sphérulites ou du moins des corps que l'on trouve toujours dans leur intérieur, bien qu'ils ne s'adaptent pas à leur forme. Voyez l'essai de M. Charles Desmoulins sur les Sphérulites.
[page] 120
LES SPHÉRULITES, Lametherie.
Dont les valves sont hérissées par des feuillets qui se relèvent inégalement,
Et l'on croit pouvoir y ranger
LES CALCEOLES.
Dont une valve est conique, mais libre, et l'autre plane et même un peu concave, en sorte qu'ils rappellent la forme d'un soulier; et même
LES HIPPURITES.
Dont une valve est conique ou cylindrique, et a en dedans deux arêtes longitudinales mousses; sa base paraît même divisée en plusieurs chambres par des cloisons transverses (1); l'autre valve fait comme un couvercle.
LES BATOLITHES Montf. 334.
Sont les hippurites cylindriques et droites; elles s'alongent souvent beaucoup.
Mais il reste beaucoup d'incertitude sur tous ces corp; (2).
Quant aux acéphales testacés que l'on connaît bien à l'état vivant, Linnæus avait réuni sous le genre
DES HUITRES. (OSTREA. L.)
Toutes celles qui n'ont à la charnière qu'un petit I-
(1) Voyez Deshayes, An. des Sc. nat., juin 1825; et Ch. Desmoulins, loc., cit. Plusieurs Hippurites ont été décrites par La Peyrouse, sous le nom impropre d'Orthocératites. Le Cornucopiœ de Will. Tbomson, Journ. de phys., ventôse an X, Pl. II, en est aussi une.
(2) Il y a même tout lieu de croire d'après les observations de M. Deshaies et de M. Audouin, qu'une partie de ces coquilles, avaient deux impressions musculaires.
[page] 121
gament logé de part et d'autre dans une fossette, et sans dents ni lames saillantes.
LES HUITRES proprement dites. (OSTREA. Brug.)
Ont le ligament tel que nous l'avons indiqué, et leurs coquilles sont irrégulières, inéquivalves et feuilletées. Elles se fixent aux rochers, aux pieux, et même les unes sur les autres, par leur valve la plus convexe.
L'animal (PELORIS, Poli) est un des plus simples parmi les bivalves; on ne lui voit de notable qu'une double rangée de franges autour du manteau, lequel n'a ses lobes unis qu'au-dessus de la tête, près de la charnière; mais il n'y a nulle apparence de pied.
Tout le monde connaît l'Huître vulgaire (Ostrea edulis. L.), que l'on va recueillir sur les rochers, et qu'on élève dans des viviers pour en disposer au besoin. Sa fécondité est aussi étonnante que son goût est agréable.
Parmi les espèces voisines on peut remarquer
La petite Huître de la Méditerranée. (Ostrea cristata.) Poli. II. XX.
Parmi les espèces étrangères, on doit noter
L'Huître parasite. (Ostrea parasitica. L.) Chemn. VIII, LXXIV, 681.
Ronde et plate, qui se fixe sur les racines des mangliers et des autres arbres de la Zone-Torride, que les eaux salées peuvent atteindre.
L'Huître feuille. (Ostrea folium. L.) Ib. LXXI, 662–666.
Ovale, à bords plissés en zig-zag, qui s'attache par des dentelures du dos de sa valve convexe, aux branches des gorgones et autres lithophytes (1).
(1) Les espèces d'huître sont difficiles à distinguer à'cause de leur irrégularité; à ce genre se rapportent les Ostr. orbicularis; — Fornicata, — Sinensis; — Forskahlii; — Rostrata; — Virginica; — Cornucopiœ; — Senegalensis; — Stellata; — Ovalis; — Papyracea et les Mytilus crista Galli; — Hyotis; — Frons, de Gmel.; et celles que Bruguières a représentées dans l'Encycl. méthod., Pl. 179–188.
Mais il est presque indubitable que plusieurs de ces prétendues espèces sont des variétés l'une de l'autre.
Ostr. semi aurita, Gualt., 84, II. est une jeune aronde oiseau.
[page] 122
M. de Lamarck sépare sous le nom de
GRYPHÉES (GRYPHÆA. Lam.)
Certaines huîtres, la plupart fossiles, d'anciennes couches calcaires et schisteuses, où le sommet de la valve plus convexe saille beaucoup et se recourbe plus ou moins en crochet ou en portion de spirale. L'autre valve est souvent concave. La plupart de ces coquillages paraissent avoir été libres, quelquefois cependant il y en a qui semblent avoir eu le crochet adhérent (1).
On n'en connaît qu'une espèce vivante (Griph. tricarinata.
LES PEIGNES1, PÉLERINES ou MANTEAUX. (PECTEN. Brug.)
Séparés avec raison des huîtres par Bruguière, quoiqu'ils en aient la charnière, sont aisés à distinguer par leur coquille inéquivalve, demi-circulaire, presque toujours régulièrement marquée de côtes, qui se rendent en rayonnant du sommet de chaque valve vers les bords, et munies de deux productions anguleuses appelées oreillettes, qui élargissent les côtés de la charnière. L'animal (ARGUS, Poli) n'a qu'un petit pied ovale (2), porté sur un pédicule cylindrique au-devant d'un abdomen en forme de sac pendant entre les branchies. Dans quelques espèces, reconnaissables à une forte échancrure sous leur oreillette antérieure, il y a un byssus. Les autres n'adhèrent point; elles nagent même avec assez de vitesse, en fermant subitement leurs valves. Le manteau est entouré de deux rangées defilets, dont l'extérieure en a plusieurs terminés par un petit globule verdâtre. La bouche est garnie de beaucoup de tentacules branchus au
(1) Voy. Brug., Encycl. méthod., vers., Pl. 189.
(2) C'est ce que M. Poli nomme mal à propos trachée abdominale
[page] 123
lieu des quatre feuillets labiaux ordinaires. La coquille des peignes est souvent teinte des plus vives couleurs.
La grande espèce de nos côtes (Ostrea maxima, L.), à valves convexes, l'une blanchâtre, l'autre roussâtre, chacune à quatorze côtes, larges et striées sur leur longueur, est connue de tout le monde sous le nom de coquille de Saint-Jacques, de Pélerine, etc.
Elle se mange.
On peut aussi remarquer la Sole de l'Océan Indien (Ostr. solea), Chemn., VII, LXI, 595, à valves extrêmement minces, presque égales, l'une brune, l'autre blanche, à côtes intérieures, fines comme des cheveux, rapprochées deux à deux (1).
LES LIMES. (LIMA. Brug.)
Diffèrent des peignes par une coquille plus alongée dans le sens perpendiculaire à la charnière, dont les oreillettes sont plus courtes, les côtés moins égaux, et qui forme ainsi un ovale oblique. La plupart ont les côtes relevées d'écailles. Les valves ne peuvent se joindre dans l'état de vie, et l'animal a à son manteau une quantité innombrable de filets de différentes longueurs sans tubercules, et plus intérieurement un large rebord qui ferme l'ouverture de la coquille, et forme même un voile en avant. Le pied est petit comme dans les peignes, et le byssus peu considérable. Les limes nagent très vite au moyen de leurs valves.
Il y en a une d'un beau blanc dans la Méditerranée (Ostrea Lima, L.), Chem. VII, LXVIII, 651 (2).
Elle se mange.
(1) Ajoutez les quatre-vingt-onze premières espèces d'ostrea de Gmel.: mais il s'en faut de beaucoup que toutes soient établies sur une bonne critique. Pour les espèces fossiles, consultez Sowerby (Minéral, conchology.), et M. Brongniart, ap. Cuvier, Oss. foss., t. 2, env. de Paris.
(2) Ajoutez Ostrea glacialis, Chemn., VII, LXVIII, 652–653; — Ostr. excavata, ib. 654; — Ostr. fragilis, ib., 650; — Ostr. hians, Gualt., LXXXVIII, FF. G. Consultez pour les espèces fossiles Lamarck, Ann. du Mus., VIII, p. 461; Brocchi, Conch. foss., et Sowerby. min. Conch.
[page] 124
LES HOULETTES. (PEDUM. Brug.)
Ont la coquille oblongue, oblique, et à petites oreillettes, des limes; mais leurs valves sont inégales, et la plus bombée a seule une échancrure profonde pour le byssus. L'animal est assez semblable à celui des limes, mais son manteau ne porte qu'une seule rangée de petits tentacules grêles. Son byssus est plus considérable.
On n'en connaît qu'une, de la mer des Indes (1).
On peut placer ici quelques coquilles fossiles qui ont la charnière, le ligament et le muscle central des huîtres, des pélerines, des limes, mais se distinguent par quelques détails de leurs tests.
LES HINNITES. Defr.
Semblent des huîtres ou des pélerines, à petites oreillettes et à coquilles adhérentes, irrégulières et très épaisses, surtout la valve convexe. Il y a à la charnière une fossette pour le ligament (2).
LES PLAGIOSTOMES. Sowerb.
Ont la coquille oblique des limes, aplatie d'un côté, de très petites oreillettes, les valves plus bombées, striées, sans écailles, l'ouverture du byssus plus pe-
(1) Ostrea spondyloïdea, Gmel., Chemm., VIII, LXXXII, 669, 670.
(2) Tout récemment on a rapporté au genre Hinnite de Defr. quelques espèces vivantes. M. Gray (Ann. of. philos., août 1826), en a décrit une sous le nom d'Hinnita gigantea; Sowerby (Zoolog. journ., n° IX, p. 67), en a ajouté une seconde sous le nom d'H. corallina; enfin, M. Deshaies rapporte à ce genre l'Ostrea sinuosa, L.; et il décrit une quatrième espèce vivante, sous le nom d'Hinnites Defrancii; M. Defrance a admis deux espèces fossiles, H. de Cortesi, Blainv., Malac., pl LXI, f. 1, et H. de Dubuisson.
[page] 125
tite (1). On les trouve dans les terrains antérieurs à la craie.
LES PACHYTES. Defr.
Ont à peu près la forme des pélerines, la coquille régulière, de petites oreillettes; entre leurs sommets est un aplatissement transversal, qui dans une des valves a une forte échancrure triangulaire, au travers de laquelle passait ou se logeait le ligament. Ils se trouvent dans la craie (2).
LES DIANCHORES. Sowerb.
Ont des valves inégales obliques, dont une est adhérente, et a le sommet percé; l'autre est libre, et a des oreillettes (3).
LES PODOPSIDES. Lam.
Ont des valves régulières, striées, sans opercules; l'une des deux a le sommet plus saillant, tronqué et adhérent; souvent ce sommet est fort épais, et forme à leur coquille une espèce de piédestal (4).
(1) Plagiostoma gigas, Sowerb., Encycl. méthod., test., Pl. 238, f. 3, Pl. lævigatum, Parkins., org., rem., III, Pl. XIII, f. 6; et les autres espèces données par M. Sowerby, miner., concl., pl. 113, 114 et 382.
(2) Pachytos Spinosus de Fr., Sowerb., Cuv., ossem. foss., II, env. de Par., Pl. IV, 2, A, B, C, et Blainv., malac., Pl. LV, f. 2: — Pach. hoperi, Sow., 380.
(3) Dianch. striata; — D. lata, Sowerb., min. conch., Pl. 80.
(4) Podops. truncata, Encycl., Pl. 188, f. 2, 6 et 7.; Cuv., ossem. foss.; II, env. de Par., Pl. V, f. 2.
N. B. M. de Blainville regarde ces quatre derniers genres comme plus voisins des Térébratules. M. Deshayes, au contraire, Ann. des sc. nat., déc. 1828, les rapproche des spondyles.
[page] 126
On doit rapprocher des huîtres, quoique multivalves,
LES ANOMIES. (ANOMIA. Brug.)
Qui ont deux valves minces, inégales, irrégulières, dont la plus plate est profondément échancrée à côté du ligament, lequel est à peu près comme dans les huîtres. La plus grande partie du muscle central traverse cette ouverture pour s'insérer à une troisième pièce ou plaque tantôt pierreuse, tantôt cornée, par laquelle l'animal s'attache aux autres corps, et le reste de ce muscle sert à joindre une valve à l'autre. L'animal (ECHION, Poli) a un petit vestige de pied semblable à celui des pélerines, qui se glisse entre l'échancrure et la plaque qui la ferme, et sert peut-être à faire arriver l'eau vers la bouche qui est très voisine (1).
On trouve ces coquilles fixées à différents corps, comme les huîtres. Il y en a dans toutes les mers (2).
Un petit genre voisin de ces anomies est celui des
PLACUNES. (PLACUNA. Brug.)
Qui ont des valves minces, inégales et souvent irrégulières comme les anomies, mais entières l'une et l'autre. Près de la charnière en dedans l'on voit à l'une des deux, deux côtes saillantes formant un chevron.
Leur animal n'est pas connu, mais il doit ressembler à celui des huîtres ou à celui des anomies (3).
(1) Ce pied a échappé à M. Poli.
(2) Anomia ephippium, Gm.; — A. cepa; — A. electrica; — A. squamula; — A. aculeata; — A. squama; — A. Punctata; — A. undulata, et les espèces ajoutées par Bruguières, Encycl. méthod., vers., I, 70 et suivantes; et Pl. 170 et 171.
Les autres Anomies de Gmel., sont des Placunes, des Térébratules et des Hyales.
(3) Anomia placenta, Chemn., VIII, LXXIX, 716; — An. sella, ib., 714. Voy. aussi les planches 173 et 174 de l'Encyclop. méth., vers.
[page] 127
LES SPONDYLES. Vulg. huîtres épineuses. (SPONDYLUS. L.)
Ont comme les huîtres, une coquille raboteuse et feuilletée, souvent même elle est épineuse; mais leur charnière est plus compliquée; outre la fossette pour le ligament, analogue à celle des huîtres, il y a à chaque valve deux dents, entrant dans des fosses de la valve opposée; les deux dents mitoyennes appartiennent à la valve plus convexe, qui est ordinairement la gauche, et qui a en arrière de la charnière un talon saillant et aplati comme s'il avait été scié. L'animal a, comme celui des peignes, les bords de son manteau garnis de deux rangées de tentacules, et dans la rangée extérieure il en est plusieurs de terminés par des tubercules colorés; au-devant de son abdomen, est un vestige de pied en forme de large disque rayonné, à pédicule court, pouvant se contracter ou se développer (1). De son centre pend un filet terminé par une masse ovale dont on ignore l'usage
On mange les spondyles commé des huîtres. Leurs coquilles sont très souvent teintes de couleurs vives. Elles adhèrent à toute sorte de corps (2).
M. Lamarck sépare des spondyles,
LES PLICATULES. Lam.
Qui ont à peu près la même charnière, mais point de talon, et des valves plates, presque égales, irrégulières, plissées et écailleuses comme dans beaucoup d'huîtres (3).
(1) C'est ce que M. Poli nomme trachée abdominale, dans le Spondyle, la Pèlerine, etc.
(2) Spondylus gæderopus, Chemn., VII, XLIV et suivantes, IX, CXV. — Sp. regius, id., XLVI, 471.
(3) Spondylus plicatus, L., Chemn., VII, XLVII, 479–482. — Plicat. Ægyptia, Savig. Egypt., Coq., Pl. XIV, f. 5.
[page] 128
LES MARTEAUX. (MALLEUS. Lam.)
Ont une simple fossette pour le ligament, comme dans les huîtres, avec lesquelles Linnæus les laissait, d'autant que leur coquille est de même inéquivalve et irrégulière; mais ils se distinguent par une échancrure à côté de ce ligament pour le passage d'un byssus.
L'espèce la plus connue (Ostrea malleus. L. Chemn. VIII, LXX, 655, 656), et qui est au nombre des coquilles rares et chères, a les deux bouts de la charnière étendus, et formant comme une tête de marteau, dont les valves, alongées dans le sens transverse, représentent le manche. Elle vient de l'Archipel des Indes.
Il y en a d'autres qui, peut-être, ne sont que des jeunes, où la charnière n'est point prolongée. Il ne faut pas les confondre avec les vulselles (1).
LES VULSELLES. (VULSELLA. Lam.)
Ont à la charnière de chaque côté une petite lame saillante en dedans, et c'est d'une de ces lames à l'autre que se porte le ligament, semblable d'ailleurs à celui des huîtres. A côté de cette lame est une échancrure pour le byssus comme dans les marteaux.
La coquille s'alonge dans le sens perpendiculaire à la charnière.
L'espèce la plus connue vient de la mer des Indes (2).
LES PERNES. (PERNA. Brug.)
Ont en travers de leur charnière plusieurs fossettes parallèles, opposées d'une valve à l'autre, et logeant
(1) Ostrea vulsella, Chemn., VIII, LXX, 657, dont l'Ostrea anatina, ib., 658–659, n'est probablement qu'une variété accidentelle.
(2) Mya vulsella, Chemn., VI, II, 10–11; — V. spongiarum. Lam., Savig. Égypt. Coq., pl. XIV, fig. 2; — V. Hians, Lam., Sav., ib., f. 3.
[page] 129
autant de ligaments élastiques; et leur coquille irrégulière et feuilletée comme celle des huîtres, a du côté antérieur, au-dessous de la charnière, une échancrure par où passe le byssus. Linnæus les laissait aussi parmi les huîtres (1).
On a récemment distingué des pernes
LES CRÉNATULES. (CRENATULA. Lam.)
Qui, au lieu de fossettes transversales sur une large charnière, en ont de petites ovales tout au bord, où elles occupent peu de largeur. Il ne paraît pas qu'elles aient de byssus. On les trouve souvent logées dans des éponges (2).
On a cru pouvoir rapprocher des pernes quelques coquilles fossiles, qui ont de même à la charnière des fossettes plus ou moins nombreuses, se-répondant et paraissant ainsi avoir donné attache à des ligaments; ainsi
LES GERVILLIES. Defr.
Ont la coquille presque comme les vulselles; mais avec une charnière en quelque sorte double; l'extérieure à fossettes opposées, recevant autant de ligaments, l'intérieure garnie de dents très obliques à chaque valve. Ou en trouve les empreintes avec les amonites dans le calcaire compacte (3).
LES INOCÉRAMES. Sowerb.
Se font remarquer par l'élévation et l'inégalité de leurs valves, dont le sommét se recourbe en crochet vers la charnière, et dont la texture est lamelleuse (4).
(1) Ostrea isognomum, Chemn., VII, LIX, 584; — O. perna, ib., 580; — O. legumen, ib., 578; — O. ephippium, ib., LVIII, 576; — O. mytiloïdes, Herm., nat. de Berl., Schr., II, IX, 9.
(2) Ostrea picta, Gm., Chemn., VII, LVIII, 575, ou Crenatula phasianoptera, Lam., Encycl. méthod., test., pl. 216, f. 2; — Crenatula avicularis, Lam., Ann. mus., III, pl: 11, f. 3, 4; — Cr. mytiloïdes, id., ib., f. 1 et 2. Voyez aussi la grande Descr. de l'Eg., coq., Pl. XII.
(3) Gervilia solenoïdés, Defr., Blainv., Malac., LXI, 4. — G. pernoïdes, Deslonchamp, soc. lin. du Calvados, l. 116. — G. siliqua, id., ib., etc.
(4) Inoceramus concentricus, Parkins, Cuv., Ossem. foss., II, pl. VI, f. 11; — In. Sulcatus, id., ib., f. 12.
TOME III. 9
[page] 130
Les CATILLES. Brongn.
Ont, indépendamment des fossettes pour le ligament, un sillon conique, creusé dans un bourrelet qui se reploie à angle droit, pour former un des bords de la coquille. Leurs valves sont à peu près égales, et de texture fibreuse. Ils paraissent avoir eu un byssus (1).
LES PULVINITES Defr.
Ont une coquille triangulaire régulière, et ses fossettes en petit nombre divergent en dedans du sommet. On les trouve en empreinte dans la craie (2).
La seconde subdivision des ostracés, ainsi que presque toutes les bivalves qui suivront, a, outre la masse musculaire transverse unique des précédentes, un autre faisceau allant d'une valve à l'autre et placé en avant de la bouche.
C'est dans cette subdivision que paraissent devoir être placées
LES ETHÉRIES (ETHERIA. Lam.)
Grandes coquilles, à valves inégales, autant et plus irrégulières que les huîtres, dont la charnière n'a point de dents, et où le ligament en partie extérieur, existe aussi intérieurement. Elles diffèrent surtout des huîtres, parce qu'elles ont deux impressions musculaires. On ne voit pas que leur animal produise de byssus (3).
On en a récemment découvert dans le haut Nil (4).
(1) Catillus Cuvieri, Brong., Cuv., Oss. foss., II, pl. IV, f. 10.
(2) Pulvinites Adansonii, Defr., Blainv., Malac., LXII, bis. 3.
(3) Etheria elliptica, Lam., An. mus., X, pl. XXIX et XXXI; — Eth. trigonula, ib., pl. XXX; — Eth. semilunaris, ib., pl. XXXII, f. 1, 2; — Eth. transversa, ib., f. 3 et 4.
(4) Etheria Caillaudi, Voyage de Caillaud à Méré, tome II, pl. LXI, f. 2 et 3.
[page] 131
LES ARONDES. (AVICULA. Brug.)
Ont une coquille à valves égales, à charnière rectiligne, souvent alongée en ailes par ses extrémités, munie d'un ligament étroit et alongé, et quelquefois du côté de la bouche de l'animal, de petites dentelures. Le côté antérieur un peu au-dessous de l'angle du côté de la bouche, a une échancrure pour le byssus. Le muscle transverse antérieur est encore excessivement petit.
On nomme PINTADINES, Lam. (MARGARITA, Leach.), les espèces à oreilles moins saillantes.
La plus celèbre est l'Aronde aux perles (Mytilus margaritiferus, L.), Chemn., VIII, LXXX, 717–721. Sa coquille est à peu près demi-circulaire, verdâtre en dehors, et du plus beau nacre en dedans. On emploie ce nacre pour toute sorte de bijoux, et ce sont ses extravasions qui produisent les perles d'Orient, ou perles fines, dont la pêche se fait par des plongeurs, principalement à Ceylan, au cap Comorin, et dans le golphe Persique.
On réserve le nom d'AVICULES pour celles dont les oreillettes sont plus pointues et la coquille plus oblique. Il y a à la charnière, en avant du ligament, un vestige de dent dont au reste on apercevait déjà la trace dans les pintadines.
Nous avons dans la Méditerranée l'Aronde oiseau (Mytilus hirundo, L.), Chemn., VIII, LXXXI, 722–728. Singulière par les oreillettes pointues qui prolongent sa charnière de chaque côté. Son byssus est grossier et robuste; il ressemble à un petit arbre (1).
LES JAMBONNEAUX. (PINNA. L.)
Ont deux valves égales en forme de segment de cercle ou d'éventail à demi-ouvert, lesquelles sont étroitement réunies par un ligament le long d'un de leurs
(1) On en fait aujourd'hui plusieurs espèces. Voyez Lam., An. sans vert., VI, première part., p. 146 et suivantes.
9*
[page] 132
côtés. L'animal (CHIMÆRA, Poli) est alongé comme la coquille; ses lèvres, ses branchies et toutes ses parties suivent cette proportion. Son manteau est fermé le long du côté du ligament; son pied est en forme de petite langue conique et creusée d'un sillon; il a un petit muscle transverse dans l'angle aigu des valves, vers lequel se trouve la bouche, et un très grand dans leur partie élargie. A côté de son anus, qui est derrière ce gros muscle, est attaché un appendice conique particulier à ce genre, susceptible de gonflement et d'alongement, et dont on ignore l'usage (1).
Le byssus de plusieurs espèces de jambonneaux est fin et brillant comme de la soie, et s'emploie pour fabriquer des étoffes précieuses.
Tel est principalement celui du Pinna nobilis, L., Chemn. VIII, LXXXIX, qui se reconnaît de plus à ses valves hérissées d'écailles relevées et demi-tubuleuses. Ces coquilles se tiennent à demi-enfoncées dans le sable et ancrées au moyen de leur byssus (2).
LES ARCHES. (ARCA. L.) (3).
Ont des valves égales, transverses, c'est-à-dire dont la charnière occupe le long côté. Elle est garnie d'un grand nombre de petites dents qui engrènent dans les intervalles les unes des autres, et comme dans les genres qui vont suivre, deux faisceaux de muscles transverses, insérés aux deux bouts des valves, et à peu près égaux, servent à rapprocher les valves.
(1) M. Poli lui donne encore le nom de trachée abdominale, tout aussi improprement qu'aux vestiges de pied des peignes et des spondyles.
(2) Tout le genre pinna peut rester tel qu'il est dans Gmel., en observant toutefois que quelques espèces rentreront peut-être les unes dans les autres. Voyez aussi Lam., An. sans vert., VI, première part., p. 130 et suivantes, et Sowerb., Gen. of. Sh., 26e livr.
(3) M. de Blainville fait du grand genre Arca, sa famille des ARCACÉES ou POLYODONTES.
[page] 133
LES ARCHES proprement dites. (ARCA. Lam.)
Ont la charnière rectiligne, et la coquille plus alongée dans le sens parallèle à la charnière. Leurs sommets sont généralement bombés et recourbés au-dessus de la charnière, mais écartés l'un de l'autre. Le milieu des valves ne ferme pas bien, parce que l'animal (Daphne, Poli) a audevant de l'abdomen une plaque de substance cornée, ou un ruban tendineux, qui lui tient lieu de pied, et par lequel il adhère aux corps sous-marins. Ces coquilles se tiennent près des rivages, dans des endroits rocailleux. Elles sont ordinairement couvertes d'un épiderme velu. On les recherche peu pour la table. Il y en a quelques espèces dans la Méditerranée (1), et un grand nombre d'espèces fossiles dans les terrains antérieurs à la craie, surtout en Italie.
M. Delamarck sépare, sons le nom de CUCULLÉES, quelques arches, où les dents des deux bouts de la charnière prennent une direction longitudinale (2).
On devra probablement aussi en séparer les espèces à côtes bien marquées, à bords complétement fermants et engrenants; car on doit croire que leur animal n'est pas fixé, et ressemble plutôt à celui des pétoncles (3).
Il faut encore plus sûrement en écarter l'Arca tortuosa; Chemn., VIII, LIII, 524, 525, à cause de sa figure bizarre et de ses valves inégalement obliques (4).
LES PÉTONCLES. (PECTUNCULUS. Lam.)
Ont la charnière en ligne courbe, et la coquille de forme
(1) Arca Noæ, Chemn., VII, LIII, 529–531; — Arca barbata, id., LIV, 535–537; — A. ovata, ib., 538; — A. magellanica, ib., 539; — A. reticulata, ib., 540; — A. candida, id., LV, 542–544; — A. indica, ib., 543; — Arca cancellata, Schrœt., intr., III, IX, 2.
(2) Arca cucullata, Chemn., VII, LIII, 526–528; — Cucullæa crassatina, Lam., Ann. mus., VI, 338.
(3) Arca antiquata, L., Chemn., VII, LV, 548–549; — A. senilis, id., LVI, 554–556; — A. granosa, ib., 557; — A. corbiculata, ib., 558–559; — A. rhomboïdea, ib., 553; — A. Jamaïcensis, List., 229, 64.
(4) M. Oken en a fait son genre Trisis.
[page] 134
lenticulaire. Les valves ferment toujours exactement, et ont leurs sommets rapprochés l'un de l'autre. L'animal (Axinea, Poli) a un grand pied comprimé, à bord inférieur double, qui lui sert à ramper. Elles vivent dans la vase. Nous en avons quelques-unes sur nos côtes (1).
LES NUCULES de Lam.
Sont des arches où les dents sont rangées sur une ligne brisée. Leur forme est alongée et rétrécie vers le bout postérieur. On ne connaît pas leur animal, mais il est probable qu'il s'éloigne peu des précédents (2).
Depuis long-temps nous avions placé ici
LES TRIGONIES. Brug.
Si remarquables par leur charnière munie de deux lames en chevron, crénelées à chaque face, pénétrant chacune dans deux fossettes ou plutôt entre quatre lames du côté opposé, crénelées de même sur leurs parois internes. La coquille faisait déjà juger par ses impressions intérieures qu'au moins l'animal n'avait pas de longs tubes.
MM. Quoi et Gaymard viennent de découvrir ce genre à l'état de vie. L'animal a, en effet, comme les arches, un manteau ouvert sans orifice séparé, même pour l'anus. Son pied est grand, tranchant et en forme de crochet à sa partie antérieure.
Les trigonies vivantes ressemblent aux bucardes par la forme de leur coquille et les cotes qui les sillonnent. Leur intérieur est nacré (3).
(1) Arca pilosa, L., Chemn., VII, LVII, 565–566; — Arc. glycimeris, ib., 564; — A. decussata, ib., 561; — A. œquilatera, ib., 562; — A. undata, ib., 560; — A. marmorata, ib., 563; — Arc. pectunculus, id., LVIII, 568–9; — Act. pectinata, ib., 570–571.
(2) Arca pellucida, Chemn., VII, LIV, 541; — Arca rostrata, L., id., LV, 550, 551; — A. pella, ib., 546; — Arc. nucleus, id., LVIII, 574.
(3) Latrigonie nacrée, Lam., An. mus., IV, LXVII, 1.
[page] 135
Les trigonies fossiles sont assez différentes. Leur coquille est aplatie d'un côté, oblique, plus longue dans le sens perpendiculaire à la charnière, et traversée en sens contraire par des séries tubercules (1).
La deuxième famille des Acéphales testacés, ou
LES MYTILACÉS,
A le manteau ouvert par devant, mais avec une ouverture séparée pour les excréments.
Tous ces bivalves ont un pied servant à ramper, ou au moins à tirer, à diriger et à placer le byssus; on les connaît vulgairement sous le nom générique de moules.
LES MOULES PROPRES ou Moules de mer. (MYTILUS. L.)
Ont une coquille close, à valves égales, bombées, en triangle. Un des côtés de l'angle aigu forme la charnière et est muni d'un ligament étroit et alongé. La tête de l'animal est dans l'angle aigu; l'autre côté de la coquille qui est le plus long, est l'antérieur, et laisse passer le byssus; il se termine par un angle arrondi, et le troisième côté remonte vers la charnière, à laquelle il se joint par un angle obtus; près de ce dernier est l'anus, vis-à-vis duquel le manteau forme une ouverture ou un petit tube particulier. L'animal (CALLITRICHE, Poli) a les bords de son manteau garnis de tentacules branchus vers l'angle arrondi, parce que c'est par là qu'entre l'eau nécessaire à la respiration. Il y a un petit muscle transverse en avant près l'angle aigu, et un grand en arrière près l'angle obtus. Son pied ressemble à une langue.
(1) Trig. scabra, Encycl. méthod., Pl. 237, f 1; Tr. nodulosa, ib., 2; — Tr. navis, ib., 3; — Tr. aspera, ib., 4. Voyez aussi Parkins, Org. rem., III, pl. XII.
[page] 136
Dans les moules proprement dites le sommet est tout près de l'angle aigu.
Il y en a de striées et de lisses.
La Moule commune. (Mytilus edulis. L.)
Est répandue en abondance extraordinaire le long de toutes nos côtes, où elle se suspend souvent en longues grappes, aux rochers, aux pieux, aux vaisseaux, etc. Elle forme un article assez important de nourriture, mais elle est dangereuse quand on en prend trop (1).
On en trouve quelques-unes à l'état fossile (2).
M. Delamark a séparé des moules
LES MODIOLES. (MODIOLUS. Lam.)
Où le sommet est plus bas et vers le tiers de la charnière. Ce sommet est aussi plus saillant et plus arrondi, ce qui rapproche davantage les modioles de la forme ordinaire des bivalves (3).
On pourrait en séparer encore
LES LITHODOMES. (LITHODOMUS. Cuv.)
Qui ont la coquille oblongue presque également arrondie aux deux bouts, et les sommets tout près du bout antérieur.
(1) Ajoutez Mytilus barbatus, L., Chemn., VIII, LXXXIV, 749; — M. angulatus, ib., 756; — M. bidens, ib., 742, 745; — M. afer, ib., LXXXIII, 739–741; — M. smaragdinus, ib., 745; — M. versicolor, ib., 748; — M. lineatus, 753; — M. exustus, ib., 754; — M. striatulus, ib., 744; — M. bilocularis, ib., LXXXII, 736; — M. vulgaris, ib., 732; — M. saxatilis, Rumph. Mus., XLVI, D.; — M. fulgidus, Argenv., XXII, D.; probablement le même que Mya perna, Gm., Chemn., VIII, LXXXIII, 738; — M. azureus, ib., H.; — M. murinus, ib., K.; — M. puniceus, Adans., I, XV, 2; — M. niger, ib., 3; — M. lævigatus, ib., 4, etc.; mais il faut remarquer que plusieurs de ces espèces pourraient bien rentrer les unes dans les autres.
(2) M. Brongniart a cru devoir en faire un sous-genre qu'il nomme Mytiloide. (Ap. Cuv., ossem. foss., tome II, pl. III, f. 4.)
(3) Mytilus modiolus, Chemn, VIII, LXXXV, 757–760, et celui de Müll., Zool. dan., II, LIII, qui paraît d'une autre espèce; — M. discors, Chemn., VIII, LXXXXIV, 764–68; — M. testaceus, Knorr., Vergn., IV, V, 4 etc.
[page] 137
Ils se suspendent d'abord aux pierres, comme les moules communes, mais ensuite ils les percent pour s'y introduire et y creusent des cavités, dont ils ne sortent plus. Une fois qu'ils y ont pénétré, leur byssus ne prend plus d'accroissement (1).
L'un d'eux (Mytilus lithophagus. L.), Chemn. VIII, LXXXII, 729, 730, est fort commun dans la Méditerranée, où il fournit une nourriture assez agréable, à cause de son goût poivré.
Il y en a un (Modiola caudigera, Encycl., pl. 221, f. 8.), qui a au bout postérieur de chaque valve un petit appendice très dur, qui lui sert peut être à creuser sa demeure.
LES ANODONTES. (ANODONTES. Brug.) Vulgairem. Moules d'étang.
Ont l'angle antérieur arrondi, comme le postérieur; et l'angle voisin de l'anus obtus et presque rectiligne; leur coquille mince et médiocrement bombée, n'a point de dents du tout à la charnière, mais seulement un ligament qui en occupe toute la longueur. L'animal (Limnæa, Poli) manque de byssus: son pied, qui est très grand, comprimé, à peu près quadrangulaire, lui sert à ramper sur le sable ou sur la vase. Le bout postérieur de son manteau est garni de beaucoup de petits tentacules. Les anodontes vivent dans les eaux douces.
Nous en avons ici quelques espèces, dont une fort
(2) M. Sowerby a contesté ce fait, qui a cependant un bon garant dans M. Poli, témoin oculaire; Test. neap., II, p. 215. La pl. XXXII du même ouvrage, fig. 10, 11, 12, 13, prouve aussi que l'animal du lithodome ressemble aux moules et non pas aux Pholades, ni aux Pétricoles.
La manière dont les Lithodomes, les Pholades, les Pétricoles et quelques autres bivalves creusent les pierres, a donné lieu à des discussions; les uns croient y voir l'effet de l'action mécanique des valves; d'autres celui d'une dissolution. Voy. le mém. de M. Fleuriau de Bellevue, Journ. de phys., floréal, an X, p. 345; Poli, Test. neap., II, 215 et Edw. Osler., Trans. phil., 1826, 3e part., p. 342. Tout examen fait, la première de ces opinions, quelques difficultés qu'elle présente, nous paraît encore la plus probable.
[page] 138
grande (Mytilus cygneus, L.), Chemn., VIII, LXXXV, 762, qui se trouve dans toutes nos eaux à fond vaseux. Ses valves minces et légères, servent à écrémer le lait. On ne peut la manger, à cause de son goût fade (1).
M. Delamarck distingue sous le nom d'IRIDINE (IRIDINA) une espèce oblongue dont la charnière est grenue sur toute sa longueur (2); Son animal a le manteau un peu fermé vers l'arrière (3);
Et M. Leach, sous celui de DIPSADE, une autre espèce qui a les angles plus prononcés, et un vestige de dent à sa charnière.
LES MULÈTES (UNIO. Brug.) Vulgairement Moules de peintres.
Ressemblent aux anodontes par l'animal et par la coquille, si ce n'est que leur charnière est plus compliquée. La valve droite a en avant une courte fossette où pénètre une courte lame ou dent de la valve gauche, et en arrière une longue lame qui s'insère entre deux lames du côté opposé. On les trouve aussi dans les eaux douces, de préférence dans celles qui sont courantes.
Tantôt la dent antérieure est plus ou moins grosse et inégale comme dans
La Moule du Rhin (Mya margaritifera, L.) Drap. X. 17. 19.
Grande espèce épaisse, dont le nacre est assez beau pour que ses concrétions puissent être employées à la parure, comme des perles.
Nous avons encore l'Unio littoralis, Lam., Drap., X, 20. Espèce plus petite, plus carrée.
(1) Aj. M. anatinus, Chemn., VIII, LXXXVI, 763;—M. fluviatilis, List., CLVII, 12; — M. stagnalis, Schrœd., fluv., I. 1; — M. zellensis, ib., II, 1; — M. dubius, Adans., XVII, 21; et les pl. 201, 202, 203 et 205, de l'Encycl. méthod., Test.
(2) Irid. exotica, Encycl. méthod., Test., pl. 204;—Aj. Irid, nilotica, Caillaud, voyage à Méroé, Pl. LX, f. 11.
(3) Voyez Deshayes, Mém de la Soc. d'hist. nat. de Paris, 1827, III, p. t, pl. 1.
[page] 139
D'autres fois la dent antérieure est en forme de lame, comme dans
La Moule des peintres (Mya pictorum. L.) Drap. XI. 1–4.
Espèce oblongue et mince, connue de tout le monde (1).
M. Delamarck distingue
LES HYRIES (HYRIA, Lam.)
Dont les angles sont si prononcés, que leur coquille est presque triangulaire (2).
Et LES CASTALIES. (CASTALIA, Lam.)
Dont la coquille un peu en cœur est striée en rayons, et dont les dents et lames de la charnière sont sillonnées en travers de leur longueur, ce qui leur donne quelques rapports avec les trigonies (3).
On doit rapprocher des mulètes quelques coquilles de mer qui ont un animal semblable et à peu près la même charnière, mais dont la coquille a les sommets plus bombés et des côtes saillantes allant des sommets aux bords. Ce sont
LES CARDITES. Brug. (4).
Leur forme est plus ou moins oblongue ou en cœur. Quelques-unes ont la coquille béante inférieurement (5).
(1) Un grand nombre d'espèces très remarquables par leur taille ou leurs formes, se trouvent aux États-Unis dans les lacs et dans les rivières. MM. Say et Barnes qui les ont décrites ont établi parmi elles quelques nouveaux sous-genres.
(2) Hyria rugosa, Enc. méth., pl. 247, 2.
(3) Castalia ambigua, Lam., Blainv., Malac., LXVII, 4.
(4) Chama antiquata, Chemn., VI, XLVIII, 488–491; — Chama trapezia; — Ch. semiorbiculata; — Chama cordata, id., 502, 503; et parmi les espèces fossiles, une des plus singulières, Cardita avicularia, Lam., An. mus., IX, pl. 19, f. 6; si toutefois elle ne doit pas être séparée.
(5) Chama caliculata, Chemn., VII, L, 500, 501; — Cardita crassicosta, Brug., Encycl., pl. 234, f. 3.
[page] 140
LES CYPRICARDES. Lam.
Sont des cardites dont la dent sous le sommet est divisée en deux ou en trois. Leur forme est oblongue, et leurs côtés inégaux (1).
M. de Blainville en sépare encore
LES CORALLIOPHAGES.
Dont la coquille est mince, et la lame latérale très effacée, ce qui pourrait les faire rapprocher des vénus.
On en connaît une qui perce les masses des coraux, pour s'y loger (2).
Les VENERICARDES, Lam., ne diffèrent des cardites que parce que la lame postérieure de leur charnière est plus transverse et plus courte; ce qui les avait fait rapprocher des vénus; leur forme est presque ronde. On peut juger par les impressions musculaires que leur animal doit aussi ressembler à ceux des cardites et des mulètes (3).
Les unes et les autres se rapprochent des bucardes, par la forme générale et par la direction des côtes.
Je soupçonne que c'est encore ici la place des CRASSATELLES, Lam. (PAPHIES, Roiss.), que l'on a rapprochées tantôt des mactres; tantôt des vénus, et qui ont à la charnière deux dents latérales peu marquées et deux au milieu très fortes, derrière lesquelles est de part et
(1) Chama oblonga, Gm., Chemn., VII, L, 504, 505, ou Cardita carinata, Enc., pl. 234, f. 2, ou Cypricard. de Guinée, Blainv., Malac., LXV bis, f. 6.
(2) Chama coralliophaga, Gm., Chemn., X, CLXII, 1673, 1674, ou Cardita dactylus, Brug., Enc., pl. 234, f. 5; Coralliophaga carditoïdes, Blainv., Mal., LXXVI, 3.
(3) Venus imbricata, Chemn., VI, XXX, 314, 315, et les espèces fossiles données par M. Delamarck, Ann. mus., VII, et IX, pl. XXXI et XXXII.
[page] 141
d'autre une fossette triangulaire pour un ligament intérieur. Leurs valves deviennent très épaisses avec l'àge, et l'empreinte des bords du manteau donne à croire que, comme les précédentes, elles n'ont pas de tubes extensibles (1).
La troisième famille des Acéphales testacés, ou
LES CAMACÉES,
A le manteau fermé, et seulement percé de trois ouvertures dont l'une sert à la sortie du pied; la suivante à faire entrer et sortir l'eau nécessaire à la respiration; la troisième est l'issue des excréments; ces deux dernières ne se prolongent point en tubes comme dans la famille suivante.
Cette famille ne comprend que le genre
CHAMA de Linnæus.
Dont la charnière a beaucoup d'analogie avec celle des mulètes, c'est-à-dire qu'elle est munie à la valve gauche, près du sommet, d'une dent, et plus en arrière d'une lame saillante, qui entrent dans des fosses de la valve opposée.
Ce genre a dû être subdivisé.
LES TRIDACNES. Brug.
Ont la coquille très alongée en travers, à valves égales; l'angle supérieur qui répond à la tête et au som-
(1) Venus ponderosa, Chemn., VII, LXIX, A.-D., ou Crassatella tumida, Lam., Ann. mus., VI, 408, 1; peut-être mactra cygnus, Chemn., VI, XXI, 207; — Venus divaricata, Chemn., VI, XXX, 317–319. Ce genre renferme en outre beaucoup d'espèces fossiles, surtout aux environs de Paris. Voyez à leur sujet l'ouvrage de M. Deshayes.
[page] 142
met, très obtus. L'animal de ce genre est fort extraordinaire, parce qu'il n'est point placé dans la coquille comme la plupart des autres, mais que ses parties sont toutes dirigées ou comme pressées vers le devant. Le côté antérieur du manteau est largement ouvert pour le passage du byssus; un peu au-dessous de l'angle antérieur, il a une autre ouverture qui introduit l'eau vers les branchies, et au milieu du côté inférieur en est une troisième plus petite, qui répond à l'anus; en sorte que l'angle postérieur n'a besoin de donner passage à rien, et n'est occupé que par une cavité du manteau ouverte seulement au troisième orifice dont nous venons de parler.
Il n'y a qu'un seul muscle transverse répondant au milieu du bord des valves.
Dans
LES TRIDACNES proprement dites. Lam.
La coquille a en avant, comme le manteau, une grande ouverture à bords dentelés pour le byssus; celui-ci est bien sensiblement de nature tendineuse, et se continue sans interruption avec les fibres musculaires.
Telle est la coquille de la mer des Indes, fameuse par son énorme grandeur, dite la Tuilée ou le Bénitier (Chama gigas, L., Chemn., VII, XLIX, qui a de larges côtes relevées d'écailles saillantes demi-circulaires. Il y en a des individus qui pèsent plus de trois cents livres. Le byssus tendineux, qui les suspend aux rochers, est si gros et si tenace, qu'il faut le trancher à coups de hache. La chair est mangeable, bien que fort dure.
Dans
LES HIPPOPES. (HIPPOPUS. Lam.)
La coquille est fermée et aplatie en avant, comme si elle eût été tronquée (1).
(1) Chama hippopus, L., Chemn., VII, L, 498–499.
[page] 143
LES CAMES proprement dites. (CHAMA. Brug.)
Ont la coquille irrégulière, à valves inégales, le plus souvent lamelleuses et hérissées, se fixant aux rochers, aux coraux, etc., comme les huîtres. Ses sommets sont souvent très saillants, inégaux et recoquillés. Souvent aussi leur cavité intérieure a cette forme, sans qu'on s'en aperçoive à l'extérieur. L'animal (Psilopus, Poli) a un petit pied, coudé presque comme celui de l'homme. Ses tubes s'il en a, sont courts et disjoints, et l'ouverture du manteau qui sert au passage du pied n'est guère plus grande qu'eux. Nous en avons quelques espèces dans la Méditerranée (1).
Il y en a aussi plusieurs de fossiles (2).
LES DICÉRATES. Lam.
Ne paraissent différer des cames en rien d'essentiel; seulement leur dent cardinale est fort épaisse, et les spirales de leurs valves sont assez saillantes pour rappeller la forme de deux cornes (3).
LES ISOCARDES. (ISOCARDIA. Lam.)
Ont une coquille libre, régulière, bombée, et des sommets recoquillés en spirale, divisés vers le devant. Leur animal (Glossus, Poli) ne diffère de celui des cames ordinaires, que par un pied plus grand et ovale, et parce que l'ouverture antérieure de son manteau commence à reprendre les proportions ordinaires. La Méditerranée en produit une espèce assez grande, lisse, rousse. (Chama cor, L., Chemn., VII, XLVIII, 483). (4).
(1) Chama lazarus, Chemn., VII, LI, 507, 509; — Ch. gryphoïdes, ib., 510–513; — Ch. archinella, id., LII, 522, 523; — Ch. macrophylla, ib., 514, 515; — Ch. foliacea, ib., 521; — Ch. citrea, Regenf., IV, 44, — Ch. bicornis, ib., 516–520.
(2) Voyez la Conch. foss. subap. de Brocchi, et les Coq. foss. des env. de Paris de M. Delamarck.
(3) Ce sont des coquilles fossiles des terrains jurassiques. Dic. arietina, Lam., de Saussure., Voyage aux Alpes, I, pl. 11, f. 1–4.
(4) Ajoutez Ch. moltkiana, Chemn., VII, XLVIII, 484–487.
[page] 144
La quatrième famille des acéphales testacés, ou
LES CARDIACÉS,
A le manteau ouvert par devant et, en outre, deux ouvertures séparées, l'une pour la respiration, l'autre pour les excréments, qui se prolongent en tubes tantôt distincts, tantôt unis en une seule masse. Il y a toujours un muscle transverse à chaque extrémité, et un pied qui le plus souvent sert à ramper. On peut regarder comme une règle assez générale que ceux qui ont de longs tubes vivent enfoncés dans la vase ou dans le sable. On reconnaît sur la coquille cette circonstance d'organisàtion par un contour plus ou moins rentrant que l'impression d'attache des bords du manteau décrit avant de se réunir à l'impression du muscle transverse postérieur (3).
LES BUCARDES. (CARDIUM. L.)
Ont, comme beaucoup d'autres bivalves, une coquille à valves égales, bombées, à sommets saillants et recourbés vers la charnière, ce qui, lorsqu'on la regarde de côté, lui donne la figure d'un cœur et a occasioné les noms de cardium, cœur, cœur de bœuf, etc. Des côtes plus ou moins saillantes se rendent régulièrement des sommets aux bords des valves. Mais ce qui distingue les bucardes, c'est la charnière, où l'on voit de part et d'autre au milieu, deux petites dents, et à quelque distance en avant et en arrière, une dent ou lame saillante. L'animal (Cerastes, Poli) a généralement une ample ou-
(3) M. de Blainville en fait la famille des CONCHACÉES.
[page] 145
verture au manteau, un très grand pied, coudé dans son milieu, à pointe dirigée en avant, et deux tubes courts ou de longueur médiocre.
Les espèces de bucardes sont nombreuses sur nos côtes. Il y en a que l'on mange, comme
La Coque ou Sourdon (Cardium edule, L., Chemn. VI, XIX, 194),
Fauve ou blanchâtre, à vingt-six côtes ridées en travers.
On pourrait séparer, sous le nom d'HÉMICARDES, les espèces à valves comprimées d'avant en arrière, et fortement carénées dans leur milieu, car il est difficile que leur animal ne soit pas modifié en raison de cette configuration singulière (1).
LES DONACES. (DONAX. L.)
Ont à peu près la charnière des cardiums; mais leur coquille est d'une tout autre forme, en triangle, dont l'angle obtus est au sommet des valves et la base à leur bord, et dont le côté le plus court est celui du ligament, c'est-à-dire le postérieur, circonstance rare à ce degré parmi les bivalves. Ce sont en général de petites coquilles joliment striées, des sommets aux bords. Leur animal (Peronæa, Poli) a de longs tubes qui rentrent dans un sinus du manteau. Nous en avons quelquesuns sur nos côtes (2).
(1) Cardium cardissa, Chemn., VI, XIV, 143–146; — C. roseum, ib., 147; — C. monstrosum, ib., 149, 150; — C. hemicardium, id., XI, 159–161.
Les autres cardiums de Gmel. peuvent rester dans le genre, excepté C. gaditanum qui est un pétoncle. Il y en a plusieurs espèces fossiles décrites par MM. Lamarck, Brocchi et Brongniart.
(2) Donax rugosa, Chemn., VI, XXV, 250–252; — D. trunculus, ib., XXVI, 253, 254; — D. striata, Knorr., Delic., VI, XXVIII, 8; — D. denticulata, Chemn., l, c. 256, 257; — D. faba, ib., 266; — D. spinosa, b., 258. Les espèces fossiles sont nombreuses aux environs de Paris. Voy. Lamarck, Ann du Mus., VIII, 139, et Deshaies, Coq. foss. des env. de Paris, I, pl. XVII, XVIII.
Le Donax irregularis des environs de Dax, que M. Bastorat a fait connaître dans les Mémoires de la soc. d'hist. nat. de Paris, t. 2, pl. IV, fig. 19, A B, est le type d'un genre nouveau que M. Ch. Desmoulins (Bull. de la soc. Linn. de Bordeaux, II,) vient s'établir sous le nom de Gratelupia. Il se distingue des donaces par la présence de plusieurs lamelles dentiformes qui accompagnent les dents cardinales.
Gmel. mêle à ces vrais Donax, quelques Vénus et quelques Mactres.
TOME III. 10
[page] 146
LES CYCLADES. Brug.
Démembrées des vénus par Bruguière, ont, comme les cardium et les donax, deux dents au milieu de la charnière, et en avant et en arrière deux lames saillantes quelquefois crénelées; mais leur coquille, comme celle de beaucoup de vénus, est plus ou moins arrondie, équilatérale et a ses stries en travers. L'animal a des tubes médiocres. On les trouve dans les eaux douces, et leur teinte extérieure est généralement grise ou verdâtre.
Nous en avons une fort commune dans nos mares (Tellina cornea, L.), Chem., VI, XIII, 133 (1).
M. Delamarck en détache
LES CYRÈNES. (CYRENA. Lam.)
Dont la coquille est épaisse, un peu triangulaire et oblique et recouverte d'un épiderme, et qui se distinguent en outre des cyclades, parce qu'elles ont trois dents cardinales. Elles habitent aussi les rivières, mais nous n'en avons pas en France (2); et
LES CYPRINES. (CYPRINA. Lam.)
Dont la coquille est épaisse, ovale à sommets recourbés,
(1) Ajoutez Tellina rivalis, Müll., Draparn., X, 4, 5; — Cyclas fontinalis, Drap., ib., 8–12; — Cycl. caliculata, ib., 13, 14; — Tellina lacustris, Gm., Chemn., XIII, 135; — Tell. amnica, ib., 134; — Tell. fluviatilis; Tell. fluminalis, Chemn., VI, XXX, 320.
(2) Tell. fluminea, Chemn., ib., 322, 323; — Venus coaxans, id., XXXII, 336, ou Cyrena ceylanica, Lam., Enc. méth. pen., Pl. 302, f. 4; — Venus borealis, id., VII, XXXIX, 312–314; — Cyclas caroliniana, Bosc., coq., III, XVIII, 4. Les espèces fossiles sont assez abondantes aux environs de Paris Voy. Deshayes, coq. foss., I, pl. 18, 19.
[page] 147
à trois dents fortes, de plus une lame éloignée en arrière; sous les dents est une grande fossette où se loge une partie du ligament (1).
LES GALATHÉES. (GALATHÆA. Brug.)
Ont la coquille triangulaire droite; les dents du sommet au nombre de trois à une valve et de deux à l'autre, formant des chevrons; les lames latérales sont rapprochées (2).
On n'en connaît qu'une des eaux douces des grandes Indes.
C'est encore ici que doit venir un autre démembrement des vénus,
LES CORBEILLES (CORBIS. Cuv. FIMBRIA. Megerl.)
Coquilles de mer transversalement oblongues, qui ont aussi de fortes dents au milieu et des lames latérales très marquées; leur surface extérieure est garnie de côtes transverses, croisées par des rayons avec une régularité comparable à celle des ouvrages de vannerie.
L'empreinte de leur manteau n'ayant pas de repli, leurs tubes doivent être courts (3).
Il y en a de fossiles (4).
LES TELLINES. (TELLINA. L.)
Ont au milieu une dent à gauche et deux à droite,
(1) Venus islandica, Chemn., VI, XXXII, 342, Encycl., Pl. 301., f. 1, il y en a une grande espèce fossile des collines du Siennois et des environs de Dax, de Bordeaux.
(2) L'Égérie, Roiss., ou Galathée, Brug., Enc., 249, et Lam., Ann. mus., V, XXVIII, et Ven. hermaphrodita, Chemn., VI, XXXI, 327–29? ou Ven. subviridis, Gm.
(3) Venus fimbriata, Chemn, VII, 43, 448.
(4) Voyez Deshayes, coq. foss. des environs de Paris, I, XIV, Brong., mém. sur le Vicentur, pl. V, f. 5.
10*
[page] 148
souvent fourchues, et à quelque distance en avant et en arrière, à la valve droite, une lame qui ne pénètre pas dans une fosse de l'autre valve. Les deux valves ont, près du bout postérieur, un pli léger qui les rend inégales dans cette partie, où elles sont un peu bâillantes.
L'animal des tellines (Peronæa, Poli) a, comme celui des dona ces, deux longs tubes pour la respiration et pour l'anus, lesquels rentrent dans la coquille et s'y cachent dans un repli du manteau.
Leurs coquilles sont généralement striées en travers, et peintes de jolies couleurs.
Les unes sont ovales et assez épaisses.
Les autres oblongues et très comprimées.
Les autres lenticulaires. Au lieu du pli, l'on y voit souvent une simple déviation des stries transversales (1).
On pourrait séparer quelques espèces oblongues, qui n'ont aucunes dents latérales (2), et d'autres qui, avec la charnière des tellines, n'ont pas le pli du bout postérieur. Ce sont les TELLINIDES, Lam. (3).
Il est nécessaire de distinguer des tellines
LES LORIPÈDES (LORIPES. Poli.)
Qui ont la coquille lenticulaire et les dents du milieu presque effacées, et en arrière des nates un simple sillon pour le ligament. L'animal a un court tube double, et son pied se prolonge comme en une corde cylindrique. En dedans des valves on voit, outre les empreintes ordinaires, un trait allant obliquement de l'empreinte du muscle antérieur qui est très longue, vers les nates.
(1) Ce sont les trois divisions de Gmelin; mais notez que l'on doit ôter de son genre telline: 1° Tell. Knorrü, qui est une capse polie; 2° Tell. inæquivalvis, qui est le genre pandore; 3° les Tell. cornea, lacustris, amnica, fluminalis, fluminea, fluviatilis, qui sont des cyclades ou des cyrènes.
(2) Tell. kyalina, Chemn., VI, XI, 99; — Tell. vitrea, ib., 101.
(3) Tellinides timoriensis. Lam.
[page] 149
L'empreinte du man teau n'a pas de repli pour le muscle rétracteur du tube (1).
LES LUCINES. (LUCINA. Brug.)
Ont, comme les cardiums, les cyclades, etc., des dents la térales écartées, pénétrant entre des lames de l'autre valve; au milieu sont deux dents souvent très peu apparentes. Leur coquille est orbiculaire, sans impression du muscle rétracteur du tube; mais celle du muscle constricteur antérieur est très longue. Ayant ainsi les mêmes traits que les loripèdes, leurs animaux doivent avoir de l'analogie (2).
Les espèces vivantes sont jusqu'à présent beaucoup moins nombreuses que les fossiles: celles-ci sont très communes aux environs de Paris (3).
On doit rapprocher des lucines les ONGULINES, qui ont comme elles la coquille orbiculaire, deux dents cardinales, mais les latérales leur manquent, et l'impression musculaire antérieure n'est pas si longue (4).
LES VÉNUS. (VÉNUS. L.)
Comprennent beaucoup de coquilles dont le caractère commun est d'avoir les dents et lames de la charnière rapprochées sous le sommet en un seul groupe. Elles sont en général plus aplaties et plus alongées parallèlement à la charnière, que les bucardes. Leurs côtes, quand elles en ont, sont presque toujours parallèles aux bords, ce qui est l'opposé des bucardes.
Le ligament laisse souvent en arrière des sommets,
(1) Tellina lactea.
(2) Venus pensy lvanica, Chemn., VII, XXXVII, 394–396, XXXIX, 408, 409; — V. edentula, id., XL, 427, 429.
(3) Lucina Saxorum, Lam., Deshayes, coq. foss. des environs de Paris, tom. 1, pl. XV, fig. 5, 6; — Luc. grata, Defr.: ibid, pl. XVI, fig. 5, 6; — Luc concentrica, Lam., Desh., ibid, pl. XVI, fig. 11, 12.
(4) Ungulina transversa, Kam., Sowerby, Gen. of Shells, 10e cahier.
[page] 150
une impression elliptique, à laquelle on a donné le nom de vulve ou de corselet; et il y a presque toujours en avant de ces mêmes sommets une impression ovale qu'on a nommée anus ou lunule (1).
L'animal des vénus a toujours deux tubes susceptibles de plus ou moins de saillie, mais quelquefois réunis l'un à l'autre, et un pied comprimé qui lui sert à ramper.
M. Delamarck réserve le nom de VÉNUS à celles qui ont trois petites dents divergentes sous le sommet.
Ce caractère est surtout fort marqué dans les espèces oblongues et peu bombées (2).
Quelques-unes (les ASTARTÉS, SOWERB., ou CRESSINES, Lam.) n'ont à la charnière que deux dents divergentes, et rapprochent des crassatelles par leur épaisseur et quelques autres caractères (3).
Parmi les espèces en forme de cœur, c'est-à-dire plus courtes et à nates plus bombées qui ont a ussi leurs dents rapprochées, on doit remarquer celles dont les lames ou stries transversales se terminent en arrière par des crêtes (4), ou des tubérosités (5), et celles qui ont des côtes longitudinales et des crêtes élevées sur l'arriére.
Mais on arrive ensuite par degré aux CYTHÉRÉES, Lam.,
(1) Ce sont probablement ces noms bizarres de vulve et d'anus qui ont fait appeler antérieure l'extrémité de la coquille où répond le véritable anus de l'animal, et postérieure celle où est située la bouche. Nous avons rendu à ces extrémités leurs vraies dénominations. Il faut se souvenir que le ligament est toujours de côté postérieur des sommets.
(2) Venus litterata, Chemn., VII, XLI; — Ven. rotundata, ib., XLII, 441; — Ven. textile, ib, 442; — Ven. decussata, XLIII, 456, etc.
(3) Venus scotica, Hans Lerin, VIII, tab. 2, fig. 3; — Crassina danmoniensis, Lam., et parmi les espèces fossiles. Ast. lucida, Sow., min. couch., II, tab. 137, fig. 1; — Ast. Omalii, Lajonkere., soc. d'hist. nat. de Paris, I, tab. 6, fig. 1.
(4) Venus dysera, Chemn., VI, 27, 299; — Ven. plicata, Enc., Pl. 275, 3, a, b; — Ven. crebrisulica, ibid., fig 4, 5, 6.
(5) Venus puerpera, Encyc., 278; — Ven. corbis, Lam., Encyc., Pl. 276, fig. 4.
[page] 151
qui ont une quatrième dent sur la valve droite, avancée sous la lunule et reçue dans une fossette correspondante creusée sur la valve gauche.
Il y en a, comme dans les vénus, de forme elliptique et alongée (1), d'autres de forme bombée (2), et parmi celles-ci il faut placer une espèce fameuse dont la forme a occasioné le nom du genre vénus, et dont les lames transversales sont terminées en arrière par des épines saillantes et pointues (Vénus Dione), Lin., Chemn., VI, 27, 271.
Il y a des espèces de forme orbiculaire, à sommets un peu crochus, où l'empreinte du muscle rétracteur des tubes forme un grand triangle presque rectiligne (3).
Quand on connaîtra mieux les animaux, ou devra probablement séparer des cythérées,
1° Les espèces en forme de lentille très comprimée, à nates rapprochées en une seule pointe. Le repli du tour du manteau leur manque et annonce que leurs tubes ne sont pas extensibles (4);
2° Celles en forme orbiculaire bombée, qui non-seulement manquent du repli, mais ont encore, comme les lucines, l'empreinte du muscle antérieur très longue (5);
3° Les espèces épaisses, à côtes en rayons, qui manquent aussi du repli, et lient le genre des vénus à celui des vénéricardes (6).
On a déja séparé du genre vénus,
LES CAPSES. (CAPSA. Brug.)
Qui ont d'un côté deux dents à la charnière, et de l'autre une seule, mais bifide; leur coquille manque de lunule, est
(1) Ven. gigantea, Enc. 28, 3; — Ven. chione, Chemn., VI, 32, 343; — Ven. erycina, ibid., 347; — Ven. maculata, ibid., 33, 345.
(2) Ven. meretrix; — Ven. lusoria; — Ven. castrensis.
(3) Ven. exoleta, Chemn., VII, 38, 404. C'est le genre ORBICULUS, Megesle.
(4) Ven. scripta, Chemn., VII, 40, 422.
(5) Ven. tigerina, Chemn., VII, 37, 390; — Ven. punctata, ib., 397.
(6) Venus pectinata, Chemn., VII, 39, 419. Le genre ARTHEMIS, d'Oken.
[page] 152
assez bombée, oblongue, et le repli, indice du rétracteur du pied, y est considérable (1).
ET LES PÉTRICOLES. (PETRICOLA. Lam.)
Qui ont de chaque côté deux ou trois dents à la charnière, bien distinctes, dont une fourchue. Leur forme est plus ou moins en cœur; mais comme elles habitent l'intérieur des pierres, elles y deviennent quelquefois irrégulières. D'après l'impression des bords du manteau, leurs tubes doivent être grands (2).
LES CORBULES. (CORBULA. Brug.)
Semblables pour la forme aux cythérées triangulaires ou en cœur, n'ont qu'une dent forte à chaque valve, au milieu, répondant à côté de celle de la valve opposée. Leur ligament est intérieur. Leurs tubes doivent être courts et leurs valves sont rarement bien égales (3).
Les espèces fossiles sont bien plus nombreuses que les vivantes (4).
Quelques-unes vivent dans l'intérieur des pierres (5).
LES MACTRES. (MACTRA. L.)
Se distinguent parmi les coquilles de cette famille parce que leur ligament est interne et logé de part et d'autre dans une fossette trangulaire, comme dans les huîtres, elles ont toutes un pied comprimé propre à ramper.
(1) Ven. deflorata, Chemn., VI, IX, 79–82.
(2) Venus lapicida, Chemn., X, 172, 1664, et les RUPELLAIRES de M. Fleuriau de Bellevue; — Venus perforans, Montag., Test. Brit., Pl. III, f. 6; — Donax irus? Chemn., VI, XXVI, 270.
(3) Voyez l'Encycl. méthodique, vers, pl. 230, fig. 1, 4, 5, 6.
(4) Corb. Gallica, Complanata, Ombonella, Desh., coq. foss. des env. de Paris, t. 1, pl. 7, 8 et 9.
(5) Venus monstrosa, Chemn., VII. 42, 445–6.
[page] 153
Dans
LES MACTRES, proprement dites. (MACTRA. Lam.)
Le ligament est accompagné à la valve gauche, en avant et en arrière, d'une lame saillante qui pénètre entre deux lames de la valve opposée. Tout près du ligament vers la lunule est de part et d'autre une petite lame en chevron. Les tubes sont réunis et courts (1).
Nous en avons quelques-unes sur nos côtes.
Dans les LAVIGNONS, les lames latérales sont presque effacées; on ne voit qu'une petite dent près du ligament interne, et on observe en outre un petit ligament extérieur; le côté postérieur de la coquille est le plus court. Les valves bâillent un peu. Les tubes sont séparés et fort longs, comme dans les tellines.
Nous en avons une sur nos côtes (Chemn., VI, III, 21, sous le nom de Mya hispanica), qui vit à plusieurs pouces sous la vase (2).
La cinquième famille des acéphales testacés, ou
LES ENFERMÉS (3),
A le manteau ouvert par le bout antérieur, ou vers son milieu seulement, pour le passage du pied,
(1) Le genre MACTRA de Gmel. peut rester tel qu'il est, quand on en a retiré les Lavignons et les Lutraires; mais les espèces sont loin d'être bien distinguées. Ajoutez Mya australis, Chemn., VI, III, 19, 20.
Les ÉRYCINES, Lam., sont voisines des mactres et assez mal caractérisées. Voyez Ann. mus., IX, XXXI, et Deshayes, coq. foss., I, VI; une partie rentrera peut-être dans les crassatelles. Les AMPHIDESMES de M. Lamarck, ou les LIGULES de Montagu, paraissent voisines des Mactres, mais elles sont trop mal connues pour qu'on puisse leur assigner des caractères distinctifs.
(2) Gmel. l'a nommée mal à propos Mactra piperata.
Ajoutez Mactra papyracea, Chemn., VI, XXIII, 231; — M. complanata, id., XXIV, 238; — Mya nicobarica, id., III, 17, 18.
(3) M. de Blainville, de cette famille en fait deux; ses PYLORIDÉES et les ADESMACÉES. Les dernières comprennent les Pholades, les Tarets et les Fistulanes; les premières tous les autres, et même l'Arrosoir.
Nous devons remarquer au reste que l'on a établi dans cette famille et dans la précédente un assez grand nombre de genres trop peu caractérisés pour que nous ayons cru devoir les adopter.
[page] 154
et prolongé de l'autre bout en un tube double qui sort de la coquille, laquelle est toujours bâillante par ses extrémités. Ils vivent presque tous enfoncés dans le sable, dans la vase, dans les pierres ou dans des bois.
LES MYES. (MYA. L.)
N'ont que deux valves à leur coquille oblongue, dont la charnière varie. Le double tube forme un cylindre charnu; le pied est comprimé; les formes de la charnière ont donné à MM. Daudin, Lamarck, etc., les subdivisions suivantes (1), dont les trois premières ont le ligament interne.
LES LUTRAIRES. (LUTRARIA. Lam.)
Ont comme les mactres un ligament inséré de part et d'autre dans une large fossette triangulaire de chaque valve, et en avant de cette fossette une petite dent en chevron; mais les lames latérales manquent; les valves très bâillantes, surtout au bout postérieur par lequel sort le gros double tube charnu de la respiration et de l'anus, les ramènent dans cette famille. Le pied qui sort à l'opposite, est petit et comprimé.
On en trouve dans le sable des embouchures de nos fleuves (2).
(1) N. B. La moitié des Mya de Gmel. n'appartiennent ni à ce genre ni même à cette famille; mais aux Vulselles, aux Mulètes, aux mactres, etc.
(2) Mactra lutraria, List., 415, 259; Chemn., VI, XXIV, 240, 241; — Mya oblonga, id., ib., II, 12; — Acosta, Conch., brit., XVII, 4; Gualt., 90, A, fig. min.
[page] 155
LES MYES proprement dites. (MYA. Lam.)
Ont à une valve, une lame qui fait saillie dans l'autre valve, et dans celle-ci une fossette. Le ligament va de cette fossette à cette lame.
Nous en avons quelques-unes le long de nos côtes dans le sable (1).
On doit rapprocher de ces myes
LES ANATINES. Lam.
Qui ont à chaque valve une petite lame saillante en dedans, et le ligament allant de l'une à l'autre.
On en connaît une oblongue excessivement mince, dont les valves sont soutenues par une arête intérieure (2); et une autre de forme plus carrée qui n'a point cette arête (3).
Dans les SOLÉMYES, Lam., le ligament se montre au dehors de la coquille. Une partie reste attachée dans un cuilleron horizontal intérieur de chaque valve. Il n'y a point d'autre dent cardinale; un épiderme épais dépasse les bords de la coquille.
Il y en a une espèce dans la Méditerranée (Tellina togata), Poli, II, XV, 20 (4).
LES GLYCYMÈRES. (GLYCYMERIS. Lam. CYRTODAIRE. Daud.)
N'ont à leur charnière ni dents, ni lames ni fossettes, mais un simple renflement calleux, derrière lequel est un
(1) Mya truncata: L. Chemn., VI, I, 1, 2; — M. arenaria, ib. 3, 4.
(2) Solen anatinus, Chemn., VI, VI, 46–48.
(3) Encycl., 230, 6, sous le nom de Corbule; — An. hispidula, Nob., au. s. vert. Egypt., coq., pl. VII, f. 8. Je pense que les RUPICOLES, Fleuriau de Bellev. (Voy. Roissy, VI, 440), doivent être voisines de ce sous-genre. Elles vivent dans l'intérieur des pierres, comme les Pétricoles, les Pholades, etc.
(4) La Nouvelle-Hollande en fournit une autre espèce (Sol. australis, Lam.)
[page] 156
ligament extérieur. Leur animal ressemble á celui des myes.
L'espèce la plus connue (Mya Siliqua, L., Chemn., XI, 193 f. 194), vient de la mer glaciale.
LES PANOPES (PANOPEA. Mesnard. Lagr.)
Ont en avant du renflement calleux des précédentes une forte dent, immédiatement sous le sommet, qui croise avec une dent pareille de la valve opposée; caractère qui les rapproche des solens. On en connaît une grande espèce, des collines du pied de l'Apennin, oû elle est si bien conservée qu'on l'a crue quelquefois tirée de la mer (4).
Peut-être pourrait-on en séparer une autre espèce fossile, qui ferme presque entièrement au bout antérieur (5).
On peut mettre à la suite de ces diverses modifications des myes,
LES PANDORES. Brug.
Qui ont une valve beaucoup plus plate que l'autre, un ligament intérieur placé en travers, accompagné en avant d'une dent saillante de la valve plate. Le côté postérieur de la coquille est alongé. L'animal rentre plus complétement dans sa coquille que les précédents, et ses valves ferment mieux, mais il a les mêmes mœurs.
On n'en connaît bien qu'une espèce de nos mers (1).
Ici viennent encore se grouper quelques petits genres singuliers.
LES BYSSOMIES. Cuv.
Dont les coquilles, oblongues et sans dent marquée,
(4) Mya glycimeris, L., Chemn., VI, III. Une espèce très voisine, mais un peu plus courte, habite la Méditerranée. Il y en a une autre fossile près de Bordeaux.
(5) Panope de Faujas, Mesnard Lagr., Ann. Mus., IX, XII.
C'est dans ce voisinage que doivent venir sans doute les SAXICAVES de M. Fleuriau de Bellevue, petites coquilles creusant l'intérieur des pierres. Vid., Roissy, VI, 441.
(1) Tellina inœquivalvis, Chemn., VI, XI, 106, et pour l'animal Poli., II, XV, 7.
[page] 157
ont l'ouverture pour le pied à peu près dans le milieu de leurs bords et vis-à-vis des sommets.
Ils pénètrent aussi dans les pierres, les coraux.
On en a un très nombreux dans la mer du Nord, qui est pourvu d'un byssus (1).
LES HIATELLES. (HIATELLA. Daud.)
Ont la coquille bâillante, pour le passage du pied, vers le milieu de ses bords, comme les précédents, mais leur dent de la charnière est un peu plus marquée. Leur coquille a souvent en arrière des rangées d'épines saillantes.
Elles se tiennent dans le sable, les zoophytes, etc.
La mer du Nord en possède une petite (2).
LES SOLENS. (SOLEN. L.)
Ont aussi la coquille seulement bivalve, oblongue ou alongée, mais leur charnière est toujours pourvue de dents saillantes et bien prononcées, et leur ligament toujours extérieur.
LES SOLENS proprement dits. (SOLEN. Cuv.) Vulgairement manches de couteau.
Ont la coquille en cylindre alongé, et deux ou trois dents à chaque valve, vers l'extrémité antérieure par où sort le pied. Celui-ci est conique et sert à l'animal à s'enfoncer dans le sable qu'il creuse avec assez de vitesse quand il aperçoit du danger.
Nous en avons plusieurs le long de nos côtes (3).
(1) Mytilus pholadis, Müll., Zool., Dan., LXXXVII, 1, 2, 3, ou mya byssifera, Fabr., Grënl.
(2) Solen minutus, L., Chemn., VI, VI, 51, 52, ou mya arctica, Fabric., Groënl. qui paraît le même que l'hiat. à une fente, Bosc., coq., III, XXI, 1; — l'hiat. à deux fentes, id., ib., 2.
(3) Solen vagina, Chemn., VI, IV, 26–28; — S. siliqua, ib., 29; — S. ensis, ib., 30; — S. maximus, ib., V, 35; — S. cultellus, ib., 37.
[page] 158
On pourrait distinguer les espèces où les dents se rapprochent du milieu; les uns ont encore la coquille longue et étroite (1);
D'autres l'ont plus large et plus courte; leur pied est très gros. Nous en avons de ceux-ci dans la Méditerranée (2).
Dans
LES SANGUINOLAIRES. (SANGUINOLARIA. Lam.)
La charnière est à peu près comme dans les solens larges, et de deux dents au milieu de chaque valve; mais les valves ovales se rapprochent beaucoup plus à leurs deux bouts, où elles ne font que bâiller, comme dans certaines mactres (3).
LES PSAMMOBIES (PSAMMOBIA. Lam.)
Diffèrent des sanguinolaires, parce qu'elles n'ont qu'une dent sur une valve au milieu, qui pénètre entre deux de la valve opposée (4).
LES PSAMMOTHÉES. (PSAMMOTHEA. Lam.)
Sont indiquées comme n'ayant à chaque valve qu'une seule dent, mais d'ailleurs semblables aux psammobies (5).
LES PHOLADES ou DAILS. (PHOLAS. L.)
Ont deux valves principales larges et bombées du côté de la bouche, se rétrécissant et s'alongeant du côté op-
(1) Solen legumen, Chemn., VI, V, 32–34.
(2) Solen strigilatus, Chemn., VI, VI, 41–43; — S. radiatus, id., V, 38–40; — S. minimus, ib., 31; — S. coarctatus, VI, 45; — S. vespertinus, id., VII, 60. Ces deux divisions sont devenues le genre SOLECURTE, de M. de Blainville.
(3) Solen sanguilonentus, Chemn., VI, VII, 56; — S. roseus, ib., 55.
(4) Tellina gari, Linn., Poli, 15, 23; — Solen vespertinus, Chemn., VI, 7, 59; — Psammobia maculosa Lam.? Egypt., Coq, pl. 8, fig. 1; Psamm. elongata; Lam. Egypt., pl. 8, fig. 2.
(5) Psammothea violacea, Lam., etc.
N. B. M. de Blainville réunit ces deux genres en celui qu'il nomme PSAMMOCOLE. Au total, ils diffèrent bien peu des sanguinolaires. On doit observer avec beaucoup de précaution la coquille parce que le plus souvent leurs dents sont cassées.
[page] 159
posé, et laissant à chaque bout une grande ouverture oblique; leur charnière a, comme celle des myes proprement dites, une lame saillante d'une valve dans l'autre, et un ligament intérieur allant de cette lame à une fossette correspondante. Leur manteau se réfléchit en dehors sur la charnière et y contient une et quelquefois deux ou trois pièces calcaires surnuméraires. Le pied sort par l'ouverture du côté de la bouche qui est la plus large, et du bout opposé sortent les deux tubes réunis et susceptibles de se beaucoup dilater en tout sens.
Les pholades habitent des conduits qu'elles se pratiquent les unes dans la vase, les autres dans l'intérieur des pierres, comme les lithodomes, les pétricoles, etc.
On les recherche à cause de leur goût agréable.
Nous en avons quelques espèces sur nos côtes, tel est le Dail commun (Pholas dactylus, L.), Chemn., VIII, CI, 859 (1).
LES TARETS. (TEREDO. L.)
Ont le manteau prolongé en un tuyau beaucoup plus long que leurs deux petites valves rhomboïdales, et terminé par deux tubes courts, dont la base est garnie de chaque côté d'une palette pierreuse et mobile. Ces acéphales pénètrent tout jeunes, et s'établissent à demeure dans l'intérieur des bois plongés sous l'eau, tels que pieux, quilles de navires, etc., et les détruisent en les criblant de toute part. On croit que pour s'enfoncer à mesure qu'il grandit, le taret creuse ces bois à l'aide de ses valves; mais ses tubes restent vers l'ouverture par où il est entré, et où il amène l'eau et les aliments par le mouvement de ses palettes. Le canal où il se tient est tapissé d'une croûte calcaire qu'il a trans-
(1) Ajoutez Phol. orientalis, ib., 860, qui n'est peut-être qu'une variété de Dactylus; — Phol. costata, ib., 863; — Ph. crispata, id., CII, 872–874; — Phol. pusilla, ib., 867–71; — Phol. striata, ib., 864–66.
[page] 160
sudée, et qui lui forme encore une sorte de coquille tubuleuse. Ces animaux sont très nuisibles dans les ports de mer.
L'espèce commune (Teredo navalis, L.) apportée, dit-on, de la Zone-Torride, a menacé plus d'une fois la Hollande de sa destruction, en ruinant ses digues. Elle est longue de six pouces et plus, et a des palettes simples.
Les pays chauds en produisent de plus grands, dont les palettes sont articulées et ciliées. On doit les remarquer à cause de l'analogie qu'elles établissent avec les cirrhopodes. Tel est le Teredo palmulatus, Lam., Adans., Ac. des sc., 1759, pl. 9, fig. 12 (les Palettes.).
On a distingué des tarets,
LES FISTULANES. (FISTULANA. Brug.)
Dont le tube extérieur est entièrement fermé par le gros bout, et ressemble plus ou moins à une bouteille ou à une massue; on l'observe tantôt enfoncé dans des bois ou des fruits qui apparemment avaient été plongés sous l'eau, tantôt simplement enveloppé dans le sable. L'animal a d'ailleurs deux petites valves et deux palettes comme les tarets. Il ne nous en vient de frais que des mers des Indes; mais nos couches en recèlent de fossiles (1).
On doit en rapprocher
LES GASTROCHÈNES. (GASTROCHÆNA. Spengler.)
Dont les coquilles manquent de dents, et dont les
(1) Teredo clava, Gmel., Spengl., Naturforsch., XIII, 1 et 11, cop., Encycl. méthod., vers, pl. CLXVII, f. 6–16. C'est le Fistulana gregata, Lamarck: — Teredo utriculus, Gm., Naturf., X, I, 10, probablement le même que Fistulana lagenula, Lam., Encycl. méth., I, C, f. 23; — Fistulana clava, Lam., ib., 17–22.
Il est probable que le Pholas teredula, Pall., nov. act., Petrop., II, VI, 25, est aussi une Fistulane.
[page] 161
bords, très écartés en avant, y laissent une grande ouverture oblique, vis-à-vis de laquelle le manteau a un petit trou pour le passage du pied. Le double tube qui rentre entièrement dans la coquille est susceptible de beaucoup d'alongement.
Il paraît constant qu'elles ont un tube calcaire (1).
Les unes ont, comme les moules, les sommets à l'angle antérieur (2); d'autres les ont plus rapprochés du milieu (3).
Elles vivent dans l'intérieur des madrépores qu'elles percent.
On a reconnu parmi les fossiles deux genres d'acéphales munis de tuyaux, comme les tarets, mais dont le premier,
LES TÉRÉDINES. (TEREDINA. Lam.)
A un petit cuilleron en dedans de chacune de ses valves et une petite pièce libre en forme d'écusson à la charnière (4).
L'autre,
LES CLAVAGELLES. (CLAVAGELLA. Lam.)
A une de ses valves saisie par le tube, qui laisse néanmoins l'autre libre (5).
Il s'en trouve une espèce vivante qui se tient dans les madrepores des mers de Sicile et qui a été décrite par M. Audouin.
Quelques-uns croient aussi pouvoir placer dans cette famille
LES ARROSOIRS. (ASPERGILLUM.)
Dont la coquille est formée d'un tube en cône alongé,
(1) MM. Turton, Deshayes et Audouin ont observé ce tube.
(2) Pholas bians, Chemn., X, CLXXII, 1678, 1679.
(3) Id., 1681, espèce très différente de la précédente, que Chemn., n'a pas assez distinguée.
(4) Teredina personata. Lam. et Desh., foss. de Paris. I. pl. 1, f. 23–28.
(5) Cl. echinata., Lam., An., Mus. XII, XLII 19, Cl. coronata, Desh., foss., par. I. V. 15, 16.
TOME III. 11
[page] 162
fermé au bout le plus large par un disque percé d'un grand nombre de petits trous tubuleux; les petits tubes de la rangée extérieure, plus longs, forment autour de ce disque comme une corolle. Le motif pour les rapprocher des acéphales à tuyaux, c'est que l'on voit sur un endroit du cône une double saillie qui ressemble réellement à deux valves d'acéphales qui y seraient enchâssées. Plus anciennement, les rapports de ces petits tubes avec ceux qui enveloppent les tentacules de certaines térébelles avaient fait supposer que cet animal appartenait aux annélides.
L'espèce la plus connue, l'Arrosoir de Java, Martini, Conch., I, pl. 1, f. 7, est longue de sept ou huit pouces. (1)
DEUXIÈME ORDRE DES ACÉPHALES.
LES ACÉPHALES SANS COQUILLES (2).
Sont en très petit nombre et s'éloignent assez des acéphales ordinaires pour que l'on pût en faire une classe distincte si on le jugeait convenable. Leurs branchies prennent des formes diverses, mais ne sont jamais divisées en quatre feuillets; la coquille est remplacée par une substance cartilagineuse, quelquefois si mince qu'elle est flexible comme une membrane.
Nous en faisons deux familles; la première com-
(1) Aj. l'Arrosoir à manchettes. Sav., Ég., coq., pl. XIV, f. 9.
(2) C'est ce que M. de Blainville a nommé depuis Acéphalophores hétérobranches. Quant à M. de Lamark, il en fait une classe à part qu'il nomme TUNICIERS, et qu'il place entre ses radiaires et ses vers; mais ces animaux ayant un cerveau, des nerfs, un cœur, des vaisseaux, un foie, etc., cette collocation est inadmissible.
[page] 163
prend les genres dont les individus sont isolés et sans connexion organique les uns avec les autres, quoiqu'ils vivent souvent en société.
LES BIPHORES. Brug. (THALIA. Brown. SALPA et DAGYSA. Gm.)
Ont le manteau et son enveloppe cartilagineuse ovales ou cylindriques, et ouverts aux deux bouts. Du côté de l'anus, l'ouverture est transverse, large et munie d'une valvule, qui permet seulement l'en trée de l'eau, et non pas sa sortie; du côté de la bouche, elle est simplement tubuleuse. Des bandes musculaires embrassent le manteau et contractent le corps. L'animal se meut en faisant entrer de l'eau par l'ouverture postérieure, qui a une valvule, et en la faisant sortir par celle du côté de la bouche, ensorte qu'il est toujours poussé en arrière, ce qui a fait prendre, par quelques naturalistes, son ouverture postérieure pour sa véritable bouche (1). Il nage aussi généralement le dos en bas. Ses branchies forment un seul tube ou ruban muni de vaisseaux réguliers, placé en écharpe dans le milieu de la cavité tubuleuse du manteau, ensorte que l'eau le frappe sans cesse en traversant cette cavité (2). Le cœur, les viscères et le foie sont pelotonnés près de la bouche et du côté du dos; mais la position de l'ovaire varie. Le manteau et son enveloppe brillent au soleil des couleurs de l'iris, et
(1) C'est ce qui est arrivé encore à M. de Chamisso, dans sa Diss. des Salpa. Berlin, 1819, et à d'autres d'après lui; mais il est évident que de ce qu'un animal nage le dos en bas et la tête en arrière, ce n'est pas une raison pour changer les dénominations de ces parties. C'est ainsi que l'on s'est mépris sur l'organisation des Ptérotrachées, parce qu'elles nagent toujours le dos en bas; ce qui arrive du reste à une infinité de Gastéropodes avec ou sans coquille.
(2) Quelques auteurs disent que ce tube est percé aux deux bouts, et que l'eau le traverse; c'est ce dont j'ai cherché inutilement à m'assurer.
11*
[page] 164
sont si transparents, que l'on voit au travers toute natomie de l'animal: dans beaucoup d'espèces ils ont des tubercules perforés. On a vu quelquefois l'animal sortir de son enveloppe sans paraître souffrir. Ce que les biphores offrent de plus curieux, c'est que pendant long-temps ils restent unis ensemble, comme ils l'étaient dansl'ovaire, et nagent ainsi en longues chaînes, où les individus sont disposés en différents ordres, mais toujours selon le même dans chaque espèce.
M. de Chamisso assure avoir constaté un fait beaucoup plus singulier encore, c'est que les individus qui sont sortis ainsi d'un ovaire multiple n'en ont point de pareil, mais produisent seulement des individus isolés et assez différents pour la forme, qui, eux, donnent des ovaires pareils à celui dont est sortie leur mère, en sorte qu'il y aurait alternativement une génération peu nombreuse d'individus isolés, et une génération nombreuse d'individus aggrégés, et que ces deux générations alternantes ne se ressembleraient pas (1).
Il est certain que l'on observe dans quelques espèces de petits individus adhérents dans l'intérieur des grands par une sorte de petit suçoir particulier et d'une forme différente de ceux qui les contiennent (2).
On trouve de ces animaux en abondance dans la Méditerranée et les parties chaudes de l'Océan; ils sont souvent doués de phosphorescence.
Les THALIA, Brown. ont une petite crête ou nageoire verticale vers le bout postérieur du dos (3).
(1) Chamisso, loc. cit. 1, p. 4.
(2) Voyez mon Mém. sur les Biphores, fig. 11.
(3) Holothuria Thalia, Gm., Br., Jam., XLIII, 3; — H. caudata, ib., 4; — H. denudata, Encycl. méthod., vers, LXXXVIII; — Salpa cristata, Cuv., Ann. Mus., IV, LXVIII, 1, représenté sous le nom de Dagysa, Home, Lect. on comp. anat., II, LXIII; — Salpa pinnata, Forsk., XXXV, B.
[page] 165
Parmi les SALPA proprement dits, les uns ont, dans l'épaisseur du manteau, au-dessus de la masse des viscères, une plaque gélatineuse, de couleur foncée, qui pourrait être un vestige de coquille (1).
D'autres n'y ont qu'une simple proéminence de la même substance que le reste du manteau, mais plus épaisse (2).
D'autres n'ont ni plaque ni proéminence, mais leur man teau est prolongé de quelques pointes, et parmi ceux là,
Il y en a qui ont une pointe à chaque extrémité (3).
D'autres en ont deux à l'extrémité la plus voisine de la bouche (4), et même trois et davantage (5).
Quelques-unes n'en ont qu'une à cette même extrémité (6).
Le plus grand nombre est simplement ovale ou cylindrique (7).
LES ASCIDIES. (ASCIDIA. Lin.) Thetyon des Anciens.
Ont le manteau et son enveloppe cartilagineuse, qui
(1) Salpa scutigera, Cuv., Ann. Mus., IV, LXVIII, 4, 5, probablement le même que le Salpa gibba, Bosc, vers, II, XX, 5.
(2) Salpa Tilesii, Cuv., loc., cit., 3; — S. punctata, Forsk., XXV, C.; — S. pelagica, Bosc., loc. cit., 4; — S. infundibuliformis, Quoy et Gaym., Voyage de Freyc., Zool. 74, f. 13.
(3) Salpa maxima, Forsk., XXXV, A.; — S. fusiformis, Cuv., loc., cit., 10, peut-être le même que Forsk., XXXVI; — S. mucronata, ib., D.; — S. aspera, Chamisso, f. IV.; — S. runcinata, id., f. V, G. H. I. Mais selon l'auteur, c'est la génération aggrégée d'une espèce dont l'autre génération est cylindrique.
(4) Salpa democratica, Forsk., XXXVI, G.; — S. longicauda, Quoy et Gaym. Voyage de Freyc., pl. 73, f. 8; — S. costata, ib., f. 2.
(5) S. tricuspis, ib., f. 6; — S. Spinosa, Otto., Nov. act. nat. Cur., t., pl. XLII, f. 1.
(6) Holothuria zonaria, Gm., Pall., Spic., X, I, 17; — Thalia lingulata, Blumenb., Abb, 30.
(7) Salpa octofora, Cuv., loc. cit., 7; peut-être le même que les petits Dagysa, Home, loc. cit., LXXIII, 1; — S. africana, Forsk., XXXVI, C.; — S. fasciata, ib., D.; — S. confederata, ib., A.; peut-être le même que S. gibba, Bosc., loc. cit., 1, 2, 3; — S. polycratica, ib., F.; — S. cylindrica, Cuv., loc. cit., 8 et 9; — Dagysa strumosa, Home, l. c., LXXI, 1; — S. ferruginea, Chamiss., X; — S. cœrulescens, id. IX; — S. vaginata, id., VII; et plusieurs autres.
[page] 166
est souvent très épaisse, en forme de sacs, fermés de toute part, excepté à deux orifices qui répondent aux deux tubes de plusieurs bivalves, et dont l'un sert de passage à l'eau, et l'autre d'issue aux excréments. Leurs branchies forment un grand sac, au fond duquel est la bouche, et près de cette bouche est la masse des viscères. L'enveloppe est beaucoup plus ample que le manteau proprement dit. Celui-ci est fibreux et vasculaire; on y voit un des ganglions entre les deux tubes. Ces animaux se fixent aux rochers et aux autres corps, et sont privés de toute locomotion; leur principal signe de vie consiste dans l'absorption et l'évacuation de l'eau par un de leurs orifices; ils la lancent assez loin quand on les inquiète. On en trouve en grand nombre dans toutes les mers, et il y en a que l'on mange (1).
(1) Tout le genre Ascidia de Gm., auquel il faut ajouter l'Asc. gelatina, Zool. dan., XLIII; — l'Asc. pyriformis, ib., CLVI; — le Salpa sipho, Forsk., XLIII, C.; — l'Ascidia microcosmus, Redi, opusc., III, Planc., app., VII, le même que l'Asc. sulcata, Coquebert, Bullet. des Sc., avr. 1797, I, 1; — l'Asc. glandiformis, Coqueb., ib. — N. B. que l'Ascidia canina, Müll., Zool. dan., LV, Asc. intestinalis, Bohatsch., X, 4; peut-être même Asc. patula, Müll., LXV, et A. corrugata, id., LXXIX, 2, ne paraissent qu'une espèce. Il y a aussi quelques interversions de synonymie, et en général, les espèces sont loin d'être encore bien déterminées.
M. Savigny, d'après ses observations et les miennes, a essayé de subdiviser les Ascidies en plusieurs sous-genres (dans la deuxième partie de ses Mém. sur les An. sans vert, Paris 1816), tels que
Les CYNTHIES dont le corps est sessile et le sac branchial plissé longitudinalement; leur test est coriace;
Les PHALLUSIES qui diffèrent des précédentes parce que leur sac branchial n'est pas plissé; leur test est gélatineux;
Les CLAVELLINES qui ont le sac branchial sans plis, ne pénétrant pas jusqu'au fond de l'enveloppe, et dont le corps est porté sur un pédoncule; leur test est gélatineux;
Les BOLTENIES dont le corps est pédiculé et l'enveloppe coriace.
Il prend aussi en considération le nombre et la forme des tentacules qui entourent intérieurement l'orifice branchial; mais ces caractères, en partie anatomiques, ne peuvent être encore appliqués avec sûreté à un grand nombre d'espèces.
M. Makleay (Trans. Lin., XIV, 3e part.), en établit encore deux autres, CYSTINGIA et DENDRODOA, fondés sur des caractères de même nature.
[page] 167
Quelques espèces sont remarquables par le long pédoncule qui les supporte (1).
La deuxième famille des acéphales sans coquille,
LES AGGRÉGÉS,
Comprend des animaux plus ou moins analogues aux ascidies, mais réunis en une masse commune, de sorte qu'ils paraissent communiquer organiquement ensemble, et que sous ce rapport ils sembleraient lier les mollusques aux zoophytes; mais ce qui, indépendamment de leur organisation propre, s'oppose à cette idée, c'est que, d'après les observations de MM. Audouin et Milne - Edwards, les individus vivent et nagent d'abord séparés, et ne se réunissent qu'à une certaine époque de leur vie.
Leurs branchies forment, comme dans les ascidies, un grand sac que les aliments doivent traverser avant d'arriver à la bouche; leur principal ganglion est de même entre la bouche et l'anus; la disposition des viscères et de l'ovaire est à peu près semblable (2).
(1) Ascidia pedunculata, Edw., 356; et Asc. clavata ou Vorticella boltenii. Gm.
(2) C'est M. Savigny qui a fait connaître récemment l'organisation singulière de toute cette famille, que l'on confondait autrefois avec les Zoophytes proprement dits. En même temps, MM. Desmarets et Lesueur faisaient connaître la structure particulière des Botrylles et des Pyrosomes. Voyez l'excellent travail de M. Savigny, dans ses Mémoires sur les animaux sans vertèbres, deuxième partie, premier fascicule.
[page] 168
Néanmoins les uns ont, comme les biphores, une ouverture à chaque extrémité.
Tels sont
LES BOTRYLLES (BOTRYLLUS. Gærtn.)
Qui sont de forme ovale, fixés sur divers corps et réunis à dix ou douze comme des rayons d'une étoile; les orifices branchiaux sont aux extrémités extérieures des rayons, et les anus aboutissent à une cavité commune qui est au centre de l'étoile. Quand on irrite un orifice, un animal seul se contracte; si on irrite le centre, ils se contractent tous. Ces très petits animaux s'attachent sur certaines ascidies, sur certains fucus, etc. (1).
Dans certaines espèces, trois ou quatre étoiles paraissent empilées l'une sur l'autre (2).
LES PYROSOMES (PYROSOMA. Péron.)
Sont réunis en très grand nombre pour former un grand cylindre creux, ouvert par un bout, fermé par l'autre, qui nage dans la mer par les contractions et les dilatations combinées de tous les animaux particuliers qui le composent. Ceux-ci se terminent en pointe à l'extérieur, en sorte que tout le dehors du tube est hérissé; les orifices branchiaux sont percés près de ces pointes, et les anus donnent dans la cavité intérieure du tube. Ainsi l'on pourrait comparer un pyrosome à un grand nombre d'étoiles de botrylles enfilées les unes à la suite des autres, mais dont l'ensemble serait mobile (3).
(1) Voyez Desmarets et Lesueur, Bullet. des Sc., mai 1815; — Botryllus stellatus, Gærtner, ou Alcyonium Schlosseri, Gm.; Pall., Spicil. Zool., X, IV, 1–5.
(2) Botryllus conglomeratus, Gærtn., ou Alcyonium conglomeratum, Gm.; Pall., Spic. zool., X, IV, 6.
(3) Voyez Desmarets et Lesueur, loc., cit.
[page] 169
La Méditerranée et l'Océan en produisent de grandes espèces, dont les animaux sont disposés peu régulièrement. Elles brillent pendant la nuit de tout l'éclat du phosphore (1).
On en connaît aussi une petite, où les animaux sont rangés par anneaux très réguliers (2).
Les autres de ces mollusques aggrégés ont, comme les ascidies ordinaires, l'anus et l'orifice branchial rapprochés vers la même extrémité. Tous ceux qu'on connaît sont fixés, et on les avait jusqu'ici confondus avec les alcyons. La masse des viscères de chaque individu est plus ou moins prolongée dansla masse cartilagineuse ou gélatineuse commune, plus ou moins rétrécie ou dilatée en certains points; mais chaque orifice représente toujours à la surface une petite étoile à six rayons.
Nous les réunissons sous le nom de
POLYCLINUM (3).
Les uns s'étendent sur les corps comme des croûtes charnues (4).
D'autres s'élèvent en masse conique ou globuleuse (5),
(1) Plusieurs des Polyclinum et des Aplidium de Sav.
(2) Pyrosoma atlanticum, Péron. Annal. Mus., IV, LXXII;—le Pyrosome géant, Desmarets et Lesueur, Bull. des Sc., mai 1815, pl. 1, f. 1.
(3) Le Pyrosome élégant, Lesueur, Bullet. des Sc., juin 1815, pl. V, f. 2.
(4) C'est d'après le nombre des étranglements, c'est-à-dire le plus ou moins de séparation de la branchie, de l'estomac et de l'ovaire, que M. Savigny a formé ses genres Polyclinum, Aplidium, Didemmum, Eucælium, Diazona, Sigillina, etc. qu'il ne nous paraît pas nécessaire de conserver. Ici doivent encore venir l'Alcyonium ficus, Gm.; le Distomus variolosus, Gærtn. ou Alcyonium ascidioïdes, Gm., Pall., Spic., Zool., X, IV, 7.
(5) Les Eucœlium, Sav.; les Distomus sont disposés de même.
[page] 170
Ou s'étalent en disque comparable à une fleur ou à une actinie (1), ou s'alongent en branches cylindriques portées par des pédicules plus minces, etc. (2), ou se groupent parallèlement en cylindres (3).
Il paraît même d'après des observations récentes que les ESCHARES rangées jusqu'à présent parmi les polypiers, appartiennent à des mollusques de cette famille (4).
LA CINQUIÈME CLASSE DES MOLLUSQUES,
LES MOLLUSQUES BRACHIOPODES (5).
Ont, comme les acéphales, un manteau à deux lobes, et ce manteau est toujours ouvert; au lieu de pied ils ont deux bras charnus, et garnis de nombreux filaments, qu'ils peuvent étendre hors de la coquille et y retirer; la bouche est entre les bases des bras. On ne connaît pas bien leurs organes de la génération ni leur système nerveux.
Tous les brachiopodes sont revêtus de coquilles bivalves, fixés, et dépourvus de locomotion. L'on n'en connaît que trois genres.
LES LINGULES. (LINGULA. Brug.)
Ont deux valves égales, assez plates, oblongues, ayant
(1) Le genre Diazona, Sav. composé d'une belle et grande espèce de couleur pourprée, découverte près d'Ivice par M. Delaroche.
(2) Le genre Sigillina, Sav., dont les branches cylindriques ont souvent un pied de long, et les animaux, minces comme des fils, trois à quatre pouces.
(3) Le genre Synoicum, Lam.
(4) MM. Audouin et Milne Edwards d'un côté, et M. de Blainville de l'autre, viennent de constater ce fait, que les observations de Spallauzani semblaient déjà annoncer.
(5) M. de Blainville a donné à mes BRACHIOPODES, le nom de PALLIOBRANCHES, et il en fait un ordre dans sa classe des ACÉPHALOPHORES.
[page] 171
les sommets au bout d'un des côtés étroits, baîllantes par le bout opposé, et attachées entre les deux sommets à un pédicule charnu, qui les suspend aux rochers; leurs bras se roulent en spirale pour rentrer dans la coquille. Il paraît que leurs branchies consistent en petits feuillets, rangés tout autour de chaque lobe du manteau à sa face interne.
On n'en connaît qu'une, de la mer des Indes (Lingula anatina, Cuv. Ann. Mus. I, VI, Séb. III, XVI, 4), à valves minces, cornées et verdâtres (1).
LES TÉRÉBRATULES (TEREBRATULA. Brug.)
Ont deux valves inégales, jointes par une charnière; le sommet de l'une, plus saillant que l'autre, est percé pour laisser passer un pédicule charnu, qui attache la coquille aux rochers, aux madrépores, à d'autres coquilles, etc. On remarque à l'intérieur une petite charpente osseuse, quelquefois assez compliquée, composée de deux branches qui s'articulent à la valve non percée et qui supportent deux bras bordés tout autour de longues franges serrées, entre lesquelles est, du côté de la grande valve, un troisième lambeau simplement membraneux, beaucoup plus long, ordinairement roulé en spirale, et bordé comme les bras de nombreuses franges fines et serrées. La bouche est une petite fente verticale entre ces trois grandes productions. Le corps principal de l'animal, situé vers la charnière, contient les muscles nombreux qui vont d'une valve à l'autre,
(1) Linn. qui n'en connaissait qu'une valve, l'appela Patella unguis. Solander et Chemnitz qui surent qu'elle a deux valves, lui donnèrent l'un le nom de Mytilus lingua, l'autre celui de Pinna unguis. Bruguières connut son pédicule, et en fit en conséquence un genre sous le nom de Lingule, Encycl. méth., vers, pl. 250. Ce qui est singulier, c'est que personne n'avait remarqué avant nous que Séba, loc. cit., la représente très bien avec son pédicule.
[page] 172
et entre eux les viscères qui n'occupent qu'un bien petit espace. Les ovaires paraissent deux productions ramifiées adhérentes aux parois de chaque valve. Je n'ai pu encore m'assurer exactement de la position des branchies.
On trouve une quantité innombrable de térébratules à l'état fossile ou pétrifié dans certaines couches secondaires d'anciennes formations (1). Les espèces sont moins nombreuses dans la mer actuelle (2).
Il y en a à coquille plus large transversalement, ou plus longue dans le sens perpendiculaire à la charnière; à contour entier, ou échancré, ou trilobé ou à plusieurs lobes; il y en a même de triangulaires; leur surface peut être lisse, ou sillonnée en rayons, ou veinée; elles peuvent être épaisses, ou minces, et même transparentes. Dans plusieurs, au lieu d'un trou au sommet de la valve mince, il y a uneéchancrure, et cette échancrure est quelquefois formée en partie par deux pièces accessoires, etc. Il est probable que leurs animaux lorsqu'on les connaîtra mieux, offriront des différences génériques.
Déjà on a reconnu dans
Les SPIRIFÈRES. (SPIRIFER.) Sowerby.
Deux grands cônes formés d'un filet en spirale, qui paraissent avoir été les supports de l'animal (3).
(1) M. Defrance en a distingué plus de deux cents.
(2) Anomia scobinata, Gualt., 96, A.; — An. aurita, id., ib., B.; — An. retusa; — An. truncata, Chemn., VIII, LXXVII, 711; — An. capensis, ib., 703; — An. pubescens, id., LXXVIII, 702; — An. detruncata, ib., 705; — An. sanguinolenta, ib., 706; — — An, vitrea, ib., 707, 709; — An. dorsata, ib., 710, 711; An. psittacea, ib., 713; — An. cranium, etc.
Pour les espèces fossiles, voyez les pl. 239–246 des vers de l'Encycl. méthodique.
(3) Voyez sur ce genre la conchiol. minér. de Sowerby, et l'article spirifère de M. Defrance. Dict. des Sc. nat., tom. L.
[page] 173
Dans
Les THÉCIDÉES. (THECIDEA.) Def.
Le support semble s'être incorporé à la petite valve (1).
LES ORBICULES. (ORBICULA. Cuv.)
Ont deux valves inégales, dont l'une, ronde et conique, ressemble, quand on la voit seule, à une coquille de patelle; l'autre est plate et fixée aux rochers. L'animal (Criopus, Poli) a les bras ciliés et recourbés en spirale comme celui des lingules.
Nos mers en produisent une petite espèce, Patella anomala. Müll. Zool. Dam. V, 2–6. Anomia turbinata. Poli. XXX, 15. Brett. Sowerb. trans. Linn. XIII, pl. XXVI, f. 1.
Les DISCINES, Lam., sont des orbicules dont la valve inférieure est creusée d'une fente.
On a dû rapprocher des orbicules,
Les CRANIES. (CRANIA. Brug.)
Dont l'animal a aussi des bras ciliés, mais dont les coquilles ont intérieurement des impressions musculaires rondes et profondes qui lui ont fait trouver quelque rapport avec une figure de tête de mort.
Il y en a une dans nos mers (Anomia craniolaris, Linn., ou Crania personata, Bret. Sowerby, Trans. lin., XIII, pl. XXVI, f. 3). Il y en a plusieurs parmi les fossiles, tels que Cr. antiqua, et les autres dont M. Hœninghaus a donné une belle monographie.
(1) Thecid. mediterranea, Risso., Hist. nat. de la Fr. mérid., IV, f. 183; — Th. radiata, Fauj. mont. de Saint-Pierre, pl. XXVII, f. 8. Des observations plus précises me paraissent nécessaires avant de pouvoir placer les MAGAS de Sowerby, les STRIGOCÉPHALES de Defrance, et quelques autres groupes voisins de ceux-là.
[page] 174
SIXIÈME CLASSE DES MOLLUSQUES,
LES MOLLUSQUES CIRRHOPODES (1),
(LEPAS et TRITON. Linn.)
Établissent, par plusieurs rapports, une sorte d'intermédiaire entre cet embranchement et celui des animaux articulés: Enveloppés d'un manteau et de pièces testacées qui se rapprochent souvent de ce que l'on voit dans plusieurs acéphales, ils ont à la bouche des mâchoires latérales, et le long du ventre des filets nommés cirres, disposés par paires, composés d'une multitude de petites articulations ciliées, et représentant des espèces de pieds ou de nageoires, comme celles qu'on voit sous la queue de plusieurs crustacés; leur cœur est situé dans la partie dorsale et leurs branchies sur les côtés; leur système nerveux forme, sous le ventre, une série de ganglions. Cependant on peut dire que ces cirres ne sont que les analogues des battants articulés de certains tarets, tandis que les ganglions ne sont à quelques égards que des répétitions du ganglion postérieur des bivalves. Ces animaux sont placés dans leur coquille de manière que la bouche est dans le fond, et les
(1) M. Delamark a changé ce nom en CIRRIPÈDES, et il en fait une classe. M. de Blainville en fait aussi une classe; mais il en change le nom en NÉMATOPODES, et il l'associe avec les oscabrions, dans ce qu'il nomme son type des MALENTOZAIRES.
[page] 175
cirres vers l'orifice. Entre les deux derniers cirres est un long tube charnu qu'on a pris quelquefois mal à propos pour leur trompe, et à la base duquel, vers le dos, est l'ouverture de l'anus. A l'intérieur on observe un estomac boursoufflé par une multitude de petites cavités de ses parois qui paraissent remplir les fonctions de foie; un intestin simple, un double ovaire, et un double canal serpentin que les œufs doivent traverser, dont les parois produisent la liqueur prolifique et qui se prolonge dans le tube charnu pour s'ouvrir à son extrémité. Ces animaux sont toujours fixés; Linnæus n'en faisait qu'un genre (les LEPAS), que Bruguières a divisé en deux, eux-mêmes subdivisés plus nouvellement (1).
LES ANATIFES (ANATIFA. Brug.)
Dont le manteau, comprimé, ouvert d'un côté et suspendu à un tube charnu, varie beaucoup pour le nombre de pièces testacées qui le garnissent. Les anatifes ont douze paires de cirres, six de chaque côté; les plus près de la bouche sont les plus courts et les plus gros. Leurs branchies sont des appendices en pyramides alongées, adhérentes à la base extérieure de tout ou partie de ces cirres.
Dans les espèces les plus nombreuses (PENTALASMIS,
(1) Ce nom de lepas appartenait autrefois aux Patelles. Linnæus supposant qu'il existe aussi de ces cirrhopodes sans coquilles, leur donnait alors le nom de TRITON; mais l'existence de ces TRITONS dans la nature ne s'est pas confirmée, et l'on doit croire que Linnæus n'avait vu qu'un animal d'anatife arraché de sa coquille.
[page] 176
Leach), les deux principales valves ressembleraient assez à celles d'une moule; deux autres semblent compléter une partie du bord de la moule opposé au sommet, et une cinquième, impaire, réunit le bord postérieur à celui de la valve opposée; ces cinq pièces garnissent la totalité du manteau. De l'endroit où serait le ligament, naît le pédicule charnu; un fort muscle transverse réunit les deux premières valves près de leur sommet; la bouche de l'animal est cachée derrière lui, et l'extrémité postérieure de son corps avec tous ses petits pieds articulés, sort un peu plus loin entre les quatre premières valves.
L'espèce la plus répandue dans nos mers (Lepas anatifera, L.), a pris ce nom d'anatifère, à cause de la fable qui en faisait naître les bernaches ou les macreuses, fable qui tient sans doute à la ressemblance grossière qu'on a trouvée entre les pièces de cette coquille et un oiseau. Les anatifes s'attachent aux rochers, aux pieux, aux quilles des navires, etc. (1)
On peut en distinguer:
LES POUCE-PIEDS. (POLLICIPES. Leach.)
Qui outre les cinq valves principales, en ont plusieurs petites vers le pédicule (2); dont quelques-unes, dans certaines espèces, égalent presque les premières (3): souvent il y en a une impaire vis-à-vis l'impaire ordinaire.
(1) Ajoutez Lepas anserifera, Chemn., VIII, C, 856; — Anat. dentata, Brug., Enc. méth., pl. 166, f. 6, ou Pentalasmis falcata, Leach.; Enc. d'Edimb.
(2) Lep. pollicipes, Linn. ou Poll. cornucopia, Leach.; Encycl. méth., pl. 266, f. 10 et 11; — Poll. villosus, Leach., Encycl. Edimb.
(3) Lep. mitella, Chemn., VIII, 849, 850, Encycl. méth., pl. 266, f. 9, ou Polylepe couronné, Blainv., Malac.; — Poll. scalpellum, Chemn. VIII, p. 294, ou Polylep. vulgaire, Blainv., Malac., LXXXIV, f. 4. C'est le genre SCALPELLUM, Leach., loc. cit.
[page] 177
LES CINERAS. Leach.
Dont le manteau cartilagineux renferme cinq valves, mais très petites, et qui n'en occupent pas toute l'étendue (1).
Les OTION. Leach.
Dont le manteau cartilagineux ne contient que deux très petites valves, avec trois petits grains qui à peine méritent ce nom, et porte deux appendices tubuleux en forme d'oreilles (2).
Les TETRALASMIS. Cuv.
N'ont que quatre valves paires entourant l'ouverture, dont deux plus longues. L'animal est en partie contenu dans le pédicule, qui est large et couvert de poil. Ce sont en quelque sorte des balanes sans tube (3).
LES GLANDS DE MER. (BALANUS. Brug.)
Ont pour pièce principale de leur coquille un tube testacé fixé á divers corps, et dont l'ouverture se ferme plus ou moins par deux ou quatre valves ou battants mobiles. Ce tube est formé de divers pans ou compartiments qui paraissent se détacher et s'écarter à mesure que l'accroissement de l'animal l'exige. Les branchies, la
(1) Cineras vittata, Leach, Encycl. Edimb., ou Lepas coriacea Poli., VI, 20, ou Gymnolepas cranchii, Blainv., Malac., LXXXIV, 2.
(2) Otion Cuvieri, Leach, ou Lepas. leporina, Poli., I, VI, 21, ou Lepas aurita, Chemn., VIII, pl. C, f. 857, 858. M. de Blainville réunit les cineras et les otions sous son genre GYMNOLEPE.
(3) Tetral. hirsutus, Cuv., Moll., anatif., f. 14.
N. B. La LITHOTRIE de Sowerby, dont M. de Blainville a changé le nom en Litholepe, pourrait, selon la conjecture de M. Rang, n'être qu'une anatife fixée par hasard dans un trou creusé par quelque bivalve.
Les ALÈPES, Rang, seraient des anatifes dont le manteau cartilagineux ne contiendrait aucune pièce testacée; je n'en ai pas vu. Dans aucun cas il ne faudrait les confondre avec le Triton de Linn., qui était un animal d'anatife, retiré de son manteau et de sa coquille.
TOME III. 12
[page] 178
bouche, les tentacules articulés, le tube servant d'anus, diffèrent peu des anatifes.
Dans
LES BALANES proprement dits.
La partie tubulaire est un cône tronqué, formé de six pans saillants, séparés par autant de pans enfoncés, et dont trois sont plus étroits que les autres. Leur base est le plus souvent formée d'une lame calcaire et fixée sur divers corps. Les quatre valves de leur opercule ferment exactement l'orifice.
Les rochers, les coquilles, les pieux de toutes nos côtes sont pour ainsi dire couverts d'une espèce (Lepas balanus, L.), Chemn., VIII, XCVII, 826 (1).
On en a distingué
Les ACASTES, Leach, dont la base est irrégulière, convexe vers le dehors, et ne se fixe point; la plupart se tiennent dans des éponges (2);
Les CONIES, Blainv., dont le tube n'a que quatre pans saillants (3);
Les ASEMES, Ranzani, dont le tube n'a point de parties saillantes marquées (4);
Les PYRGOMES, Savig., dont la partie tubuleuse en cône très déprimé, n'a qu'un orifice fort petit, presque comme une coquille de fissurelle (5).
(1) Ajoutez Lep. balanoïdes, Chemn., VIII, XCVII, 821–825; — L. tintinnabulum, ib., 828–831; — L. minor, ib., 827; — L. porosa, id., XCVIII, 836; — L. verruca, ib., 840, 841; — L. angustata, ib., 835, — L. elongata, ib., 838; — L. patellaris, ib., 839; — L. spinosa, ib., 840; — L. violacea, id., XCIX, 842; — L. tulipa, Ascan. icon., X, — L. cilindrica, Gronov., Zooph., XIX, 3, 4; — L. cariosa, Pall., nov. act. Petr., II, VI, 24, A. B.
(2) Acasta Montagui, Leach, Encycl. Ed., copié Blainv., Malac., LXXXV, 3; — Lepas spongites, Poli, 1, VI 5.
(3) Conia radiata, Blainv., Malac., LXXXV, 5.
(4) Lepas porosus, Gm., Chemn., VIII, XCVIII, 836, 837, Encycl. méth., pl. 165, f. 9, 10.
(5) Pyrgoma cancellata, Leach, loc. cit., copié Blainv., Mal., LXXXV, 5.
[page] 179
Les OCHTHOSIES, Ranzani, qui n'ont que trois pans saillants et seulement deux valves à l'opercule (1).
Les CREUSIES, Leach, à quatre pans saillants et deux valves à l'opercule (2).
M. Delamarck sépare, sous le nom de CORONULES, des espèces très évasées, où les parois du cône ont des cellules si grandes, qu'elles représentent des espèces de chambres (3).
Et sous celui de TUBICINELLES, des espèces où la partie tubuleuse est assez élevée, plus étroite vers le bas, et divisée en anneaux, qui marquent ses accroissements successifs (4).
Il y en a des unes et des autres qui s'implantent dans la peau des baleines, et pénètrent jusque dans leur lard.
Il faut y ajouter
LES DIADEMES. (DIADEMA. Ranz.)
Dont la partie tubuleuse est presque sphérique, et qui n'ont que deux petites valves presque cachées dans la membrane qui ferme leur opercule. Leurs valves operculaires ne fermeraient pas complétement leur orifice, sans la membrane qui les réunit.
Ils se tiennent aussi sur les baleines, et l'on voit souvent des otions qui s'attachent à leur surface (5).
(1) Lepas Strœmii, Müll., Zool. Dan., III, XCIV, 1–4.
(2) Creusia spinulosa, Leach., loc. cit., copié Blainv., Mal., LXXXV, 6.
(3) Lepas balænaris, L., Chemn., VIII, XCIX, 845, 846; — L. testudinarius, ib., 847, 848. Celui-ci s'attache au test des tortues.
(4) La Tubicinelle, Lam., Ann. Mus., I, XXX, 1, 2.
(5) Lepas diadema, Chemn., VIII, XCIX, 843, 844.
12*
[page] 180
TROISIÈME GRANDE DIVISION
DU RÈGNE ANIMAL.
LES ANIMAUX ARTICULÉS.
Cette troisième forme générale est tout aussi caractérisée que celle des animaux vertébrés; le squelette n'est pas intérieur comme dans ces derniers, mais il n'est pas non plus toujours nul comme dans les mollusques. Les anneaux articulés qui entourent le corps et souvent les membres, en tiennent lieu, et comme ils sont presque toujours assez durs, ils peuvent prêter au mouvement tous les points d'appui nécessaires, en sorte qu'on retrouve ici, comme parmi les vertébrés, la marche, la course, le saut, la natation, le vol. Il n'y a que les familles dépourvues de pieds, ou dont les pieds n'ont que des articles membraneux et mous, qui soit bornées à la reptation. Cette position extérieure des parties dures, et celle des muscles dans leur intérieur, réduit chaque article à la forme d'un étui, et ne lui permet que deux genres de mouvements. Lorsqu'il tient à l'article voisin par une jointure ferme, comme il arrive dans les membres, il y est fixé par deux points, et ne peut se mouvoir que par gyn-
[page] 181
glyme, c'est-à-dire dans un seul plan, ce qui exige des articulations plus nombreuses pour produire une même variété de mouvement. Il en résulte aussi une plus grande perte de force dans les muscles, et par conséquent plus de faiblesse générale dans chaque animal, à proportion de sa grandeur.
Mais les articles qui composent le corps n'ont pas toujours ce genre d'articulation; le plus souvent ils sont unis seulement par des membranes flexibles, ou bien ils emboîtent l'un dans l'autre, et alors leurs mouvements sont plus variés, mais n'ont pas la même force.
Le système d'organes par lequel les animaux articulés se ressemblent le plus, c'est celui des nerfs.
Leur cerveau placé sur l'œsophage et fournissant des nerfs aux parties qui adhèrent à la tête, est fort petit. Deux cordons qui embrassent l'œsophage, se continuent sur la longueur du ventre, se réunissant d'espace en espace par des doubles nœuds ou ganglions, d'où partent les nerfs du corps et des membres. Chacun de ces ganglions semble faire les fonctions de cerveau pour les parties environnantes, et suffire pendant un certain temps à leur sensibilité, lorsque l'animal a été divisé. Si l'on ajoute à cela que les mâchoires de ces animaux, lorsqu'ils en ont, sont toujours latérales, et se meuvent de dehors en dedans, et non de haut en bas, et que l'on n'a encore découvert dans aucun d'eux d'organe bien distinct de l'odorat, on aura exprimé à peu
[page] 182
près tout ce qui s'en laisse dire de général; mais l'existence d'organes de l'ouie; l'existence, le nombre, la forme de ceux de la vue; le produit et le mode de la génération (1), l'espèce de la respiration, l'existence des organes de la circulation, et jusqu'à la couleur du sang, présentent de grandes variétés, qu'il faut étudier dans les diverses subdivisions.
DISTRIBUTION
DES ANIMAUX ARTICULÉS EN QUATRE CLASSES.
Les animaux articulés, qui ont entre eux des rapports aussi variés que nombreux, se présentent cependant sous quatre formes principales, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur.
LES ANNÉLIDES, Lam., ou VERS A SANG ROUGE, Cuv., constituent la première. Leur sang, généralement coloré en rouge, comme celui des animaux vertébrés, circule dans un système double et clos d'artères et de veines, qui a quelquefois un ou plusieurs cœurs ou ventricules charnus assez marqués; il respire dans des organes qui tantôt se développent au dehors, tantôt restent à la surface de la peau ou s'enfoncent dans son intérieur. Leur corps, plus ou moins alongé,
(1) Une découverte remarquable à ce sujet est celle de M. Hérold, que dans l'œuf des crustacés et des arachnides, le vitellus communique par le dos avec l'intérieur. Voyez sa dissert. sur l'œuf des araignées, Marburg, 1824, et celle de M. Rathke, sur l'œuf des écrevisses, Leipzig, 1829.
[page] 183
est toujours divisé en anneaux nombreux, dont le premier, qui se nomme tête, est à peine différent des autres, si ce n'est par la présence de la bouche et des principaux organes des sens. Plusieurs ont leurs branchies uniformément répandues sur la longueur de leur corps ou sur son milieu; d'autres, et ce sont en général ceux qui habitent des tuyaux, les ont toutes à la partie antérieure. Jamais ces animaux n'ont de pieds articulés; mais le plus grand nombre porte au lieu de pieds des soies ou des faisceaux de soies roides et mobiles. Ils sont généralement hermaphrodites, et quelques-uns ont besoin d'un accouplement réciproque. Leurs organes de la bouche consistent tantôt en mâchoires plus ou moins fortes, tantôt en un simple tube; ceux des sens extérieurs en tentacules charnus, et quelquefois articulés, et en quelques points noirâtres que l'on regarde comme des yeux, mais qui n'existent pas dans toutes les espèces.
Les CRUSTACÉS constituent la seconde forme ou classe des animaux articulés. Ils ont des membres articulés, et plus ou moins compliqués, attachés aux côtés du corps. Leur sang est blanc; il circule par le moyen d'un ventricule charnu placé dans le dos, qui le reçoit des branchies situées sur les côtés du corps, ou sous sa partie postérieure, et où il retourne par un canal ventral quelquefois double. Dans les dernières espèces, le cœur ou ventricule dorsal s'alonge lui-même en canal. Ces animaux ont
[page] 184
tous des antennes ou filaments articulés, attachés au-devant de la tête, presque toujours au nombre de quatre, plusieurs mâchoires transversales, et deux yeux composés. C'est dans quelques-unes de leurs espèces seulement que l'on trouve une oreille distincte.
La troisième classe des animaux articulés est celle des ARACHNIDES, qui ont, comme un grand nombre de crustacés, la tête et le thorax réunis en une seule pièce, portant de chaque côté des membres articulés, mais dont les principaux viscères sont renfermés dans un abdomen attaché en arrière de ce thorax; leur bouche est armée de mâchoires et leur tête porte des yeux simples en nombre variable; mais ils n'ont jamais d'antennes. Leur circulation se fait par un vaisseau dorsal qui envoie des branches artérielles, et en reçoit de veineuses; mais leur respiration varie, les uns ayant encore de vrais organes pulmonaires qui s'ouvrent aux côtés de l'abdomen, les autres recevant l'air par les trachées, comme les insectes. Les uns et les autres ont cependant des ouvertures latérales, de vrais stygmates.
Les INSECTES sont la quatrième classees animaux articulés, et en même temps la plus nombreuse de tous le règne animal. Excepté quelques genres (les myriapodes) dont le corps se divise en un assez grand nombre d'articles à peu près égaux, ils l'ont partagé en trois parties: la tête qui porte les antennes, les yeux et la bouche; le thorax ou corselet qui porte les pieds et les ailes quand il y en
[page] 185
a; et l'abdomen qui est suspendu en arrière du thorax et renferme les principaux viscères. Les insectes qui ont des ailés ne les reçoivent qu'à un certain âge, et passent souvent par deux formes plus ou moins différentes avant de prendre celle d'insecte ailé. Dans tous leurs états ils respirent par des trachées, c'est-à-dire par des vaisseaux élastiques qui reçoivent l'air par des stygmates percés sur les côtés, et le distribuent en se ramifiant à l'infini dans tous les points du corps. On n'aperçoit qu'un vestige de cœur, qui est un vaisseau attaché le long du dos, et éprouvant des contractions alternatives, mais auquel on n'a pu découvrir de branches; en sorte que l'on doit croire que la nutrition des parties se fait par imbibition. C'est probablement cette sorte de nutrition qui a nécessité l'espèce de respiration propre aux insectes, parce que le fluide nourricier qui n'était point contenu dans des vaisseaux (1), ne pouvant être dirigé vers des organes pulmonaires circonscrits pour y chercher l'air, il a fallu que l'air se répandît par tout le corps pour y atteindre le fluide. C'est aussi pourquoi les insectes n'ont point de glandes sécrétoires, mais seulement de longs vaisseaux spongieux qui paraissent absorber
(1) M. Carus a reconnu des mouvements réguliers dans le fluide qui remplit le corps de certaines larves d'insectes; mais ces mouvements n'ont pas lieu dans un système clos de vaisseaux, comme dans les animaux supérieurs. Voyez son Traité, intitulé: Découverte d'une circulation simple du sang, etc., en allem. Leipzig, 1827, in-4°.
[page] 186
par leur grande surface, dans la masse du fluide nourricier, les sucs propres qu'ils doivent produire (1).
Les insectes varient à l'infini par les formes de leurs organes de la bouche et de la digestion, ainsi que par leur industrie et leur manière de vivre; leurs sexes sont toujours séparés.
Les crustacés et les arachnides ont été long-temps réunis avec les insectes sous un nom commun, et leur ressemblent à beaucoup d'égards pour la forme extérieure, et pour la disposition des organes du mouvement, des sensations et même de la manducation.
PREMIÈRE CLASSE DES ANIMAUX ARTICULÉS.
LES ANNÉLIDES (2).
Sont les seuls animaux sans vertèbres qui aient le sang rouge. Il circule dans un double système de vaisseaux compliqués (3).
(1) Voyez, à ce sujet, mon Mémoire sur la nutrition des insectes, imprimé en 1799 dans ceux de la Soc. d'Hist. nat. de Paris. Baudouin, an VII, in-4°, pag. 32.
(2) Jai établi cette classe, en la distinguant par la couleur de son sang et d'autres attributs, dans un mémoire lu à l'Institut en 1802. Voyez Bullet. des Sc., messid. an X, où j'ai fait connaître principalement ses organes circulatoires.
M. Lamarck l'a adoptée et nommée Annélides, dans l'extrait de son cours de Zoologie, imprim. en 1812.
Auparavant Bruguières la réunissait à l'ordre des vers intestins; et plus anciennement encore Linnæus en plaçait une partie parmi les mollusques et une autre parmi les intestinaux.
(3) On a dit que les aphrodites n'ont pas le sang rouge. Je crois avoir observé le contraire dans l'Aphrodita squamata.
[page] 187
Leur système nerveux consiste dans un double cordon noueux, comme celui des insectes.
Leur corps est mou, plus ou moins alongé, divisé en un nombre souvent très considérable de segments ou au moins de plis transversaux.
Presque tous vivent dans l'eau (les vers de terre ou lombrics exceptés); plusieurs s'y enfoncent dans des trous du fonds, ou s'y forment des tuyaux avec de la vase, ou d'autres matières, ou transsudent même une matière calcaire qui leur produit une sorte de coquille tubuleuse.
DIVISION
DES ANNÉLIDES EN TROIS ORDRES.
Cette classe peu nombreuse, offre dans ses organes respiratoires des bases de divisions suffisantes.
Les uns ont des branchies en forme de panaches ou d'arbuscules, attachées à la tête ou sur la partie antérieure du corps; presque tous habitent dans des tuyaux. Nous les appellerons TUBICOLES.
D'autres ont sur la partie moyenne du corps, ou tout le long de ses côtés, des branchies en forme d'arbres, de houppes, de lames, ou de tubercules, où des vaisseaux se ramifient; la plupart vivent dans la vase, ou nagent librement dans la mer; le plus petit nombre a des tuyaux. Nous les nommons DORSIBRANCHES.
[page] 188
D'autres enfin n'ont point de branchies apparentes et respirent, ou par la surface de la peau, ou, comme on le croit de quelques-uns, par des cavités intérieures. La plupart vivent librement dans l'eau ou dans la vase; quelques-uns seulement dans la terre humide. Nous les appelons ABRANCHES.
Les genres des deux premiers ordres ont tous des soies roides et de couleur métallique sortant de leurs côtés, tantôt simples, tantôt en faisceaux, et leur tenant lieu de pieds; mais dans le troisième ordre il se trouve quelques genres dépourvus de ces soutiens (1).
L'étude spéciale que M. Savigny a faite de ces pieds ou organes de locomotion, y a fait distinguer, 1° le pied même ou le tubercule qui porte les soies; tantôt il n'y en a qu'un a chaque anneau; tantôt il y en a deux au-dessus l'un de l'autre, et c'est ce que l'on nomme rame simple ou double; 2° les soies qui composent un faisceau pour chaque rame et varient beaucoup pour la forme, et pour la consistance; tantôt formant de vraies épines, tantôt des soies fines et flexibles, souvent dentelées, bar-
(1) M. Savigny a proposé une division des annélides, selon qu'elles ont des soies pour la locomotion, ou qu'elles en manquent: ces dernières se réduisent aux sangsues. M. de Blainville, qui a adopté cette idée, fait des Annélides qui ont des soies, sa classe des ENTOMOZOAIRES CHÉTOPODES, et de celles qui n'en ont pas, celle des ENTOMOZOAIRES APODES, mais ce que M. Savigny n'avait point fait, il entremèle dans les apodes beaucoup de vers intestinaux.
[page] 189
belées, en flèches, etc. (1); 3° les cirrhes ou filaments charnus adhérents soit au-dessus soit au-dessous des pieds.
Quant à leurs organes des sens, les annélides des deux premiers ordres portent généralement à la tête des tentacules ou filaments auxquels, malgré leur consistance charnue, quelques Modernes donnent le nom d'antennes, et plusieurs genres du second et du troisième ont des points noirs et luisants que l'on a sujet de regarder comme des yeux. L'organisation de leur bouche varie beaucoup.
PREMIER ORDRE DES ANNÉLIDES,
LES TUBICOLES. (Vulg. PINCEAUX DE MER. (2)
Les uns se forment un tube calcaire, homogène, résultant probablement de leur transsudation comme la coquille des mollusques, auquel cependant ils n'adhèrent point par des muscles; d'autres se le construisent en agglutinant des grains de sable,
(1) Voyez à ce sujet les mémoires de M. Savigny, sur les animaux sans vertèbres, et ceux de MM. Audouin, et Milne Edwards sur les Annélides.
(2) M. Savigny joignant à cet ordre les Arenicoles, en change le nom en SERPULÉES; M. de Lamarck, adoptant la même réunion, change le nom de SERPULÉES en SÉDENTAIRES. Mes genres de Tubicoles sont pour M. Savigny sa famille des AMPHITRITES. Pour M. de Lamarck, ils composent celles des AMPHITRITÉES, et des SERPULÉES. M. de Blainville en forme son ordre des ENTOMOZOAIRES CHÉTOPODES HÉTÉROCRISIENS; mais il y introduit contre sa propre définition les SPIO et les POLYDORES.
[page] 190
des fragments de coquilles, des parcelles de vase, au moyen d'une membrane qu'ils transsudent sans doute aussi; il en est enfin dont le tube est entièrement membraneux ou corné.
A la première catégorie appartiennent,
LES SERPULES. (SERPULA. L.) Vulg. Tuyaux de mer.
Dont les tubes calcaires recouvrent, en s'entortillant, les pierres, les coquilles et tous les corps sousmarins. La coupe de ces tubes est tantôt ronde, tantôt anguleuse, selon les espèces.
L'animal a le corps composé d'un grand nombre de segments; sa partie antérieure est élargie en disque, armé de chaque côté de plusieurs paquets de soies roides, et à chaque côté de sa bouche est un panache de branchies en forme d'éventail, ordinairement teint de vives couleurs. A la base de chaque panache est un filament charnu, et l'un des deux, celui de droite, ou celui de gauche indifféremment, est toujours prolongé et dilaté à son extrémité en un disque diversement configuré, qui sert d'opercule et bouche l'ouverture du tube quand l'animal s'y retire (1).
L'espèce commune (Serpula contortuplicata (2)), Ell. Corall., XXXVIII, 2, a des tubes ronds, entortillés, de trois lignes de diamètre. Son opercule est en entonnoir, et ses branchies souvent d'un beau rouge, ou variées de jaune et de violet, etc. Elle recouvre promptement de ses tubes des vases ou autres objets que l'on jette dans la mer.
(1) La serpule la plus commune, ayant ce disque en forme d'entonnoir, les naturalistes l'ont pris pour une trompe, mais il n'est pas percé, et les autres espèces l'ont plus ou moins en forme de massue.
(2) C'est le même animal que l'Amphitrite penicillus, Gmel., ou Proboscidea, Brug.; Probosciplectanos, Fab. Column., aquat., c. XI, p. 22.
[page] 191
Nous en avons sur nos côtes de plus petites, à opercule en massue, armé de deux ou trois petites pointes (Serp. vermicularis, Gm.), Müll., Zool. Dan., LXXXVI, 7, 9, etc. Leurs branchies sont quelquefois bleues. Rien n'est plus agréable à voir qu'un groupe de ces serpules, lorsqu'elles s'épanouissent bien.
En d'autres, l'opercule est plat et hérissé de pointes plus nombreuses (1).
Il y en a une aux Antilles (Serpula gigantea, Pall., Miscell., X, 2, 10), qui se tient parmi les madrépores, et dont le tube est souvent entouré de leurs masses. Ses branchies se roulent en spirale quand elles rentrent; et son opercule est armé de deux petites cornes rameuses, comme des bois de cerfs (2).
M. de Lamarck distingue:
Les SPIRORBES (SPIRORBIS, Lam.), dont les filets branchiaux sont beaucoup moins nombreux (3 ou 4 de chaque côté); leur tube est en spirale assez régulière, et ils sont d'ordinaire très petits (3).
LES SABELLES. (SABELLA. Cuv.) (4).
Ont le même corps et les mêmes branchies en éventail que les serpules; mais les deux filets charnus adhérents
(1) Ce sont les GALÉOLAIRES, Lam. On en voit un opercule: Berl., Schr., IX, III, 6.
(2) La même que Terebella bicornis, Abildg., Berl. Schr., IX, III, 4, Séb., III, XVI, 7, et que l'Actinia ou animal flower, Home, lect., on comp. Anat., II, pl. 1. Sur ce roulement en spirale des branchies, M. Savigny établit sa subdivision des SERPULES CYMOSPIRES dont M. de Blainville a ensuite fait un genre.
Aj. Terebella stellata, Gm., Abildg., loc. cit., f. 5. Remarquable par un opercule formé de 3 plaques enfilées.
(3) Serpula spirillum, Pall., nov. act., Pétrop., V, pl. V, f. 21; — Serp. spirorbis, Müll., Zool., Dan., III, LXXXVI, 1–6.
(4) Ce nom de Sabella désigne, dans Linnæus et dans Gmelin, divers animaux à tuyaux factices et non transsudés; nous le restreignons à ceux qui se ressemblent par leurs caractères propres.
M. Savigny l'a employé comme nous, sauf notre première division qu'il met dans ses serpules. M de Lamarck appelle nos sabelles AMPHITRITES.
[page] 192
aux branchies se terminent l'un et l'autre en pointe et ne forment pas d'opercule; ils manquent même quelquefois. Leur tube paraît le plus souvent composé de grains d'une argile ou vase très fine, et est rarement calcaire.
Les espèces connues sont assez grandes et leurs panaches branchiaux d'une délicatesse et d'un éclat admirable.
Les unes ont, comme les serpules, sur la partie antérieure de leur dos, un disque membraneux au travers duquel passent leurs premières paires de paquets de soies; leurs peignes branchiaux se contournent en spirale, et leurs tentacules se réduisent à de légers replis (1).
La Méditerranée en possède une belle et grande espèce, à tube calcaire comme celui des serpules, à branchies orangées, etc., Sabella protula, Nob., ou Protula Rudolphii, Risso (2).
En d'autres il n'y a point de disque membraneux en avant, leurs peignes branchiaux forment deux spirales égales (3).
Quelquefois les filets sont sur deux rangs à chaque peigne (4).
En d'autres encore l'un des deux peignes seulement est
(1) M. Savigny laisse cette division dans les serpules, et en fait ses SERPULES SPIRAMELLES, dont ensuite M. de Blainville a fait son genre SPIRAMELLE.
(2) L'existence de cette magnifique espèce, et la nature calcaire de son tube sont incontestables, malgré le doute exprimé; Dict. des Sc. nat., LVII, p. 432, note. La Sabelle bispirale (Amphitrite volutacornis, Trans., Linn., VII, VII, en diffère fort peu. Je n'oserais affirmer que c'est la même que Seb., I, XXIX, 1, mal à propos citée par Pallas et Gmel., sous Serpula gigantea, car cette figure ne montre pas de disque.
(3) Ce sont les SABELLES simples de Savigny. Amphitrite reniformis, Müll., vers XVI, ou Tubularia penicillus, id., Zool., LXXXIX, 1, 2, ou Terebella reniformis, Gmel.; — Amphitr. infundibulum, Montag., Trans., Linn., IX, VIII; — Amph. vesiculosa, id., ib., XI, V.
(4) Ce sont les SABELLÆ ASTARTÆ, Sav., telles que Sabella grandis, Cuv., ou Indica, Sav.; — Tubularia magnifica, Shaw., Trans. Linn., V, IX.
[page] 193
ainsi contourné, et l'autre plus petit, enveloppe la base du premier (Sabella unispira, Cuv.; Spirographis spallanzanii, Viviani Phosph., Mar., pl. IV et V (1)).
Il y en a dont les branchies ne forment autour de la bouche, qu'un simple entonnoir, mais à filets nombreux, serrés et fortement ciliés à leur face interne (2); leurs pieds soyeux sont presque imperceptibles.
On en a décrit enfin qui n'ont que six filets disposés en étoile (3).
LES TÉREBELLES. (TÉREBELLA. Cuv.) (4)
Habitent, comme la plupart des sabelles, un tube factice; mais il est composé de grains de sable, de fragments de coquilles; de plus, leur corps a beaucoup moins d'anneaux et leur tête est autrement ornée. De nombreux tentacules filiformes, susceptibles de beaucoup d'extension, entourent leur bouche, et sur leur col sont des branchies en forme d'arbuscules et non pas d'éventail.
Nous en avons plusieurs sur nos côtes, confondues longtemps sous le nom de Terebella conchilega, Gm. (Pall., Miscell., IX, 14–22), et remarquables pour la plupart par des tubes formés de gros fragments de coquilles, et dont l'ouverture a ses bords prolongés en plusieurs petites
(1) Ce sont les SABELLES SPIROGRAPHES de Savigny.
N. B. Je ne sais à laquelle de ces subdivisions doit être rapportée l'Amphitrite ventilabrum, Gm., ou Sabella penicillus, Linn., éd. XII, à cause de l'imperfection de la fig. d'Ellis, Corall., pl. XXXIII.
(2) Sab. villosa, Cuv., esp. nouv.
(3) Tubularia Fabricia, Gm., Fabr., Faun., Grœnl., p. 450; c'est le genre FABRICIE de Blainv.
(4) Linnæus, ed. XII, avait nommé ainsi un animal décrit par Kæhler, et qui pourrait appartenir à ce genre, parce qu'on croyait qu'il perce les pierres. M. Lamarck a employé ce nom (An. sans vert., p. 324) pour une Néréide et pour un Spio. Les Térebelles de Gmel., comprennent des Amphinomes, des Néréides, des Serpules, etc. Aujourd'hui MM. Savigny, Montagu., Lamarck, Blainville, emploient ce nom comme moi et comme je l'avais proposé: Dict. des Sc. nat., II, p. 79.
TOME III. 13
[page] 194
branches formées des mêmes fragments, et servent à loger les tentacules.
Le plus grand nombre a trois paires de branchies, qui, dans celles dont le tube a des branches, sortent par un trou qui leur est destiné (1).
LES AMPHITRITES. (AMPHITRITE. Cuv.) (2)
Sont faciles à reconnaître à des pailles de couleur dorée, rangées en peignes ou en couronne, sur un ou sur plusieurs rangs, à la partie antérieure de leur tête, où elles leur servent probablement de défense, ou peut-être de moyen de ramper ou de ramasser les matériaux de leur tuyau. Autour de la bouche sont de très nombreux tentacules, et sur le commencement du dos, de chaque côté, des branchies en formes de peignes.
Les unes se composent des tuyaux légers, en forme de cônes réguliers, qu'elles transportent avec elles. Leurs pailles dorées forment deux peignes, dont les dents sont dirigées vers le bas. Leur intestin très ample et plusieurs fois replié, est d'ordinaire plein de sable (3).
(1) Ce sont les TÉREBELLES simples de M. Savigny, telles que: Tereb. medusa, Sav., Eg., Annel., I, f. 3; — Ter. cirrhata, Gm., Müll., vers, XV; — Ter. gigantea, Montag., Trans. Linn., XII, 11; — T. nebulosa, id., ibid., 12, 2; — T. constrictor, id., ibid., 13, 1; — T. Venusta, ib., 2; il en nomme aussi une T. cirrhata, ib., XII, 1; mais qui ne paraît pas la même que celle de Müller. Ajoutez T. variabilis, Risso, etc.
N. B. M. Savigny a encore deux divisions de térebelles, ses T. PHYZELIÆ, qui n'ont que deux paires de branchies, et ses T. IDALIÆ qui n'en ont qu'une. Parmi ces dernières viendraient Amphitrite cristata, Müll., Zool. Dan., LXX, 1, 4; Amph. ventricosa, Bosc., vers, I, VI, 4–6.
(2) Ce genre tel qu'il est dans Müller, Bruguières, Gmelin, Lamarck, comprend aussi des Térebelles et des Sabelles.
Je l'ai réduit en 1804 (Dict. des Sc. nat., II, p. 78), à ses limites actuelles; depuis lors M. de Lamarck a changé mes divisions en genres: ses PECTINAIRES et ses SABELLAIRES que M. Savigny appelle AMPHICTÈNES et HERMELLES. Le nom d'AMPHITRITE est transporté par M. de Lamarck à mes SABELLES. M. Savigny en fait au contraire un nom de famille.
(3) Ce sont les PECTINAIRES de Lamarck; les AMPHICTÈNES de Savigny; les CHRYSODONS d'Oken; les CISTÈNES de Leach. Ces perpétuels changements de noms (et dans le cas actuel ils n'avaient pas même le prétexte d'un changement de limites dans le groupe), finiront par rendre l'étude de la nomenclature beaucoup plus difficile que celle des faits.
[page] 195
Telle est sur nos côtes l'Amphitrite auricoma Belgica, Gm, (Pall., Miscell., IX, 3–5), dont le tube, de deux pouces de long, est formé de petits grains ronds de diverses couleurs (1).
La mer du Sud en produit une espèce plus grande (Amphitrite auricoma Capensis, Pall., Miscell. IX, 1–2), dont le tube, mince et poli, a l'air d'être transversalement fibreux, et formé de quelque substance molle et filante, desséchée (2).
D'autres amphitrites habitent des tuyaux factices fixés à divers corps. Leurs pailles dorées forment sur leur tête plusieurs couronnes concentriques, d'où résulte un opercule qui bouche leur tuyau quand elles s'y contractent, mais dont les deux parties peuvent s'écarter. Elles ont un cirrhe à chaque pied. Leur corps se termine en arrière en un tube recourbé vers la tête, sans doute pour émettre les excréments. Je leur ai trouvé un gésier musculeux (3).
Telle est le long de nos côtes
L'Amphitrite à ruche. (Sabella alveolata. Gm. Tubipora arenosa. Linn. Ed. XII.) Ellis. Corall. XXXVI.
Dont les tuyaux, unis les uns aux autres en une masse compacte, présentent leurs orifices, assez régulièrement disposés, comme ceux des alvéoles des abeilles (4).
(1) C'est la même que Sabella Belgica, Gm., Klein., tab., 1, 5, echinod., XXXIII, A, B, et que Amph. auricoma, Müll., Zool. dan., XXVI, dont Brug. a fait son Amphitrite dorée.
(2) C'est la même que Sabella chrysodon, Gm., Bergius, mém. de Stokh. 1765, IX, I, 3; que Sabella Capensis, id., Stat., Müll., nat., Syst. VI, XIX, 67, qui n'est qu'une copie de Bergius; que Sabella indica, Abildgaardt, Berl. Schr., IX, IV. Voyez aussi Mart. Slabber, mém. de Flessing., I, II, 1–3.
(3) Ce sont les SABELLAIRES de Lam.; les HERMELLES de Savigny.
(4) N. B. C'est peut-être ici que doit venir l'Amphitrite plumosa, de Fab., Faun., Grœnl., p. 288, et Müll., Zool. Dan., XC; mais les descriptions en sont si obscures et si peu d'accord entre elles que je n'ose la placer. M. de Blainville en fait son genre PHÉRUSE.
13*
[page] 196
Un autre (Amph. ostrearia, Cuv.) établit ses tubes sur les coquilles des huîtres, et nuit beaucoup, dit-on, à leur propagation.
Je soupçonne que c'est à cet ordre qu'il faut rapporter
LES SYPHOSTOMA. Otto.
Qui ont à chaque articulation supérieurement un faisceau de soies fines, inférieurement une soie simple, et à l'extrémité antérieure deux paquets de soies fortes et dorées. Sous ces soies est la bouche, précédée d'un suçoir, entourée de beaucoup de filaments mous, qui pourraient bien être des branchies, et accompagnée de deux tentacules charnus. On voit le cordon médullaire noueux au travers de la peau du ventre. Ils vivent enfoncés dans la vase (1).
On avait jusqu'à ces derniers temps placé dans ce voisinage,
LES DENTALES. (DENTALIUM. L.)
Qui ont une coquille en cône alongé, arquée, ouverte au deux bouts, et que l'on a comparée en petit à une défense d'éléphant. Mais les observations récentes de M. Savigny et surtout de M. Deshayes (2), rendent cette classification très douteuse.
Leur animal ne paraît point avoir d'articulation sensible, ni de soies latérales; mais il a en avant un tube membraneux dans l'intérieur duquel est une sorte de pied ou d'opercule charnu et conique, qui en ferme l'orifice. Sur la base de ce pied est une tête petite et aplatie, et
(1) Siphostoma diplochaitos, Otto; — Siph. uncinata, Aud. et Edw. Littoral de la France, Annél., pl. IX, fig. 1.
(2) Monographie du genre DENTALE, Mém. de la soc. d'Hist. nat. de Paris, t. II, p. 321.
[page] 197
on voit sur la nuque des branchies en forme de plumes. Si l'opercule rappelle le pied des vermets et des siliquaires, qui déjà ont été transportés dans la classe des mollusques, les branchies rappellent beaucoup celle des amphitrites et des térebelles. Des observations ultérieures sur leur anatomie et principalement sur leur système nerveux et vasculaire, résoudront ce problème.
Il y en a à coquille anguleuse (1), ou striée longitudinalement (2).
D'autres à coquilles rondes (3).
DEUXIÈME ORDRE DES ANNÉLIDES.
LES DORSIBRANCHES.
Ont leurs organes et surtout leurs branchies distribués à peu près également le long de tout leur corps, ou au moins de sa partie moyenne.
Nous placerons en tête de l'ordre les genres dont les branchies sont le plus développées.
LES ARÉNICOLES. (ARENICOLA. Lam.) (4)
Ont des branchies en forme d'arbuscules sur les anneaux de la partie moyenne de leur corps seulement; leur bouche est une trompe charnue plus ou moins dilatable,
(1) Dent. elephantinum, Martini, I, 1, 5, A; — D. aprinum, ib., 4, A; — D. striatulum, ib., 5, B; — D. arcuatum, Gualt., X, G; — D. sexangulum.
(2) Dent. dentalis, Rumpf., Mus.; XLI, 6; — D. fasciatum, Martini, Conch., I, 1, 3, B; — D. rectum, Gualt., X, H, etc.
(3) Dent. entalis, Martini, I, 1, 1, 2, etc.
(4) M. Savigny a fait de ce genre une famille qu'il nomme THÉLÉTHUSES, et qui a été adoptée par ses successeurs.
[page] 198
et on ne leur voit ni dents, ni tentacules, ni yeux. L'extrémité postérieure manque non-seulement des branchies, mais encore des paquets de soie qui garnissent le reste du corps; il n'existe de cirrhe à aucun anneau du corps.
L'espèce connue, Arénicole des Pêcheurs, Lam., (Lumbricus marinus, L.) Pall., Nov., Act., Petr. II, I, 19–29, est très commune dans le sable des bords de la mer, où les pêcheurs vont la chercher avec des bêches, pour s'en servir comme d'appât. Elle est longue de près d'un pied, de couleur rougeâtre, et répand, quand on la touche, une liqueur jaune abondante. Elle porte treize paires de branchies (1).
LES AMPHINOMES. (AMPHINOME. Brug.) (2).
Ont sur chacun des anneaux de leur corps, une paire de branchies en forme de houppe ou de panache plus ou moins compliqué, et à chacun de leurs pieds deux paquets de soies séparés, et deux cirrhes. Leur trompe n'a point de machoires.
M. Savigny les divise en
CHLOES. (CHLOEIA. Sav.)
Qui ont cinq tentacules à la tête et les branchies en forme de feuille tripinnatifide.
La mer des Indes en produit une, l'Amphinome chevelue, Brug. (Terebella flava, Gm.) Pall., Miscell. VIII, 7–11, extrêmement remarquable par ses longs faisceaux de soies couleur de citron, et par les beaux panaches pourpres de ses branchies. Sa forme est large et déprimée; elle porte une crête verticale sur le museau.
(1) Aj. Arenicol. clavata, Ranzani, dec., I, p. 6, pl. 1, f. 1; si toutefois c'est une espèce distincte.
(2) Ce genre a été retiré avec raison par Bruguières, des APHRODITES de Pallas, et des TÉREBELLES de Gmelin; il est pour M. Savigny le type d'une famille qu'il nomme AMPHINOMES, et qui est aussi adoptée par ses successeurs.
[page] 199
Et en
PLÉIONES (PLEÏONE. Sav. AMPHINOME. Blainv.)
Qui avec les mêmes tentacules, ont des branchies en forme de houppes. Elles sont aussi de la mer des Indes, et il y en a de fort grandes (1).
Il y ajoute les EUPHROSINES (EUPHROSINE, Sav. (2)), qui n'ont à la tête qu'un seul tentacule, et dont les branchies en arbuscules, sont très développées et compliquées.
MM. Audouin et Edwards rapprochent des amphinomes les HIPPONOÉS, qui, dépourvues de caroncule, n'ont à chacun de leurs pieds qu'un seul paquet de soies et un seul cirrhe.
On en a une espèce du port Jackson, Hipponoe Gaudichaudii, Ann. des Sc. nat., t. XVIII, pl. VI.
LES EUNICES. Cuv. (3).
Ont aussi des branchies en forme de panaches, mais leur trompe est puissamment armée par trois paires de machoires cornées différemment faites; chacun de leurs pieds a deux cirrhes et un faisceau de soies; leur tête porte cinq tentacules au-dessus de la bouche, et deux à la nuque. Quelques espèces seulement montrent deux petits yeux.
La mer des Antilles en a une de plus de quatre pieds de
(1) Terebella carunculata, Gm., Aphr. car., Pall., Miscell., VIII, 12–13; — Ter. rostrata, ib., 14–18; — Ter. complanata, ib., 19–26; — Pleione alcyonia, Sav., Eg., Annél., II, f. 3.
(2) Euphrosine laureata, id., ib., f. 1; — E. mirtosa, id., ib., 2.
N. B. C'est aussi près des amphinomes que doit venir le genre ARISTÉNIE, Sav. Eg., Annel., pl. 2, f. 4; mais il n'est établi que sur un individu mutilé.
(3) Eunice, nom d'une néréide dans A pollodore. M. Savigny en fait le nom d'une famille et donne au genre le nom de LÉODICE. M. de Blainville a changé ces noms, d'abord en Branchionéréide, et aujourd'hui en Néréidonte.
[page] 200
long (Eun. gigantea, Cuv.), qui est la plus grande annelide connue.
Il y en a sur nos côtes plusieurs moins considérables (1).
M. Savigny en distingue sous le nom de MARPHISES, les espèces d'ailleurs très semblables, mais qui manquent des deux tentacules de la nuque; leur cirrhe supérieur est très court (2).
Une espèce au moins très voisine (N. tubicola, Müll., Zool., Dan, I, XVIII, 1–5) habite un tube corné (3).
Après ces genres à branchies compliquées, on peut placer ceux où elles se réduisent à de simples lames, ou même à de légers tubercules, ou enfin dans lesquels les cirrhes seuls en tiennent lieu.
Il y en a qui tiennent encore aux eunices par la forte armure de leur trompe et par leurs antennes en nombre impair.
Telles sont:
LES LYSIDICES. Sav.
Qui avec des machoires semblables à celles des eunices, ou même plus nombreuses, et souvent en nombre impair, n'ont que trois tentacules et des cirrhes pour toutes branchies (4).
(1) Nereis Norvegica, Gm., Müll., Zool., Dan., I, XXIX, 1; — N. pinnata, ib., 2; — N. cuprea, Bosc., vers., I, V, 1; — Leodice gallica, et L. hispanica, Sav. — Aj. Leod. antennata, Sav., Annel., V, 1. — Eun. bellii, Aud. et Edw., Littoral de la France, Annél., pl. III, fig. 1–4; — Eun. harassii, ib., fig. 5–11.
(2) Ner. sanguinea, Montag., Trans., Linn., XI, pl. 3.
(3) C'est probablement auprès des eunices que doit venir le Nereis crassa, Müll., Verg., pl. XII, que M. de Blainville, sans l'avoir vue, propose de reporter au genre ETEONE de M. Savigny, lequel aurait cependant des branchies toutes différentes.
(4) Lysidice Valentina, Sav.; — L. Olympia, id.; — L. galatina, id., Eg. Annel., p. 53.
[page] 201
LES AGLAURES. Sav.
Ont aussi des mâchoires nombreuses et en nombre impair, sept, neuf, etc.; mais elles manquent de tentacules, ou les ont tout-à-fait cachés; leurs branchies sont aussi réduites à leurs cirrhes (1).
LES NÉRÉIDES proprement dites. (NEREIS. Cuv. LYCORIS. Savign.)
Ont des tentacules en nombre pair attachés aux côtés de la base de la tête, un peu plus en avant deux autres biarticulés, entre lesquels en sont deux simples; elles n'ont qu'une paire de mâchoires dans leur trompe; leurs branchies ne forment que de petites lames sur lesquelles rampe un lacis de vaisseaux; il y a en outre à chacun de leurs pieds deux tubercules, deux faisceaux de soies, un cirrhe dessus et un dessous.
Nous en avons sur nos côtes un assez grand nombre (2).
Auprès de ces néréides viennent se grouper plusieurs genres également à corps grêle et à branchies réduites à de simples lames ou même à de simples
(1) Je réunis les AGLAURES et les OENONES de Savigny; et même certaines espèces sans tentacules que MM. Audouin et Milne Edward, laissent dans les lysidices. Aglaura fulgida, Eg. Annel., V, 2; — OEnone lucida, ib., f. 3.
(2) Nereis versicolor, Gm., Müli., Würm., VI; — N. fumbriata, id., VIII, 1–3; — N. pelagica, id., VII, 1–3; — Terebella rubra, Gm., Bommé, mém. de Flessing, VI, 357, fig., 4, A. B.; — Lycoris Ægyptia, Eg., Annel., pl. IV, f. 1; — Lycoris nuntia, id., ib., f. 2; — Ner. beaucoudraisü, Aud. et Edw., Littor. de la France, Annél., pl. IV, fig. 1–7; — Ner. pulsatoria, ib., fig. 8–13.
N. B. Les Nereis verrucosa, Müller, vers, pl. VII, et Incisa, Ott., Fabric., Soc. d'hist. nat. de Copenh., V, 1re part., pl, IV, f. 1 — 3 paraissent avoir la tête des lycoris, mais de longs filaments au lieu de brauchies; elles ont besoin d'un nouvel examen.
[page] 202
filets ou tubercules. Plusieurs manquent de mâchoires ou de tentacules.
LES PHYLLODOCES. Sav. (NEREIPHYLLES. Blainv.)
Ont, comme les Néréides propres, des tentacules en nombre pair aux côtés de la tête, et de plus quatre ou cinq petits en avant. On leur voit des yeux; leur trompe grande et garnie d'un cercle de très courts tubercules charnus, ne montre point de mâchoires, et ce qui surtout les distingue, leurs branchies sont en forme de feuilles assez larges, se recouvrant sur une rangée de chaque côté du corps, sur lesquelles on voit ramper des vaisseaux très ramifiés (1).
LES ALCIOPES. Aud. et M. Edw.
Ont à peu près la bouche et les tentacules des phyllodoces; mais leurs pieds présentent, outre le tubercule qui porte les soies et les deux cirrhes foliacés (ou branchies), deux tubercules branchiaux qui en occupent les bords supérieur et inférieur (2).
(1) Nereis lamellifera Atlantica, Pall., nov. act., Pétrop., II, pl. V, f. 11–18., peut-être la même que la Néréiphylle de Pareto, Blainv., Dict. des Sc. nat.; — N. flava, Ott. Fabr., Soc. d'hist. nat. de Copenh., V, prem. part., pl. IV, f. 8–10.
N. B. N. viridis, Müll., vers, pl. XI, dont M. Savigny, sans l'avoir vue, propose de faire le genre EULALIA; et les deux EUNOMIA de M. Risso, Europ. mérid., IV, p. 420, me paraissent aussi des phillodoces; peut-être même faut-il y rapporter le Nereis pinnigera, Montag., Trans., Linn., IX, VI, 3; et le Nereis stellifera, Müll., Zool.. Dan,, pl. LXII, f. 1. dont M. Savigny, sans l'avoir vue, propose de faire un genre sous le nom de LEPIDIA; et le N. longa, Ott., Fab., que M. Sav. place avec le N. flava, dans son genre ETEONE: toutes ces annélides auraient besoin d'être examinées de nouveau d'après la méthode détaillée de M. Savigny.
Il ne faut pas confondre ces phillodoces de M. Savigny, avec celles de M. Ranzani, qui sont voisines des aphrodites et surtout des polynoës.
(2) Alciopa Reynaudii, Aud. et Edw. De l'Océan atlantique. — Le prétendu Naïs, Rathke, Soc. d'hist nat. de Copenh., V, prem. part., lp. III, f. 15, pourrait bien être une alciope.
[page] 203
LES SPIO. Fab. et Gmel.
Ont le corps grêle, deux très longs tentacules qui ont l'apparence d'antennes, des yeux à la tête, et sur chaque segment du corps une branchie de chaque côté en forme de filament simple. Ce sont de petits vers de la mer du Nord qui habitent des tuyaux membraneux (1).
LES SYLLIS. Sav.
Ont des tentacules en nombre impair, articulés en chapelets, ainsi que les cirrhes supérieurs de leurs pieds, qui sont fort simples et n'ont qu'un paquet de soies. Il paraît qu'il y a des variétés relativement à l'existence de leurs mâchoires (2).
LES GLYCÈRES. Sav.
Se reconnaissent à ce que leur tête est en forme de pointe charnue et conique, qui a l'apparence d'une petite corne, et dont le sommet se divise en quatre très petits tentacules à peine visibles. La trompe de quelques-unes a encore des mâchoires; on dit qu'en d'autres on ne peut l'apercevoir (3).
LES NEPHTHYS. Cuv.
Avec la trompe des phyllodoces, manquent de tentacules, et ont à chaque pied deux faisceaux de soies très séparés, entre lesquels est un cirrhe (4).
(1) Spio seticornis, Ott., Fabr., Berl., Schr., VI. V. 1–7: — Spio filicornis, ib., 8–12. Les POLYDORES, Bosc, vers., I, V, 7, me paraissent appartenir à ce genre. Speio, nom d'une néréide.
(2) Syllis monilaris, Sav., Eg., Annel., IV, f. 3, copié Dict. des Sc. nat. N. B. Le Nereis armillaris, Müll., vers., pl. IX, dout M. Savigny, sans l'avoir vue, propose de faire un genre qu'il nomme Lycastis, a des tentacules et des cirrhes en chapelets comme les syllis; mais ses tentacules sont représentés en nombre pair. Elle a aussi besoin d'un nouvel examen.
(3) Nereis alba, Müll., Zool., Dan., LXXII, 6, 7; — Glyc. Meckelü, Aud. et Edw., Littor. de la France, Annél., pl. VI, fig. 1.
(4) Nephthys hombergü, Cuv,, représ, dans le Dict. des Sc. nat.
[page] 204
LES LOMBRINÈRES. Blainv.
Manquent de tentacules; leur corps, très alongé, n'a à chaque article qu'un petit tubercule fourchu, duquel sort un petit paquet de soies. S'il y a un organe extérieur de respiration, il ne peut être qu'un lobe supérieur de ce tubercule (1).
LES ARICIES. Sav.
Manquent de dents et de tentacules. Leur corps, qui est alongé, porte sur le dos deux rangées de cirrhes lamelleux, et leurs pieds antérieurs sont garnis de crêtes dentelées qu'on ne retrouve pas dans les autres pieds (2).
Nos côtes de l'Océan ont des espèces de plusieurs de ces genres.
LES HÉSIONES.
Ont le corps court, assez gros, composé de peu d'anneaux mal prononcés; un très long cirrhe qui fait probablement fonction de branchies, occupe le dessus de chaque pied, qui en a un autre inférieur, et un paquet de soies; leur trompe
(1) Nereis ebranchiata, Pall., Nov. act., Pétrop., II, pl. VI, f. 2; — Lombrinère brillant, Blainv., pl. du Dict. des Sc. nat.; — Lumbricas fragilis, Müll., Zool., dan., pl. XXII, dont M. de Blainville fait, mais avec doute, son genre SCOLETOME.
N. B. Les SCOLELÈPES, Blainv., qui ne sont connus que par la fig. d'Abildgaardt (Lumbricus squamatus, Zool., dan., IV, CLV, 1–5), ont le corps très grèle, les anneaux très nombreux; à chacun un cirrhe servant de branchie, et deux faisceaux de soies, dont l'inférieur semble sortir d'un repli de peau comprimé comme une écaille, leur tête n'a ni mâchoires ni tentacules.
(2) Ar. Cuvieri, Aud. et Edw., Litt. de la France, Annél., pl. VII, fig. 5–13.
Le Lumbricus armiger, Müll., Zool., dan., pl. XXII, f. 4 et 5, dont M. de Blainville, sans l'avoir vu, propose de faire un genre sous le nom de SCOLOPLE, paraît manquer de dents et de tentacules, et porter sur ses premiers segments de simples petits faisseaux de soies courts, et sur les autres un verrue bifide, une petite soie, et une lame branchiale, longue et pointue.
[page] 205
est grande et sans mâchoires ni tentacules. Nous en avons de la Méditerranée (1).
LES OPHÉLIES. Sav.
Ont le corps assez gros et court, les anneaux peu marqués, les soies à peine visibles, de longs cirrhes servant de branchies sur les deux tiers de sa longueur; la bouche contenant à son palais une crête dentelée, ses lèvres entourées de tentacules, dont les deux supérieurs sont plus grands que les autres (2).
LES CIRRHATULES. Lam.
Ont un très long filament servant de branchies et deux petits paquets de soie à chacune des articulations de leur corps, qui sont fort nombreuses et fort serrées, il y a de plus un cordon de longs filaments autour de sa nuque. Sa tête peu marquée n'a ni tentacule ni mâchoires (3).
LES PALMYRES. (PALMYRE. Sav.)
Se reconnaissent à leurs faisceaux supérieurs dont les soies sont grandes, aplaties, disposées en éventail, et brillent comme l'or le mieux poli; leurs faisceaux inférieurs sont petits; leurs cirrhes et leurs branchies peu
(1) Hesione splendida, Sav., Eg., Annel., pl. III, f. 3; — H. festiva, id., ib., pag. 41; — Hes. pantherina, Risso, Eur. mér., IV, p. 418.
(2) N. B. C'est probablement dans ce voisinage que doivent venir les Nereis prismatica, et bifrons, dit Fabric., Soc. d'hist. nat. de Copenh., V. prem. part., pl. IV, pag. 17–23.
(3) Lumbricus cirrhatus, Ott., Fabr., Faun., Grœnl., f. 5, dont la Terebella tentaculata, Montag., Lin., Trans., IX, VI, et le CIRRHINÈRE filigère, Blainv., pl. du Dict. des Sc., N. ne me paraissent pas différer par le genre; — Cirrh. Lamarkii, Aud. et Edw., Littoral de la France, Annélides, pl. VII, fig. 1–4.
[page] 206
marquées; elles ont le corps alongé, deux tentacules assez longs et trois fort petits.
On n'en connaît qu'une de l'lle de France, longue d'un à deux pouces (Palmyra aurifera, Sav.).
LES APHRODITES. (APHRODITA. L.)
Se reconnaissent aisément dans cet ordre aux deux rangées longitudinales de larges écailles membraneuses qui recouvrent leur dos, auxquelles par une assimilation peu motivée on a donné le nom d'élytres, et sous lesquelles sont cachées leurs branchies, en forme de petites crêtes charnues.
Leur corps est généralement de forme aplatie, et plus court et plus large que dans les autres annélides. On observe à leur intérieur un œsophage très épais et musculeux susceptible d'être renversé en dehors comme une trompe, un intestin inégal, garni de chaque coté d'un grand nombre de cœcum branchus, dont les extrémités vont se fixer entre les bases des paquets de soie qui servent de pieds.
M. Savigny y distingue les HALITHÉES, qui ont trois tentacules, et entre deux une très petite crête, et qui manquent de mâchoires.
Nous en avons une sur nos côtes qui est l'un des animaux les plus admirables par leurs couleurs, l'Aphrodite hérissée (Aphrodita aculeata, L.), Pall, Misc., VII, 1–13. Elle est ovale, longue de six à huit pouces, large de deux à trois. Les écailles de son dos sont recouvertes et cachées par une bourre semblable à de l'étoupe, qui prend naissance sur les côtés. De ces mêmes côtés naissent des groupes de fortes épines, qui percent en partie l'étoupe, des faisceaux de soies flexueuses, brillantes de tout l'éclat de l'or, et changeantes en toutes les teintes de l'iris. Elles ne le cèdent en beauté ni au plumage des colibris, ni à ce que les pierres précieuses ons de plus vif. Plus bas est un tubercule d'où sortent des épines en trois groupes, et de
[page] 207
trois grosseurs différentes, et enfin un cône charnu. On compte quarante de ces tubercules de chaque côté, et entre les deux premiers sont deux petits tentacules charnus. Il y a quinze paires d'écailles larges, et quelquefois boursoufflées, sur le dos, et quinze petites crêtes branchiales de chaque côté.
Il y a de ces HALITHÉES qui n'ont point d'étoupes sur le dos (1), et nos mers en produisent une espèce (Aphr. hystrix, Sav.) (2).
Une autre subdivision des aphrodites est celle
Des POLYNOE. Sav. (EUMOLPE. Oken.)
Qui n'ont point d'étoupes sur le dos; leurs tentacules sont au nombre de cinq, et leur trompe renferme des mâchoires cornées et fortes.
Nous en avons plusieurs petites espèces sur nos côtes (3).
Les SIGALIONS, Aud. et Miln. Edw., sont d'une forme bien plus alongée que les autres aphrodites; ils ont des cirrhes à tous les pieds (4).
Les ACOÉTES des mêmes, ont des cirrhes qui alternent avec les Élytres dans une grande longueur (5); leurs mâchoires sont plus fortes et mieux dentées; les Antilles en
(1) Ce sont les Halithées hermiones de M. Savigny, dont M. de Blainville a fait son genre HERMIONE.
(2) Littoral de la France, Annél., pl. 1, fig. 1–9.
(3) Aphr. squamata, Pall., misc., Zool., VII, 14, Littor. de la France, Annél., pl. 1, fig, 10–16; — Polyn. lævis, Aud. et Edw., ib., pl. 11, fig. 11–18; — Aphr. punctata, Müll., vers, XIII; — Aphr. cirrhosa, Pall., misc., Zool., VIII, 3–6; — Aphr. lepidota, id., ib., 1–2; — Aphr. clava, Montag., Trans., Linn., IX, VII, qui est au moins bien voisine d'Aphr. plana, Müll., vers, XIX; — Polynoë impatiens; Sav., Eg., Annel., pl., 3, f. 2; — Polynoë muricata, id., ib., f. 1.
(4) Sigalion Mathildæ, Aud. et Edw., Littor. de la France, Annél.
(5) Acoëes Pleei, Aud. et Edw., Collect. du Mus.
[page] 208
possèdent une grande espèce qui habite dans un tuyau de consistance de cuir (1).
Nous ne pouvons placer qu'ici un nouveau genre très singulier, que je nomme
CHÆTOPTÈRE. (CHÆTOPTERUS. Cuv.)
A bouche sans mâchoires ni trompe, garnie en dessus d'une lèvre à laquelle s'attachent deux très petits tentacules. Ensuite vient un disque avec neuf paires de pieds, puis une paire de longs faisceaux soyeux comme deux ailes. Les branchies en forme de lames sont attachées plutôt en dessous qu'en dessus, et règnent le long du milieu du corps.
On en a une espèce (Chætopterus pergamentaceus, Cuv.) longue de huit ou dix pouces, et qui habite un tuyau de substance de parchemin. Elle est de la mer des Antilles (2).
(1) N. B. La Phyllodoce maxillosa, de M. Ranzani, nommé POLYODONTE, par Reinieri, et Eumolpe maxima, par Oken, paraît fort voisine de l'ACOETES; sa trompe, ses mâchoires sont les mêmes, et ni l'un ni l'autre genre n'a peut-être été décrit sur des individus assez complets.
Au surplus il reste encore beaucoup d'annélides trop imparfaitement décrites pour pouvoir être bien caractérisées; telles que Nereis cœca, Fabr., Soc. d'hist. nat. de Copenh., prem. part., pl. IV, f. 24–28; — N. longa, id., ib., f. 11–13; — N. aphroditoïdes, ib., 4–7; ib., f. 11–13; — Branchiarius quadrangulatus, Montag., Trans., Lin., XII, pl. XIV, f. 5; — Diplotes hyalina. id., ib., f. 6 et 7; et le prétendu Hirudo branchiata, d'Archib., Menzies, Trans., Lin., I, pl. XVII, f. 3. Je n'ai point placé non plus, faute d'en avoir pu renouveler l'examen, les MYRIANES, ni deux ou trois autres des genres de M. Savigny.
(2) Elle sera décrite plus en détail par MM. Audouin et M. Edw., dans les Annales des Sciences naturelles.
[page] 209
TROISIÈME ORDRE DES ANNÉLIDES.
LES ABRANCHES.
N'ont aucun organe de respiration apparent à l'extérieur, et paraissent respirer, les unes, comme les lombrics, par la surface entière de leur peau; les autres, comme les sangsues, par des cavités intérieures. On leur voit un système circulatoire clos, rempli le plus souvent de sang rouge, et un cordon nerveux noueux, comme dans toutes les annélides (1). Il y en a qui ont encore des soies servant au mouvement, et d'autres qui en sont dépourvues, ce qui donne lieu à établir deux familles.
La première famille, celle
DES ABRANCHES SÉTIGÈRES, ou POURVUES DE SOIES.
Comprend les lombrics et les naïdes de Linnæus.
LES LOMBRICS. (LUMBRICUS. L.) Vulg. Vers de terre.
Caractérisés par un corps long, cylindrique, divisé par des rides en un grand nombre d'anneaux et par une bouche sans dents, ont dû être subdivisés.
LES LOMBRICS proprement dits. (LUMBRICUS. Cuv.)
Manquent d'yeux, de tentacules, de branchies et de
(1) Voyez sur l'anatomie et la physiologie des annélides abranches, le mémoire de M. Ant. Dugès, inséré dans les annales des sciences naturelles de sept. 1828.
TOME III. 14
[page] 210
cirrhes; un bourrelet ou renflement sensible, surtout au temps de l'amour, leur sert à se fixer l'un à l'autre pendant la copulation. A l'intérieur on leur voit un intestin droit, ridé, et quelques glandes blanchâtres vers le devant du corps qui paraissent servir à la génération. Il est certain qu'ils sont hermaphrodites; mais il se pourrait que leur rapprochement ne servît qu'à les exciter l'un et l'autre à se féconder eux-mêmes. Selon M. Montègre, les œufs descendent entre l'intestin et l'enveloppe extérieure, jusqu'autour du rectum, où ils éclosent. Les petits sortent vivants par l'anus. M. L. Dufour dit au contraire qu'ils font des œufs analogues à ceux des sangsues. Le cordon nerveux n'est qu'une suite d'une infinité de petits glanglions serrés les uns contre les autres (1).
M. Savigny les subdivise encore.
Ses ENTÉRIONS ont sous chaque anneau quatre paires de petites soies, huit en tout.
Chacun connaît le Ver de terre ordinaire (Lumbricus terrestris, L.), à corps rougeâtre, atteignant près d'un pied de longueur, à 120 anneaux et plus. Le renflement est vers le tiers antérieur. Sous le seizième anneau sont deux pores dont on ignore l'usage.
Cet animal perce dans tous les sens l'humus, dont il avale beaucoup. Il mange aussi des racines, des fibres ligneuses, des parties animales, etc. Au mois de juin il sort de terre la nuit pour chercher son semblable et s'accoupler (2).
(1) Conf. Montègre, Mém. du Mus., I, p. 242, pl. XII, et Léon Dufour, Ann. des Sc. nat., V, p. 17, et XIV, p. 216 et pl. XII, B, f. 1–4.
Voyez aussi le Traité de M. Morren, de Lumbrici terrestris historiâ naturali nec non anatomicâ. Bruxelles 1829, 4°.
(2) Ce que je dis dans le texte, est commun à beaucoup d'especes, que M. Savigny a le premier distinguées. Il en a caractérisé jusqu'à vingt. Voyez mon analyse des travaux de l'Académie des Sciences; année 1821. M. Dugès en distingue six; mais qu'il ne rapporte pas exactement à celles de M. Savigny.
N. B. Müller et Fabricius, parlent de lombries à deux soies par anneau, dont Savigny propose de faire son genre CLITELLIO, (Lumbr. minutus, Fabr., Faun., Grœnl., f. 4), et de lombrics à 4 et à 6 soies; mais leurs descriptions déjà anciennes auraient besoin d'être confirmées et complétées avant que l'on puisse classer leurs espèces.
[page] 211
Ses HYPOGÆONS en ont en outre une impaire sur le dos de chaque anneau.
On n'en connaît que d'Amérique (1).
MM. Audouin et Milne-Edwards en distinguent aussi les TROPHONIES, qui portent sur chaque anneau quatre faisceaux de soies courtes, et à l'extrémité antérieure un grand nombre de soies lougues et brillantes qui entourent la bouche (2).
LES NAÏDES. (NAÏS. L.)
Ont le corps allongé et les anneaux moins marqués que les lombrics. Elles vivent dans des trous qu'elles se creusent dans la vase, au fond de l'eau, et d'où elles font sortir la partie antérieure de leur corps qu'elles remuent sans cesse. On voit à plusieurs à la tête des points noirs que l'on peut prendre pour des yeux. Ce sont de petits vers, dont la force de reproduction est aussi étonnante que celle des hydres ou polypes à bras. Il en existe plusieurs dans nos eaux douces.
Les unes ont des soies assez longues (3),
Et quelquefois une longue trompe en avant (4),
Ou plusieurs petits tentacules à l'extrémité postérieure (5).
(1) Hypogæon hirtum, Sav., Eg., Annel., p. 104.
(2) Trophonia barbata, Aud. et Edw., Littor. de la France, Annél., pl. X, f. 13–15.
(3) Naïs elinguis, Müll., Würm., II; — N. littoralis, id., Zool., dan., LXXX.
(4) Naïs proboscidea, id., Würm., I, 1–4, dont M. de Lamarck fait son genre STYLARIA.
(5) Naïs digitata, Gm. cæca, Müll., ib., V, dont M. Oken fait son genre PROTO.
14*
[page] 212
D'autres ont des soies très courtes (1).
On pourrait rapprocher de ce genre certaines annelides rapportées jusqu'ici aux lombrics, qui se fabriquent des tubes de glaise, ou de débris, où elles se tiennent (2).
LES CLIMÈNES. Savigny.
Paraissent aussi appartenir à cette famille. Leur corps assez gros, de peu d'anneaux, porte sur la plupart une rangée de soies fortes et un peu plus haut du côté dorsal un faisceau de soies plus fines. Leur tête n'a ni tentacules ni appendices. Leur extrémité postérieure est tronquée et rayonnée, elles habitent aussi des tuyaux. (3)
La deuxieme famille, ou celle
DES ABRANCHES SANS SOIES,
Comprend deux grands genres, l'un et l'autre aquatiques.
LES SANGSUES. (HIRUDO. L.)
Ont le corps oblong, quelquefois déprimé, ridé transversalement; la bouche est entourée d'une lèvre, et l'extrémité postérieure munie d'un disque aplati, propres l'un et l'autre à se fixer aux corps par une sorte de
(1) Naïs vermicularis, Gm., Rœs., III, XCIII, 1–7; — N. serpentina, id., XCII, et Müll., IV. 2–4; — Lumbricus tubifex, Gm., Bonnet, vers d'eau donce, III, 9, 10, Müll., Zool., dan., LXXXIV; — Lumbr. Lineatus, Müll., Würm., III, 4–5.
(2) Lumbricus tubicola, Müll., Zool., dan., LXXV; — Lumbr. sabellaris, ib., CIV, 5. M. de Lamarck les réunit avec le Naïs tubifex, et en fait son genre TUBIFEX; mais il est nécessaire d'en faire un nouvel examen.
(3) Clym. amphistoma, Sav., Ég., Annél., pl. 1, fig.;—Cl. lumbricalis, Ot., Fabr., Aud. et Edw., Littor. dela France, Annél., pl. X, fig. 1–6;—Cl. Ebiensis, Aud. et Edw., ib., fig. 8–12.
[page] 213
succion, et servant à la sangsue d'organes principaux de mouvement; car a près s'être allongée, elle fixe l'extrémité antérieure et en rapproche l'autre qu'elle fixe à son tour pour porter la première en avant. On voit dans plusieurs en dessous du corps deux séries de pores, orifices d'autant de petites poches intérieures que quelques naturalistes regardent comme des organes de respiration bien qu'ils soient la plupart du temps remplis d'un fluide muqueux. Le canal intestinal est droit, boursouflé d'espace en espace, jusqu'aux deux tiers de sa longueur, où il a deux cœcums. Le sang avalé s'y conserve rouge et sans altération, pendant plusieurs semaines.
Les ganglions du cordon nerveux sont beaucoup plus séparés qu'aux lombries.
Les sangsues sont bermaphrodites. Une grande verge sort sous le tiers antérieur du corps, et la vulve est un peu plus en arrière. Plusieurs rassemblent leurs œufs en cocons, enveloppés d'une excrétion fibreuse (1).
On les a subdivisées d'après des caractères dont les principaux sont tirés de leurs organes de la bouche.
Dans les SANGSUES proprement dites (SANGUISUGA. Sav.) (2)
Le suçoir antérieur a sa lèvre supérieure de plusieurs segments; son ouverture est transversale, et il contient
(1) Voyez Mémoires pour servir à l'Hist. nat. des sangsues, par P. Thomas; un Mém. de M. Spix, parmi ceux de l'Acad. de Bavière pour 1813; et un autre de M. Carena, dans le vingt-cinquième vol. de l'Ac. de Turin; mais surtout le Systême des Annélides par M. Savigny et la Monographie des hirudinées, par M. Moquin Tandon, Montpellier, 1826, in-4°. Consultez aussi l'Essai d'une monographie de la famille des Hirudinées, extrait du Dict. des Sc. nat., par M. de Blainville. Paris, 1827, in-8°, et l'art, SANGSUE de ce Dict. par M. Audouin.
(2) M. de Blainville change ce nom en JATROBDELLA. Voyez, sur les diverses sangsues médicinales, les fig. de MM. Carena, Acad. de Turin, t. XXV, pl. XI, et Moquin-Tandon, pl. V.
[page] 214
trois mâchoires armées chacune sur leur tranchant, de deux rangées de dents très fines, ce qui leur donne la faculté d'entamer la peau sans y faire de blessure dangereuse; on leur voit dix petits points que l'on a regardés comme des yeux.
Tout le monde connaît la Sangsue médicinale (Hirudo medicinalis, L.), si utile instrument pour les saignées locales. Elle est d'ordinaire noirâtre, rayée de jaunâtre en dessus, jaunâtre tachetée de noir en dessous. On la trouve dans toutes les eaux dormantes.
Les HÆMOPIS, Sav. (1), en différent parce que leurs mâchoires n'ont que des dents peu nombreuses et obtuses.
La Sangsue des chevaux. (Hirudo sanguisuga. L. Hæmop. Sanguisorba. Sav. Moq. Tand. pl. IV. f. I. Car. pl. XI. f. 7.)
Beaucoupplus grande, et toute d'un noir-verdâtre; on l'a dite quelquefois dangereuse par les plaies qu'elle cause (2).
Les BDELLES, Sav. (3), n'ont que huit yeux, et leurs mâchoires manquent absolument de dents.
Il y en a une dans le Nil (Bd. Nilotica, Eg., Annél., pl. v., f. 4).
Les NEPHELIS, Sav. (4), n'ont aussi que huit yeux, leur bouche n'a intérieurement que trois plis de la peau.
(1) M. de Blainville change ce nom en HYPOBDELLE.
(2) C'est une chose singulière que la diversité des opinions sur la faculté que cette sangsue des chevaux aurait de tirer du sang. Linnæus dit que neuf peuvent tuer un cheval. MM. Huzard et Pelletier au contraire, dans un Mémoire ad hoc présenté à l'Institut et inséré dans le Journal de Pharmacie, mars 1825, assurent qu'elle n'attaque aucun animal vertébré. M. de Blainville pense que c'est qu'on l'a confondue avec une espèce très voisine, la Sangsue noire, dont il fait un type d'un genre qu'il nomme PSEUDOBDELLA, et dont les mâchoires ne seraient que des plis de la peau sans aucunes dents. Je crois que ce fait mériterait un nouvel examen. L'une et l'autre espèce dévore avec avidité les lombrics.
(3) M. Moquin-Tandon change ce nom en LIMNATIS, B.
(4) M. de Blainv. les nomme ERPOBDELLES. M. Oken les avait appelées auparavant HELLUO. Telles sont: Hir. vulgaris, L., ou H. octoculata, Bergm, Mém. de Stokh., 1757, pl. VI, f. 5–8;—N. atomaria, Caren., L., C., pl. XII. Voyez aussi la pl. VI de M. Moquin-Tandon.
[page] 215
Il y en a dans nos eaux plusieurs petites espèces; on croit devoir en distinguer
LES TROCHÉTIES. Dutrochet. (1)
Qui n'en diffèrent que par un renflement à l'endroit des organes génitaux.
Nous en avons une espèce qui va souvent à terre poursuivre les lombrics, Geobdella trochetii, Blainv., Dict. des Sc. nat.; Hirud., pl. IV, f. 6.
M. Moquin-Tandon, sous le nom d'AULASTOME, en décrit même un sous-genre, dont la bouche aurait seulement des plis longitudinaux et assez nombreux, Aulast. nigrescens, Moq.-Tand., pl. VI, f. 4.
A la suite des néphélis viennent se placer les BRANCHIOBDELLES de M. Odier, remarquables par les mâchoires au nombre de deux, et l'absence des yeux.
On en connaît une espèce qui vit sur les branchies de l'écrevisse (2).
Toutes ces subdivisions ont le suçoir antérieur peu séparé du corps; dans les deux suivantes, il s'en distingue nettement par un étranglement, ne se compose que d'un segment unique, et a l'ouverture transversale.
Les HÆMOCHARIS (3), Sav., ont, avec cette conformation, huit yeux, le corps grêle et les anneaux peu distincts. Leurs mâchoires sont des points saillants, à peine visibles; elles ne nagent point, marchent à la manière des chenilles dites géomètres, et s'attachent surtout aux poissons.
Nous en avons une assez fréquente sur les cyprins, Hirudo piscium, L., Rœsel, III, XXXII (4).
(1) M. de Blainv. change ce nom en GEOBDELLE.
(2) Branchiobdella Astaci, Od., Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris, tom. I, pl. IV.
(3) M de Blainville, qui leur avait donné le nom de PISCICOLES, adopté par M. de Lamarck, l'a changé encore en ICHTYOBDELLE.
(4) Aj. Pisciola cephalota, Caren., pl. XII, f. 19, et Moq.-Tand, pl. VII, f. 2; — Piscic. tesselata, Moq., f. 3.
[page] 216
Les ALBIONES, Sav. (1), diffèrent des précédentes parce que leur corps est hérissé de tubercules, et que leurs yeux sont au nombre de six; elles vivent dans la mer.
Nos mers nourrissent abondamment l'Albionne verruqueuse (Hirudo muricata, L.), toute hérissée de petits tubercules (2).
On a nommé BRANCHELLION (3) un parasite de la torpille, très semblable à une sangsue, par ses deux ventouses, son corps déprimé, ses plis transverses; sa ventouse antérieure, qui paraît avoir une très petite bouche à son bord postérieur, est portée sur une partie amincie en forme de col, à la racine de laquelle est un petit trou pour les organes de la génération; il paraît y en avoir un autre en arrière.
Les bords latéraux de ses plis, comprimés et saillants, ont été regardés comme des branchies, mais je n'y vois point de vaisseaux; son épiderme est ample, et l'enveloppe comme un sac très lâche (4).
On range communément aussi parmi les sangsues
LES CLEPSINES. Sav. ou GLOSSOPORES. Johns. (5)
Qui ont le corps élargi, une ventouse postérieure seulement, et la bouche en forme de trompe, et sans suçoir; mais il ne serait pas impossible que quelques-unes appartinssent plutôt à la famille des planaires (6).
(1) Ce sont les PONTOBDELLA de Leach et de Blainv.
(2) Aj. Pontobd. areolata;—P. verrucata;—P. Spinulosa, Leach, Miscell. Zool., LXIII, LXIV, LXV; — Hirudo vittata, Chamiss., et Eisenhardt, Nov. ac nat. Car., t. X, pl. XXIV, f. 4.
(3) Ce sont les POLYDORES d'Oken, les BRANCHIOBDELLION de Rudolphi, es BRANCHIOBDELLA de Blainville.
(4) C'est le Branchellion torpedinis de Sav.; mais on ne doit pas lui associer l'espèce observée sur la tortue (Hir. branchiata, Menzies, Trans. Linn., I, XVIII, 3), qui paraît vraiment avcir des branchies en panache, et qu'il serait nécessaire d'examiner de nouveau.
(5) M. de Blainville les nomme GLOSSOBDELLES.
(6) Hir. complanata, L., ou sexoculata, Bergm., Mém. de Stokh., 1757, pl. VI, f. 12–14; — H. trioculata, ib., f. 9–11; — Hir. hyalina, L., Gm., Trembley, Polyp., pl. VII, f. 7; — Clepsine paludosa, Moq. Tand., pl. IV, f. 3, etc.
[page] 217
Je le crois encore davantage des PHYLLINES, Oken, (1) et des MALACOBDELLES, Blainv. (2), qui ont aussi des corps élargis, et manquent de trompe et de suçoir antérieur. Ce sont des animaux parasites.
LES DRAGONNEAUX. (GORDIUS. L.)
Ont le corps en forme de fils, de légers plis transverses en marquent seuls les articulations, et l'on n'y voit ni pieds, ni branchies, ni tentacules. Cependant, à l'intérieur, on y distingue encore un système nerveux à cordon noueux. Peut-être cependant faudra-t-il définitivement les placer avec les vers intestinaux cavitaires, comme les némertes.
Ils habitent dans les eaux douces, dans la vase, les terres inondées, qu'ils perçent en tous sens, etc.
Les espèces n'en sont pas encore très bien distinguées. La plus commune (Gordius aquaticus, L.), est longue de plusieurs pouces, presque déliée comme un crin, brune, à extrémités noirâtres.
(1) Nommées ÉPIBDELLES par M. de Blainv.; — Hir. hippoglossi, Müll., Zool., dan., LIV, 1–4.
(2) Hir. grossa, Müll,, Zool., dan., XXI.
[page] 218
QUATRIÈME ET DERNIER EMBRANCHEMENT
ou
GRANDE DIVISION DES ANIMAUX.
LES ZOOPHYTES,
OU ANIMAUX RAYONNÉS (1).
COMPRENNENT un nombre considerable d'êtres, dont l'organisation toujours manifestement plus simple que celle des trois embranchements précédents, présente aussi plus de degrés que celles de chacun d'eux, et semble ne s'accorder qu'en ce point, que les parties y sont disposées autour d'un axe, et sur deux ou plusieurs rayons, ou sur deux ou plusieurs lignes allant d'un pôle à l'autre; les vers intestinaux eux-mêmes, ont au moins deux lignes tendineuses ou deux filets nerveux partant d'un collier autour de leur bouche; plusieurs d'entre eux ont quatre suçoirs autour d'une proéminence en
(1) Ni l'une ni l'autre de ces dénominations ne doivent être prises dans un sens absolu; il y a dans cet embranchement des genres où le rayonnement est peu marqué, ou manque même tout-à-fait, et ce n'est que dans la classe des polypes que se voit cette fixité et cette forme de fleurs qui les a fait appeler zoophytes. Néanmoins ces dénominations marquent bien que l'on est arrivé aux degrès les plus inférieurs du règne animal, et à des êtres dont la plupart rappellent plus ou moins le règne végétal, même par leurs formes extérieures; c'est dans ce sens que je les emploie.
[page] 219
forme de trompe; en un mot, malgré quelques irrégularités, et à très peu d'exceptions près (telles que les planaires et la plupart des infusoires) on retrouve toujours quelques traces de la forme rayonnante, très marquée dans le grand nombre de ces animaux, et surtout dans les étoiles, les oursins, les acalèphes et les innombrables polypes.
Le système nerveux n'est jamais bien évident; lorsqu'on a cru en voir des traces, elles étaient aussi disposées en rayons; mais le plus souvent il n'y en a pas la moindre apparence.
Il n'y a jamais non plus de système véritable de circulation; les holothuries ont deux appareils vasculaires; l'un lié aux intestins, et correspondant aux organes de la respiration; l'autre servant seulement au renflement des organes qui tiennent lieu de pieds. Ce dernier seul paraît distinctement dans les oursins et les astéries. On voit au travers de la substance gélatineuse des méduses, des canaux plus ou moins compliqués qui dérivent de la cavité intestinale; tout cela n'offre aucune possibilité de circulation générale; et dans le très grand nombre des zoophytes, il est aisé de se convaincre qu'il n'y a pas de vaisseaux du tout.
Quelques genres, tels que les holothuries, les oursins, plusieurs intestinaux, ont une bouche et un anus avec un canal intestinal distinet; d'autres ont un sac intestinal, mais avec une seule issue tenant lieu de bouche et d'anus; au plus grand nom-
[page] 220
bre il n'y a qu'une cavité creusée dans la substance même du corps, qui s'ouvre quelquefois par plusieurs suçoirs; enfin il en est beaucoup où l'on n'aperçoit aucune bouche, et qui ne peuvent guère se nourrir que par l'absorption de leurs pores.
On observe des sexes parmi plusieurs vers intestinaux. Le plus grand nombre des autres zoophytes est hermaphrodite et ovipare; plusieurs n'ont aucun organe génital, et se reproduisent par bourgeons ou par division.
Les animaux composés, dont nous avions déjà vu quelques apparences parmi les derniers mollusques, sont très multipliés dans certains ordres de zoophytes, et leurs aggrégations y forment des troncs et des expansions de toute sorte de figures. Cette circonstance, jointe à la simplicité d'organisation de la plupart des espèces, et à cette disposition rayonnante de leurs organes, qui rappellent les pétales des fleurs, est ce qui leur a valu le nom de zoophytes ou d'animaux-plantes, par lequel on ne veut indiquer que ces rapports apparents; car les zoophytes, jouissant de la sensibilité, du mouvement volontaire, et se nourrissant, pour la plupart, de matières qu'ils avalent ou qu'ils sucent, et qu'ils digèrent dans une cavité intérieure, sont bien certainement à tous égards des animaux.
Le plus ou moins de complication des zoophytes a donné lieu à leur division en classes; mais comme on ne connaît pas encore parfaitement toutes les
[page] 221
parties de leur organisation, ces classes n'ont pu être caractérisées avec autant de précision que celles des embranchements précédents.
Les oursins et les astéries, auxquels les épines qui les garnissent d'ordinaire ont fait donner, par Bruguière, le nom d'ECHINODERMES, ont un intestin distinct, flottant dans une grande cavité, et accompagné de plusieurs autres organes pour la génération, pour la respiration, pour une circulation partielle. Il a fallu leur réunir les holothuries, qui ont une organisation intérieure analogue, peutêtre même encore plus compliquée, bien qu'elles n'aient point d'épines mobiles à la peau.
Les VERS INTESTINAUX, qui forment la seconde classe, n'ont point de vaisseaux bien évidents et où se fasse une circulation distincte, ni organes séparés de respiration; leur corps est en général allongé ou déprimé, et leurs organes disposés longitudinalement; les différences de leur système nutritif les feront probablement diviser un jour en deux classes, que nous indiquons déjà en y établissant deux ordres; en effet, dans les uns il y a un canal alimentaire suspendu dans une vraie cavité abdominale, qui manque dans les autres.
La troisième classe comprend les ACALÈPHES ou ORTIES DE MER. Elles n'ont aussi ni vaisseaux vraiment circulatoires, ni organes de respiration; leur forme est généralement circulaire et rayonnante; et presque toujours leur bouche tient lieu d'anus. Elles
[page] 222
ne diffèrent des polypes que par plus de développement dans le tissu de leurs organes. Les acalèphes hydrostatiques, que nous laissons à la fin de cette classe, en donneront peut-être un jour une séparée, quand elles seront mieux connues; mais ce n'est encore que par conjecture que l'on juge des fonctions de leurs singuliers organes.
Les POLYPES, qui composent la quatrième classe, sont tous ces petits animaux gélatineux, dont la bouche entourée de tentacules, conduit dans un estomac tantôt simple, tantôt suivi d'intestins en forme de vaisseaux; c'est dans cette classe que se trouvent ces innombrables animaux composés, à tige fixe et solide, que l'on a long-temps regardés comme des plantes marines.
On a coutume de laisser à leur suite les théthyes et les éponges, bien que l'on n'ait pu encore y découvrir de polypes.
Enfin les INFUSOIRES, ou la cinquième et dernière classe des ZOOPHYTES, sont ces petits êtres qui n'ont été découverts que par le microscope, et qui fourmillent dans les eaux dormantes. La plupart ne montrent qu'un corps gélatineux sans viscères; cependant on laisse à leur tête des espèces plus composées, possédant des organes visibles de mouvement, et un estomac; on en fera aussi peutêtre quelque jour une classe à part.
[page] 223
PREMIÈRE CLASSE DES ZOOPHYTES.
LES ÉCHINODERMES (1).
Les échinodermes sont encore les animaux les plus compliqués de cet embranchement. Revêtus d'une peau bien organisée, souvent soutenue d'une sorte de squelette et armée de pointes, ou d'épines articulées et mobiles, ils ont une cavité intérieure où flottent des viscères distincts. Une sorte de système vasculaire, qui à la vérité ne s'étend pas à tout le corps, entretient une communication avec diverses parties de l'intestin, et avec les organes de la respiration, qui, le plus souvent, sont très distincts aussi. On voit même dans plusieurs espèces des filets, qui pourraient remplir des fonctions nerveuses, mais qui ne sont jamais distribués avec la régularité et dans l'ordre fixe des deux autres embranchements sans vertèbres.
Nous divisons les échinodermes en deux ordres: ceux qui ont des pieds, ou du moins des organes vésiculaires auxquels on a donné ce nom, parce qu'ils en tiennent lieu, et ceux qui en manquent.
(1) M. de Lamarck les nomme ra laires échinodermes.
[page] 224
PREMIER ORDRE DES ÉCHINODERMES.
LES PÉDICELLÉS.
Se distinguent par des organes du mouvement qui leur sont tout particuliers. Leur enveloppe est percée d'un grand nombre de petits trous placés en séries très régulières, au travers desquels passent des tentacules membraneux cylindriques, terminés chacun par un petit disque qui fait l'office de ventouse. La partie de ces tentacules qui reste à l'intérieur du corps est vésiculaire; une liqueur est épanchée dans toute leur cavité, et se porte, au gré de l'animal, dans la partie cylindrique extérieuré qu'elle étend, ou bien elle rentre dans la partie vésiculaire intérieure, et alors la partie extérieure s'affaisse, C'est en allongeant ou en raccourcissant ainsi leurs centaines de petits pieds ou de tentacules, et en les fixant par les ventouses qui les terminent, que ces animaux exécutent leurs mouvements progressifs. Des vaisseaux partant de ces petits pieds, se rendent dans des troncs qui répondent à leurs rangées, et qui aboutissent vers la bouche. Ils forment un système distinct de celui des vaisseaux intestinaux qui s'observent dans quelques espèces (1).
(1) Sur l'organisation des astéries, des oursins et des holothuries, on doit consulter principalement la belle monographie anatomique qu'en a donnée M. Tiédemann; Landshut, 1816, in-fol.
[page] 225
Linnæus en fait trois genres très naturels, mais assez nombreux, et comprenant des espèces assez variées pour être considérés comme trois familles.
LES ASTÉRIES (ASTERIAS. L.), vulgairement ÉTOILES DE MER,
Ont reçu ce nom parce que leur corps est divisé en rayons, le plus souvent au nombre de cinq, au centre desquels, en dessous, est la bouche, qui sert en même temps d'anus.
La charpente de leur corps se compose de petites pièces osseuses diversement combinées, et dont l'arrangement mériterait d'être étudié. Elles ont une grande force de reproduction, et non-seulement reproduisent les rayons qui leur sont enlevés isolément, mais un seul avec le centre rayon conservé peut reproduire les autres ce qui fait qu'on en trouve assez souvent d'irrégulières,
Dans
Les ASTÉRIÉS proprement dites. (ASTERIAS, Lam.)
Chaque rayon a en dessous un sillon longitudinal, aux côtés duquel sont percés tous les petits trous qui laissent passer les pieds. Le reste de la surface inférieure est muni de petites épines mobiles. Toute la surface est aussi percée de pores qui laissent passer des tubes beaucoup plus petits que les pieds, servant probablement à absorber l'eau, et à l'introduire dans la cavité générale pour une sorte de respiration. Sur le milieu du corps, un peu de côté, se trouve une petite plaque pierreuse à laquelle répond intérieurement un canal rempli de matière calcaire que l'on croiservir à l'accroissement des parties solides. A l'intérieur, on voit un grand estomac, immédiatement sur la bouche, d'où partent pour chaque rayon deux cœcums, ramifiés comme des arbres, et suspendus chacun à une sorte de
TOME III. 15
[page] 226
mésentère. Il y a aussi deux ovaires dans chaque rayon, et il paraît que les astéries se fécondent elles-mêmes. Un système vasculaire particulier correspond à leur intestin, et il y en a un autre pour les pieds.
M. Tiédemann regarde comme leur système nerveux un filet très fin qui entoure la bouche et envoie un rameau à chaque bras, lequel marche entre les pieds extérieurement, et donne deux ramuscules à l'intérieur.
Leur charpente osseuse consiste principalement pour chaque branche, en une sorte de colonne régnant le long de la face inférieure, composée de rouelles ou de vertèbres articulées les unes avec les autres, et desquelles partent les branches cartilagineuses qui soutiennent l'enveloppe extérieure. Entre les racines de ces branches sont les trous par où passent les pieds. D'autres pièces osseuses, auxquelles s'attachent souvent des épines mobiles, garnissent, dans beaucoup d'espèces, les bords latéraux des branches.
Certaines astéries ont la forme d'un pentagone à côtés rectilignes, plutôt que d'une étoile. Le rayonnement n'est marqué au dehors que par le sillon des pieds (1).
D'autres ont sur chaque côté du pentagone un léger angle rentrant (2).
En d'autres, les côtés sont concaves, ce qui commence à leur faire prendre une figure d'étoile (3).
Dans ces diverses espèces les cœcums et les ovaires ne s'alongent point autant que dans le plus grand nombre des autres qui ont leurs rayons alongés et séparés par des angles rentrants bien marqués.
(1) Asterias discoïdea, Lam., Encycl. méth., vers, XCVII, XCVIII; — Ast. tesselata, Var. A, Lam., Link., XIII, 22; Encycl., XCVI.
(2) Asterias membranacea, Link., I, 2; — A. rosacea, Lam., Encycl., XCIX, 2, 3.
(3) Ast. tesselata, Var. C. et D., Lam., Link., XXIII, 37, XXIV, 39, Encycl., 97 et 98, 1 et 2; — Ast. equestris, L., et Lam., Link., XXXIII, 53, Encycl., CI et CII; — Ast. reticulata, Lam., Link., XLI, XLII, Encycl., C, 6, 7;—Ast. militaris, Müll, Zool. dan., CXXXI; — Ast. minuta, Séb., III, V, 14, 15, Encycl., C, 1–3; — Ast. nodosa. Link., II, III et VII, Encycl., CV, CVI.
[page] 227
Telles sont
L'Astérie vulgaire ou rougeâtre. (Ast. rubens. L.) Encycl. CXIII. 1. 2.
Qui est excessivement commune sur toutes nos côtes, au point qu'on l'emploie en quelques endroits pour fumer les terres.
L'Astérie glaciale. (Ast. glacialis. L.) Link. XXXVIII. 69. Encycl. CVII et CVIII.
A souvent plus d'un pied de diamètre. Les épines qui revêtent le dessus de son corps sont entourées d'une foule de petits tubes charnus, qui forment comme des coussins autour de leurs bases.
L'Astérie orangée. (Ast. aurantiaca. L.) Link. VI. VII. XXIII. Encycl. CX. Égyp. Echin. pl. IV. 1.
Est notre plus grande espèce; les bords de ses branches sont garnis de pièces en pavés, sur lesquels s'articulent de fortes épines mobiles. Tout le dessus est couvert d'autres petites épines terminées en têtes tronquées et hérissées (1).
Quelques-unes ont un nombre de rayons supérieur à cinq (2). Leurs cœcums et leurs ovaires sont très courts.
On a dû séparer des autres astéries les espèces où les rayons n'ont point en dessous de sillon longitudinal, pour loger les pieds; généralement ces rayons ne sont pas creux, et l'estomac ne s'y prolonge pas en cœcums, mais ses proéminences restent dans leurs intervalles. La locomotion se fait principalement par les courbures et le mouvement des rayons, et non pas par les pieds, qui sont trop peu nombreux.
(1) Ajoutez: Ast. rosea, Müll., Zool. dan., LXVII;—Ast. violacea, ib., XLVI; — Ast. echinophora. Lam., Link., IV, 7, Encycl., CXIX, 2, 3; — Ast. variolata, Lam., Link., VIII, 10; Encycl., ib., 4, 5; — Ast. lævigata, Link., XXVIII, 47; Encycl., CXX; — Ast. seposita' Link., IX, 16, Encycl., CXII, 1. 2.
(2) Ast. paposa, Link., XVII, 28, XXXIV, 54, Encycl., CVII, 3, 4, 6, 7; — Ast. echinites, Lam., Solander et Ellis, Corall., LX-LXII, Encycl., CVII, A-C; — Ast. helianthus, Lam., Encycl., CVIII et CIX.
15*
[page] 228
M. Delamarck nomme OPHIURES celles qui ont autour d'un disque central cinq rayons non branchus; mais ou doit encore distinguer
Celles ou ces rayons sont garnis de chaque côté d'épines mobiles; les petits pieds charnus sortent aussi de chaque côté d'entre les bases de ces épines (1).
Et celles où n'ayant point d'épines latérales, mais étant garnis d'écailles imbriquées, ces rayons ressemblent à des queues de serpents. Le disque central a, dans chaque intervalle des rayons, à la face où est la bouche, quatre trous qui penètrent dans l'intérieur, et servent peut-être à la respiration, ou, selon d'autres, à la sortie des œufs. Il n'y a de pieds que dans cinq sillons courts, qui forment une étoile autour de la bouche (2).
Les GORGONOCÉPHALES, Leach (3), nommées EURYALES par M. Delamarck sont celles où les rayons se divisent dichotomiquement. Il y en a où cette division commence dès la base des rayons, et qui présentent l'apparence d'un paquet de serpents; on les a nommées vulgairement Têtes de Méduse (4). La base de chaque rayon a deux trous pénétrants.
Mais il y en a aussi où la division ne commence qu'au bout du rayon et se répète peu (5).
On doit encore plus séparer des autres astéries,
Les ALECTO de Leach que M. Delamarck appelle COMATULES. Elles ont cinq grands rayons articulés, divisés cha-
(1) Ast. nigra. Müll., Zool., d., XCIII; — Ast. tricolor, ib, XCVII; — Ast. fragilis, ib., XCVIII; — Ast. filiformis? ib., LIX; — Ast. aculeata, Link., XXVI, 42, Müll., Zool. dan., XCXIX; — Ophiura echinata, Lam., Encycl., CXXIV, 2, 3; — Oph. ciliaris, ib., 4, 5; — Oph. lumbricalis, ib., I.
(2) Asterias ophiura, Lin, ou Ophiura lacertosa, Lam., Encycl., CXXIII, 1, CXXII; — Oph. texturata, ejusd., Link., II, 4, Encycl., CXXIII, 2, 3; — Oph. cuspidifera, Lam.? Encycl., CXXII, 5–8.
(3) Zool., Miscell,, n° 16, p. 51.
(4) Asterias, caput Medusæ, L. (Euryale asperum, Lam.), Link., XX, 32, Encycl., CXXVII; — Euryale muricatum, ib., CXXVIII et CXXIX; — Asterias euryale, Gm. (Euryale costosum), ib., CXXX; Link., XXIX et XXX.
(5) Euryale palmiferum, Lam., Encycl., CXXVI.
[page] 229
cun en deux ou trois, qui portent deux rangées de filets articulés; ces cinq rayons s'attachent à un disque pierreux, qui porte encore du côté opposé à la bouche, une, deux ou trois rangées d'autres filets articulés sans branches, plus courts et plus minces que les grands rayons, et qui, dit-on, leur servent à se cramponner. Le sac qui contient les viscères est au centre des grands rayons, ouvert d'une bouche en étoile, et d'un autre orifice tubuleux qui pourrait être l'anus (1).
C'est près des COMATULES que doivent être placés
LES ENCRINES. (ENCRINUS. Guettard. (2))
Que l'on pourrait définir (3) des comatules à disque prolongé en une tige divisée en un grand nombre d'articulations. Leurs branches elles-mêmes sont articulées et divisées dichotomiquement en rameaux, portant des rangées de filets tous articulés, et la tige en porte de plus petits à diverses hauteurs; au centre des rayons est la bouche, et sur un côté l'anus.
Il n'y en a, dans les mers d'Europe, qu'une très petite espèce (Pentacrinus europæus, Thomson, Monogr.), qui s'attache à divers lithophytes.
Les mers des pays chauds en produisent de plus grandes et plus compliquées, telles que. Encr. asterias, Blum.; Isis aster., Linn.
Mais les encrines fossiles sont très nombreux et varient assez dans le détail pour qu'on les aitdivisés en plusieurs sous-genres, d'après la composition ducorps central placé au sommet de la tige, et duquel parteules grands rayons.
Ce corps peut être formé de pièces articulées avec la tige, et portant les rayons par des articulations semblables. Alors
(1) Asterias multiradiata, Miscell. Zool., loc. cit., L., Link., XX, 33, XXII, 34, Encycl., CXXV; — Ast. pectinata, L., Link., XXXVII, 66, Encycl, CXXIV, 6, Égypt., Echin., I, 1, 2, etc.
(2) Acad. des Sc., 1755, p. 224.
(3) Voyez Schweigger, histoire des Mollusques et Zoophytes, p. 528.
[page] 230
si la tige est ronde et renflée dans le haut, ce sont les APIOCRINITES, Mill.;
Si elle est ronde, mais non renflée, les ENCRINITES;
Si elle est pentagonale, les PENTACRINITES.
Ou bien ce corps peut être formé de plaques anguleuses jointes en semble par leurs bords, et formant plusieurs rangées.
Parmi ceux-là
Les PLATYCRINITES n'ont que deux rangées, une de trois plaques, l'autre de cinq;
Les POTÉRIOCRINITES en ont trois rangées, chacune de cinq plaques;
Les CYATHOCRINITES aussi trois, chacune de cinq, mais la dernière a des plaques intercalaires qui peuvent la porter jusqu'à dix;
Les ACTINOCRINITES en ont plusieurs rangées; la première de trois, la seconde de cinq, les autres plus nombreuses. Les deux premières ont des arêtes en rayons;
Les RHODOCRINITES ont aussi plusieurs rangées, dont la première de trois, la seconde de cinq, la troisième de dix, toutes les trois avec des arêtes; ensuite en viennent de plus nombreuses;
Enfin le corps central peut être tout d'une pièce, mais qui paraît composée de cinq soudées ensemble: ce sont les EUGENIACRINITES (1).
Les productions fossiles connues sous les noms d'entroques, sont des pièces de la tige et des branches d'animaux de ce genre.
LES OURSINS (ECHINUS. L.), vulgairement HÉRISSONS DE MER.
Ont le corps revêtu d'un test ou d'une croûte cal-
(1) Personne n'a étudié ces productions avec tant de soin, et ne les a décrites si exactement que M. J. Miller, dans son Histoire nat. des Crinoïdea, Bristol, 1821, in-4°. C'est de cet ouvrage que nous avons extrait notre article. M. Georges Cumberland en a donné aussi d'excellentes figures dans la brochure qu'il a publiée à Bristol en 1826, sous le titre de Reliquiæ conservatæ, etc.
[page] 231
caire, composée de pièces anguleuses qui se joignent exactement, et per cées de plusieurs rangées très régulières d'innombrables petits trous, par où passent les pieds membraneux. La surface de cette croûte est armée d'épines articulées sur de petits tubercules, et mobiles au gré de l'animal, à qui elles servent à ses mouvements, conjointement avec les pieds, qui sont situés entre elles. D'autres tubes membraneux, beaucoup plus fins et souvent divisés à leur extrémité, servent probablement à introduire et à faire sortir l'eau qui remplit l'intérieur de leur coquille. La bouche est garnie de cinq dents enchâssées dans une charpente calcaire très compliquée, ressemblant à une lanterne à cinq pans, garnie de divers muscles, et suspendue dans une grande ouverture du test. Ces dents, en forme de longs rubans, se durcissent vers leur racine à mesure qu'elles s'usent par leur pointe (1). L'intestin est fort long et attaché en spirale aux parois intérieures du test par un mésentère. Un double système vasculaire règne le long de ce canal et s'étend en partie sur le mésentère, et il y a aussi des vaisseaux particuliers pour les pieds. Cinq ovaires situés autour de l'anus se déchargent chacun par un orifice particulier; ils forment la partie mangeable de ces animaux.
Les oursinsvivent surtout de petits coquillages, qu'ils saisissent avec leurs pieds. Leurs mouvements sont très lents. Des test d'oursins se sont conservés en très grand nombre dans d'anciennes couches, principalement dans celles de craie, où ils sont d'ordinaire remplis de silex.
On doit diviser les oursins en réguliers et irréguliers.
(1) Voyez mes leçons d'Anat. comparée, tom. IV, et l'ouvrage cité de M. Tiedemann.
[page] 232
Les oursins réguliers,
OURSINS proprement dits. Lam. (CIDARIS. Klein.)
Ont le test généralement sphéroïdal, la bouche au milieu de leur face inférieure, et l'anus précisément à son opposite. Les petits trous y sont rangés sur dix bandes rapprochées par paires, qui se rendent régulièrement de la bouche à l'anus, comme des méridiens d'un globe.
Certaines espèces ont de grands et gros piquants de formes très diverses, portés sur de gros tubercules de leur test, et dont les bases sont entourées d'autres piquants plus petits (1).
C'est parmi ces espèces que se rangent, ainsi que l'ont découvert MM. Deluc, celles dont les piquants, en forme d'olives, se trouvent assez souvent pétrifiés dans les craies ou d'autres terrains anciens, et ont reçu le nom de pierres judaïques (2).
Les espèces les plus communes et surtout celles de nos côtes, n'ont que des épines minces articulées sur de petits tubercules, beaucoup plus nombreux. Tel est
L'Oursin commun. (Echinus esculentus. Lin.) Klein. Lesk. I. A. B. Encycl. 132.
De la forme et de la grosseur d'une pomme, tout couvert de piquants courts rayés, ordinairement violets. On mange, au printemps, ses ovaires crus, qui sont rougeâtres, et d'un goût assez agréable.
(1) Echinus mamillatus, L., Séb., III, XIII, 1–4, Encycl., pl. 138, 139, et le test dépouillé, ib., 138, 3 et 4; — Les différentes espèces rapprochées sous le nom d'Ech cidaris, Scill., Corp. mar. tab., XXII, Séb., III, XIII, 8, etc.; — Ech. verticillatus, Lam.: Encycl., 136, 2 et 3; — Ech. tribuloïdes, id., Encycl., ib., 4–5; — Ech. pistillaris, id.; Encycl., 137; — Ech. stellatus, L., Séb, III, XIII; 7; — Ech. araneïformis, id., ib., 6; — Ech. saxatilis, id., ib., 10; — Ech. calamarius, Pall., Spicil. Zool., X, 11, 1–7.
(2) Voyez les Lettres sur la Suisse d'Andreæ, pl. XV, et le Mém. de M. Deluc, Acad. des Sc., Mém. des Sav. étr., IV, 467.
N. B. Les test dépouillés sont difficiles à distinguer. Tels sont: Ech. excavatus, L., Scill., Corp., mar., XXII, 2, D.; — Ech. ovarius, Bourguet, Petrif., III, 344, 347, 348.
[page] 233
Les espèces voisines sont assez difficiles à distinguer, par le plus ou le moins de rapprochement des bandes de trous, par l'égalité ou l'inégalité des tubercules, etc. (1).
Quelques oursins ronds et déprimés, perdent de leur régularité par un sillon large dont ils sont creusés d'un côté (2).
Il y a aussi de ces oursins à bouche et á anus opposés, qui, au lieu d'une forme sphéroïdale sur un plan circulaire, sont transversalement ovales, c'est-à-dire qu'un de leurs diamètres horizontaux est plus grand que l'autre (3).
Ils diffèrent anssi entre eux par l'égalité ou l'inégalité des piquants, et par les proportions relatives des tubercules.
On en doit distinguer une espèce (echinus atratus) L.), Encycl. 140, 1–4, où les piquants élargis, tronqués et anguleux à leur extrémité, s'y touchent comme des pavés. Ceux du bord sont longs et aplatis.
Nous appelons irréguliers tous les oursins où l'anus n'est pas à l'opposite de la bouche. Il paraît qu'ils sont garnis
(1) Ech. miliaris, Kl., II, A. B., Encycl., 133, 1, 2; — Ech. hemisphericus, Kl., II, E., Enc., ib., 4; — Ech. angulosus, Kl., II, A. B. F.; Enc., ib., 5, 6, 7; — Ech. excavatus, Kl., XLIV, 3, 4; Enc., ib., 8, 9, très différent de Scill., XXII, 2, D, qui est de la sect. précédente; — Ech. saxatilis, Kl., V, A. B.; Enc., 134, 5, 6; l'Ech. saxat., B., Séb., III, XIII, 10, est très différent et de la sect. précédente; — Ech. fenestratus, Kl., IV, A. B.; — Ech. subangularis, id., III, C. D.; Enc., 134, 1, 2; — Ech. diadema, Kl., XXXVII, 1; Enc., 133, 10; — Ech. radiatus, Séb., III, XIV, 1, 2; Enc., 140, 5, 6; — Ech. circinnatus, Kl., XLV, 10; — Ech. coronalis, Kl. VIII, A. B.; Enc., 140, 7, 8; — Ech. asterisans, Kl., VIII, F.; Enc., 140, 9; — Ech. sardicus, Kl., IX, A. B.; Enc., 141, 1, 2; — Ech flammeus, Kl., X, A.; Enc., 141, 3; — Ech. variegatus, Kl., X, B. C.; Enc., 141, 4, 5; — Ech. pustulosus, Kl., XI, A. B.; Enc., 141, 6, 7; — Ech. granulatus, Kl., XI, F.: Enc., 142, 1, 2; — Ech toreumaticus, Kl., X, D. E., Enc., 142, 4, 5, etc., sans garantir les doubles emplois, ni tous les synonymes.
(2) Ech. sinuatus, Kl., VIII, A.; Enc., 142, 7, 8.
(3) Ech. lucunter, Kl., II, EF., Séb., X, 16, et les esp. représ., Séb., ib., 17 et 8.
[page] 234
seulement de piquants courts et grêles, presque comme des poils. Parmi eux, les uns ont encore la bouche au milieu de la base. Ils peuvent se subdiviser suivant l'étendue des bandes de trous pour les pieds; tantôt elles vont, comme dans les précédents, de la bouche à un point directement opposé, où elles se réunissent après avoir embrassé tout le test; et dans ceux-là,
LES ECHINONÉS. Phelsum et Leske.
Ont la forme ronde ou ovale de certains oursins réguliers, la bouche au milieu de la base, et l'anus entre la bouche et le bord ou près du bord, mais en dessous (1).
LES NUCLÉOLITES. Lam.
Ont, avec ces mêmes caractères, l'anus près du bord, mais en dessus.
Les espèces connues sont toutes fossiles (2).
D'autres,
LES GALÉRITES. Lam. (CONULUS. Kl.)
Ont une base plate sur laquelle leur corps s'élève en cône ou en demi-ellipsoïde. La bouche est au milieu de la base, et l'anus près de son bord.
Ils sont très communs dans les couches pierreuses, mais on n'en connaît point de vivants.
Le plus répandu est l'Ech. vulgaris, L., Encycl., 153, 6–7; Klein., ed. Fr.. VII, D. G. (3).
(1) Espèces ovales. Echinus cyclostomus, Müll., Zool. dan., XCI, 5, 6; Encycl., 153, 19, 20; — Ech. semilunaris, Séb., III, X, 7; Enc., 153, 21 et 22; — Ech. scutiformis, Scill., Corp. mar., XI, n° 2, f. 1 et 2.
Espèces rondes: E., Encycl., 153, 1, 2; — Ech. depressus, Walch., II, E., 11, 6, 7; Encycl., 152, 7, 8; — Ech. subuculus, Kl., XIV, L-O.; Enc., 153, 14, 17.
(2) Spatangus depressus, Leske ap. Klein, LI, fig. 1–2, Enc., 157, 5, 6
(3) Ajoutez: Ech. albo-galerus, L., Bourguet, Petrif., LIII, 361, Encycl., 152, 5, 6.
[page] 235
Quelques-uns n'ont pas leurs bandes de trous distribuées en nombre quinaire (1).
LES SCUTELLES. Lam.
Ont l'anus entre la bouche et le bord, le test excessivement déprimé, plat en dessous, d'une forme approchant de l'orbiculaire.
Quelques-uns l'ont entier et sans autres trous que les séries de petits pores qu'on voit dans tous les oursins (2).
D'autres ont le test également sans grands trous, mais découpé de deux échancrures (3).
D'autres l'ont entier et percé de part en part par quelques grands trous qui ne pénètrent point dans sa cavité (4).
D'autres encore l'ont à la fois échancré et percé de ces grands trous (5).
Il y en a enfin (les ROTULÆ, Kl.) où une partie du bord postérieur est festonnée, comme une roue dentée; et ceuxlà se divisent encore selon qu'ils ont de grands tròus (6), ou qu'ils en manquent (7).
LES CASSIDULES. Lam.
Sont ovales et ont l'anus au-dessus du bord, comme les nucléolites, mais elles se distinguent par leurs bandes de pores incomplètes, c'est-à-dire n'allant point d'un pole à l'autre, et figurant une étoile (8).
(1) Ech. quadrifasciatus, Walch., Monum. dil. supplém., IX, d, 3, et IX, g, 7–9; Encycl., 153, f. 10 et 11;—Ech. sexfasciatus, Walch., supplém., IX, g, 4, 6; Encycl., 153, f. 12 et 13.
(2) Ech., Encycl., 146, 4, 5.
(3) Echinus auritus, Séb., III, XV, 1, 2, Encycl., 151, 5, 6; — Ech. inauritus, Séb., III, XV, 3, 4, Enc.; 152, 1, 2.
(4) Echinus hexaporus, Séb., III, XV, 7, 8; Encycl., 149, 1, 2; — Ech. pentaporus, Klein., Tr. fr., XI, C.; Encycl., 149, 3, 4; — Ech. biforis, Encycl., 149, 7, 8; — Ech. emarginatus, Encycl., 150, 1, 2.
(5) Ech. tetraporus, Séb., XV, 5, 6, Encycl., 148.
(6) Echinus decadactylus, Enc., 150, 5, 6;—Ech. octodactylus, ib., 3, 4.
(7) Echinus orbiculus, Encycl., 151, 1–4.
(8) Cassidulus Caribæorum, Lam., Encycl., 143, fig. 8–10; — Ech. lapis cancri, Kl., XLIX, 10, 11; Enc., 143, 6, 7; — Ech. patellaris, Kl., LIII, 5, 6, 7.
[page] 236
D'autres oursins irréguliers n'ont pas la bouche au centre de leur base, mais elle est vers un côté, ouverte transversalement et dirigée obliquement; l'anus est vers l'autre côté. Ils se subdivisent aussi selon l'étendue de leurs rangées de trous.
Ainsi les ANANCHITES, Lam. (GALEÆ, Klein) ont à peu près la forme des galerites et leurs bandes complètes; leur plus grande différence consiste dans la position de leur bouche. On n'en connaît que de fossiles. Tel est
L'Echinus ovatus. L. Cuv. et Brong. Envir. de Paris. 2e édit. f. v. 7. A. B. C. D.
Espèce répandue en quantité innombrable dans les craies de nos environs (1).
Quelques-unes ont des bandes en nombre quaternaire (2).
On pourrait faire un sous-genre particulier de certaines espèces, où les quatre bandes latérales sont disposées par paires, et ne se rejoignent pas au même point (3).
D'autres fois ces oursins irréguliers à bouche centrale, ont des bandes de pores qui n'aboutissent pas jusqu'à la bouche, mais qui forment sur leur dos une espèce de rosace. Tels sont
LES CLYPÉASTRES. Lam. (ECHINANTHUS. Klein.)
Qui ont l'anus près du bord, et dont le corps est déprimé, à base ovale, concave en dessous. Ils ont quelquefois le contour un peu anguleux (4).
Quelquefois leur dos s'élève dans son milieu (5).
(1) Ech. scutatus, Walch., Mon. dil., II, E., 1, 3, 4; — Ech. pustulosus, Kl., XVI, A. B.; Encycl., 154, 16, 17; — Ech. papillosus, Kl., XVI, C. D.; Enc., 155, 2, 3.
(2) Ech. quadriradiatus, Kl., LIV, 1, Enc., 155, 1.
(3) Ech. bicordatus, Kl.; — Ech. ovalis, Kl., XLI, 5; Enc., 159, 13, 14; — Ech. carinatus, Kl., LI, 3, 4; Enc., 158, 1, 2.
(4) Ech. rosaceus et ses diverses variétés, Encycl., 143, 1–6, 144, 7, 8, 147, 3, 4, tirés de Klein, etc.
(5) Echinus altus, Scill., Corp. mar., IX, 1, 2.
[page] 237
Il y en a aussi dont le contour n'est point anguleux (1).
Et même où il est presque orbiculaire (les LAGANUM, Klein.) (2).
LES FIBULAIRES. Lam. (ECHINOCYAMUS. Leske.)
Ont, avec la rosace des clypéastres, le corps presque globuleux, et la bouche et l'anus rapprochés dans le milieu du dessous. Ils sont d'ordinaire fort petits (3).
Au contraire, les SPATANGUES, Lam. (SPATANGUS, Kl.) ont avec la bouche latérale des ananchites, des bandes de pores incomplètes, et formant une rosace sur le dos. Il n'y en a ordinairement que quatre; celle qui se dirige du côté de la bouche est oblitérée.
Quelques-uns (les BRISSOÏDES, Kl.) ont le test ovale, sans sillons (4).
D'autres ont un large sillon plus ou moins marqué dans la direction de la bande oblitérée (5). Quand ils conservent d'ailleurs la forme ovale, ce sont les BRISSUS, Kl.; mais quelquefois ce sillon s'approfondit, et le test s'élargissant en même temps de ce côté, prend la figure d'un cœur (6).
Nous en avons dans nos mers de ces deux dernières
(1) Echinus oviformis, Séb., III, X, 23; Enc., 144, 1, 2; — Ech. reticulatus, Séb., XV, 23, 24, 35–38; Enc., 141, 5, 6; — Ech. pyriformis, Kl., LI, 56; Enc., 159, 11, 12?
(2) Echinus orbiculatus, Bourguet, Petrif., LIII, 352; — Ech. laganum, Séb., XV, 25, 26; — Ech. subrotundus? Scill., Corp. mar., VIII, 1, 3; — Ech. orbicularis, Gualt. test, CX, B; — Ech. corollatus, Walch., Mon. dil., II, E., 11, 8.
(3) Echinus nucleus, Kl., XLVIII, 2, a-e.; Enc., 153, 24–28; — Ech. lathyrus, Kl., XLVIII, 1, a e.; Encycl., 154, 6, 10; — Ech. craniolaris, Pall., Spicil., Zool., IX, 1, 24; Enc., 154, 1–5, etc.
(4) Ech. teres, Séb., III, XV, 28, 29; Enc., 159, 5, 6; — Ech. brissoïdes, Kl., XXVII, B.; Enc., 259, 4; — Ech. amygdala, Kl., XXIV, h. i.; Enc., 159, 8 et 10.
(5) Ech. spatagus, Séb., III, XIV, 3, 4, 5, 6, X, 22, ab. 19, ab.; Enc., 158, 7–11, 159, 1, 2, 3, etc.; — Ech. radiatus, Kl., XXV, Enc., 156, 9, 10; — Spat. saborbicularis, Cuv. et Brong., Env. de Paris, 2 édit., V, 5; — Spat. ornatus, ib., 6.
(6) Ech. purpureus, Müll., Zool. dan., VI; — Ech. flavescens, id., XCI, auxquels se rapportent probablement plusieurs des tests rassemblés us Ech. lacunosus; tels que Séb., III, X, 21; Encycl., 156, 7, 8.
[page] 238
formes. On leur a observé autour de la bouche des tentacules branchus comme aux holothuries.
LES HOLOTHURIES. (HOLOTHURIA. L.)
Ont le corps oblong, coriace, ouvert aux deux bouts. A l'extrémité antérieure est la bouche, environnée de tentacules branchus très compliqués, qui peuvent rentrer entièrement; à l'extrémité opposée s'ouvre un cloaque où aboutissent le rectum et l'organe de la respiration, en forme d'arbre creux, très ramifié, qui se remplit ou se vide d'eau au gré de l'animal. La bouche n'a point de dents, et n'est garnie que d'un cercle de pièces osseuses; des appendices en forme de poches y versent quelque salive. L'intestin est fort long, replié diversement et attaché aux côtés du corps par un mésentère; une sorte de circulation partielle a lieu dans un double système fort compliqué de vaisseaux, uniquement relatif au canal intestinal, et dans une partie des mailles duquel s'entrelace l'un des deux arbres respiratoires dont nous venons de parler. Il paraît y avoir aussi un cordon nerveux, mais très délié autour de l'œsophage. L'ovaire se compose d'une multitude de vaisseaux aveugles, en partie branchus, qui aboutissent tous à la bouche par un petit oviducte commun; ils prennent, au temps de la gestation, une extension prodigieuse, et se remplissent alors d'une matière rouge et grumelée, qui paraît être les œufs. Des cordons d'une extrême extensibilité, attachés près de l'anus, et qui se développent en même temps, paraissent être les organes mâles: ces animaux seraient donc hermaphrodites. Quand ils sont inquiétés, il leur arrive souvent de se contracter avec tant de force, qu'ils déchirent et vomissent leurs intestins (1).
(1) Voyez, sur I'anatomie des Holothuries, l'excellent ouvrage déjà cité de M. Tiédemann.
[page] 239
On peut diviser les holothuries selon la distribution de leurs pieds.
Dans quelques-unes, ils sont tous situés dans le milieu du dessous du corps, qui forme un disque plus mou sur lequel l'animal rampe, relevant les deux extrémités où sont la tête et l'anus, lesquelles se rétrécissent plus que le milieu. L'anus surtout finit presque en pointe. Leurs tentacules sont très grands quand ils se développent.
Nous en avons une, dans nos mers, dont l'enveloppe est presque écailleuse (Hol. phantapus, L.), Müll., Zool. Dan., CXII, CXIII, Mém. de Stok., 1767. Les pieds de son disque ventral sont sur trois séries.
D'autres ont la face inférieure tout-à-fait plate et molle, garnie d'une infinité de pieds, et la face supérieure bombée, soutenue même par des écailles osseuses, et percée sur l'avant d'un orifice étoilé qui est la bouche, et d'où sortent les tentacules; et sur l'arrière, d'un trou rond qui est l'anus.
Nous en avons une petite (Hol. squamata, Müll., Zool. Dan., X, 1, 2. 3); mais il y en a d'assez grandes dans les mers plus chaudes (1).
D'autres ont le corps cartilagineux, aplati horizontalement; tranchant aux bords; la bouche et les pieds à la face inférieure, et l'anus à l'extrémité postérieure.
Tel est, dans la Méditerranée,
Le Pudendum regale. Fab. Colum. Aquat. XXVI. 1. (Hol. regalis. Nob.)
Espèce longue de plus d'un pied, large de trois à quatre pouces, crénelée tout autour.
D'autres encore ont le corps cylindrique, susceptible de se renfler en tout sens par l'absorption de l'eau; tout le dessous garni de pieds, et le reste de la surface diversement hérissé.
Nos mers, surtout la Méditerranée, en produisent abondamment une de couleur noirâtre, qui a plus d'un pied dans sa grande extension; son dos est hérissé de
(1) Celles que Péron avait nommées CUVIÉRIES.
[page] 240
pointes coniques et molles; sa bouche estgarnie de vingt tentacules branchus, c'est l'Holothuria tremula, Gm., Bohatsch., Anim. mar., VI et VII (1).
Il s'en trouve où les pieds sont distribués en cinq séries, qui s'étendent comme des côtes de melon de la bouche à l'anus, ce qui les a fait appeler concombres de mer.
Tel est dans nos mers
L'Hol. frondosa. L. Gunner. Mém. de Stok. 1767. Pl. IV, f. 1 et 2 Et sous le nom de Pentacta. Abildg. Zool. dan. CVIII. 1. 2. et CXXIV.
Qui a le corps brun, long d'un pied et plus (2).
Enfin il y en a dont le corps est également garni de pieds tout autour (3).
(1) Ajoutez: Holothuria elegans, Müll., Zool. dan., I, et II, qui est l'Hol. tremula de Gunner, Stokh., 1767, pl. IV, f. 3, et de la 12e éd. Cependant ces auteurs ne lui donnent pas de pieds en dessous; — la Fleurilarde Diquemare, Journal de physique, 1778, octob., pl. 1, f. 1.
(2) Les autres fig. citées sous Hol. pentactes, savoir: Zool. dan., XXXI, 8; l'Echinus coriaceus, Planc., Conch., min. not. ap., VI, D. E.; le Cucumis marinus, Rondel., Insect., et Zooph., 131, sont probablement des espèces différentes. La Fleurilarde Diquem. appartient même à une autre section du genre. Ajoutez: Hol. inhærens, Zool. dan., XXXI, 1–7; — Hol. pellucida, ib., CVXXV, 1; — Hol. lævis, Fab., Groënl., n° 345; — Hol. minuta, ib., n° 346. Peut-être Hol. Doliolum. Pall., Misc. zool., pl. XI, f. 10.
(3) Hol. papillosa, Zool dan., CVIII, 5; — Hol. fusus, ib., X, 5, 6; — Hol. impatiens, Forsk. ic., XXXIX, B. ? Eg. Echin. IX. 6.
N. B. Il est difficile de classer, faute de renseignements suffisants, les Hol. vittata, Forsk., XXXVIII, E, et reciprocans, ib., A. Ce dernier est mal à propos cité sous inhærens par Gmel.; — l'Holot. maculata, Chamiss., Ac. nat., Cur.. X, 1re p., tab. XXV, qui s'en rapproche beaucoup, mérite aussi, à cause de son excessive longueur, un examen particulier; — les Hol. thalia, caudata, denulata et zonaria, sont des biphore; — l'Hol. physalus est le genre PHYSALE; — l'Hol spirans, le genre VELELLE; — l'Hol. nuda, le genre PORPITE; — l'Hol. priapus, le genre PRIAPULE. Je soupçonne l'Hol. forcipata, Fab., Groen., n° 349, d'être un thalassème mutilé.
[page] 241
LE DEUXIÈME ORDRE DES ÉCHINODERMES,
OU LES ÉCHINODERMES SANS PIEDS,
Ne comprend qu'un petit nombre d'animaux qui offrent de grands rapports avec les holothuries, mais qui manquent des petits pieds vésiculeux de l'ordre précédent. Leur corps est revêtu d'une pean coriace et sans armure. Leur organisation intérieure n'est pas encore éclaircie sur tous les points.
LES MOLPADIES. (MOLPADIA. Cuv.)
Ont, comme les holothuries, un corps coriace, en forme de gros cylindre, ouvert aux deux bouts, et leur organisation intérieure est assez semblable; mais outre qu'elles manquent de pieds, leur bouche n'a pas de tentacules, et est garnie d'un appareil de pièces osseuses, moins compliqué cependant que celui des oursins.
Je n'en connais qu'une espèce de la mer Atlantique. L'extrémité où est l'anus finit en pointe (Molpadia holothurioïdes, Cuv.).
LES MINIADES. (MINYAS. Cuv.)
Ont aussi le corps sans pieds et ouvert aux deux bouts; mais sa forme est celle d'un sphéroïde déprimé aux pôles, et sillonné comme un melon. Je ne leur trouve point d'armure à la bouche.
Il y en a une très belle espèce d'un bleu foncé dans la
TOME III. 16
[page] 242
mer Atlantique (Mynias cyanea, Cuv., Règ. an., IV, pl. XV, f. 8 (1)).
LES PRIAPULES. Lam.
Ont un corps cylindrique marqué transversalement de rides annulaires profondes, terminé en avant par une masse elliptique, légèrement ridée en longueur, percée de la bouche, et en arrière de l'anus, d'où sort un gros faisceau de filaments qui pourraient être des organes de la génération. L'intérieur de la bouche est garni d'un grand nombre de dents cornées très aiguës, placées en quinconce et dirigées en arrière; l'intestin va droit de la bouche à l'anus. Le système musculaire ressemble à celui des holothuries.
On n'en connaît qu'une espèce des mers du Nord (Holothuria priapus, L.), Müll., Zool. dan., XCVI, 1, longue de deux à trois pouces.
LES LITHODERMES. Cuv.
Ont le corps ovale, comprimé en arrière, et sa surface est comme incrustée d'une couche de petits grains pierreux qui y forment une croûte très dure; la bouche est entourée de tentacules, et les intestins paraissent avoir des rapports avec ceux des holothuries. Je ne leur vois pas d'anus.
Nous n'en connaissons qu'une espèce des Indes (Lithod. cuneus, Cuv.), noirâtre, longue de deux pouces.
LES SIPONCLES. (SIPONCULUS. Gm.)
Ont un corps cylindrique, alongé, à peau épaisse, ridée dans les deux sens; la bouche a une extrémité en forme de trompe, qui peut rentrer ou sortir par le moyen de grands muscles intérieurs, et l'anus plus ou
(1) Elle a été rapportée par Péron.
[page] 243
moins près de la base de cette trompe. L'intestin part de la bouche, va jusque vers l'extrémité opposée, et revient en se roulant en spirale autour de sa première partie. On n'y trouve que du sable ou des fragments de coquilles. De nombreux vaisseaux paraissent l'unir a l'enveloppe extérieure, et il y a de plus, le long d'un des côtés, un filet qui pourrait être nerveux. Deux longues bourses situées en avant, ont leurs orifices extérieurs un peu au-dessous de l'anus, et l'on voit quelquefois intérieurement, près de ce dernier orifice, un paquet de vaisseaux branchus qui pourrait appartenir à la respiration.
Ces animaux se tiennent dans le sable, sous l'eau de la mer, comme les arénicoles, les thalassèmes, et ou les en retire de même pour servir d'appât.
Il en existe plusieurs espèces encore mal distinguées.
L'une d'elles, Sip. edulis, Nob.; Lumbricus edulis, Gm., Pall., Spic. Zool., X, 1, 7, sert de nourriture aux Chinois qui habitent Java, et qui vont la chercher dans le sable, au moyen de petits bambous préparés (1).
D'autres, assez petites (Sip. levis, Sip. verrucosus, Cuv.), percent les pierres sous-marines, et se logent dans leurs cavités.
LES BONELLIES. (BONELLIA. Rolando.)
Ont le corps ovale, une trompe formée d'une lame repliée, susceptible d'un extrême alongement et fourchue à son extrémité. L'anus est à l'extrémité opposée
(1) Je ne vois pas en quoi cette espèce diffère du Vermis macrorhynchoteros, Rondel., des étangs salés du Languedoc, qui est le Sipunculus nudus de Linn.
Le Sipunculus saccatus paraît n'être qu'un individu où l'épiderme s'est détaché.
Il y en a une espèce où l'épiderme est velu, une autre où la peau est toute coriace, etc., qui ne sont pas citées dans les auteurs.
La mer des Indes en produit une de près de deux pieds de long.
16*
[page] 244
du corps. L'intestin est très long, plusieurs fois replié, et près de l'anus sont deux organes ramifiés qui pourraient servir à la respiration. Les œufs sont contenus dans un sac oblong, qui a son issue près de la base de la trompe.
Ces animaux vivent profondément dans le sable, et font arriver leur trompe jusqu'à l'eau, et même jusqu'à l'air quand l'eau est basse.
Nous en avons une espèce dans la Méditerranée (Bonellia viridis, Rol., Ac. de Turin, t. XXVI, pl. XIV (1)).
LES THALASSÈMES. (THALASSEMA. Cuv.)
Ont le corps ovale ou oblong, et la trompe en forme de lame repliée ou de cuilleron, mais non fourchue. Leur canal intestinal est semblable à celui de la bonellie. On ne leur découvre aussi qu'un filet abdominal.
On y distingue:
LES THALASSÈMES proprement dits.
Qui n'ont que ces deux crochets placés très en avant et dont l'extrémité postérieure n'a point de soiés (2).
LES ECHIURES.
Dont l'extrémité postérieure est garnie de quelques rangées transversales de soies.
On en connaît un (Lumbricus echiurus, Gm.) Pall., Miscell., Zool. XI, 1–6, qui habite nos côtes, sur les fonds sableux. Il sert d'appât aux pêcheurs.
(1) M. Rolando dans sa description, prend l'anus pour la bouche, et vice versâ.
(2) Thalassema Neptuni, Gertner, ou Lumbricus thalassema, Pallas, Spicil., Zool., Fasc., X, tab. 1, fig. 6; — Thalassema Mutatorium, Montag., Trans., Linn., XI, V, 26, ne diffère peut-être pas du précédent.
[page] 245
LES STERNASPIS. Otto.
Qui outre les soies des échiures, ont sous la partie antérieure un disque un peu corné, entouré de cils (1).
DEUXIÈME CLASSE DES ZOOPHYTES.
LES INTESTINAUX. (ENTOZOA. Rudolphi.)
Se font remarquer, pour la plus grande partie, parce qu'ils n'habitent et ne peuvent se propager que dans l'intérieur du corps des autres animaux. Il n'est presque aucun animal qui n'en nourrisse de plusieurs sortes, et rarement ceux qu'on observe dans une espèce s'étendent-ils à beaucoup d'autres espèces. Il s'en trouve non-seulement dans le canal alimentaire et les canaux qui y aboutissent, tels que les vaisseaux hépatiques, mais jusque dans le tissu cellulaire, et dans le parenchyme des viscères les mieux revêtus, tels que le foie et le cerveau.
La difficulté de concevoir comment ils y parviennent, jointe à l'observation qu'ils ne se montrent point hors des corps vivants, a fait penser à quelques naturalistes qu'ils s'engendrent spontanément. Il est certain aujourd'hui, non-seulement que la plupart produisent manifestement des œufs ou des petits vivants, mais que beaucoup ont des
(1) Thalassema scutatum, Ranzan, Dec., I, pl. 1, f. 10–12, ou Sternaspis Thalassemoïdes, Otto., Monog.
Un nouvel examen de l'anatomie des thalassèmes m'a démontré que leur place est ici.
[page] 246
sexes séparés et s'accouplent comme les animaux ordinaires. On doit donc croire qu'ils se propagent par des germes assez petits pour être transmis par les voies les plus étroites, ou que souvent aussi les animaux où ils vivent en apportent les germes en naissant.
On n'aperçoil aux vers intestinaux ni trachées, ni branchies, ni aucun autre organe de la respiration, et ils doivent éprouver les influences de l'oxygène par l'intermédiaire des animaux qu'ils habitent. Ils n'offrent aucune trace d'une vraie circulation, et l'on n'y voit que des vestiges de nerfs assez obscurs, pour que plusieurs naturalistes en aient mis l'existence en doute (1).
Lorsque ces caractères se trouvent réunis dans un animal, avec une forme semblable à celle de cette classe, nous l'y rangeons, quoiqu'il n'habite pas dans l'intérieur d'une autre espèce.
Chacun sait à quel point les intestinaux nuisent aux animaux dans lesquels ils se multiplient trop. On emploie contre ceux du canal alimentaire, plusieurs remèdes, dont le plus généralement efficace paraît être l'huile animale mêlée d'huile de térébenthine (2).
Nous les divisons en deux ordres, peut-être assez
(1) Voyez, sur l'anatomie de ces vers, outre les Entozoa de M. Rudolphi, le Mémoire de M. Otto, Soc. des nat. de Berl., septième ann. (1816), et l'ouvrage de M. Jules Cloquet.
(2) Voyez Chabert, Traité des Maladies vermineuses, et Rudolphi, I, p. 493.
[page] 247
différents d'organisation pour former deux classes, si des observations suffisantes pouvaient en fixer les limites.
LES INTESTINAUX CAVITAIRES. (ENTOZOA NEMATOÏDEA. Rud.)
Qui ont un canal intestinal flottant dans une cavité abdominale distincte, et une bouche et un anus.
LES INTESTINAUX PARENCHYMATEUX. (1).
Dont le corps renferme, dans son parenchyme, des viscères mal terminés, et ressemblant le plus souvent à des ramifications vasculaires, ne s'apercevant même quelquefois point du tout.
LE PREMIER ORDRE DES INTESTINAUX.
LES CAVITAIRES. (NEMATOÏDEA. Rudolphi) (2).
Comprend ceux dont la peau extérieure, plus ou moins garnie de fibres musculaires, et en général striée transversalement, contient une cavité abdominale, dans laquelle flotte un canal intestinal distinct, allant de la bouche à l'anus, et où se voient généralement aussi des organes distincts pour les deux sexes. L'intestin s'unit aux parties voisines et à l'enveloppe générale par de nombreux filets, où les
(1) Ils comprennent les quatre derniers ordres de M. Rudolphi.
(2) M. de Blainville a fait de cet ordre, moins les deux derniers genres, ses ENTOMOZAIRES APODES OXYCÉPHALÉS.
[page] 248
uns ont cru voir des vaisseaux nourriciers, les autres des trachées, mais sans preuve. Il est impossible d'observer dans ces animaux une vraie circulation; mais il paraît y avoir, dans plusieurs, un ou deux cordons nerveux, partant d'un anneau qui entoure la bouche, et régnant sur toute la longueur du corps, à la face interne de l'enveloppe.
L'intestin est généralement droit, assez large; l'œsophage est assez souvent plus mince, et, dans quelques espèces on remarque un estomac plus ample et plus robuste. Les organes intérieurs de la génération consistent en de très longs vaisseaux contenant la semence ou les œufs, et prenant leur issue à des points différents selon les genres.
LES FILAIRES. (FILARIA. L.)
Ont le corps alongé et grêle, en forme de fil, percé en avant d'une bouche ronde; elles ressemblent beaucoup, à l'extérieur, aux gordius. Il s'en trouve principalement dans les cavités des animaux qui ne communiquent point au dehors, dans la cellulosité, et jusque dans l'épaisseur des muscles et le parenchyme des viscères; elles y sont quelquefois en paquets et en quantités innombrables, enveloppées dans des espèces de capsules. Il s'en trouve même dans les insectes et dans leurs larves, et jusque dans la cavité viscérale de plusieurs mollusques.
L'espèce la plus célèbre de ce genre est
Le Ver de Médine ou de Guinée. (Filaria Medinensis. Gm. Encycl. XXIX. 3.)
Très commun dans les pays chauds, où il s'insinue sous la peau de l'homme, principalement aux jambes;
[page] 249
s'y développe jusqu'à dix pieds de longueur et plus, si l'on s'en rapporte à quelques auteurs; peut y subsister plusieurs années, sans causer de sensations très vives, mais y produit aussi quelquefois des douleurs atroces et des convulsions, selon les parties qu'il attaque. Quand il se montre au dehors, on le saisit et le retire avec beau coup de lenteur, de peur de le rompre. Il est gros comme un tuyau de plume de pigeon. Son caractère distinctif est d'avoir le bout de la queue pointu et crochu (1).
LES TRICHOCÉPHALES. (TRICHOCEPHALUS.)
Ont le corps rond, plus gros en arrière et mince comme un fil en avant. Cette partie grêle se termine par une bouche ronde.
Le plus connu est
Le Tr. de l'homme. (Trichoc. dispar. Rud.) Gœtz. VI. 1–5. Encycl. XXXIII. 1–4. Vulgairement Ascaride à queue en fil.
Long d'un à deux pouces, dont la partie épaisse n'occupe que le tiers. Dans le mâle, cette partie est roulée en spirale, et l'on voit un petit pénis qui sort près de la queue. La femelle l'a plus droite, et simplement percée à l'extrémité.
C'est un des vers les plus communs dans les gros intestins de l'homme, et qui se multiplie outre mesure dans certaines maladies (2).
On a distingué des trichocéphales,
LES TRICHOSTOMES. Rud. (CAPILLARIA. Zeder.)
Dont la partie antérieure ne s'amincit que par degrés (3).
(1) Pour les autres filaires, voyez Rud., Hist., II, 57, Syn., p. 1.
N. B. M. Rudolphi, dans son synopsis, a supprimé le genre HAMULAIRE, que l'on caractérisait par deux petits filaments à la bouche. Il s'est trouvé, à l'observation, que c'étaient des organes mâles placés à l'extrémité postérieure.
(2) Pour les trichocéphales des animaux, voyez Rudolp., Ent., II, 86, et Syn., p. 16.
(3) Voyez Rudolphi, Syn., 13.
[page] 250
Et
LES OXYURES. (OXYURIS. Rud.)
Où c'est la partie postérieure du corps qui est amincie en forme de fil.
On en connaît une espèce du cœcum du cheval (Oxyuris curvula, Rud.), Gœtz., VI, 8, Encycl., XXXIII, 5, longue d'un à trois pouces (1).
LES CUCULLANS. (CUCULLANUS.)
Ont le corps rond, plus mince en arrière; la tête mousse, revêtue d'une sorte de petit capuchon souvent strié; la bouche ronde.
On n'en a trouvé encore que dans les poissons. Le plus commun est celui des perches (C. lacustris, Gm.), Gœtz., IX, A, 3, Encycl. XXXI, 6, qui infeste aussi le brochet, la lote, etc. Il est vivipare, long d'environ un pouce, gros comme un fil, et paraît rouge, à cause du sang dont son intestin est ordinairement rempli (2).
LES OPHIOSTOMES.
Avec le corps des précédents, se distinguent par une bouche fendue en travers, et en conséquence munie comme de deux lèvres.
Il s'en trouve un dans la vessie aérienne de quelques poissons (Ophiost. Cystidicola, R.); Cystidicola, Fischer, Monogr. (3).
LES ASCARIDES. (ASCARIS. L. (4))
Ont le corps rond, aminci aux deux bouts, et la bouche garnie de trois papilles charnues, d'entre lesquelles saille de temps en temps un tube très court.
(1) Aj. Ox. alata, et Ox. ambigua, Rud., Syn., 19.
(2) Voyez pour les autres espèces, Rud., Hist., II, 102, et Syn., 19.
(3) Rud., II, Hist., 117, et Syn., 60.
(4) άτχαρὶς, nom de la petite espèce de l'homme, vient d'ασχαρίξω, sauter, se mouvoir.
[page] 251
C'est un des genres les plus nombreux en espèces; on en trouve dans toutes sortes d'animaux. Ceux qu'on a disséqués ont montré un canal intestinal droit, et dans les femelles, qui font de beaucoup le plus grand nombre, un ovaire à deux branches, plusieurs fois plus long que le corps, donnant au dehors par un seul oviducte, vers le quart antérieur de la longueur de l'animal. Les mâles n'ont qu'un seul tube séminal aussi beaucoup plus long que le corps, et qui communique avec un pénis quelquefois double, qui sort par l'anus. Celui-ci est percé sous l'extrémité de la queue.
M. Otto, M. Cloquet regardent comme système nerveux de ces vers deux filets blancs qui règnent l'un du côté du dos, l'autre du côté du ventre; deux autres fils plus épais, régnant l'un à droite, l'autre à gauche, sont regardés, par les uns, comme musculaires, par d'autres, comme vasculaires, ou même comme des trachées.
Les uns ont la tête sans membranes latérales.
L'espèce la plus connue,
L'Ascaride lombrical. (Asc. lumbricoïdes. L.). Vulgairement Lombric des intestins.
Se trouve sans différence sensible dans l'homme, le cheval, l'âne, le zèbre, l'hémione, le bœuf, le cochon. On en a vu de plus de quinze pouces de long. Sa couleur naturelle est blanche: il se multiplie quelquefois à l'excès, et peut causer des maladies mortelles, surtout dans les enfants, auxquels il occasione des accidents de tous genres, principalement quand il remonte dans l'estomac.
D'autres espèces ont une petite membrane de chaque côté de la tête. Tel est
L'Ascaride vermiculaire. (Asc. vermicularis. L.) Gœtz. V. 1–6. Encycl. méth. Vers. XXX. pl. X. 1.
Si commun chez les enfants et dans certaines maladies
[page] 252
des adultes, auxquels il cause des démangeaisons insupportables à l'anus. Il ne passe guère cinq lignes, est plus épais en avant (1).
LES STRONGLES. (STRONGYLUS. Müll. (2))
Ont le corps rond, et l'anus enveloppé, dans le mâle, par une sorte de bourse, diversement configurée, et d'où sort un petit filet qui paraît servir à la génération. La femelle manque de ces derniers caractères, ce qui pourrait quelquefois la faire prendre pour un ascaride.
Il y a de ces strongles qui ont des cils ou dentelures à la bouche. Tel est
Le Strongle du cheval. (Str. equinus. Gm. Str. armatus. Rud.) Müll. Zool. dan. II. XLII. Enc. méth. XXXVI. 7–15.
Long de deux pouces, à tète sphérique dure, à bouche garnie tout autour de petites épines molles; la bourse du mâle divisée en trois feuillets. C'est le plus commun de tous les vers du cheval; il penètre jusque dans les artères, où il occasione des anévrismes. On le trouve aussi dans l'âne et le mulet.
D'autres n'ont autour de la bouche que des tubercules ou des papilles.
Tel est surtout
Le Strongle géant. (Strongylus gigas. Rud. Ascaris visceralis et Asc. renalis. Gmel.) Redi. An viv. in An. viv. pl. VIII et IX. Le DIOCTOPHYME. Collet-Meygret. Journal de Phys. LV. p. 458.
Le plus volumineux des vers intestinaux connus; il a jusqu'à deux et trois pieds de long et davantage, et la grosseur du petit doigt; ce qu'il y a de plus singulier, c'est qu'il se développe le plus souvent dans l'un des reins des divers animaux, comme du loup, du chien, de la
(1) Voyez, pour les ascarides des animaux, Rudolph., Hist., II, 128 et suivantes, et Syn., p. 37 et suiv.
(2) Στρογγυλος, rond.
[page] 253
marte, et même de l'homme, s'y tenant tout replié sur lui-même, faisant gonfler cet organe, y détruisant le parenchyme, et causant probablement des douleurs atroces à l'individu où il s'est logé. On en a rendu quelquefois par les urines lorsqu'ils étaient encore petits. Il habite aussi quelquefois dans d'autres viscères. On le trouve souvent du plus beau rouge; il a six papilles autour de la bouche; l'intestin est droit et ridé transversalement, l'ovaire simple, trois à quatre fois plus long que le corps, communiquant au dehors par un trou un peu en arrière de la bouche, et à ce qu'il paraît donnant de son autre extrémité dans l'anus. Un filet blanc très fin qui règne le long du ventre a paru à M. Otto être le système nerveux (1).
On a distingué récemment des ascarides et des strongles
LES SPIROPTÈRES.
Dont le corps se termine en spirale entourée de deux ailes, d'entre lesquelles sort le pénis (2).
On dit que l'on en trouve quelquefois une espèce dans la vessie de l'homme.
Il y en a une dans la taupe (Sp. strumosa, Nitsch.) qui s'enfile dans un anneau qu'elle perce dans la veloutée de l'estomac et s'y retient par un petit tubercule.
LES PHYSALOPTÈRES.
Où l'extrémité postérieure a une vessie entre deux petites ailes, et un tubercule d'où part le pénis (4).
(1) Otto, Magaz. de la Soc. des nat. de Berlin, VIIe année, 1816, p. 225, pl. V.
Voyez, pour les autres strongles, Rud., Syn., 30.
(2) Rud., Syn., p. 22.
(3) Nitsch., Monog., Gm., Hal. Sax., 1829.
(4) Rud., Syn., 29.
[page] 254
LES SCLÉROSTOMES. Blainv.
Qui ont à la bouche six petites écailles dentelées.
Il y en a un dans le cheval et un dans le cochon.
LES LIORHYNQUES. (LIORHYNCHUS, Rud.)
Qui ont la bouche en forme de petite trompe (1).
LES LINGUATULES. (PENTASTOMA. Rud.)
Ont le corps déprimé et tranchant sur les côtés, où les rides transversales se marquent par de fortes et nombreuses crénelures. La peau est mince et faible; la tête est large et a platie; la bouche percée en dessous, et à chacun de ses côtés sont deux petites fentes longitudinales, d'où sortent de petits crochets. L'intestin est droit; les vaisseaux génitaux longs et entortillés. Les uns et les autres ont leur issue à l'extrémité postérieure. Près de la bouche sont deux cœcums, comme dans les échinorynques. Un filet blanc entoure la bouche, et donne deux troncs descendants, où j'ai cru reconnaître une apparence de système nerveux.
Ce genre lie les intestinaux cavitaires aux parenchymateux.
On en connaît un (Tœnia lancéolé, Chabert; Polystoma tænioïdes, Rud., Hist., II, XII, 8–12; Pentastoma tænioïdes, id. Syn., 123), qui atteint jusqu'à six pouces de longueur. Il se tient dans les sinus frontaux du chien et du cheval (2).
(1) Rud., Hist., II, 247 et suivantes.
(2) N. B. La bouche des LINGUATULES de Froelich, est entièrement semblable à celle de ce pentastome. Je suppose donc qu'elles sont du même genre, quoique je n'aie pu, à cause de leur petitesse, observer leurs intestins. Tels sont Tænia caprina, Gm., ou Polyst. denticulatum, Rud. Zool., dan., III, CX, 4, 5; — Linguatula serrata, Gm.; Pol. serratum, Rud.; Froelich. nat., Forsch., XXIV, IV, 14, 15; le même que le TETRAGULE, Bosc., Bull. des Sc., mai 1811, pl. 11, fig. 1. M. Rudolphi fait maintenant de ces vers, son genre PENTASTOMA, Syn., 123. M. de Blainville préfère le nom de LINGUATULE.—Le Porocephalus crotali, Humboldt, Obs. Zool., pl. 26, y appartient probablement.
[page] 255
C'est ici que paraît devoir se placer
LE PRIONODERME. (PRIONODERMA. Rud.)
Dont le corps et les intestins sont fort semblables, mais qui a la bouche à l'extrémité antérieure, simple et armée de deux petits crochets.
On n'en connaît qu'un du silure (Cucullanus ascaroïdes), Gœtz., pl. VIII, f. II-III, Rud., Hist., II, XII (1).
Je crois devoir placer à la suite des intestinaux de cet ordre, mais comme une famille assez différente, et qui devra être divisée en plusieurs genres quand on en aura mieux détaillé l'économie,
LES LERNÉES. (LERNÆA. L.)
Dont le corps a à peu près la même organisation intérieure et extérieure que dans les intestinaux cavitaires mais est prolongé en avant par un col de substance cornée, au bout duquel est une bouche diversement armée, et entourée cu suivie de productions de diverses formes. Cette bouche et ses appendices s'insinuent dans la peau des ouïes des poissons et y fixent l'animal. Les lernées se distinguent encore par deux cordons, quelquefois médiocres, quelquefois très longs ou même fort repliés, qui pendent des deux côtés de leur queue, et qui pourraient être leurs ovaires (2).
(1) M. de Blainville fait de ces deux genres son ordre des ENTOMONOAIRES APODES ONCHOCÉPHALÉS.
(2) M. Surrirey a trouvé dans les cordons d'une lernée des œufs qui lui ont paru contenir un animal analogue aux crustacés, et fort différent de la lernée elle-même. Ce fait, comparé à ce que MM. Audouin et Milne Edwards ont observé sur la nicothoé du homar, fait penser à ces naturalistes que les lernées pourraient bien être, pour la plupart, des crustaces devenus monstrueux après qu'ils se sont fixés: les mâles demeureraient toujours libres, et cela expliquerait, selon eux, pourquoi on ne trouve jamais que des femelles (Ann. des Sc. nat., IX, 345, pl. XLIX). Mais pour consacrer cette opinion, il faudrait pouvoir retrouver ces mâles.
[page] 256
LES LERNÉES propres
Ont un corps oblong, un cou long et grêle, et des espèces de cornes autour de la tête.
La plus connue est celle qui attaque la morue et d'autres gades (Lernœa branchialis, L.), Encycl., Vers, LXXVIII, 2, longue d'un à deux pouces; sa bouche est entourée de trois cornes rameuses, qui sont, ainsi que le cou, d'un brun foncé. Son corps plus renflé se reploie en S, et les deux cordons sont entortillés de mille manières. Ses cornes s'enracinent pour ainsi dire dans les ouïes des poissons.
Une autre, L. ocularis, Cuv., s'attache aux yeux des harengs et d'autres poissons; elle n'a que des cornes simples et courtes, deux plus grandes et deux plus petites; son corps est grêle, ses cordons longs et non pliés (1).
Il y en a une à cornes petites, inégales et très nombreuses (L. multicornis, Cuv.) sur les ouïes d'un serran des Indes.
Un autre groupe,
LES PENNELLES. (PENNELLA. Oken).
A la tête renflée, garnie à la nuque de deux petites cornes, le cou corné, le corps long, ridé en travers, et garni en arrière de petits, filaments disposés comme des barbes de plumes. Les deux très longs filets naissent au commencèment de cette partie empennée.
(1) Aj. L. cyprinacea, L., Faun., Suec. première édit., fig. 1282, Encycl., vers, LXXVIII, 6; — L. surrirensis, Blainv.; — L. lotæ, Herm. nat. forsch., XIX, I, 6? — L. cyclopterina.
M. de Blainville nomme ce groupe LERNÉOCÈRES.
[page] 257
Il y en a dans la Méditerranée une espèce (Pennella filosa; Pennatula filosa, Gmel.), Boccone, Mus., 286, Ellis, Trans. phil., LXIII, XX, 15, longue de sept à huit pouces, qui pénètre dans la chair du xiphias, du thon, de la mole, et les tourmente horriblement (1).
Un troisième groupe,
LES SPHYRIONS. Cuv.
A la tête élargie des deux côtés, comme un marteau, de petits crochets à la bouche, un cou mince, suivi d'un corps déprimé et en forme de cœur, qui, outre les deux longs cordons, porte de chaque côté un gros faisceau de poils (2).
Un quatrième,
LES ANCHORELLES. Cuv.
Ne se fixe aux ouïes que par une seule production qui part du dessous du corps, et se dirige en arrière (3).
Un cinquième,
LES BRACHIELLES. Cuv.
A deux proéminences qui forment comme deux bras et qui se réunissent en une seule partie cornée par laquelle l'animal se fixe aux ouïes (4).
(1) Aj. Lernæa cirrhosa, la Martin., Journ. de phys, sept., 1787, II, 6; — Pennella diodontis, Chamiss. et Eisenhardt., Act. nat., car., t. part. 2, pl. XXIV, f. 3.
M. de Blainville à changé le nom de pennelle en LERNÉOPENNE.
(2) Le Chondracanthe lisse, Quoy et Gaym., Voyage de Freycinet, Zool., pl. LXXXVI, f. 10.
(3) Lernæa adunca, Stroem., Sondmoer., pl. 1, f. 7 et 8, commune sur plusieurs gades.
(4) Brachiella Thynni, Cuv., Règne anim., pl. XV, f. 5; — Lernea salmonea, Gisler, Act. Suec., 1751, et Encycl. méth., vers, pl. LXXVIII, f. 13–18;—L. Pernettiana, Blainv., Pernetti. Voyage aux Malouines, I, pl. 1; f. 5 et 6. Deux espèces mal représentées; — L. huchonis, Schrank., Voyage en Bav., pl. 1, f. A-D, l'est encore plus mal; il y en a plusieurs autres.
Je crois que ce groupe et le précédent rentreraient dans les LERNÉOMYZES, Blainv., mais qu'il faudrait alors autrement définir.
TOME III. 17
[page] 258
Un sixième,
LES CLAVELLES. (CLAVELLA. Oken.)
N'a aucun de ces appendices, et ne se fixe que par la bouche (1).
Ces trois derniers groupes ont à la bouche des crochets marqués; leurs cordons sont peu alongés; il y a quelquefois d'autres appendices à la partie postérieure de leur corps.
D'après un nouvel examen, je rapporte à la suite des lernées,
LES CHONDRACANTHES. (CHONDRACANTHUS. Laroch.)
Qui ont aussi des crochets à la bouche, et sur les côtés du corps des appendices très diverses pour le nombre et pour la forme, au point qu'avec le temps il y aura aussi plusieurs divisions à y établir.
Ainsi les uns ont de chaque côté deux espèces de bras plus ou moins prolongés (2).
D'autres en ont plusieurs paires en partie fourchus (3), ou même encore plus subdivisés (4).
Il y en a qui ont un cou grêle, le corps élargi et déchiqueté sur les bords (5).
(1) Lernea uncinata, Müller, Zool., dan., I, XXXIII, 2; — L. clavata, id., ib., 1. C'est à ces CLAVELLES d'Oken, que M. de Blainville réserve le nom de LERNÉES propres.
(2) Lernæa radiata, Müll. Zool., D., XXXIII, 4; — L. gobina, id., ib., 3; — C'est la première que M. Oken donne pour type de son genre ANONES.
(3) Lernæa cornuta, id., ib., 6, et plusieurs espèces nouvelles.
(4) Chondracanthus zei, Laroche, Bullet. des Sc., mai, 1811, pl. 2, f. 2.
(5) Lern. triglœ, Blainv., Dict. Sc. nat., XXVI, p. 325. Cuv, Règn. an., pl. XV, f.
N. B. M. de Blainville rassemble mes CHONDRACANTHES, sous ses genres LERNÉENTOME, LERNACANTHE et LERNANTHROPE.
N. B. Le Lernœa pectoralis, Müller, Zool. dan., XXXIII, f. 1, est un calyge; et le L. asellina, it. west. goth., III, 4, m'en paraît aussi un, mais défiguré.
[page] 259
Je place encore à la suite de cet ordre, un animal qui s'en rapproche à quelques égards, mais qui pourra servir un jour de type à un ordre nouveau. Il forme un genre que je nomme
NEMERTE. (NEMERTES. Cuv.)
C'est un ver d'une mollesse et d'un alongement extrêmes, lisse, grêle, aplati, terminé à une extrémité par une pointe mousse, percée d'un trou; évasé et largement ouvert à l'extrémité opposée, par où il se fixe. Son intestin traverse toute la longueur du corps. Un autre canal, probablement relatif à la génération, serpente le long de ses parois, et finit à un tubercule du bord de l'ouverture large. MM. Dorbigny et de Blainville qui ont vu cet animal vivant, assurent que c'est l'ouverture large qui est la bouche.
La seule espèce connue (Nemertes Borlasii, Cuv.) Borlase Cornw., XXVI, 13, a plus de quatre pieds de long. Elle se tient enfoncée dans le sable, et attaque, dit-on, les anomies qu'elle suce dans leur coquille (1).
Auprès de ces némertes devront probablement se placer
LES TUBULAIRES de Renieri
Également grands et de forme très alongée, mais qui ont une petite bouche percée sous l'extrémité antérieure.
LES OPHIOCÉPHALES de MM. Quoy et Gaimard.
Avec les mêmes formes ont le bout du museau fendu.
(1) Je dois ce ver singulier, dont Borlase seul fait mention, à M. Duméril, qui l'a trouvé près de Brest. M. Oken en fait son genre BORLASIA, et auparavant M. Sowerby l'avait nommé LINEUS.
17*
[page] 260
LES CÉRÉBRATULES de Renieri.
Semblent n'en différer que par un corps plus court (1).
LE DEUXIÈME ORDRE DES INTESTINAUX.
LES PARENCHYMATEUX.
Comprend ceux dont le corps est rempli d'une cellulosité, ou même d'un parenchyme continu, dans lequel on observe au plus, pour tout organe alimentaire, des canaux ramifiés, qui y distribuent la nourriture, et qui, dans la plupart, tirent leur origine de sucoirs visibles au dehors. Les ovaires sont aussi enveloppés dans ce parenchyme ou dans cette cellulosité. Il n'y a point de cavité abdominale, ni d'intestin proprement dit, ni d'anus, et si l'on excepte quelques vestiges douteux dans la première famille, on ne distingue rien qui ait l'apparence nerveuse.
On peut diviser cet ordre en quatre familles.
La première famille,
LES ACANTHOCÉPHALES. Rud.
S'attache aux intestins par une proéminence armée d'épines recourbées, qui paraît lui servir en
(1) Nous n'avons vu ni les tubulaires ni les cérébratules. D'ailleurs les noms de tubulaires et d'ophiocéphales, déjà appliqués à d'autres genres, ne peuvent subsister.
[page] 261
même temps de trompe; elle ne comprend que le genre des
ÉCHINORINQUES. (ECHINORHYNCHUS. Gm.)
Qui ont le corps rond, tantôt alongé, tantôt en forme de sac, pourvu en avant d'une proéminence en forme de trompe armée de petits crochets recourbés en arrière, qui peut saillir ou se retirer par le moyen de muscles particuliers. On observe quelquefois à son extrémité une papille ou un pore, qui pourrait être un organe d'absorption; mais il est certain aussi que l'animal plongé dans l'eau se gonfle de toute part, et qu'il absorbe le liquide par toute sa surface, où l'on croit remarquer un lacis de vaisseaux absorbants. On ne voit à l'intérieur d'autre partie comparable à des intestins que deux cœcums peu prolongés, tenant à la base de sa proéminence. Tubiforme; de chaque côté règne un vaisseau sur toute la longueur. M. de Blainville regarde comme système nerveux un filet qui rampe le long de la face inférieure; mais ni M. Rudolphi ni M. Cloquet ne veulent le reconnaître. Certaines espèces ont un oviductus distinct; en d'autres, les œufs sont répandus dans la cellulosité ou le parenchyme du corps. Les mâles ont une petite vessie au bout de la queue et des vésicules séminales intérieures très distinctes. On peut croire qu'ils fécondent les œufs après qu'ils sont pondus.
Ces vers s'attachent aux intestins par le moyen de leur trompe, et les percent même souvent; aussi en trouve-t-on des individus dans l'épaisseur des tuniques, et même dans l'abdomen, adhérents aux intestins par dehors.
La plus grande espèce (Echinorhynchus gigas, Gm.), Gœtze, X, 1–6, Encycl., XXXVII, 2–7, habite en abon-
[page] 262
dance les intestins du cochon et du sanglier, où les femelles atteignent jusqu'à quinze pouces de longueur (1).
Certaines espèces outre les aiguillons de leur trompe, en sont armées dans quelque autre partie de leur corps.
LES HÆRUCA. Gm.
Ne diffèrent des échinorinques que parce que leur proéminence se réduit à une seule couronne d'épines, terminées par de doubles crochets.
On en connaît une du foie des rats (Hæruca muris, Gm.; Echinorh. hæruca, Rud.), Gœtz. IX, B., 12, Enc., Vers, XXXVII, 1 (2).
La deuxième famille,
LES TRÉMADOTES. Rud.
Comprend ceux qui ont sous le corps, ou à ses extrémités, des organes en forme de ventouses, par lesquels ils s'attachent aux viscères.
On pourrait n'en former qu'un genre, auquel on donnerait en commun le nom de
DOUVES. (FASCIOLA. L.)
Mais que l'on peut subdiviser comme il suit, d'après le nombre et la position des ventouses.
LES FESTUCAIRES (FESTUCARIA. Schr. MONOSTOMA. Zéder.)
N'ont qu'une ventouse, tantôt au bout antérieur, tantôt sous ce même bout. On en trouve dans beaucoup d'oiseaux et de poissons (3).
(1) Voyez, pour les autres espèces, Rud., Hist., II, 251, et Syn., p. 63.
(2) Id., ib., 292 et suivantes.
(3) Rudolph., hist., II, part. 1, p. 325, et Syn., p. 82; les HYPOSTOMES, Blainv., en sont une division à corps déprimé, à ventouse placée sous l'extrémité antérieure. Van Hasselt et Kuhl en ont découvert deux espèces nouvelles sur la Cheloni a midas, Bulletin de Férussac, 1824, t. II, p. 311.
[page] 263
LES STRIGÉES. (STRIGEA. Abildg. AMPHISTOMA. Rud.)
Ont un ventouse à chaque extrémité; il en existe dans plusieurs quadrupèdes, oiseaux, etc. (1).
Il faut probablement en rapprocher
LES GÉROFLÉS. (CARYOPHYLLÆUS. Bl.)
Où la tête est dilatée, frangée, et a en dessous un suçoir garni de deux lèvres que l'on voit difficilement. Un autre suçoir pareil s'est montré quelquefois sous la queue.
On en connaît un, tiré de divers poissons d'eau douce, et commun surtout dans la brême (2).
LES DOUVES proprement dites. (DISTOMA. Retz et Zeder.)
Ont un suçoir ou la bouche à l'extrémité antérieure, et une ventouse un peu plus en arrière, sous le ventre. Les espèces en sont extrêmement nombreuses; il s'en trouve jusque dans le peigne de l'œil de quelques oiseaux; mais il paraît qu'il en habite aussi quelques-unes à nu dans les eaux douces et salées.
La plus célèbre est
La Douve du foie. (Fasciola hepatica. L.) Schœffer. Monogr. Copié Encycl. Vers pl. LXXX. 1 - 11.
Qui est si commune dans les vaisseaux hépatiques des moutons, mais qui se trouve aussi dans ceux de beaucoup d'autres ruminants, du cochon, du cheval, et même de l'homme. Sa forme est celle d'une petite feuille ovale, pointue en arrière, ayant en avant une petite partie rétrécie, au bout de laquelle est le premier suçoir, qui donne dans une sorte d'œsophage d'où partent des canaux qui se ramifient par tout le corps, et y portent la bile dont cet animal se nourrit. Un peu en arrière est un petit tentacule rétractile qui est la verge; et immédiatement derrière est le deuxième suçoir; des vaisseaux spermatiques très repliés, remplissent le milieu de la feuille. L'ovaire qui se
(1) Rud. hist., p. 340, et Syn., p. 87.
(2) Id., Hist, part. 11, 9, et Syn., p. 127.
[page] 264
trouve dans tous les individus est enchâssé dans les intervalles des intestins, et les œufs sortent par un canal replié qui aboutit à un petit trou à côté de la verge. Ces animaux exercent un accouplement réciproque.
La douve des moutons se multiplie beaucoup quand ils paissent dans des terrains humides, et leur occasione l'hydropisie et la mort (1).
M. Rudolphi fait une division qu'il nomme ECHINOSTOME des espèces qui ont en avant un petit renflement armé de crochets (2).
LES HOLOSTOMA. Nitzsch.
Ont une moitié du corps concave et disposée, de façon à servir tout entière comme de ventouse. Leurs orifices paraissent d'ailleurs assez semblables à ceux des distomes.
On en trouve dans quelques oiseaux. Il y en a un dans le renard.
LES POLYSTOMA. Zeder. ou plutôt Hexastoma.
Ont le corps déprimé, lisse, et six ventouses rangées sur une ligne transverse sous le bord postérieur. Leur bouche paraît être à l'extrémité opposée.
On en a trouvé dans la vessie urinaire des grenouilles, dans l'ovaire de la femme, sur les branchies de quelques poissons (3), dans la cavité nasale de certaines tortues.
(1) Voyez pour les autres espèces Rudolph. hist. II, part. 1, p. 357, et Syn., 92, et pour l'organisation, les observationes anat. de Distomate hepatico, et lanceolato de M. Ed. Mehlis., Gotting, 1825; in-fol.
(2) M. de Blainville en fait son genre ECHINOSTOME.
(3) Polyst. integerrimum, Rud., pl. VI, 1–6, genre HEXATHIRÉDIE, Treutler; — P. pinguicola; — P. thynni, Laroche, nouv. Bull. des Sc., mai 1811, pl. II, f. 3, genre HEXACOTYLE de Blainv. — Polyst. Midas, Kull et Van Hasselt (Allg. Koust. en Latterbode, n° 6), et Bull. des Sc, nat. de Férussac, 1824, tom. 2, p. 310.
[page] 265
Les CYCLOCOTYLES. Otto.
Ont huit ventouses formant un cercle presque complet sous l'arrière du corps, qui est large, et porte en avant une petite trompe.
On n'en connaît qu'un très petit, pris sur le dos de l'orphie (Cycl. bellones., Ott., Nat. ac. eur., XI, part. 2, pl. XLI, f. 2.).
Je rapproche aussi des douves un sous-genre que je nomme
TRISTOME. (TRISTOMA. Cuv.)
Leurs corps est un disque large et plat; à sa face inférieure est en arrière un grand suçoir cartilagineux, qui ne tient au corps que par un court pédicule, et sous son bord antérieur s'en trouvent deux petits entre lesquels un peu en arrière est la bouche. Dans le parenchyme du corps rampe un vaisseau circulaire ramifié, dont la nature est difficile à déterminer.
Une espèce d'un pouce et plus de largeur, colorée en rouge vif (Tristoma coccineum, Cuv.), s'attache aux branchies de plusieurs poissons de la Méditerranée, tels que la môle, le xiphias, etc. (1).
Un des genres les plus extraordinaires de cette famille est celui des
HECTOCOTYLES. Cuv.
Vers longs, plus gros et comprimés à l'extrémité anté-
(1) Lamartinière en a trouvé un très semblable, mais gris, sur un diodon, près de Nootka-Sound. M. Bosc en avait fait son genre CAPSALA, nouv. Bullet. des Sc., 1811, et M. Oken son genre PHYLLINE, Zool., pl. x. Voyez Journal de phys., sept. 1787, pl. 11, f. 4, 5. On peut y joindre le Tristoma elongatum de Nitsch., ou NITSCHIA de Bær., Acad. des Cur. de la nat., XIII, 2e part., pl. XXXII, f. 1–5. — l'AXINE de l'Orphie, Abildg, Soc. d'hist. nat. Copenh., III, part. 2, pl. VI, f. 3, semble un tristoma à corps très alongé, à ventouses postérieures très grande, et les antérieures très petites.
[page] 266
rieure, sur laquelle est la bouche, dont la face inférieure est toute garnie de suçoirs rangés par paires et en nombre très considérable, de soixante ou de cent, et qui portent à l'extrémité postérieure un sac rempli des replis de l'oviductus.
La Méditerranée en a une espèce longue de quatre et cinq pouces, à cent quatre ventouses, qui habite sur le poulpe granuleux et pénètre dans ses chairs (Hectocotyle octopodis), Cuv., An. sc. nat., XVIII, pl. XI.
Et une autre plus petite, à soixante-dix ventouses, qui vit sur l'argonaute (H. argonautœ ou trichocephalus acetabularis. Delle chiaie, mem., part. II, pl. 16, f. 1 2.
Peut-être est-ce ici que doit venir
L'ASPIDOGASTER. Bær.
Qui a sous le ventre une lame creusée de quatre rangées de petites fossettes.
Il y en a un très petit, parasite des moules, (asp. conchicola), Bær., An. nat., Cur., XIII, part. 2, pl. XXVIII.
Je ne puis m'empêcher de croire que l'on doit encore rapprocher des DOUVES la plus grande partie des animaux compris sous le genre
DES PLANAIRES. (PLANARIA. Müll.) (1).
Bien qu'elles n'habitent point dans d'autres animaux, mais seulement dans des eaux douces ou salées. En effet, leur corps est déprimé, parenchymateux, sans cavité
(1) Lors de ma première édition je n'avais placé ici que par conjecture le genre des planaires, faute d'observations anatomiques suffisantes pour me donner une idée de ses rapports naturels. Depuis lors, les observations de MM. Raulins-Johnson (Trans. phil.), Dallyell (Monogr.), Bær. (Ac. nat. Cur., XIII), Dugès (Ann. des Sc. nat., XV), et celles que j'ai faites moi-même, me paraissent avoir confirmé cette classification, que M. Lamarck a aussi adoptée.
[page] 267
abdominale distincte; l'orifice alimentaire, placé sous le milieu du corps, ou plus en arrière, et se dilatant en une petite trompe, conduit, comme dans les douves, dans un intestin dont les nombreuses ramifications sont creusées dans l'épaisseur de tout le corps; un réseau vasculaire occupe les côtés, il y a de plus derrière l'orifice alimentaire un double système d'organes génitaux, et un accouplement réciproque. On leur voit de petits points noirs, qui sont probablement des yeux.
Ces animaux sont très voraces et n'épargnent pas même leur propre espèce; ils se multiplient non-seulement par les voies ordinaires, mais très facilement par division, et éprouvent même des divisions spontanées.
Nous en avons aussi plusieurs dans nos eaux douces (1).
Nos côtes en ont aussi beaucoup et surtout de plus grandes (2).
Il y en a dont la superficie est comme velue (3).
Plusieurs ont deux tentacules en avant (4).
M. Dugès en distingue
LES PROSTOMES.
Qui ont un orifice à l'extrémité antérieure, et un autre à la postérieure.
(1) Planaria lactea, Zool. dan., CIX, 1, 2; — Pl. nigra, ib., 3, 4, et les autres espèces décrites par M. Dugès, An. Sc. nat., XV, pl. IV. On trouve dans Gmel. le très long catalogue de ce genre, que Müller a surtout fort enrichi; une partie des figures de Müller sont copiées dans l'Encycl. méthod.
(2) Pl. aurantiaca, Nob.
(3) Pl. brocchii, Risso.
(4) Pl. cornuta, Müll., Zool. dan., XXXII, 5, 7. Il y en a qui se forment par déchirure des tentacules, à la vue du spectateur. C'est de cette division que sont les Planocères, Blainv.
[page] 268
Et
LES DEROSTOMES.
Où l'orifice alimentaire est en dessous, mais plus près de l'extrémité antérieure.
C'est des premiers que je rapproche les PHÆNICURES, Rudolph., ou VERTUMNUS, Otto, qui n'ont qu'un orifice à l'extrémité antérieure.
On n'en connaît qu'un (V. thethidicola, Otto., Ac. nat. cur., XI, part. 2, pl. XLI, f. 2), grand parasite du Thethys fimbria, de couleur marbrée, souvent à queue fourchue par déchirure (1).
La troisième famille, des intestinaux parenchymateux.
LES TÉNIOIDES.
Réunit ceux où la tête a deux ou quatre pores, ou suçoirs, placés autour de son milieu, qui luimême est tantôt marqué d'un pore, tantôt muni d'une petite trompe, ou nue, ou armée d'épines; quelquefois il y a quatre petites trompes ainsi armées.
Son genre le plus nombreux est celui des
TÆNIA. (TÆNIA. L.)
Leur corps alongé, souvent à un degré excessif, plat, composé d'articulations plus ou moins marquées, se rétrécit en avant, et y porte généralement une tête carrée, creusée de quatre petits suçoirs.
On a cru apercevoir des canaux qui partent de ces suçoirs et rampent le long du bord des articles du corps.
(1) Voyez sur son anatomie: Delle chiaie, Memor., part. I, pl. II, f. 9–15.
[page] 269
Ceux-ci ont chacun un ou deux pores diversement placés selon les espèces, et qui paraissent être les orifices des ovaires, lesquels sont eux-mêmes situés dans l'épaisseur des articles, où ils prennent tantôt une figure simple, et tantôt se divisent en ramifications. Les tœnia sont au nombre des plus cruels ennemis des animaux dans lesquels ils se développent, et qu'ils paraissent épuiser.
Les uns n'ont aucune partie saillante au milieu des quatre suçoirs. Tel est dans l'homme
Le Tænia large. (Tænia lata. Rud.) T. vulgaris. Gm. Gœtz. XLI. 5–9.
Dont les articulations sont larges et courtes, et ont un double pore dans le milieu de chaque face latérale. Il est fort communément long de vingt pieds, et on en a vu de plus de cent; les grands ont près d'un pouce de largeur, mais la tête et la partie antérieure sont toujours très minces. Il est très fâcheux et très tenace. Les remèdes les plus violents ont souvent peine à l'expulser.
D'autres ont la proéminence d'entre les suçoirs armée de petites pointes disposées en rayons. Tel est encore dans l'homme
Le Tœnia à longs anneaux, plus particulièrement nommé Ver solitaire. (Tænia solium. L.) Gœtz. XXI. 1–7. Encycl. XL. 15–22. XLI. 1–7.
Dont les articulations, excepté les antérieures, sont plus longues que larges, et ont le pore alternativement à l'un de leurs bords. D'ordinaire il a de quatre à dix pieds de long, mais il s'en trouve de bien plus grands. Il s'en faut de beaucoup qu'il n'y en ait qu'un à la fois dans un individu, comme on le croit vulgairement. Ses articulations détachées sont ce qu'on appelle des cucurbitains. C'est un des intestinaux les plus dangereux et les plus difficiles à expulser.
(1) Voyez, pour les autres espèces, Rud., hist., II, 77, et Syn. 144.
[page] 270
On a distingué de ces tænia ordinaires, à cause de la forme de leur tête,
LES TRICUSPIDAIRES. (TRICUSPIDARIA. Rud.)
Que M. Rudolphi appelle maintenant TRIANOPHORES, dont la tête divisée comme en deux lèvres ou en deux lobes, a de chaque côté au lieu de suçoirs deux aiguillons à trois pointes.
On n'en connaît qu'une qui habite divers poissons, le brochet, la perche, etc. (Tænia nodulosa, Gm.), Gœtz., XXXIV, 5, 6, Encycl., XLIX, 12–15 (1).
LES BOTHRYOCÉPHALES. (BOTHRYOCEPHALUS. Rud.)
Dont la tête n'a pour tous suçoirs que deux fossettes longitudinales placées à l'opposite l'une de l'autre.
On en trouve dans divers poissons et dans quelques oiseaux (2).
Parmi les bothryocéphales mêmes, il est à propos de distinguer
LES DIBOTHRYORHYNQUES. Blainv.
Qui ont au sommet deux petites trompes ou tentacules hérissés de crochets.
On n'en connaît qu'un à corps court du lépidope, Blainv., App. ad Brems., pl. II, f. 8.
LES FLORICEPS. Cuv.
Qui ont quatre petites trompes ou tentacules armés
(1) Rudolph., hist. II, part. 11, 32, et Syu., 135.
(2) Id., ib., 37, et El., 136. Voyez sur les Bothriocéphales et leurs démembrements, les Fragments zoologiques de F. S. Leuckardt, 1er cah., Helmstædt, 1819.
[page] 271
d'épines recourbées, par le moyen desquels ils s'enfoncent dans les viscères.
Certaines espèces (les RHYNCHOBOTHRIUM, Blainv.), ont le corps long, articulé et sans vessie.
Il y en a un assez commun dans les raies (Bothryocephalus corollatus, Rud., IX, 12), long de quelques pouces. Sa tête ressemble tout-à-fait à une fleur.
Quelques autres (les FLORICEPS proprement dits) (3), ont le corps terminé par une vessie dans laquelle il rentre et se cache.
LES TÉTRARINQUES. (TETRARHYNCHUS. Rud.)
Ne paraissent que des floriceps, réduits naturellement à la tête et à deux articles, au lieu d'un corps alongé et de plusieurs articles.
Il s'en trouve un très communément dans la chair de la langue du turbot et de plusieurs autres poissons (Tetr. lingualis, Cuv.) (4).
LES TENTACULAIRES. Bosc.
N'en différeraient que par des tentacules non armés d'épines.
On a aussi distingué des tœnia ordinaires, ceux qui avec une tête pareille à la leur, c'est-à-dire à quatre suçoirs, ont le corps terminé en arrière par une vessie. Leurs articulations ne sont pas aussi distinctes que dans les précédents.
LES CYSTICERQUES. (CYSTICERCUS. Rud.), vulgairement HYDATIDES.
Sont ceux où la vessie ne porte qu'un seul corps et
(1) M. Rudolphi a changé ce nom en ANTHOCEPHALUS, El., 177.
(2) Voyez sur ce genre Rudolph. Hist., II, 318, et Syn., 129.
[page] 272
une seule tête. Ils se développent surtout dans les membranes et dans la cellulosité des animaux.
Il y en a une espèce qui se multiplie dans un grand nombre de quadrupèdes, surtout de ruminants; c'est l'Hydatide globuleuse (Tænia ferarum; — T. caprina; — T. ovilla; — T. vervecina; — T. bovina; — T. apri; — T. globosa. Gm.) Gœtz. XXII, A B. Encycl. XXXIX, 1–5.
Une autre est fort commune dans les lièvres et les lapins, l'Hydat. pisiforme (Tænia cordata; — T. pisiformis; T. utricularis), Gm., Gœtz., XVIII, A. B.; Encycl. XXXIX, 6–8.
Mais la plus célèbre est celle qui se tient entre les fibres des muscles des cochons, et produit ce que l'on nomme la ladrerie (Tænia cellulosæ et T. finna, Gm.), Blumenb. Abb., 4e cah. pl. 39. Elle est petite, et se multiplie excessivement dans cette maladie dégoûtante, pénétrant jusque dans le cœur, dans les yeux, etc. Il paraît qu'on en a observé de semblables dans quelques singes et même dans l'homme; mais on dit qu'il ne s'en trouve jamais dans le sanglier sauvage (1).
L'ACROSTOME (Le Sauvage, Ann. des Sc. nat.), est très voisin de ce genre. Il vit dans l'amnios des vaches.
LES COENURES, (COENURUS. Rud.)
Ont plusieurs corps et plusieurs têtes tenant à la même vessie.
On en connaît une espèce bien célèbre (Tænia cerebralis, Gm.), Gœtz., XX, A. B., Encycl. XL, 1–8, qui se d éveloppe dans le cerveau des moutons, détruit une partie de sa substance, et leur cause une sorte de paralysie qui a été appelée le tournis, par ce qu'elle les fait tourner involontairement de côté comme s'ils avaient des vertiges. On en a vu aussi dans les bœufs et d'autres ruminants, où elle produisait les mêmes effets. Sa vessie a
(1) Pour les autres espèces, voyez Rud. ent., II, part. 11, p. 215, et El., 179.
[page] 273
quelquefois la grosseur d'un œuf; ses parois sont très minces, fibreuses et montrent des contractions sensibles Les petits vers sont à peine longs d'une demi - ligne, et rentrent dans la vessie par contraction (1).
LES SCOLEX. (SCOLEX. Mull.)
Ont le corps rond, pointu en arrière, très contractile, terminé en avant par une espèce de tête variable, autour de laquelle sont deux ou quatre suçoirs, quelquefois en forme d'oreilles ou de languettes.
On n'en connaît que de très petits, tirés de quelques poissons (2).
J'en ai vu un grand (Scol. gigas, Cuv.) qui penètre la chair de la castagnole (Sparus raii, L.), et dont la partie moyenne du corps est renflée en une vessie qui, dans l'état de vie, se rétrécit ou s'élargit alternativement dans son milieu. C'est le gymnorhynchus reptans, Rud., Syn. 129.
La quatrième famille,
LES CESTOIDES.
Comprend ceux où l'on n'observe point de suçoirs extérieurs.
On n'y connaît qu'un genre,
LES LIGULES. (LIGULA. Bloch.)
Ce sont, de tous les intestinaux, ceux qui paraissent le plus simplement organisés. Leur corps ressemble à un long ruban; il est plat, obtus en avant, marqué d'une strie longitudinale, et finement strié en travers. On n'y distingue point d'organe extérieur, et à l'intérieur
(1) Ici devrait probablement venir le genre ECHINOCOCCUS, Rud., II, part. II, p. 247; mais je ne l'ai point observé et ne m'en fais point une idée assez claire pour le classer.
(2) Voyez Rudolph., Hist, II. part., p. 3, et Syn., 128.
TOME III. 18
[page] 274
on ne voit que les œufs, diversement distribués dans la longueur du parenchyme.
Elles vivent dans l'abdomen de quelques oiseaux, et surtout de divers poissons d'eau douce, dont elles enveloppent et serrent les intestins au point de les faire périr. A de certaines époques elles percent même leur abdomen pour en sortir.
Il y en a une dans la brême (Lig. abdominalis, Gm., L. cingulum, Rud.), Gœtz., XVI, 4–6, qui atteint jusqu'à cinq pieds de longueur (1). On regarde ces vers dans quelques endroits d'Italie comme un mets agréable.
LA TROISIÈME CLASSE DES ZOOPHYTES.
LES ACALÈPHES.
Vulgairement ORTIES DE MER LIBRES. (ACALEPHÆ. Cuv.)
Comprend des zoophytes, qui nagent dans les eaux de la mer, et dans l'organisation desquels on aperçoit encore des vaisseaux qui ne sont à la vérité le plus souvent que des productions des intestins creusées dans le parenchyme du corps.
(1) Pour les autres, voyez Rud., Hist., II, part. 11, p. 12, et Syn., 132.
N. B. On trouve dans les intestins des phoques et des oiseaux qui vivent de poissons, des vers très semblables aux ligules; mais où il se développe des organes génitaux, et même une tête analogue à celle des bothryocéphales, et M. Rudolphi hasarde l'hypothèse que ces vers des oiseaux sont les mêmes que les ligules des poissons, mais qui ne peuvent prendre tout leur développement que lorsque de l'abdomen des dermers elles ont passé dans l'intestin des autres.
[page] 275
LE PREMIER ORDRE DES ACALÈPHES.
LES ACALÈPHES SIMPLES,
Flottent et nagent dans l'eau de la mer par les contractions et les dilatations de leur corps, bien que leur substance soit gélatineuse, sans fibres apparentes. Les sortes de vaisseaux que l'on voit à quelques-unes, sont creusés dans la substance gélatineuse; ils viennent souvent de l'estomac d'une manière visible, et ne donnent point lieu à une véritable circulation.
LES MÉDUSES. (MEDUSA. L.)
Ont un disque plus ou moins convexe en dessus, semblable à la tête d'un champignon, et auquel on a donné le nom d'ombrelle. Ses contractions et ses dilatations concourent aux mouvements de l'animal. Les bords de cette ombrelle, ainsi que la bouche ou les suçoirs plus ou moins prolongés en pédicules qui en tiennent lieu, au milieu de la face inférieure, sont garnis de tentacules de formes et de grandeurs très diverses. Ces différents degrés de complication ont donné lieu à des divisions très nombreuses (1).
(1) On doit principalement consulter sur ce genre le prodrome donné par MM. Péron et Lesueur, dans les 14 et 15e vol. des Annales du Muséum; mais en observant qu'ils ont souvent formé des genres d'après de mauvaises figures d'auteurs peu exacts, tels que Baster et Borlase, et sans en avoir vu les sujets; que par la même cause ils ont multiplié outre me sure les espèces.
18*
[page] 276
Nous donnerons le nom général de
MÉDUSES PROPRES.
A celles qui ont une vraie bouche sous le milieu de la surface inférieure, soit simplement ouverte à la surface, soit prolongée en pédicule; et parmi les méduses propres
On pourrait réunir sous le nom
D'ÉQUORÉES
Toutes celles où cette bouche est simple et non prolongée ni garnie de bras.
Quand il n'y a point de tentacules autour de l'ombrelle, ce sont les PHORCYNIES de Lamarck (1).
Lorsque l'ombrelle est garnie de tentacules tout autour, ce sont les ÉQUORÉES, plus particulièrement ainsi nommées (les ÉQUORÉES de Péron), l'un des sous-genres les plus nombreux, surtout dans les mers des pays chauds (2).
Certaines espèces sont remarquables par des lames qui garnissent leur surface inférieure; d'autres (les FOVÉOLIES, Pér.) par de petites fossettes creusées au pourtour de l'ombrelle (3).
On pourrait ainsi réunir sous le nom de
PÉLAGIES
Celles où la bouche se prolonge en pédoncule, ou se divise en bras (4).
(1) Les Phorcinies et les Eulimènes, de Péron.
(2) Medusa æquorea, Gm., Forsk., XXXI; Encycl., vers, XCV, 1; — Æquorea mesonema, Péron; Forsk., XXVIII, B.; — Med. Mucilaginosa, Chamiss. et Eisenh., Ac. nat. Cur., X, 1re part., pl. XXX, f. 2; et les espèces gravées par M. Lesueur, et indiquées par Péron, An. Mus., XV, et par M. Lamarck (Hist. des Anim. sans vert., II, 498 et suivantes). Il est à regretter que ces planches ne soient pas dans le commerce. J'y joins aussi les PÉGASIES de Péron, et ses MÉLITÉES.
(3) Medusa mollicina, Forsk., XXXIII, C; Encycl., XCV, 1, 2; — Medusa perla. (le genre MELICERTE Pér.)
(4) Pelagia panopyra, Péron, Voyage aux Terres aust., XXXI, 2; les CALLIRHOE, les EVAGORES de Pér. s'y réunissent également.
[page] 277
Dans tous ces sous-genres, il n'y a point de cavités latérales; mais un nombre bien plus grand de ces méduses à bouche simple, a dans l'épaisseur de l'ombrelle, quatre organes formés d'une membrane plissée, remplie à certaines époques d'une substance opaque, et qui paraissent être des ovaires. Ils sont le plus souvent logés dans autant de cavités ouvertes à la face inférieure, ou sur les côtés du pédicule, et que l'on a pris mal à propos (selon moi) pour des bouches, parce qu'il s'y engage quelquefois des petits animaux (1). Quelques-uns les prennent aussi pour des organes de respiration (2), mais il est plus vraisemblable que cette fonction s'exerce sur les bords de l'ombrelle. Les tentacules, soitdu bord de l'ombrelle, soit du tour de la bouche, varient non-seulement selon les espèces, mais même selon l'âge (3).
Nous réunirons sous le nom de
CYANÉES. (CYANÆA. Cuv.)
Toutes les méduses à bouche centrale et à quatre ovaires latéraux.
La plus répandue (Medusa aurita, L.), Müll., Zool. dan., LXXVI et LXVII, prend avec l'âge quatre longs bras; son ombrelle est finement ciliée toutautour; des vaisseaux rougeâtres se rendent en se divisant de l'estomac vers la circonférence.
Une autre (Med. chrysaora, Cuv.), a les bords garnis de longs tentacules et des lignes ou des taches fauves ou brunes disposées en rayons sur sa convexité. Elle est aussi fort commune et varie beaucoup pour ses taches (4).
(1) Cette opinion de Baster et de Müller, a engagé Péron à diviser une partie de ses méduses en monostomes et en polystomes.
(2) Eisenhardt, sur le Rhisostome, etc.
(3) Voyez Müller, Zool. dan, II, pag. 51.
(4) La plupart des chrysaores de Péron n'en sont que des variétés. Aj. Aurelia crenata, Chamiss. et Eisenh., Acad. nat., Cuv., X, 1re p., pl. XXIX.
Outre les chrysaores, nous rapportons à ce genre les AURÉLIES, les CYANÉES, les OBÉLIES, les OCÉANIES de Péron: nous y comprenons Medusa hemispherica, Mül., VII, 5; Encycl., 93, 8, 11, — med. cymballoïdes., Slaber., Encyc., ib., 2–4, si toutefois on peut s'en rapporter aux caractères d'individus si petits; — Callirhoe basteriana, Per.; Baster, Op. subs., II, V, 2, 3; Encycl., XCIV, 4, 5; — la Cyanée bleue, Per.; Diquemare, Journ. Phys., 1784, déc., I; — les espèces ou variétés figurées par Borlase; mais grossièrement, Hist.nat. Cornw., pl. XXV, fig. 7–12, qui se rapportent à notre chrysaore, et dont on doit rapprocher le Med. hysocella, Gm., — Medusa tyrrhena, Gm. etc.
[page] 278
Nous avons donné le nom général de RHIZOSTOMES à la portion du grand genre MEDUSA, comprenant les espèces qui n'ont point de bouche ouverte au centre, et qui paraissent se nourrir par la succion des ramifications de leur pédicule ou de leurs tentacules. Ils ont quatre ovaires ou davantage.
LES RHIZOSTOMES propres. (RHIZOSTOMA. Cuv.)
Sont ceux qui ont au milieu un pédicule plus ou moins ramifié selon les espèces.
Les vaisseaux partis des petites ramifications des pédicules se réunissent en une cavité de sa base, d'où il part des branches pour toutes les parties de l'ombrelle.
Le plus commun est le Rhizostome bleu, Cuv., Journ. de Phys., tom. XLIX, p. 436. Réaum., Acad. des Sc., 1710, pl. XI, f. 27, 28. On le trouve partout sur le sable de nos côtes quand la mer se retire, et son ombrelle approche quelquefois de deux pieds de largeur. Son pédicule se divise en quatre paires de bras fourchus et dentelés presque à l'infini, garnis chacun à leur base de deux oreillettes également dentelées; l'ombrelle a tout autour, dans l'épaisseur de ses bords, un fin lacis de vaisseaux (1).
(1) C'est le Pulmo marinus, Matthiol., Aldrov. Zooph., lib. IV, p. 575; — le Medusa pulmo, Gm., Macri, Polm. mar., I, B.; Borlase, XXV, 15. Voyez à son sujet Eisenhardt, Ac. des Cur. de la nat., X, part. II, p. 377.
Le Potta marina, Aldrov., ib., p. 576, en est peut-être une autre espèce.
Je soupçonne l'ÉPHIRE, Péron (Medusa simplex, Pennant: Borlas e, Cornw., XXV, 13 et 14), de n'être qu'un rhizostome mutilé de son pédicule.
La Medusa pileata, Forsk. dont Péron fait une Océanie, a le pédicule ramifié des Rhizostomes propres, mais enfermé sous une ombrelle en forme de cloche, garnie au bord de tentacules.
[page] 279
D'après les observations de MM. Audouin et Milne Edwards, ces méduses vivent en société ou du moins se rencontrent toujours réunies en très grand nombre et nageant dans une même direction, le corps incliné obliquement.
Les CÉPHÉES, Péron, ne se distinguent des autres Rhizostomes que par des filaments mêlés aux dentelures de leur pédicule (1).
Les CASSIOPÉES n'ont point proprement de pédoncule; leurs bras ordinairement au nombre de huit, quelquefois branchus, naissent immédiatement de la surface inférieure (2)
D'autres espèces, sans bouche centrale, n'ont point de ces nombreuses ramifications au pédicule, ni de cavités ouvertes pour loger les ovaires. On pourrait les réunir sous le nom
d'ASTOMES.
Les unes ont cependant encore un grand pédicule garni, de chaque côté, de filaments chevelus qui pourraient servir de suçoirs (les LYMNORÉES et les FAVONIES, Péron).
D'autres n'ont pas même ces filaments, mais une membrane en forme d'entonnoir au bout du pédicule et du fond de laquelle semblent partir des vaisseaux qui remontent dans le pédicule et s'épanouissent dans l'ombrelle (les GÉRYONIES proprement dites, Pér.). Il y en a une dans la Méditerranée, Med. proboscidalis, Forsk., XXXVI, 1 (3).
Cette membrane manque même à d'autres (les ORYTHIES, id.) (4).
(1) Medusa cephæa, Forsk., XXIX; Encycl., XCII, 3, 4; — Med. octostyla, id., XXX; Encycl., ib., 4; — Med. ocellata, Modeer., nov. Act. Holm., 1791.
(2) Med. frondosa, Pall., Spic., X, II, 1, 3; — Medusa octopus, Gm.; Borlase, XXV, 16, 17; — Med. andromeda, Forsk., XXXI? — Med. corona, id., pag. 107? — Rhizostoma leptopus, Chamisso et Eisenhardt, ac. nat. cur., X, 1re p. XXVIII, f. 1.—Cass. borbonica, Delle chiaie. mem. I. tab. 3. 4.
(3) Aj. Dianée gabert, Zool. de Freyc., pl. 84, f. 2; Geryonia tetraphylla, Chamiss. et Eisenh., loc. cit., f. 2.
(4) Medusa minima, Baster, Op. subs., II; — Dianée dubaul, Zool. de Freyc., pl. 84, f. 3, qui est la Geryonie dinème, Pér. Il se pourrait que l'on eût pris pour des orythies des géryonies mutilées comme elles le sont souvent.
[page] 280
Il y en a sans aucun pédicule, mais où le dessous paraît garni de petits suçoirs le long du trajet des vaisseaux (les BÉRÉNICES, Pér.) (1).
Il en existe enfin où l'on n'aperçoit pas même de suçoirs, mais où les deux faces sont lisses et sans organes apparents (les EUDORES, Pér.)
La Méditerranée en a une espèce de la grandeur d'une pièce de cinq francs et à laquelle le peuple en donne le nom (Eud. moneta, N.).
Lorsque ces animaux si simples prennent plus de concavité, leur surface inférieure devient intérieure, et peut être regardée comme un véritable estomac. Ce sont les CARYRDÉES, Pér. Ceux où l'on ne voit à l'intérieur aucunes traces de vaisseaux, ne diffèrent proprement des hydres que par la grandeur (2).
On a dû séparer des méduses quelques genres que Linnæus y avait réunis sur des rapports trop légers, tels que
LES BÉROÉS. (BEROE. Müller).
Ils ont un corps ovale ou globuleux, garni de côtes saillantes hérissées de filaments ou de dentelles, allant d'un pôle à l'autre, et dans lesquelles on aperçoit des ramifications vasculaires, et une sorte de mouvement de fluide. La bouche est à une extrémité; dans ceux qu'on a examinés, elle conduit dans un estomac qui occupe l'axe du corps, et aux côtés duquel sont deux organes probablement analogues à ceux que nous avons appelés ovaires dans les méduses.
Tel est
Le Béroé globuleux (Medusa pileus. Gm.) Baster. l. III. XIV. 6. 7. Encycl. XC. 3. 4.
A corps sphérique, garni de huit côtes; à deux tenta-
(1) Cuvieria eerisochroma, Péron, Voyages aux Terres Austr., XXX, 2.
(2) Medusa marsupialis, Gm., Plancus, Conch., min. Not., IV, 5; — Carybdea periphylla, Péron.
[page] 281
cules ciliés, susceptibles d'un grand alongement, sortant de son extrémité inférieure (1). Il est très commun dans les mers du Nord, et même dans la Manche, sur nos côtes, et passe aussi pour l'un des aliments de la baleine (2).
L'on a rapporté au même genre, des espèces plus simples, et seulement en forme de sac garni de côtes ciliées et ouvert aux deux bouts (IDYA. Oken.) (3).
(1) Selon MM. Audouin et M. Edward, il existe, dans l'axe de ces animaux, une cavité qui va d'un pôle à l'autre, et qui communique au dehors à l'aide d'une ouverture inférieure qu'on peut considérer comme l'avant bouche. Dans le tiers supérieur de cette cavité, est contenu et comme suspendu une sorte de tube intestinal droit et cylindrique qui a son ouverture extérieure immédiatement au pôle supérieur, et qui porte de chaque côté, deux cordons granuleux (peut-être les ovaires)? La cavité est remplie par un liquide en mouvement qu'on voit passer dans deux tubes latéraux, lesquels se divisent bientôt chacun en quatre branches et parviennent à la surface du corps en s'ouvrant dans les canaux longitudinaux qui conduisent le liquide dans les cils dont le mouvement est continuel, et qui paraissent des organes respiratoires. Enfin, des parties latérales de chacun des huit canaux costaux, naissent une infinité de petits vaisseaux ou sinus transversaux qui les font communiquer entre eux, et qui s'enfoncent dans le parenchyme environnant. — De chaque côté du sphéroïde et intérieurement on aperçoit deux petites masses qui occupent chacune le fond d'une cavité ou cul-de-sac, et donnent naissance à deux longs filaments contractiles, sortant par deux ouvertures circulaires situées vers le tiers inférieur du corps. Ces filaments se divisent ensuite en un grand nombre de branches.
(2) Aj. Beroë novem-costatus, Brug. (Baster, loc. cit., fig. 5; et Encycl., XC, 2.)
Le Beroë ovum, Fab., Groënl., 362, ne me paraît pas différer du Pileus.
(3) Beroë ovatus, Brug., ou Medusa infundibulum, Gm., Brown., Jam., XLIII, 2; et Encycl., XC, 1; — Beroë macrostomus, Péron. Voyag. pl. XXXI, fig. 1; — Beroë ovata, capensis, punctata et constricta, Chamiss. et Eisenh., Ac. nat. cur., X, 1re p., pl. XXX et XXXI.
N. B. L'anim. de Martens, Spitzb., pl. P., f. b, que l'on regarde comme de même espèce que celui de Brown, paraît devoir plutôt être rapproché du premier sous-genre.
[page] 282
Il y en a qui n'ont pas même de côtes et dont la forme représente celle d'un baril sans fonds (DOLIOLUM, Otto) (1).
LES CALLIANIRES, Péron, ne paraissent différer des béroés que par des côtes beaucoup plus saillantes, et réunies deux à deux pour former deux espèces d'ailes. On ne connaît pas assez leur organisation intérieure (2).
Les JANIRES, Oken, paraissent être voisines des callianires, mais on leur dessine de chaque côté trois grandes côtes ciliées et deux longs filaments divisés en rameaux (3).
Les ALCINOÉS, Rang., ont le corps cylindrique, ouvert à une extrémité, garni de l'autre de deux grandes ailes qui, en se ployant sur lui, peuvent l'envelopper en entier. Sa partie cylindrique est flanquée de quatre côtes saillantes, terminées chacune en pointe, et a huit lignes de cils (4).
Les OCYROÉS, Id., ont le même corps à quatre rangées de cils, mais sans côtes, et des ailes semblables, garnies chacune à leur base de deux pointes ciliées (5).
C'est aussi près des béroés que doit être rangé
LE CESTE. (CESTUM. Lesueur.)
Très long ruban gélatineux, dont l'un des bords est garni d'un double rang de cils; l'inférieur en a aussi, mais plus petits et moins nombreux. C'est au milieu du bord inférieur
(1) Doliolum mediterraneum, Otto. Ac. nat. cur. XI, part. 2, pl. XLII, f. 4;
(2) Le Callianire didiploptère, Péron, An. Mus., XV, pl. 11, fig. 16.
(3) Beroë hexagone, Brag., Encycl. vers, pl. 90, f. 6.
(4) Alcinoë vermiculata, Rang, Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris, IV, XIX, 1, 2.
(5) Ocyroë maculata, id., ib., XX, 1, 2; — Oc. fusca, ib., 3; — Oc. crystallina, ib., 4.
Le Callianira heteroptera, Chamiss: et Eisenh., Ac., nat. cur., X, part. 2, pl. XXXI, f. 3, fera probablement encore un sous-genre.
[page] 283
qu'est la bouche, large ouverture qui donne dans un estomac percé au travers de la largeur du ruban et allant à un anus très petit. De l'extrémité voisine de l'anus partent des vaisseaux qui parcourent les deux extrémités du ruban. Aux côtés de la bouche s'ouvrent deux sacs qui sont probablement des ovaires. On peut comparer cet animal à une callianire à deux côtes, et dont les ailes seraient excessivement prolongées.
La seule espèce connue,
Le Ceste de Vénus. Lesueur. Nouv. Bull. des sc. juin 1813. pl. V. f. 1.
Est de la Méditerranée. Sa longueur, ou plutôt sa largeur, est de plus de cinq pieds, sa hauteur de deux pouces. Il se conserve très-difficilement entier (1).
Les deux genres suivants, qui avaient aussi été réunis aux méduses, pourraient former une petite famille dans cet ordre, à cause du cartilage intérieur qui soutient la substance gélatineuse de leur corps.
LES PORPITES. (PORPITA. Lam.)
Ont ce cartilage circulaire, et sa surface marquée de stries concentriques, croisant avec des stries rayonnantes. A la face supérieure il n'est revêtu que d'une membrane mince, qui le déborde. L'inférieure, est garnie d'un très grand nombre de tentacules, dont les extérieurs sont plus longs, et munis de petits cils terminés chacun par un globule. Ils contiennent quelquefois de l'air; les mitoyens sont plus courts, plus simples et plus charnus. Au centre de tous ces tentacules est la bouche en forme de petite trompe saillante. Elle conduit à un estomac simple entouré d'une substance comme glanduleuse.
(1) Le Lemnisque, Quoy et Gaym., Zool. de Freyc., pl. 86, f. 1, est peut-être un fragment de ceste.
[page] 284
On en connaît une espèce d'un beau bleu, de la Méditerranée et des mers plus chaudes (1).
LES VÉLELLES. (VELELLA. Lam.)
Ont, comme les porpites, à la face inférieure une bouche en forme de trompe, entourée d'innombrables tentacules dont les extérieurs sont plus longs; mais ceux-ci ne sont pas ciliés, et ce qui donne un caractère plus important, c'est que le cartilage qui est ovale, a sur sa face supérieure une crête verticale posée obliquement, et assez élevée. Ce cartilage est transparent et n'a que des stries concentriques.
On en connaît aussi une espèce, de la même couleur et vivant dans les mêmes mers que la porpite. Elle se mange frite (2).
LE DEUXIÈME ORDRE DES ACALÈPHES.
LES ACALÈPHES HYDROSTATIQUES
Se reconnaissent à une ou plusieurs vessies ordinairement remplies d'air, moyennant lesquelles
(1) C'est le Med. umbella, Müll., Natur. de Berl., Besch., II, IX, 2, 3; l'Holothuria nuda, Gm.; Forsk., XXVI, L, 1; et Encycl., XC, 6, 7; et le Porpita gigantea, Péron, voy. XXXI, 6.
Medusa porpita, L. n'en est que le cartilage, dépouillé de sa partie gélatineuse et des tentacules.
La Porpite appendiculée, Bosc., vers, II, XVIII, 5, 6, doit faire un sous-genre à part si ce n'est pas un individu altéré. C'est le genre POLYBRACHIONIE, Guilding, Zool. journ., n° XI.
(2) C'est le Medusa velella et l'Holothuria spirans, de Gmel.; Forsk. XXVI, k; Encycl., XC, 1, 2. Le Velella scaphidia, Péron, voy. XXX, 6, n'en diffère en rien de générique; il paraît que l'on peut distinguer plusieurs espèces, telles que Velella oblonga; V. sinistra; V. lata, Chamiss. et Eisenh., Ac. Cur., nat., X, 1re part., pl. XXXII.
[page] 285
elles sont suspendues dans les eaux. Des appendices singulièrement nombreux et variés pour les formes, dont les uns servent probablement de suçoirs, les autres peut-être d'ovaires, et quelques-uns plus longs que les autres de tentacules, se joignent à ces parties vésiculeuses pour composer toute l'organisation apparente de ces animaux. On ne voit pas qu'ils aient de bouche bien reconnaissable pour telle.
LES PHYSALIES (PHYSALIA. Lam.)
Consistent en une très grande vessie oblongue, relevée en dessus d'une crête saillante oblique et ridée, et garnie en dessous, vers l'une de ses extrémités, d'un grand nombre de productions cylindriques, charnues, qui communiquent avec la vessie, et se terminent diversement. Les mitoyennes portent des groupes plus ou moins nombreux de petits filaments; les latérales se bifurquent seulement en deux filets, l'un desquels se prolonge souvent beaucoup. Une des extrémités de la vessie paraît avoir un très petit orifice; mais à l'intérieur, on ne trouve pour tout intestin qu'une autre vessie à parois plus minces, et qui a des cœcums se prolongeant en partie dans les cavités de la crête. Du reste, nul système nerveux, ni cirlatoire, ni glanduleux (1). L'animal nage à la surface de la mer quand elle est calme, et emploie
(1) Je me suis assuré de cette absence de tout organe intérieur compliqué, sur de grands et nombreux individus, en sorte que je ne puis admettre l'idée présentée récemment que la physale pourrait être un mollusque.
[page] 286
sa crête comme une voile, ce qui lui a fait donner par les navigateurs le nom de petite galère. Il porte aussi, dans l'état de vie, de très longs filaments plus minces que les autres, et semés comme de perles ou de gouttelettes. On dit que leur attouchement brûle comme celui de l'ortie.
Il y en a dans toutes les mers chaudes (1).
LES PHYSSOPHORES. (PHYSSOPHORA. Forsk.)
Ont des rapports sensibles avec les physalies; mais leur vessie est beaucoup plus petite à proportion, sans crête, souvent accompagnée de vessies latérales et leurs divers et nombreux tentacules sont suspendus verticalement sous cette vessie, comme uneguirlande ou comme une grappe.
Dans
LES PHYSSOPHORES proprement dits. (PHYSSOPHORA. Pér.)
Entre la vessie supérieure et les tentacules, il se trouve d'autres vessies placées à côté ou au-dessus les unes les autres, et deforme tantôt irrégulière, tantôt polyèdre, et formant par leur réunion des prismes ou des cylindres; les tentacules en partie coniques, en partie cylindriques, en partie formés de groupes de filets ou de globules, quelques-uns enfin filiformes et susceptibles de beaucoup d'a-
(1) Holothuria physalis, L., Amœn., Ac., IV, III, 6; Sloane, Jam., I, IV, 5; — Medusa utriculus, Gm. Lamartinière, Journ. de Phys., nov. 1787, II, 13, 14; — Medusa caravella, Müll., natu al. de Berl (Besch.), II, 9, 2, sont des physalies, mais qui ne paraissent pas assez bien décrites pour pouvoir être ni réunies ni distinguées comme espèces. J'en dis autant de la Physalie pélagique, Bosc., vers, II, XIX, 1 et 2, de la Physalie mégaliste, Péron, voy. I, XXIX, 1. Cette observation s'appliquera même à celles de Tilesius, Voyage de Krusenst. et de M. Lesson, Voyage de Duperr., Zooph., pl. 4 et 5, quoique mieux caractérisées, tant que nous n'aurons pas d'observations précises sur les changements que l'âge ou d'autres circonstances peuvent produire dans le nombre des tentacules.
[page] 287
longement, forment une grappe ou une guirlande à l'extrémité inférieure (1).
LES HIPPOPODES. (HIPPOPUS. Quoy et Gaym.)
Ont seulement des vésicules latérales, presque demi-circulaires, ou en forme de pied de cheval, serrées sur deux rangs, et formant ainsi une sorte d'épi comparable à celui de certains gramens, d'où il pend aussi une guirlande qui traverse toutes ces pièces. Les contractions de ces vésicules impriment à l'ensemble un mouvement rapide (2).
LES CUPULITES.
Ont leurs vésicules attachées régulièrement des deux côtés d'un axe souvent très long (3).
LES RACEMIDES. Cuv.
Ont toutes leurs vésicules globuleuses, petites, garnies chacune d'une petite membrane et réunies en une masse ovale qui se meut par leurs contractions combinées (4).
LES RHIZOPHYZES. (RHIZOPHYZA. Péron.)
N'ont pas de vessies latérales, mais seulement une vessie supérieure et une longue tige, le long de laquelle sont sus-
(1) Tel est le Physsophora hydrostatica, Gm. L'individu nommé Physsoph. musonema par Péron, Voy., XXIX, 4, est bien conservé; celui de Forskahl, Ic., XXXIII, E, e, 1, e, 2; Encycl., LXXXIX, 7–9, me paraît de la même espèce, mais mutilé de la partie de ses tentacules qui tombent aisément. Je crois aussi que le Physsophora rosacea Forsk., XLIII, B, b, 2, Encycl., LXXXIX, 10, 11, est un individu, mutilé d'une autre espèce. — Aj. Rhizophysa Chamissonis, Eisenhardt, Meduses, Ac. nat. cur., tome x, pl. 35, f. 3, Rh. helianthus, et Rh. melo Quoy et Gaym., An. des Sc. nat. X, pl. 5, et beaucoup d'espèces non encore décrites.
(2) Quoy et Gaym., An. des Sc. nat., tome X, pl. 10, 4. A, f. 1–12.
N. B. la Glèbe d'Otto, Ac. nat. Cur., XI, part. 2, pl. 42, f. 3, n'est qu'une vésicule d'hippopode.
(3) Voyage de Freyc., Zool., pl. 87, f. 15.
(4) Genre nouv. de la Médit.
[page] 288
pendus des tentacules, les uns coniques, les autres filiformes (1).
Les STÉPHANOMIES. (STEPHANOMIA. Péron.)
Paraissent une troisième combinaison, où les vessies latérales qui, dans les physsophores propres, adhéraient au haut de la tige, au-dessus des tentacules, se prolongent sur sa longueur, et s'y mêlent à des tentacules de diverses formes (2).
C'est à la suite des acalèphes hydrostatiques que peuvent se placer
LES DIPHYES. (DIPHYES. Cuv.)
Genre très singulier, où deux individus différents sont toujours ensemble, l'un s'emboîtant dans un creux de l'autre, ce qui permet cependant de les séparer sans détruire leur vie propre. Ils sont gélatineux, transparents, et se meuvent à peu près comme les méduses; l'emboîtant produit du fond de son creux un chapelet qui traverse un demi-canal de l'emboîté, et paraît se composer d'ovaires, de tentacules et de suçoirs comme ceux des genres précédents.
MM. Quoy et Gaymard y ont établi des divisions d'après les formes et les proportions relatives des deux individus.
Ainsi dans
LES DIPHYES propres,
Les deux individus sont presque semblables, pyramidaux,
(1) Physsophora filiformis, Forsk., XXXIII; F. Encycl., LXXXIX, 12; le même que Rhizophyza planestoma, Péron, Voy., XXIX, 3. Mais MM. Quoy et Gaymard pensent que ces rhisophyses ne sont que des physsophores qui ont perdu leurs vessies latérales.
(2) Stephanomia Amphitritis, Péron, Voy., XXIX, 5. Quant au Stephanomia uvaria, Lesueur, il me paraît devoir être plutôt rapproché des physsophores proprement dits.
[page] 289
avec quelques pointes autour de leur ouverture qui est à la base de la pyramide (1).
Dans les CALPES, l'emboîté a encore la forme pyramidale, mais l'emboîtant est fort petit et carré.
Dans les ABYLES, l'emboîté est oblong ou ovale; l'emboîtant un peu plus petit et en forme de cloche.
Dansles CUBOÏDES, c'est l'emboîté qui est petit et en forme de cloche; l'emboîtant est beaucoup plus grand et carré.
Dans les NAVICULES, l'emboîté est en forme de cloche; l'emboîtant aussi grand, mais en forme de sabot (2).
Il y en a encore plusieurs autres combinaisons.
QUATRIÈME CLASSE DES ZOOPHYTES.
LES POLYPES.
Ont été ainsi nommés, parce que les tentacules qui entourent leur bouche les font un peu ressembler au poulpe, que les Anciens appelaient polypus. La forme et le nombre de ces tentacules varient; le corps est toujours cylindrique ou conique, souvent sans autre viscère que sa cavité, souvent aussi avec un estomac visible, auquel adhèrent des intestins ou plutôt des vaisseaux creusés dans la substance du corps, comme ceux des méduses; alors on voit ordinairement aussi des ovaires. La plupart de ces animaux sont susceptibles de former des êtres composés, en poussant de nouveaux individus comme des bour-
(1) Bory-Saint-Vincent, Voyage aux îles d'Afrique.
(2) Voyez le Mém. de MM. Quoy et Gaim., Ann. des Sc. nat., tome X.
TOME III. 19
[page] 290
geons. Néanmoins il se propagent aussi par des œufs.
LE PREMIER ORDRE DES POLYPES,
OU LES POLYPES CHARNUS. Vulg. ORTIES DE MER FIXES.
Comprend des animaux charnus, qui ont l'habitude de se fixer par leur base, mais dont plusieurs peuvent aussi ramper sur cette base, ou la détacher tout-à-fait, et nager ou se laisser emporter au mouvement des eaux; le plus souvent ils se bornent à épanouir plus ou moins l'ouverture de leur bouche, laquelle leur tient aussi lieu d'anus. Elle est entourée de tentacules plus ou moins nombreux, et donne dans un estomac en cul-de-sac. Entre ce sac intérieur et la peau extérieure, est une organisation assez compliquée, mais encore obscure, consistant surtout en feuillets verticaux et fibreux, auxquels adhèrent les ovaires, semblables à des fils très entortillés. Les intervalles de ces feuillets communiquent avec l'intérieur des tentacules; et il paraît que l'eau peut y entrer et en sortir par de petits orifices du tour de la bouche; du moins l'actinie la fait-elle jaillir quelquefois par là (1).
(1) Voyez Spix, Ann. Mus., XIII, XXXIII, f. 1–5.
[page] 291
LES ACTINIES. (ACTINIA. L.)
Leur corps charnu, souvent orné de couleurs vives, développant des tentacules nombreux, et placés autour de la bouche sur plusieurs rangs comme les pétales d'une fleur double, leur a fait donner le nom d'anémones de mer. Elles sont infiniment sensibles à la lumière, et s'épanouissent ou se ferment selon que le jour est plus ou moins beau; lorsqu'elles retirent leurs tentacules, l'ouverture d'où ces organes sortent, se contracte et se referme sur eux comme celle d'une bourse.
Leur force de reproduction n'est guère moindre que celle des polypes à bras; elles repoussent les parties qu'on leur coupe, et peuvent se multiplier par la division. Leur génération ordinaire est vivipare. Les petites actinies passent de l'ovaire dans l'estomac et sortent par la bouche. Ces zoophytes dilatent beaucoup leur bouche, quand ils ont faim. Ils dévorent toute sorte d'animaux, et spécialement des crustacés, des coquilles, de petits poissons qu'ils saisissent avec leurs tentacules, et digèrent assez promptement (1).
LES ACTINIES proprement dites.
Se fixent par une base large et plate.
Les espèces les plus communes sur nos côtes, sont
L'Actinie coriace. (Act. senilis (2). L.)
Large de trois pouces; à enveloppe coriace, inégale, orangée, à tentacules sur deux rangs, de longueur mé-
(1) Voyez Diquemare, Journ. de Phys., 1776, juin, p. 515. et le Mémoire sur les Polypes et les Actinies, par M. Rapp; Weimar, 1829, in-4°.
(2) C'est à la fois l'Actinia senilis, Gm., Diquemare, Trans. phil., tome LXIII, pl. XVI, f. 10, et pl. XVII, f. 11; l'Actinia crassicornis, Baster, XIII, 1; l'Act. digitata, Zool. dan., CXXXIII, et 'Act. holsatica, ib., CXXXIX.
19*
[page] 292
diocre, ordinairement marqués d'un anneau rose. Elle se tient principalement dans le sable, où elle se renfonce pour peu qu'on l'effraie.
L'Actinie pourpre. (Act. equina (1). L.)
A peau douce, finement striée; couleur ordinairement d'un beau pourpre, souvent tacheté de vert; plus petite, les tentacules plus longs, plus nombreux qu'à la précédente. Elle couvre tous les rochers de nos côtes de la Manche, et les orne comme s'ils portaient les plus belles fleurs.
L'Actinie blanche. (Act. plumosa (2). Cuv.)
Blanche, large de quatre pouces et plus; les bords de sa bouche s'épanouissent en lobes, tous chargés d'innombrables petits tentacules; il y en a un rang intérieur de plus grands.
L'Actinie brune. (Act. effæta.) Rond. lib. XVII. cap. XVIII. Bast. XIV. 2 (3)
D'un brun clair, rayé en long de blanchâtre; de forme alongée, souvent plus étroite vers le bas; à peau lisse; à tentacules nombreux. Quand elle se contracte, il lui sort souvent par la bouche de longs filaments qui viennent de ses ovaires. Elle s'attache de préférence sur des co-
(1) C'est à la fois l'Act. equina, L. Diquem., Trans. phil., LXIII, XVI, 1, 2, 3, et l'Hydra mesembrianthemum, Gm.; Gærtner, Trans. phil, LII, 1–5.
(2) Elle n'est bien figurée nulle part, mais je crois que c'est elle que doit représenter Baster, XIII, 2. L'Hydra dianthus Gm.; Ellis, Trans. phil., LVII, XIX, 8; et Encycl., LXXI, 5, en est aussi fort voisine. Peut-être même l'Hydra anemone, Trans. phil., ib., 4, 5; Encycl., ib., 5, 6.
(3) C'est aussi, à ce que je crois, l'Act. felina, Diquem., Trans. phil., LXIII, XVI, 13, que Gmel. rapporte à son Actin. truncata.
Il est essentiel de remarquer que les variations de formes et de couleur des actinies en rendent la détermination très difficile, et que l'on ne doit point se fier aux caractères établis par les observateurs, et moins encore aux rapprochements proposés par les compilateurs.
[page] 293
quilles, et est extrêmement commune dans la Méditerranée (1).
Les THALASSIANTHES, Ruppel, sont des actinies à tentacules ramifiés (2).
Ses DISCOSOMES en sont où les tentacules se réduisent à peu près à rien par leur brièveté (3).
LES ZOANTHES. (ZOANTHUS. Cuv.)
Ont le même tissu charnu, la même disposition de bouche et de tentacules et une organisation à peu près semblable à celle des actinies; mais ils sont réunis en nombre plus ou moins considérable sur une base commune, tantôt en forme de tige rampante (4), tantôt en forme de large surface (5).
LES LUCERNAIRES. (LUCERNARIA. Müll.)
Paraissent devoir être rapprochées des actinies; mais leur substance est plus molle, elles se fixent aux fucus et autres corps marins, par un pédicule mince; leur partie supérieure se dilate comme un parasol; au milieu est la bouche. Des tentacules nombreux, rapprochés
(1) Aj. en espèces à peu près certaines, Hydra cereus, Gm.; Gærtner, Trans. phil., LII, 1, 1; Encycl., LXXIII, 1, 2; — Hydra bellis, Tr., ib., 2; Encycl., ib., 4; — Hydra helianthus, Ellis, Trans., LVII, XIX, 6, 7; Encycl., LXXI, 1, 2; — Hydra aster, Ellis, Trans., LVII, XIX, 3; Encyl., LXXI, 3; — Actinia varians, Zool. dan., CXXIX; — Act. candida, ib., CXV; — Act. plumosa, ib., LXXXVIII; — Act. coccinea, ib., LXIII, 1, 3; — Act. viridis, Forsk., XXVII, B.; Act. rubra, Brug.; Forsk., ib., A; — Act. maculata, Brug.; Forsk., ib., C.; — Actinia quadricolor, Ruppel, voyage, Moll., pl. 1, f. 3, etc.
(2) Thal. aster, Ruppel, Moll., pl. 1, f. 2.
(3) Discos. nummiforme, id., ib., f. 1.
(4) Hydra sociata, Gm.; Ell. et Sol., Corall., I, 1; Encycl., LXX, 1.
(5) Alcyonium mamillosum, Ell. et Sol., loc. cit., 4; — Alc. digitatum, id., ib., 6.
Ces dernières forment le genre PALYTHOÉ de Lamouroux et conduisent aux alcyons. Ce genre paraît avoir été caractérisé sur des individus desséchés. Voyez le grand ouvrage d'Égypte, Zool., polypes, pl. 11, f. 1–4.
[page] 294
en faisceaux, en garnissent les bords. Entre la bouche et ces mêmes bords sont huit organes, en forme d'intestins aveugles qui partent de l'estomac et contiennent une matière rouge et grenue.
Dans la Lucernaire à quatre cornes, Müll., Zool. Dan., XXXIX, 1–6, le bord est divisé en quatre branches fourchues, et portant chacune deux groupes de tentacules; dans le L. auricula, ibid., CLII, les huit groupes sont également répartis autour d'un bord octogone (1).
DEUXIÈME ORDRE DES POLYPES.
LES POLYPES GÉLATINEUX.
Ne sont, comme les précédents, revêtus d'aucune enveloppe dure, et ne produisent pas non plus dans l'intérieur de leur réunion un axe de substance ligneuse charnue ou cornée. Leur corps est gélatineux, de forme plus ou moins conique; sa cavité tient lieu d'estomac.
LES POLYPES A BRAS. (HYDRA. Lin.)
Nous offrent les animaux de cette classe réduits à leur plus grande simplicité. Un petit cornet gélatineux, dont les bords sont garnis de filaments qui leur servent de tentacules, voilà tout ce qui paraît de leur organisation. Le microscope ne fait voir dans leur substance
(1) Aj. Luc. fascicularis, Fleming., Soc. Werner, II, XVIII, 1, 2; — — Luc. campanula, Lamouroux, Mém. Mus., II, XVI. Le Lucernaria phrygia, Fabr.; Faun. Groënl., 345, paraît devoir former un autre genre. Voyez au reste le mémoire de M. Lamouroux sur ces zoophytes, dans les Mém du Mus., tom. II.
[page] 295
qu'un parenchyme transparent rempli de grains un peu plus opaques. Néanmoins ils nagent, ils rampent, ils marchent même en fixant alternativement leurs deux extrémités, comme les sangsues ou les chenilles arpenteuses; ils agitent leurs tentacules et s'en servent pour saisir leur proie, qui se digère à vue d'œil dans la cavité de leur corps; ils sont sensibles à la lumière et la recherchent; mais leur propriété la plus merveilleuse est celle de reproduire constamment et indéfiniment les parties qu'on leur enlève, en sorte que l'on multiplie à volonté les individus au moyen de la section. Leur multiplication naturelle se fait par des petits qui sortent en différents points du corps de l'adulte, et en sont d'abord comme des branches.
Nos eaux dormantes en nourrissent cinq ou six espèces, qui diffèrent par la couleur, le nombre et la proportion des tentacules.
La plus célèbre, par les expériences de reproduction qu'elle a occasionées la première, est
Le Polype vert (Hydra viridis.) Trembley. Pol. I. 1. Rœs. III. LXXXVIII. Encyc. LXVI.
Qui est en effet d'un beau vert clair. On le trouve surtout sous les lentilles d'eau.
Le Polype à longs bras (Hydra fusca.) Tremb. Pol. I. 3. 4. Rœs. III. LXXXIV. Encyc. LXIX.
Est plus rare; de couleur grise. Son corps n'a pas un pouce de long, et ses bras en ont plus de dix (1).
LES CORINES. (CORINE. Gærtner.)
Ont une tige fixée, terminée par un corps ovale, plus
(1) Aj. Hydr. grisea, Trembl., 1, 2; Rœs., III, LXXVIII-LXXXIII; Encycl., LXVII; — Hyd. pallens, Rœs., III, LXXVI, LXXVII; Encycl., LXVIII; — Hyd. gelatinosa, Zool. dan., CXV, 1, 2.
B. N. Les dix premières hydres du Gmel. sont des actinies; la onzième (H. doliolum), une holothurie.
[page] 296
consistant que celui des hydres, ouvert au sommet, et hérissé à toute sa surface de petits tentacules. Quelques-unes portent leurs œufs au bas de ce corps (1).
LES CRISTATELLES. (CRISTATELLA. Cuv.)
Ont sur la bouche une double rangée de nombreux tentacules, courbée en demi-lune, formant un panache de cette figure, et attirant par leur mouvement régulier, les molécules nutritives. Ces bouches sont portées sur des cols courts attachés à un corps gélatineux commun qui se transporte comme les hydres. On trouve ces animaux dans nos eaux dormantes. A l'œil nu ils ne paraissent que de petites taches de moisissure (2).
LES VORTICELLES. (VORTICELLA.)
Ont une tige fixée, souvent branchue et très divisée, dont chaque branche se termine par un corps en forme de cornet ou de cloche. On voit sortir de l'ouverture des filaments en deux groupes opposés, qui exercent un mouvement continuel, et attirent les molécules nutritives. Les espèces en sont nombreuses dans nos eaux douces, et la plupart trop petites pour être bien distinguées sans microscope. Elles forment des buissons, des arbuscules, des panaches, et prennent d'autres formes toutes très agréables (3).
(1) Tubularia coryna, Gm.; ou Coryne pusilla, Gærtner ap., Pall., Spic., X, IV, 8; Encycl., LXIX, 15, 16; — Tubularia affinis, Gm., Pall., ib., 9; Encycl., ib., 14; — Hydra multicornis, Forsk., XXVI, B, b, Encycl., ib., 12, 13; — Hydra squamata, Müll., Zool. dan., IV; Encycl., ib, 10, 11; — et les espèces esquissées par M. Bosc., Hist. des Vers, II, pl. XXII, f. 3, 6, 7 et 8.
N. B. Le genre des corines, que je n'ai point observé par moi-même, me paraît mériter encore un examen particulier.
(2) Cristatella mucedo, Cuv.; Rœs., III, XCI;
(3) Je ne rapporte à ce genre que les espèces représentées dans les planches XXIV, XXVI de l'Encycl. Elles s'unissent par de grands rapports avec certaines espèces rangées parmi les microscopiques.
[page] 297
LES PÉDICELLAIRES. (PEDICELLARIA.)
Se trouvent entre les épines des oursins, et sont regardées par divers auteurs comme des organes de ces animaux; cependant il est plus vraisemblable que ce sont des polypes qui prennent là leur asyle. Une longue tige grêle se termine par un cornet garni à son extrémité de tentacules, tantôt en forme de filets, tantôt en forme de feuilles (1).
TROISIÈME ORDRE DES POLYPES.
LES POLYPES A POLYPIERS.
Forment cette nombreuse suite d'espèces que l'on a long-temps regardées comme des plantes marines, et dont les individus sont en effet réunis en grand nombre pour former des animaux composés, pour la plupart fixés comme des végétaux, soit qu'ils forment une tige ou de simple expansions, par le moyen des appuis solides qui les revêtent à l'intérieur. Les animaux particuliers plus ou moins analogues aux actinies ou polypes à bras, sont liés tous par un corps commun, et en communauté de nutrition; en sorte que ce qui est mangé par l'un profite au corps général et à tous les autres polypes. Ils sont même en communauté de volonté; du moins ce dernier article est-il certain pour les espèces libres, telles que les pennatules, que l'on voit nager par les contractions de leurs tiges, et
(1) Voyez Müll., Zool. dan., XVI; copié Encycl., LXVI.
[page] 298
par les mouvements combinés de leurs polypes.
On a donné le nom de polypiers aux parties communes de ces animaux composés; elles sont toujours formées par dépôt et par couches, comme l'ivoire des dents; mais tantôt elles sont à la surface, tantôt dans l'intérieur de l'animal composé. Ces positions diverses ont donné lieu à l'établissement des familles de cet ordre.
La première famille,
LES POLYPES A TUYAUX.
Habite des tubes dont le corps gélatineux commun traverse l'axe, comme ferait la moelle d'un arbre, et qui sont ouverts, soit au sommet, soit aux côtés, pour laisser passer les polypes.
Leurs polypes plus simples paraissent ressembler principalement aux hydres et aux cristatelles.
LES TUBIPORES. (TUBIPORA. L.)
Ont des tubes simples, de substance pierreuse, contenant chacun un polype. Ces tubes sont parallèles et unis ensemble de distance en distance par des lames transversales, ce qui les a fait comparer à des tuyaux d'orgues.
L'espèce la plus connue (Tubipora musica, L.), Seb., III, CX, 89, est d'un beau rouge; ses polypes sont verts et de la forme d'hydres. Elle abonde dans l'Archipel des Indes (1).
(1) Les autres tubipores de Gm., n'appartiennent pas à ce genre; quelques-unes, surtout celles de Fabric, Faun. Groën., sont peut-être des tubes d'annelides; mais c'est à tort qu'on a supposé un habitant de cette classe dans l'espèce ci-dessus. C'est bien un polype. Voyez Quoy et Gaim., Zool. de Freyc., pl. 88.
[page] 299
Il paraît que c'est des tubipores que l'on doit rapprocher quelques polypiers fossiles, également composés de tubes simples, tels que les CATÉNIPORES, Lam., où les tubes sont dressés sur des lignes qui interceptent des mailles vides (1); les FAVOSITES, id. (2), composés de tubes hexagones serrés les uns près des autres, etc.
LES TUBULAIRES. (TUBULARIA. L.)
Ont des tubes simples ou branchus de substance cornée, des extrémités desquels sortent et se montrent les polypes.
Les polypes des tubulaires d'eau douce (PLUMATELLES, Bosc. (3), paraissent fort rapprochés des cristatelles par la disposition de leurs tentacules.
Nous en avons quelques-unes qui rampent sur les plantes de nos eaux dormantes (4).
LES TUBULAIRES MARINES.
Ont des polypes à deux rangs de tentacules; l'extérieur se développant en rayons; l'intérieur se relevant en houppe.
Nos côtes en produisent une (Tub. indivisa. Lam.), Ellis, Corall., XVI, c, à tubes simples de deux et trois pouces de haut, semblables à des brins de paille (5).
LES TIBIANES. Lamour.
Ont des tubes en zigzag qui donnent de chaque angle une petite branche ouverte (6).
(1) Tubipora catenulata, Gm., Linn., Amœn. Ac., I, IV, 20.
(2) Corallium gothlandicum, Amœn. Ac., I, IV, 27; — Favos. commune, Lamouroux, Ac., Sol. et Ell., pl. 75, f. 1, 2.
(3) Lamouroux a changé ce nom en NAÏSA.
(4) Tubularia campanulata, Rœsel., III, LXXIII-LXXV; — Tub. sultana, Blumenb., Man., trad. fr., tom. II, pl. de la p. 10, fig. 9; — Tub lucifuga, Vaucher, Bullet. des Sc., frim. an 12, pl. XIX, f. 6, 7.
(5) Aj. Tub. ramosa, Ellis, Corall., XVII, a; — Tub. muscoïdes, id., XVI, b.; — Tub. trichoïdes, id., ib., a; — Tub. solitaria, Rapp., Ac. nat. cur., XIV, XXXVIII, 2.
(6) Tibiana fasciculata, Lamouroux, polyp. flex., pl. VII, f. 3, a.
Lamouroux place ici les LIAGORES les TÉLESTO et les NÉOMERIS, petits genres qui seraient peut-être aussi bien près des coralliues creuses
[page] 300
LES CORNULAIRES. Lam.
Ont de petits tubes coniques, de chacun desquels sort un polype à huit bras dentelés, comme ceux des alcyons, des gorgones, etc. (1).
LES ANGUINAIRES. (ANGUINARIA. Lam.)
Ont de petits tubes cylindriques adhérant à une tige rampante, et dont chacun est ouvert latéralement près de son extrémité, pour le passage d'un polype (2).
LES CAMPANULAIRES. Lamarck.
Ont les bouts des branches par où passent les polypes, élargis en forme de cloches.
Lamouroux les distingue en CLYTIES dont les tiges sont grimpantes (3),
Et en LAOMÉDÉES, où elles ne le sont pas, les cloches y sont plus petites et à branches plus courtes (4).
LES SERTULAIRES. (SERTULARIA. L.)
Ont une tige cornée, tantôt simple, tantôt branchue, et sur ses côtés des cellules de formes très variées qu'occupent des polypes, tenant tous à une tige gélatineuse qui traverse l'axe, comme ferait la moelle d'un arbre. Ces zoophytes ont l'air de petites plantes aussi délicates qu'agréables à voir. Leur propagation se fait par des œufs ou des gemmes qui se développent dans des cellules plus grandes que les autres et de forme différente.
(1) Tubularia cornucopia. N. B. Les prétendues tubulaires des planches XI-XXVI d'Esper; ne représentent que des enveloppes d'œufs de mollusques de gastéropodes (excepté la dix-huitième qui est une galaxaure).
(2) Sertularia anguina, Ell., Corall., XXII, 11, c, C, D. Lamouroux a changé ce nom en AÉTÉE.
(3) Sertularia verticillata, Ell., Corall., XIII, a; — Sert. volubilis, id., XIV, a; — Sert. uva, id., XV, 6; — Sert. rugosa, id., XV, a, A.
(4) Sertularia dichotoma, Gm., Ell., Corall., XII, a, C; — Sert. spinosa, id., ib., XI, b, d; — Sert. geniculata, ib., b; — Sert. muricata, Sol. et Ell., Cor., VII, 3, 4.
[page] 301
Les diverses directions de leurs cellules ont donné lieu de les distribuer en plusieurs subdivisions. Ainsi, quand les petites cellules sont rangées d'un seul côté sur les branches ce sont des AGLAOPHÉNIES de M. Lamouroux, que M. Lamarck nomme PLUMULAIRES (1).
Quand elles sont rassemblées, en certains endroits, comme de petits tuyaux d'orgue, ce sont les AMATIA, Lamour., ou SÉRIALAIRES, Lam. (2).
On pourrait en distinguer les espèces où les cellules ainsi disposées entourent la tige d'une spirale.
Quand les cellules sont placées autour de la tige, en anneaux horizontaux, ce sont les ANTENNULAIRES, Lam., que M. Lamouroux avait nommées CALLIANYRES (3).
Ainsi le nom de SERTULAIRES propres ne reste qu'aux espèces où les cellules sont des deux côtés de la tige, soit opposées (4), soit alternes (5). Encore M. Lamouroux distingue-t-il les premières sous le nom de DYNAMÈNES.
(1) Sertularia myriophyllum, Gm.., Ell., Corall., VIII, a, A; — S. pennatula, Sol et Ell., VII, 1, 2; — S. pluma, Ell., Cor., VII, b, B. 3; — S. setacea, ib., XXXVIII, 4, D, T; — Ol. pinnata, ib., XI, a, A; — S. fructescens, Sol. et Ell., VI, a, A; — S. falcata, Ell., Corall., VII, a, A, et XXXVIII, 5, f.; — Aglaoph. cyprès, Zool. de Freyc., pl. XCI, 1–3; — Agl. godard, ib., XCV, 9, 10.
(2) Sertularia lendigera, Ell., Coroll., XV, b, B.
(3) Lamouroux a depuis changé ce nom en NÉMERTESIE, Sertularia antennina, Gm., Ell., Corall., IX, a, A, B, C; — Nemert. ramosa, Lamour., Ell., ib., b.
(4) Sertularia abictina, Gm., Ell., Corall., I, b, B; — S. tamarindus, ib., a, A; — S. filicula, Sol. et Ell., c, C; — S. polyzonias, Ell., Cor., II, a, b, A, B; — S. cupressina, ib., III, a, A; — S. argentea, ib., II, c, C; — S. thuya, ib., V, b, B; — S. cupressoïdes, Lepêch., Act. Pétrop. 1780, IX, 3, 4; — S. lichenastrum, Ell., Cor., VI, a, A; — S. racemosa, Cavol., Pol. mar., III, VI, 1, 2; — S. fuscescens, Baster., op. subs. 1, 6; — S. obsoleta, Lepech., Act., Pétrop. 1778, deuxième part., VII, B; — S. pinus, id., 1780, première part., IX, 1–2; — S. cuscuta, Ell., Corall., XIV, c, C.
(5) Sertularia operculata, Ell., Coral., III, b, B; — S. pinastrum, Sol. et Ell., VI, b, B; — S. rosacea, Ell., Cor., IV, a, A, B, C; — S. pumila, ib., V, a, A; — S. disticha, Bosc., vers, III, XXIX, 2; — S. pelasgica, id., ib., 3; — Dinam. crisioïde, Zool. de Freyc., pl. XC, f 12.
[page] 302
L'extrême petitesse des cellules lui fait établir le genre THOEA (1).
La deuxième famille est celle
DES POLYPES A CELLULES.
Où chaque polype est adhérent dans une cellule cornée ou calcaire à parois minces, et ne communique avec les autres que par une tunique extérieure très tenue, ou par les pores déliés qui traversent les parois des cellules. Ces polypes resemblent en général à des hydres.
LES CELLULAIRES. (CELLULARIA. L.)
Ont ces cellules disposées de manière à former des tiges branchues, à la manière des sertulaires; mais sans tube de communication dans l'axe. Leur substance est d'ailleurs plus calcaire.
Lamouroux y distingue
LES CRISIES.
Dont les cellules sur deux rangs, ordinairement alternes, s'ouvrent sur la même face (2).
LES ACAMARCHIS.
Qui avec la même disposition ont une vésicule à chaque ouverture (3).
(1) Sertularia hælecina, Gm., Ell., Corall., X, a, A, B, C. Voyez pour d'autres petits genres établis dans cette famille par Lamouroux, (les PASYTHÉES, les SALACIES, les CYMODOCÉES), son Hist. des polypiers flexibles, in-8°, 1816; et son Exposition méthod. des genres des polypiers, in-4°, 1821.
(2) Sertularia eburnea, Gm., Ell., Corall., XXI, a, A; — S. scruposa, id., XX, c, C; — S. reptans, ib., b, B, E, F; — S. fastigiata, ib., XVIII, a, A.
(3) Sertularia neritina, Gm., Ell., Corall., XIX, a, A, B, C.
[page] 303
LES LORICULES.
Où chaque articulation se compose de deux cellules adossées, dont les orifices opposés sont vers le haut qui est élargi (1).
LES EUCRATÉES.
Où chaque articulation n'a qu'une seule cellule à ouverture oblique (2).
On peut en rapprocher
LES ELECTRES. Lamouroux.
Où chaque articulation se compose de plusieurs cellules disposées en anneau (3).
On doit en séparer celles qui ont des articulations cylindriques, vides à l'intérieur, creusées à toute leur surface de cellules en quinconce: elles conduisent aux flustres et peut-être aux corallines. Je les nomme SALICORNIAIRES (4).
LES FLUSTRES. (FLUSTRA. L.) (5)
Présentent un grand nombre de cellules, unies comme
(1) Sertularia loricata, Ell., Cor., XXI, b, B. Lamouroux les nomme LORICAIRES; mais ce nom est depuis long-temps consacré à un poisson de la famille des silures.
(2) Sertularia chelata, Gm., Ell., Corall., XXII, b, B; — S. cornuta, id., XXI, c, C.
Ici se rattachent les genres moins nombreux: LAFOÉE, ALECTO, HIPPOTHEE, sur lesquels on peut consulter Lamouroux aux ouvrages cités. Quant à ses MENIPPÉES (Sertularia flabellum, Gm., Sol. et Ell., IV c, c, 1, C, C, 1; et S. crispa, ib., I, D, D) je doute qu'elles appartiennent à ce groupe.
(3) Flustra verticillata, Gm., Sol. et Ell., IV, a, A.
(4) Cellularia salicornia, Ellis, Corall., XXIII; — Cell. cereoïdes, Ell., et Sol., V, b, B, C, etc.; — Cell. cirrata, Sol. et Ell., IV, d, D; — Cell. flabellum, ib., c, C.
(5) N. B. D'après les observations de Spallanzani, de MM. Audouin, Edwards et de Blainville, certaines flustres seraient habitées par des animaux du groupe des ascidies; mais il y en a aussi, qui bien certainement, d'après MM. Quoy et Gaimard, le sont par de vrais polypes. Il sera important de savoir quelles espèces appartiennent à l'une ou à l'autre catégorie.
[page] 304
des rayons d'abeilles, et tantôt recouvrant divers corps, tantôt formant des feuilles ou des tiges, dont un seul côté est garni de cellules dans certaines espèces, tous les deux dans d'autres; leur substance est plus ou moins cornée (1).
LES CELLÉPORES. (CELLEPORA. Fabr.)
Offrent des amas de petites cellules ou vésicules calcaires, serrées les unes contre les autres et percées chacune d'un petit trou (2).
(1) Flustra foliacea, Gm., Ell., Corall., XXIX, a, A; — Fl. truncata, id., XXVIII, a, A; — Fl. bombicina, Sol. et Ell., IV, b, B; — Fl. carbasea, iid., III, 6, 7; — Fl. pilosa, Ell., Corall., XXXI, a, A, b; — Fl. tomentosa, Müller, Zool. dan., III, XCV, 1, 2; — Fl. compressa, Moll., Esch., C, 9; — Fl. membranacea, Zool. dan., CXVII, 1, 2; — Fl. papiracea, Moll., esch., 8; — Fl. tubulosa, Bose, XXVII, III, XXX, 2; — Fl. dentata, Ell., Cor., XXIX, C, D, D; — Fl. quadrata, Desmar. et Less., Bullet. Philom. 1814, X, V; — Fl. depressa, Moll., f. 21; — Fl. épineuse; — Fl. à diadème; — Fl. à collier; — Fl. globifère. Toutes les quatre, Zool. de Freyc., pl. 89; — Fl. à petit vase., ib., 91; — Fl. gentille; — Fl. margaritifera, ib., 92; — Fl. à grande ouverture, ib., pl. 93, f. 6, 7; — Fl. à petits sillons; — Fl. à gibecière; — Fl. à petits nids, ib., 95, et les espèces nouvelles représentées dans le grand ouvrage sur l'Égypte, Zool. zooph., p. 7—10. A ce genre se rattachent aussi les PHERUSES de Lamouroux. — Fl. tubulosa, Esper., IX, 1, 2; — ses BÉRÉNICES, Lamour., ad Sol. et Ell., pl. LXXX, f. 1–6; — ses ELSERINES, ib., LXIV, 15 et 16; et d'autres petits genres sur lesquels on peut le consulter.
(2) Cellepora hyalina, Gm., Cavol., Pol., Mar., III, IX, 8, 9; — C. magneville, Lamour., Polyp., Flex., pl. 1, f. 3; — C. megastoma, Desmar. et Less., Bullet. Phil., 1814, II, 5; — C. globulosa, ib., 7; C. annulans, Moll., Esc., 4; — C. pumicosa, Ell., Corall., XXVII, F. et XXX, d, D; — C. rubra, Müll., Zool. dan., CXLVI, 1, 2; — C. radiata, Moll., Esc., 17, A, I; — C. sedecimdentata, id., 16, A, C; — C. bïmucronata, id., 18, A, C; — C vulgaris, id., 10, A, B; — C. cyclostoma, id., 12, A, F; — C. pallasiana, id., 15 A, B. — C. borniana, id., 14, A, C; — C. otto-mulleriana, id., 15, A, C.
[page] 305
LES TUBULIPORES. (TUBULIPORA. Lam.)
Sont des amas de petits tubes, dont l'entrée est autant ou plus large que le fond (1).
Il existe dans la mer des corps assez semblables aux polypiers pour leur substance et leur forme générale, où l'on n'a pu encore apercevoir de polype. Leur nature est donc douteuse, et de grands naturalistes, tels que Pallas et autres, les ont regardés comme des plantes; cependant il en est plusieurs qui les regardent comme des polypiers à polypes et à cellules extrêment petites. Si cette conjoncture était vraie, c'est à l'ordre présent qu'ils appartiendraient. Ceux d'entre eux où l'intérieur est rempli de filets cornés, présentent toutefois de l'analogie avec les CÉRATOPHYTES.
LES CORALLINES. (CORALLINA. L.)
Ont des tiges articulées, portées sur des espèces dé racines, divisées en rameaux également articulés, à la surface desquels on ne voit aucuns pores, et où il n'a pas été possible d'a percevoir de polypes.
On les divise comme il suit:
LES CORALLINES propres.
Ont leurs articles calcaires, d'apparence homogène, sans écorce sensible.
Le fond de la mer est tout couvert, sur certains rivages, du Corallina officinalis, L., Ell., Coral., XXIV, a. A, b, B, dont les articles sont en ovale renversé les petites branches
(1) Millepora tubulosa, Gm., Ell., Corall XXVII, c, E.
TOME III. 20
[page] 306
disposées comme dans les feuilles pennées, et portant elles-mêmes d'autres branches disposées semblablement. Elle est blanche, rougeâtre ou verdâtre. On l'employait autrefois en pharmacie, à cause de sa substance calcaire (1).
Lamouroux en distingue encore, mais assez légèrement
LES AMPHIROÉS.
Dont les articulations sont alongées (2).
LES JANIES.
Qui ont seulement les branches plus menues et les articulations moins crétacées (3).
LES CYMOPOLIES.
Où les articulations sont séparées les unes des autres (4) par des intervalles cornés; leur surface a des pores plus marqués.
Déjà M. Delamarck avait séparé
LES PÉNICILLES Lamark. (NESEA. Lamouroux.)
Qui ont une tige simple, composée intérieurement de fibres cornées tissues ensemble et comme feutrées; encroûtée
(1) Aj. C. corallina elongata, Gm., Ell., Corall., XXIV, 3; — C. cupressina, Esper., Zooph., VII, 1, 2; — C. squamata, Ell., XXIV, c, C; — C. granifera, Sol. et Ell., XXI, c, C; — C. subulata, iid., ib., b; — C turneri, Lamour., Pol., Fl, X, 2; — C. crispata, id., ib., 3; — C. simplex, id., ib., 4; — C. calvadosii, Soî. et Ell., XXIII, 14; — C. palmata, id., XXI, a, A; — C. sagittata, Zool. de Freyc., pl. 95, f. 11 et 12.
(2) Corallina rigens, Sol. et Ell., XXI, d; — Cor. tribulus, id., ib., c; — C. cuspidata, ib., f; — Amph. fucoïdes, Lamour., Polyp., Fl., XI, 2; — A. gailloni, id., ib., 3; — A. verrucosa, id., ib., 5; A. jubata, ib., 6.
(3) Corallina rubens, Ell., Corall., pl. XXIV, f. F; — jania micrarthrodia, Lamour., Pol. flex., I, 69, f. 5, ad Sol. et Ell., pl. 69, f. 7 et 8; — J. crassa, id., pl. 69, f. 9, 10; — J. compressa, Zool. de Freyc. pl. 90, f. 8, 9, 10.
(4) Corallina barbata, Gm., Ell., Corall., XXV, c, C; — C. rosarium, Sol. et Ell., XXI, h, H.
[page] 307
d'un enduit calcaire, et terminée par un faisceau de branches articulées, analogues à celles des corallines ordinaires (1).
LES HALYMÈDES. Lamouroux.
Ont des tiges articulées et divisées comme les corallines; mais la substance de leurs articles qui sont fort larges, est pénétrée à l'intérieur de filets cornés, qu'on débarrasse aisément de leur croûte calcaire par les acides (2).
LES FLABELLAIRES. Lamarck.
N'ont pas d'articulations distinctes, mais forment de grandes expansions foliacées, composées comme les articles des halymèdes, et la tige des pénicilles, de filets cornés encroûtés d'nne enveloppe calcaire (3).
LES GALAXAURES. Lamouroux.
Ont des tiges divisées par dichotomie, mais leurs rameaux sont creux (4).
LES LIAGORES. Id.
Ont des tiges creuses et divisées par dichotomie, mais sans articulations (5).
(1) Corall. penicillus; — Cor. peniculum; — Cor. phœnix; — Nesea nedulosa. Zool. de Freyc., pl. 91, f. 8 et 9.
(2) Corallina tuna, Sol. et Ell., XX, e; — Cor. opuntia, id, ib., b, — Cor. incrassata, id., ib., d. C'est la deuxième division des flabellaires de Lamarck.
(3) Corallina conglutinata, Sol. et Ell., XXV, 7; — Corall. flabellum, iid., XXIV, C; et Corall. pavonia, Esper., Corall., VIII, IX; la première division des flabellaires de Lam. Lamouroux en a changé le nom en UDOTEA.
(4) Corall. obtusata, Sol. et Ell., XXII, 2; — Corall. lapidescens, id., ib., 9; — Tubularia fragilis, Linn., Sloane, Jam., XXX, 10; — Tubul. umbellata, Esper., tubul., XVII; — Corallina marginata, Sol. et Ell., XXII, 6; — Corall. fruticulosa, ib., 5; — Galaxaure roide, Zool. de Freyc., pl. 91, f. 10, 11.
(5) Corall. marginata, Sol. et Ell. XXII, 6; — Corall. fruticulosa, iid., ib., 5.
20*
[page] 308
C'est peut-être à la suite des corallines que doit être placée
L'ANADIOMÈNE. Lamouroux.
Vulgairement connue sous le nom de mousse de Corse, et si utilement employée comme vermifuge. Elle se compose d'articulations régulièrement disposées en branche, de substance un peu cornée recouverte d'un enduit gélatineux (1).
Parmi ces productions sans polypes apparents, que l'on rapporte par conjecture aux polypiers, il en est peu de plus singulières que
LES ACÉTABULES. (ACETABULUM. Lam.)
Une tige grêle et creuse porte une plaque ronde et mince, comme un parasol, striée en rayons, crénelée au bord, ayant au centre un petit disque lisse entouré de pores. On n'y aperçoit point de polypes. Les rayons de son disque sont creux et contiennent des grains verdâtres, ce qui l'a fait regarder comme une plante par Cavolini (2).
Il y en a une dans la Méditerranée. (Tubularia acetabulum, Gm.) Donat., Adr., III, Tournef., Inst. CCCXVIII. (3)
LES POLYPHYSES. (POLYPHYSA. Lam.)
Ont, comme les précédents, une tige grêle et creuse, mais
(1) Anadiomene flabellata, Lamour., Pol., flex., XIV, f. 3, et App., ad Sol. et Ell., pl. 69, f. 15 et 16.
N. B. Les GALAXAURES et les LIAGORES forment le genre DICHOTOMAIRE de Lamark; mais ce ne sont pas, comme le croit ce naturaliste, des polypiers vaginiformes, car leur tube ne contient aucun polype.
(2) Je ne trouve pas au pourtour les ouvertures dont parle M. Lamarck. Les tubes qui forment les rayons, sont clos. Les prétendus tentacules, décrits par Donati, étaient des corps étrangers. Ni l'ACÉTABULE, ni la POLYPHYSE, ne sont des polypes vaginiformes.
N. B. Depuis ma première édition, M. Rafeneau de Lille, a présenté à l'Académie un mémoire où il considère l'acétabule comme un végétal de la famille des conferves.
(3) Aj. l'Acétabule petit godet, Zool. de Freyc., pl. XC, f. 6, 7.
[page] 309
qui porte à son sommet un paquet de petites vessies closes, au lieu d'un disque formé de tubes (1).
La troisième famille,
LES POLYPES CORTICAUX.
Comprend les genres où les polypes se tiennent tous par une substance commune, épaisse, charnue ou gélatineuse, dans les cavités de laquelle ils sont reçus, et qui enveloppe un axe de forme et de substance variables. Les polypes de ceux que l'on a observés, sont un peu plus composés que les précédents, et se rapprochent davantage des actinies. On distingue dans leur intérieur un estomac, duquel partent huit intestins, dont deux se prolongent dans la masse commune, et les autres se terminant plus tôt paraissent tenir lieu d'ovaires (2).
On la subdivise en quatre tribus.
La première est celle
DES CÉRATOPHYTES.
Où l'axe intérieur est d'apparence de bois ou de corne et fixé: on en connaît deux genres, fort nombreux l'un et l'autre.
LES ANTIPATHES. (ANTIPATHES. Lin.) Vulgairement CORAIL NOIR.
Ont la substance branchue et d'apparence ligueuse
(1) Pol. aspergillum, Lamour., Ap. ad Sol. et Ell., pl. 69, f. 2–6, ou Fucus peniculus, D. Turner., fuc., IV, pl. 228.
(2) M. Savigay a publié sur ces animaux des observations non moins intéressantes que celles qu'il a faites sur les ascidies composées.
[page] 310
de leur axe, enveloppée d'une écorce si molle, qu'elle se détruit après la mort. Aussi ressemblent-ils, dans les cabinets, à des branches de bois sec (1).
LES GORGONES. (GORGONIA. L.)
Ont, au contraire, cette substance ligneuse ou cornée de leur axe enveloppée d'une écorce, dont la chair est tellement pénétrée de grains calcaires, qu'elle se dessèche sur l'axe, et y conserve ses couleurs souvent très vives et très belles; elle se dissout dans les acides. On a observé les polypes de plusieurs espèces; ils ont chacun huit bras dentelés, un estomac, etc., comme ceux du corail et des alcyons (2).
M. Lamouroux en distingue,
LES PLEXAURES
Dont l'écorce épaisse, à cellules non saillantes, fait peu d'effervescence dans les acides (3).
LES EUNICÉES.
Dont l'écorce organisée comme celle des plexaures, a des mamelons saillants, d'où sortent ses polypes (4).
(1) Ant. spiralis, Sol. et Ell., pl. XIX, f. 1–6; et les autres espèces indiquées par M. de Lamarck. Anim. sans vert, II, p. 305 et suivantes.
(2) Gorgonia pinnata, Gm.; — G. americana; — G. setosa; — G. sanguinolenta, que Lamouroux regarde comme autant de variétés d'une seule espèce; — G. petechisans, Sol. et Ell., pl. XVI; — G. patula, Sol. et Ell., pl. XV, f. 3, 4; — G. palma, Sol. et Ell., pl. XI; — G. verriculata, pl. XVII; — G. umbraculum, id., X; — G. exserta, iid., XV, 1, 2; — G. ceratophyta, iid., II, 1, 2, 3; IX, 5, 6, 7, 8; XII, 2, 3; G. viminalis, iid., XII, 1; — G. verticillaris, iid., II, 4, 5; — G. briareus, iid., XIV, 1, 2, etc.
(3) G. crassa, Gmel., Ac. des Sc., 1700, pl. 11; — G. suberosa, Ell., Corall., pl. 26, f, p, q, r; — G. friabilis, Lamour., Soll. et Ell., pl. XVIII, f. 3.
(4) Gorgonia antipathes, Séb., III, CIV, 2, CVII, 4; — Eun. limiformis, Lamour., Sol., et Ell., pl., XVIII, f. 1; — Eun. clavaria, iid., ib., 2; — Eun. mammosa, Lamour., ad Sol. et Ell., pl. LXX, f. 3.
[page] 311
LES MURICÉES.
Dont l'écorce médiocrement épaisse a des mamelons saillants, couverts d'éeailles imbriquées et hérissées (1).
LES PRIMNOA.
Dont les mammelons alongés s'imbriquent, en pendant les uns sur les autres (2).
La deuxième tribu,
LE LITHOPHYTES.
A l'axe intérieur, de substance pierreuse et fixé.
LES ISIS. (ISIS. L.)
Ont cet axe branchu et sans empreintes ni cellules creusées à sa surface. L'écorce animale qui l'enveloppe est mélangée de grains calcaires, comme dans les gorgones.
LE CORAIL. (CORALIUM. Lamarck.)
A son axe sans articulations, et seulement strié à sa surface.
C'est à ce sous genre qu'appartient
Le Corail du commerce. Isis nobilis. L.), Esp. I. VII,
Célèbre par la belle couleur rouge de son axe pierreux et le beau poli dont il est susceptible, ce qui le rend propre à des bijoux agréables. On en fait une pêche très productive en plusieurs endroits de la Méditerranée. Son écorce est crétacée et rougeâtre. Ses polypes, comme dans beaucoup d'autres genres, ont huit bras dentelés.
(1) M. spicifera, Lam., ou Gorg. muricata, Gm., Ap., ad Sol. et Ell., pl. LXXI, f. 1, 2; — M. elongata, Lam., id. f. 3, 4.
(2) Gorg. reseda, Gm., Sol. et Ell., pl. XIII, f. 1, 2.
[page] 312
LES MÉLITES. Lamarck.
Ont la substance pierreuse de leur axe interompue par des nœuds renflés d'une matière semblable à du liége (1).
LES ISIS proprement dites. Lamarck.
L'ont interrompue par des étranglements dont la matière ressemble à de la corne. Leur écorce épaisse et molle, tombe plus facilement que dans les précédents (2).
M Lamouroux distingue encore des isis proprement dites,
LES MOPSÉES.
Dont l'écorce est plus mince et persistante (3).
LES MADRÉPORES. (MADREPORA. L.)
Ont leur partie pierreuse tantôt branchue, tantôt en masses arrondies, ou en lames étendues, ou en feuilles; mais toujours garnie de lamelles, qui s'y réunissent concentriquement en des points où elles représentent des étoiles, ou bien qui aboutissent à des lignes plus ou moins serpentantes. Dans l'état de vie, cette partie pierreuse est recouverte d'une écorce vivante, molle et gélatineuse, toute hérissée de rosettes de tentacules, qui sont les polypes, ou plutôt les actinies; car ils ont généralement plusieurs cercles de tentacules et les lames pierreuses des étoiles correspondent à quelques égards aux lames membraneuses du corps des actinies. L'écorce et les polypes se contractent au moindre attouchement.
Les variétés de leur forme générale et des figures qui ré-
(1) Isis ocracea, Esper., I, IV; — Is. coccinea, id., III, A, 5.
(2) Isis hippuris, L.; Sol. et Ell., Zooph., III; Esp., I, 1; — Isis elongata, Esp., I, VI.
(3) Isis dichotoma, Séb., III, CVI, 4; — Is. encrinula, Lamarck, ou verticillata, Lamouroux, Pol., Flex., XVIII, f. 2, et Ap., ad Sol. et Ell., pl. LXX f. 4.
[page] 313
sultent des combinaisons de leurs lamelles, ont donné lieu à beaucoup de subdivisions, dont plusieurs rentrent cependant les unes dans les autres. On ne pourra les établir définitivement que lorsqu'on connaîtra les rapports des polypes avec ces dispositions.
Quand il n'y a qu'une seule étoile circulaire, ou en ligne alongée, à lames très nombreuses, ce sont les FONGIES, Lam.(1). Leur animal représente vraiment une seule actinie à tentacules grands et nombreux, et dont la bouche répond à la partie enfoncée où aboutissent toutes les lames.
On trouve parmi les fossiles des polypiers pierreux, à une seule étoile, qui paraissent avoir été libres de toute adhérence. Ce sont les TURBINOLIES, Lamarck (2), les CYCLOLITHES (3), et les TURBINOLOPSES, Lamour. (4).
Quand le madrépore est branchu, et qu'il n'y a d'étoiles qu'au bout de chaque branche, c'est une CARYOPHYLLIE, Lam. Les rameaux sont striés. A chaque étoile est une bouche entourée de beaucoup de tentacules (5).
LES OCULINES. Lam.
Ont de petites branches latérales très courtes, ce qui leur
(1) Mad. fungites, L. ou Fungia agariciformis, Lamarck, Sol. et Ell., pl XXVIII, f. 5, 6; — M. patella, ou F. patellaris, Lam., iid., ib., 1, 2, 3, 4; — M. pileus, ou Fung. limacina, Lam., iid. pl. XLV, Séb. III, CXI, 3–5; — F. talpa, Lam., Séb., CXI, 6, CXII, 31.
(2) Madr. turbinata, Lim., An., Ac., I, IV. 1, 2, 3, 7; — Turb. crispa, Lam., Ap., ad Sol. et Ell., pl. LXXIV, f. 14–17; — T. cristata, ib., f. 18–21; — T. compressa. ib., 22, 23.
(3) Mad. porpita, Linn., Am., Ac., I, IV, 5; Cycl. elliptica, Guett., Mém., III, XXI, 17, 18.
(4) Turbinolopsis ocracea, Lamour., ad Sol. et Ell., pl. LXXXII, f. 4–4.
(5) Madr. cyathus, Sol. et Ell., pl. XXVIII, f. 7; — M. calicularis, Gm., Esper., I, pl. XVI; — M. fasciculata, Sol. et Ell., XXX; — M. flexuosa, Sol. et Ell., XXXII, 1; — M. ramea, Sol. et Ell., XXXVIII; — M. fastigiata, iid., XXXIII; — M. angulosa, iid., XXXIV; — M. carduus, iid., XXXV. etc.
[page] 314
donne l'air d'avoir des étoiles le long des branches comme au bout (1).
LES MADRÉPORES proprement dits du même,
Ont toute leur surface hérissée de petites étoiles à bords saillants (2).
Ses POCILLOPORES y ont de petites étoiles enfoncées, et des pores dans les intervalles (3).
Dans les SÉRIALOPORES, les petites étoiles sont rangées par séries linéaires (4).
LES ASTRÉES du même.
Ont une large surface, le plussouvent bombée, creusée d'étoiles serrées, dont chacune a un polype armé de bras nombreux, mais sur une seule rangée au centre de laquelle est la bouche (5).
Quand c'est une surface plane ou en larges lames, semée d'étoiles d'un seul côté, on les nomme EXPLANAIRES (6).
Les PORITES sont en quelque sorte des astrées rameuses (7).
Quand cette surface est creusée de lignes alongées, comme des vallons séparés par des collines sillonnées en travers, ce sont les MÉANDRINES, Lam.
(1) Madr. virginea, L., Sol. et Ell., XXXVI; — M. hirtella, iid., XXXVII; — M. axillaris, iid, XIII, 5; — M. prolifera, iid., XXXII, 2, etc.
(2) Les espèces que Lamarck place dans ce sous-genre, sont regardées par Gmelin, Esper., etc. comme des variétés du Madrepora muricata, Linn., Sol. et Ell., pl. LVII, etc.
(3) Madr. damicornis, Esper., XLVI; — Millepora cærulea, Sol. et Ell., XII, 4.
(4) Madr. seriata, Pall., Sol. et Ell., XXXI, 1, 2.
(5) Madr. radiata, Sol. et Ell., XLVII, 8; — M. annularis, Sol. et Ell., LIII, 1, 2; — M. rotulosa, iid., LV, 1, 3; — M. ananas, iid., XLVII, 6; — M. pleïades, iid., LIII, 7, 8; — M. stellulata, iid., LIII, 3, 4; — M. favosa, iid., L, 1; — M. denticulata, iid, XLIX, 1; — M. abdita, iid., L, 2; — M. siderea, iid., XLIX, 2; — M. galaxea, iid., XLVII, 7.
(6) Madr. cinerascens, Sol. et Ell., XLIII; — M. aspera, iid., XXXIX.
(7) Madr. porites, Sol. et Ell., XLVII; — M. foliosa, iid., LII, etc.
[page] 315
Dans chaque vallon s'ouvrent d'espace en espace des bouches, et les tentacules au lieu de former des rosettes autour deces bouches, forment unerangée le long des côtés de chaque vallon. Quelques espèces n'en ont point du tout, mais le bord de chaque bouche y est seulement festonné (1).
Si les collines qui séparent ces vallons sont élevées en feuilles ou en crêtes sillonnées des deux côtés, ce sont des PAVONIES. Il y a des bouches dans le fond des vallons, et d'ordinaire sans tentacules (2).
Quand ces collines sont élevées en cônes, comme si c'était des étoiles saillantes, M. Fischer les nomme HYDNOPHORES, M. Lam. MONTICULAIRES. On devra les distinguer selon que leurs polypes sontau sommet des parties saillantes, comme dans les oculines, ou dans le fonds des parties concaves, comme dans les méandrines (3).
LES AGARICINES.
Se composent de lames creusées d'un seul côté par des vallons eux-mêmes sillonnés (4).
On croit pouvoir rapprocher des madrépores en général, certains polypiers (les SARCINULES, Lam.), formés de cylindres dont la coupe forme une étoile à cause de lames saillantes qui en parcourent l'intérieur (5). Quand il y a un axe solide au milieu des lames, ce sont les STYLINES. Ces polypiers tiennent peut-être d'aussi près aux tubipores.
(1) Madr. labyrinthica, Sol. et Ell., XLVI, 3, 4; — M. cerebriformis, Séb., III, CXII, 1, 5, 6; — M. dædalea, iid., XLVI, 1; — M. meandrites, iid., XLVIII, 1; — M. areolata, iid., XLVIII, 4, 5; — M. crispa, Séb., III, CVIII, 3–5; — M. gyrosa, Sol. et Ell., L1, 2; — M. phrygia, iid., XLVIII, 2; — M. filograna, Gm, Guall. ind., XCVII.
(2) Madr. agaricites, Sol. et Ell., 43; — Madr. lactuca, iid., XLIV; — M. cristata, iid., XXXI, 3, 4, etc.
(3) Madr. exesa, Sol. et Ell., XLIX, 3; — et les différentes hydnophores de Fischer.
(4) Madr. cucullata, Sol. et Ell., XLII; — M. undata, iid, XL; — M. complicata, iid., XLI, 1, 2.
(5) Madr. organum, Linn., Am. Ac., I, IV, 6.
[page] 316
LES MILLÉPORES. (MILLEPORA. L.)
Ont leur partie pierreuse de formes très diverses, et sa surface creusée seulement de petits trous ou pores, ou même sans trous apparents.
M. Lamarck distingue
LES DISTICHOPORES.
Où des pores plus marqués sont rangés des deux côtés des branches (1).
Parmi ceux où les pores sont également répartis, on distingue
LES MILLÉPORES propres. (MILLEPORA. Lam.)
Solides, diversement branchus (2).
Quand leurs pores ne sont pas apparents, comme il arrive quelquefois, on les nomme NULLIPORES (3).
LES ESCHARES. (ESCHARA. Lam.)
Qui ont des expansions aplaties en feuilles (4).
LES RÉTÉPORES. (RETEPORA. id.)
Qui sont des eschares percées de mailles (5).
(1) Millepora violacea, Pall., Sol. et Ell., pl. XXVI, f. 3, 4, copié Encycl. méth., vers, pl. 481, f. 1.
(2) Mill. alcicornis, Pall., Esper., 1, V, 7, et sup., I, XXVI; — Mill. aspera, Lam., Esper., sup., I, XVIII; — M. truncata, Sol. et Ell., pl. XXIII, f. 1–8.
(3) Millepora informis, Ell., Corall., pl. XXVII, f, C; — M. calcarea, Sol. et Ell., pl. XXIII, f. 13; — M. cretacea, iid., ib., 9; — M alga, iid., ib., 10, 11, 12.
(4) Millepora foliacea, Ell., Corall., pl. XXX, f, a; — Esc. lichenoïdes, Séb., III, C, 10; — Esc. lobata, Lamour., ad Sol. et Ell., pl. LXXII, f. 9–12.
(5) Millepora cellulosa, vulgairement manchette de Neptune, Ell., Corall., pl. xxv, f, d. Daubent.; pl. enl., n° 23; — M. reticulata, Marsill. Hist. mar., pl. XXXIV, f. 165, 166.
[page] 317
LES ADÉONES. (ADEONA. Lamouroux.)
Qui sont des escharres portées sur une tige articulée; il y en a d'entières et de percées de mailles (1).
Troisième tribu,
LES POLYPIERS NAGEURS,
Dont l'axe est pierreux, mais non fixé.
LES PENNATULES. (PENNATULA. L.)
Ont le corps commun, libre de toute adhérence (2), de forme régulière et constante, et pouvant se mouvoir par les contractions de sa partie charnue, et aussi par l'action combinée de ses polypes. Ce corps est charnu, susceptible de se contracter ou de se dilater dans ses diverses parties, au moyen de couches fibreuses qui entrent dans sa composition; son axe renferme une tige pierreuse simple; les polypes ont généralement huit bras dentelés.
La plupart des espèces répandent une vive lueur phosphorique.
Quelle que soit la forme générale des pennatules, elles ont toujours une de leurs extrémités sans polypes; c'est ce que l'on a comparé à la partie tubuleuse des plumes d'oiseaux.
(1) Ad. grisea, Lamouroux, Sol. et Ell., pl. LXX, f. 5; — Ad. follicolina, id.
Sur ces genres ainsi que sur plusieurs autres établis d'après des considérations assez peu importantes, consultez l'exposition méthod des genres des polypiers avec les planches de Solander et Ellis, par Lamouroux. Paris 1821.
(2) Quelques espèces s'enfoncent dans le sable ou s'embarrassent dans les replis de divers corps marins, mais ne contractent point d'adhérence constante.
[page] 318
LES PENNATULES proprement dites. (PENNATULA, Cuv.) Vulgairement Plumes de mer.
Qui ont donné leur nom à tout le genre, l'ont tiré ellesmêmes de leur ressemblance avec une plume. La partie sans polypes, est cylindrique et terminée en pointe mousse. L'autre partie est garnie de chaque côté d'ailes ou de barbes plus ou moins longues et larges, soutenues par des épines ou soies roides qui naissent de leur intérieur, et hérissent un de leurs bords sans s'articuler toutefois avec la tige pierreuse de l'axe; c'est d'entre ces barbes que sortent les polypes.
L'Océan et la Méditerranée produisent également
La Pennatule rouge (Pennat. rubra, et Penn. phosphorea, Gm. (1), Albinus, Annot. acad., I, VI, 3, 4,
Qui a la tige entre les barbes très rude par derrière, excepté sur une ligne qui parcourt sa longueur.
On trouve plus particulièrement dans la Méditerranée
La Pennatule grise (Pennat.grisea, Gm.), Albinus, Annot. acad., I, VI, 1–2,
Plus grande, à barbes plus larges, plus épineuses, à tige lisse (2).
LES VIRGULAIRES. Lam.
Ne diffèrent des pennatules que parce que leurs ailes, beaucoup plus courtes à proportion de leur longueur totale, sont dépourvues d'épines (3).
Ces ailes ne représentent quelquefois que de simples rangées transversales de tubercules (4).
(1) L'une et l'autre sont rouges. Le P. rubra ne diffère que par une petite épine à la base de chaque barbe en arrière. Ce n'est peut-être qu'une variété.
(2) Aj. Pennatula argentea, Soland. et Ellis, Zooph., VIII, 1, 2, 3; — P. grandis.
(3) Pennatula mirabilis. Müll., Zool. dan., XI, très différente du vrai Pennat. mirabilis de Linn.
(4) Pennat. juncea, Pall. et Gm. Elle est aussi très différente du Pen. mirabilis. La Virgulaire australe, Lam., n'est point différente du Juncea.
[page] 319
LES SCIRPÉAIRES. Cuv.
Ont le corps très long et très grêle, et les polypes isolés, rangés alternativement le long des deux côtés (1).
LES PAVONAIRES. Cuv.
Ont aussi le corps alongé et grêle, mais ne portent de polypes que d'un seul côté, et ils y sont serrés en quinconce (2).
LES RENILLES (RENILLA. Lam.)
Ont le corps court, et au lieu de la partie qui dans les pennatules propres est garnie de barbes, un large disque en forme de rein, portant les polypes sur l'une de ses faces (3).
LES VÉRÉTILLES. (VERETILLUM. Cuv.)
Ont un corps cylindrique, simple et sans branches, garni de polypes dans une partie de sa longneur. Leur os est d'ordinaire petit, et les polypes grands. On y suit plus aisément que dans aucun autre zoophyte composé, les prolongements de leurs intestin dans la tige commune.
Nous en avons un dans la Méditerranée (pennatula cynomorium, Pall., Miscell., Zool., XIII; 1–4; alcyonium epipetrum, Gmel.; Rap., ac. nat. cur. XIV, p. 2, XXXVIII, 1.), long souvent de plus d'un pied, plus gros que le pouce, remarquable par l'éclat de la lumière qu'il répand (4). Enfin
LES OMBELLULAIRES. Cuv.
Ont une très longue tige, soutenue par un os de même
(1) Pennatula mirabilis, L. Mus., Ad. Fred., XIX, 4.
(2) Pennat. antennina, Bohatsch., IX, 4, 5; — Penn. scirpea, Pall. et Gmel.
(3) Pennat. reniformis, Ellis, Trans. Phil., LIII, XIX, 6–10, ou Alcyonium agaricum, Gm.
(4) Aj. Pennat. phalloïdes, Pall., Misc. Zool., XIII, 5–9; — Pennat. stellifera, Müll, Zool. dan., XXXVI, 1–3.
[page] 320
longueur, et terminée au sommet seulement par un bouquet de polypes (1).
On trouve dans la mer et parmi les fossiles de petits corps pierreux percés de pores, que l'on a cru pouvoir rapprocher des millépores. S'ils étaient en effet enveloppés d'une écorce contenant des polypes, ce seraient des polypiers mobiles, et il faudrait plutôt les rapprocher des pennatules. Tels sont
Les OVULITES, Lam., en forme d'œufs, creux intérieurement, souvent percés aux deux bouts; les LUNULITES, orbiculaires, convexes, striés et poreux d'un côté, concaves de l'autre; les ORBULITES, orbiculaires, plats ou concaves, poreux des deux côtés ou aux bords. Si le DACTYLOPORE est libre, comme le pense M. de Lamarck, il appartiendrait aussi à cette subdivision; c'est un ovoïde creux, ouvert aux deux bouts, à deux enveloppes, l'une et l'autre percées de mailles, comme les rétépores (2).
Quatrième tribu, l'écorce animale ne renferme qu'une substance charnue, sans axe ni osseux ni corné.
LES ALCYONS. (ALCYONIUM. L.)
Ont, comme les pennatules, des polypes à huit bras dentelés, des intestins se prolongeant dans la masse com-
(1) Pennatula encrinus, Ellis, Corall., XXXVII, a, b, c.
N. B. Pennatula filosa, et Pennatula sagittata, sont des animaux parasites, du genres des lernées (les PENNELLES, Oken); mais nullement des pennatules. Le Penn. sagitta, Esper, Pennat., pl. v, est tout autre chose que celui de Linn.; peut-être est-ce un NEPTHYS.
(2) Le Rétéporite, Bosc., Journ. Phys., juin 1806. Voyez aussi sur ces genres de petits millépores libres, l'ouvrage de Lamouroux que nous venons de citer.
[page] 321
mune des ovaires; mais cette masse n'est point soutenue par un axe osseux; elle est toujours fixée au corps, et quand elle s'élève en troncs ou en branches, on ne trouve dans son intérieur qu'une substance gélatineuse, parcourue de beaucoup de canaux entourés de membranes fibreuses. L'écorce est plus dure et creusée de cellules où les polypes se retirent plus ou moins complétement.
Nous avons en abondance dans nos mers,
L'Alcyon, main de mer (Alc. digitatum), Ell. Corall. XXXII.
Qui se divise en grosses branches courtes; l'Alc. exos, qui a des branches plus grêles, d'un beau rouge, etc.
Linnæus et ses successeurs ont réuni un peu légèrement aux alcyons, divers corps marins de tissus variés, mais toujours sans polypes visibles. Tels sont
LES THÉTHYES. (THETHYA. Lam.)
Dont l'intérieur est tout hérissé de longues spirales siliceuses qui se réunissent sur un noyau central également siliceux. Leur croûte présente comme dans les éponges deux ordres de trous; les uns, fermés par une sorte de treillage, seraient à l'entrée de l'eau, les autres, béants, sont destinés à sa sortie (1).
On place encore à la suite des alcyons,
LES ÉPONGES. (SPONGIA. L. (2)
Corps marins fibreux, qui ne paraissent avoir de sen-
(1) Voyez MM. Audouin et M. Edwards (Ann. des Sc. nat., tome XV, p. 17).
N. B. Une grande partie des Alcyons de Lam., appartiennent réellement à ses théthyes.
Aj. les genres fossiles que M. Lamouroux croit pouvoir rapprocher des Alcyons ou des Tethyes: ses HALLIROES et ceux dont il compose son ordre des ACTINAIRES; ses CHENONDOPORES, ses HIPPALINES, ses LIMNORIES, ses SÉRÉES, etc.; toutes productions dont la nature est plus ou moins problématique.
(2) Le genre des éponges est très riche en espèces curieuses, et mérite d'être étudié. M. de Lamarck (an. sans vert, II, 345 et suivants), sera un excellent guide à cet égard. Consultez aussi le Mémoire important de M. Grant; Ann. des Sc. nat., tome XI, pl. XXI.
TOME III. 21
[page] 322
sible qu'une sorte de gélatine ténue, laquelle se dessèche et ne laisse presque aucune trace, et où l'on n'a pu encore observer de polypes ni d'autres parties mobiles. On a dit que les éponges vivantes éprouvent une sorte de frémissement ou de contraction quand on les touche; que les pores dont leur superficie est percée palpitent en quelque sorte; mais ces mouvements sont contestês par M. Grant (1).
Les éponges prennent des formes innombrables, chacune selon son espèce, comme d'arbustes, de cornets, de vases, de tubes, de globes, d'éventails.
Tout le monde connaît l'Éponge usuelle (Spongia officinalis), qui est en grandes masses brunes formées de fibres très fines, flexibles, élastiques, et percées d'un grand nombre de pores et de petits conduits irréguliers donnant les uns dans les autres.
CINQUIÈME ET DERNIÈRE CLASSE DES ZOOPHYTES ET DE TOUT LE RÈGNE ANIMAL.
LES INFUSOIRES.
On a coutume de placer à la fin du règne animal, des êtres si petits, qu'ils échappent à la vue simple, et n'ont pu être distingués que depuis que le microscope nous a dévoilé en quelque sorte un nouveau monde. La plupart présentent un corps gélatineux, de la plus extrême simplicité, et ceux-là
(1) MM. Audouin et Edwards adoptent l'opinion de M. Grant, Ann. des Sc. nat., XI, pl. XVI.
[page] 323
doivent en effet trouver ici leur place; mais on a aussi laissé parmi les infusoires des animaux beaucoup plus compliqués en apparence, et qui ne leur ressemblent que par leur petitesse et le séjour où on les trouve d'ordinaire.
Nous en ferons un premier ordre, en insistant toutefois sur les doutes qui subsistent encore relativement à leur organisation (1).
L'ORDRE PREMIER DES INFUSOIRES.
LES ROTIFÈRES.
Se distinguent, comme nous venons de le dire, par une plus grande complication. Leur corps est ovale et gélatineux; on y distingue une bouche, un estomac, un intestin, et un anus près de la bouche. En arrière il se termine le plussouvent par une queue diversement construite; et en avant il porte un organe singulier, diversement lobé, à bords dentelés, et dont les dentelures exécutent une vibration successive qui ferait croire que cet organe consiste en une ou plusieurs roues dentées et tournantes. Une ou deux proéminences sur le cou ont même paru
(1) N. B. La nature de mon ouvrage n'exigeant point que j'entre dans le détail infini de ces infiniment petits, et n'ayant point à leur égard d'observations qui me soient propres, je ne puis que renvoyer à l'ouvrage de M. Bory de Saint-Vincent, intitulé: Essai d'une classification des animaux microscopiques, extrait du tome II, Zoophytes de l'Encyclopédie méthodique. Paris 1826. Ces petits êtres y sont divisés en quatre-vingideux genres.
21*
[page] 324
porter des yeux à quelques observateurs. Cet organe tournant ne sert pas à conduire les aliments vers la bouche; on pourrait soupçonner qu'il a quelques rapports avec la respiration (1).
LES FURCULAIRES. (FURCULARIA. Lam.) Vulgairement ROTIFÈRES proprement dits.
Ont le corps sans armure; la queue composée d'articulations qui rentrent les unes dans les autres et terminée par deux filets.
C'est sur l'une d'elles (la Furculaire ou le Rotifère des toits), que Spallanzani a fait ses fameuses expériences de résurrection. Couverte de poussière dans les gouttières, elle se dessèche de manière à reprendre après plusieurs semaines la vie et le mouvement si on l'humecte d'un peu d'eau.
LES TRICHOCERQUES, Lam. ne me paraissent différer des furculaires que par un peu moins de développement de leurs organes vibratiles (2).
LES VAGINICOLES, Lam.
Paraissent des trichocerques enveloppées d'un étui transparent; mais il y a lieu de craindre quelque illusion d'optique (3).
LES TUBICOLAIRES. (TUBICOLARIA. Lam.)
Ne différent des furculaires que parce qu'elles se tiennent dans de petits tubes, qu'elles construisent avec des molécules étrangères, mais qui ne font point partie de leur corps, comme ceux des polypiers. Leur
(1) Voyez, sur l'organisation de ces animaux, le mémoire de M. Dutrochet, Ann. du Mus., XIX, p. 355.
(2) Trichoda paxillum, Müll., XXIX, 9–12; Encycl., XV, 19–20; — Trich. longicauda, Müll., XXXI, 8–10.
(3) Trich. innata; — Tr. ingenita; — Tr. inquilina, Müll.
[page] 325
organe rotatoire se montre cependant hors du tube à peu près à la manière de la tête des polypes.
Nous en avons une assez commune sur les conferves de nos mares (Vorticella tetrapetala, Blumenb). Dutrochet, Ann., Mus., XIX, XVIII, 1–10, dont l'organe rotatoire est divisé en quatre lobes.
LES BRACHIONS. (BRACHIONUS. Müll.)
Avec des organes rotatoires et une queue à peu près semblables à ceux des furculaires, portent une espèce de bouclier membraneux ou écailleux qui leur couvre le dos, comme celui de certains monocles.
DEUXIÈME ORDRE.
LES INFUSOIRES HOMOGÈNES.
Dont le corps ne montre point de viscères ni d'autres complications, et ne présente souvent pas même une apparence de bouche.
La première tribu,
Comprend ceux qui, avec un corps gélatineux, plus ou moins contractile dans ses diverses parties, offrent encore pour organes extérieurs des cils plus ou moins forts.
On les nomme URCÉOLAIRES, Lam., quand ils ont la forme d'un cornet, d'où sortent les cils comme dans les polypes appelés vorticelles; TRICHODES, quand avec un corps plat ces cils sont à une extrémité; LEUCOPHRES, quand ils entourent tout le corps; KÉRONES, quand il y en a quelques-uns de gros et représentant des espèces de cornes; HIMANTOPES, quand ces prétendues cornes s'alongent en espèces de filets.
[page] 326
La deuxième tribu,
Offre ceux qui n'ont point d'organes extérieurs visibles, si ce n'est tout au plus une queue.
LES CERCAIRES. (CERCARIA. Müll.)
Ont leur corps ovale en effet terminé par un filet. A ce genre appartiennent entre autres les animalcules qui se montrent dans le sperme de divers animaux, et sur lesquels on a fondé tant d'hypothèses bizarres.
Quand ce filet est fourchu, comme il arrive quelquefois, M. Delamarck nomme ces animaux FURCOCERQUES.
LES VIBRIONS. (VIBRIO. Müll.)
Ont le corps grêle et rond comme un petit bout de til.
C'est à ce genre qu'appartiennent
Les prétendues Anguilles de la colle et du vinaigre. (Vib. glutinis et aceti.) Ces dernières se distinguent souvent à l'œil nu. On prétend qu'elles changent de peau, qu'elles ont des sexes, font des petits vivants en été, et des œufs en automne. La gelée ne les fait point périr. Les premiers paraissent dans la colle de farine délayée.
LES ENCHELIDES. (ENCHELIS. Müll.)
Ont le corps oblong, plus mou, moins déterminé que les vibrions.
Les CYCLIDES (CYCLIDIUM) l'ont plat et ovale; les PARAMÈCES, plat et oblong; les KOLPODES, plat et sinueux; les GONES, plat et anguleux; les BURSAIRES, creux comme un sac.
Les plus singuliers de tous sont
LES PROTÉES. (PROTEUS. L.)
On ne peut leur assigner de forme déterminée; leur
[page] 327
figure change à chaque instant, et prend successivement toute sorte de circonscriptions, tantôt arrondi et ramassé, tantôt divisé et subdivisé en lanières de la ma nière la plus bizarre (1).
LES MONADES. (MONAS. Müll.)
Ressemblent, au microscope, à de petits points qui se meuvent avec beaucoup de vitesse, quoique sans aucun organe apparent de mouvement.
LES VOLVOCES. (VOLVOX.)
Ont un corps globuleux et tournant sur lui-même, renfermant souvent des globules plus petits qui doivent sans doute en propager la race.
(1) Proteus diffluens, Rœs., III, CI; Encycl., I, 1, a-m; — Prottenax, Müll., Inf., II, 13–18; Encycl., I, 2, a-f.
Voyez au reste sur tous ces animaux, l'ouvrage posthume d'Othon-Frédéric Müller, intitulé Animalcula infusoria, dont les planches ont été copiées dans l'Encyclopédie méthodique. Consultez aussi le IIIe tome de Rœsel, et, pour la classification, l'ouvrage cité de M. Bory de Saint-Vincent.
FIN DU TOME TROISIÈME.
[page 328]
[page 329]
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES AUTEURS CITÉS DANS CET OUVRAGE.
EN expliquant les abréviations dont on s'est servi pour indiquer les nombreux auteurs que l'on a été obligé de citer, on a cru utile de donner quelques notions sur leur état, l'époque de leur naissance et de leur mort, et le caractère de leurs écrits.
A.
ABILD. — ABILDGAARDT (Pierre-Chrétien), naturaliste danois, professeur à Copenhague, mort en 1808.
L'un des continuateurs du Zoologia danica de Müller, et auteur de divers mémoires parmi ceux de la Société d'Histoire naturelle et de la Société royale des Sciences de Copenhague, ainsi que de la Société des Naturalistes de Berlin.
ACAD. DES SC.
Je cite ainsi les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris, dont il a paru un volume in-4° pour chaque année, depuis 1700 jusqu'à 1790.
J'ai cité aussi quelquefois les Mémoires des Savants étrangers à l'Académie, 11 vol. de 1750—1786.
J'ai cité souvent aussi les Mémoires de l'Académie de Berlin depuis 1819, et les nouveaux Mémoires des Curieux de la Nature (Academia naturœ curiosorum) de Bonn, à compter du tome IX, 1818, où ils ont pris leur nouvelle forme.
Pour ceux de l'Académie de Pétersbourg, voyez cidessous Peterob., ou Petrop.
TOME III. 22
[page] 330
ALB. ou ALBIN. — ALBIN (Eleazar), peintre anglais.
Histoire naturelle des Oiseaux, 3 vol. in-4°. Londres, 1731–38, contenant 306 figures enluminées médiocres.
L'Histoire naturelle des Araignées, en Anglais (a natural History of Spiders), 1 vol. in-4°. avec figures. Londres, 1736.
ACOSTA, ou plutôt MENDEZ DA COSTA (Emmanuel), naturaliste portugais, établi à Londres.
Historia naturalis Testaceorum Britanniæ, 1 vol. in-4°. Londres, 1778
ADANSON (Michel), né à Aix en 1727, mort à Paris en 1806, membre de l'Académie de Sciences, l'un des premiers qui aient essayé de classer les coquilles d'après leurs animaux.
Histoire naturelle des Coquillages du Sénégal, 1775, 1 vol. in-4°.
AGASSIS, naturaliste allemand.
Éditeur des Poissons de Spix et auteur de mémoires dans l'Isis.
AHR. — AHRENS.
Augusti Ahrensii fauna insectorum Europæ, fasc. 1–12.
ALBINUS (Bernard-Sigefroy), professeur à Leyde, l'un des grands anatomistes du dix-huitième siècle, né à Francfort en 1697, mort en 1770.
Nous n'avons eu occasion de le citer quer pour la description des pennatules, insérée dans les Annotationes Academicæ. 8 cahiers in-4°. Leyde, 1754–1768.
ALDROV. ou ALDR. — ALDROVANDI (Ulysse), noble bolonais, professeur à l'université de Bologne, né en 1525, mort aveugle en 1605.
Son Histoire naturelle en 14 vol. in-fol. de 1599 — 1640, dont 11 sur les animaux, a été en grande partie publiée par ses successeurs. Il n'a paru de son vivant que
[page] 331
les 3 vol. d'Ornithologie et le premier des Insectes. C'est une compilation indigeste et pénible à consulter.
AMOR. — AMOREUX (N.), médecin de Montpellier.
Notice des Insectes de la France réputés venimeux, 1 vol. in-fol., avec fig. Paris, 1786.
Description méthodique d'une espèce de Scorpion, commune à Souvignargues, en Languedoc. Journal de Physique, tom. 35.
ANDERS. — ANDERSON (Jean), négociant et bourguemestre d'Hambourg, né en 1674, mort en 1743.
Histoire naturelle de l'Islande, du Groëland, etc. 2 vol. in-8°. Paris, 1750.
Cet ouvrage, quoique ancien et superficiel, est encore la principale source, relativement aux Cétacés.
ANDREÆ (Jean-Gérard-Reinhard), apothicaire à Hanovre, né en 1724, mort en 1793;
A donné (en allemand): Lettres écrites de la Suisse à Hanovre, dans l'année 1763. Imprimées d'abord séparément dans le Magasin d'Hanovre de 1764 et 65, réimprimées en 1 vol. in-4°. Zurich, 1776.
ANN. MUS. — Annales du Muséum d'histoire naturelle de Paris, par les Professeurs de cet établissement; 20 vol. in-4°., de 1802 à 1813.
Ce recueil est continué sous le titre de:
Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle, etc. Paris, 1815 et suiv. Il y en a maintenant 18 volumes.
ARGENV. — ARGENVILLE (Antoine-Joseph DES-ALLIERS D'), maître des Comptes à Paris, né en 1680, mort en 1765.
L'Histoire naturelle éclaircie dans une de ses principales parties, la CONCHYLIOLOGIE, in-4°. première édit. Paris, 1742; deuxième, augmentée de la Zoomorphose, ib. 1757; troisième, augmentée par MM. Favanne, 2 vol. ib. 1780.
23*
[page] 332
ARTEDI (Pierre), naturaliste suédois, ami de Linnæus, né en 1705, noyé à Amsterdam en 1735.
Son ouvrage sur les poissons a été publié par Linnæus. P. ARTEDI Ichtyologia sive Opera omnia de Piscibus. 1 vol. in-8°. Leyde, 1738.
L'édition de Walbaum, Artedius renovatus, en 5 vol. in-8°. Gripswald, 1788–89, est fort augmentée, mais par nn compilateur sans jugement.
ASCAN. — ASCANIUS (Pierre), professeur à Copenhagúe.
A donné cinq cahiers in-fol., dont le premier, transverse, de figures enluminées d'histoire naturelle du Nord, de 1767 à 1779.
AUDEB. — AUDEBERT (Jean-Baptiste), peintre à Paris, né à Rochefort en 1759, mort en 1800.
Histoire naturelle des Singes et des Makis. Paris, 1800, in-fol. avec 62 planches dessinées d'après les individus empaillés du Muséum.
Oiseaux dorés ou à reflets métalliques. Paris, 1802, 2 vol. in-fol.
AUD. — AUDOUIN (Jean-Victor), docteur en médecine, sous-bibliothécaire de l'Institut, aide naturaliste, suppléant de MM. Lamarck et Latreille, au Jardin du Roi, membre de plusieurs sociétés, né à Paris, le 27 avril 1797.
Anatomie d'une larve apode (Conops) trouvée dans le bourdon des pierres, par MM. Lachat et Audouin, 1818.
Mémoire sur les rapports des trilobites avec les animaux articulés. (Ann. générales des Sc. phys., tom. 8, p. 233, avec fig.).
Mémoires sur l'Achlysie, nouveau genre d'Arachnide. (Mém. Soc. d'hist. naturelle, tom. 1, p. 98, av. fig.,
Et note sur une nouvelle esp. d'Achlysie. (Ann. des Sc. nat., tom. 2, p. 497).
Lettres sur la génération des insectes, adressée à l'Acad. des Sciences. (Ann. Sc. natur., tom. 2, p. 281).
[page] 333
Recherches Anatomiques, sur la famille du Drele et sur le mâle de cette espèce. (Ann. Sc. natur., tom. 2, p. 443, fig.).
Recherches Anatomiques pour servir à l'histoire naturelle des Cantharides. (Ann. Sc. natur., t. 9, p. 31, fig.).
Prodrome d'une hist. nat. chimique, etc., des Cantharides, thèse pour le doctorat, in-4°. Paris.
Mémoire sur la Nicothoé, genre nouveau de crustacé qui suce le sang du homard. MM. Aud et Milne Edwards. (Ann. Sc. natur., tom. 9, p. 345.)
Divers mémoires sur l'anatomie et la physiologie des crustacés, insérés dans les Ann. des Sc. naturel.
Explication sommaire des planches du grand ouvrage d'Égypte, relatives aux animaux sans vertèbres, et dont la publication avait été interrompue par la maladie de M. Savigny. On doit aussi à M. Audouin la description des mammifères faite conjointement avec M. Geoffroy-St.-Hilaire.
Observations pour servir à l'histoire de la formation des perles (insérées dans les Mém. du Mus. d'hist. natur. en 1829).
Mémoires sur plusieurs mollusques, entre autres sur la glycimère, sur une clavagelle vivante, genre siliquaire, sur le genre magile, présenté à l'Acad. des sciences eu 1829, et insérées par extrait dans la revue des Ann. des Sc. natur.
Avec MILNE EDWARDS.
Résumé d'Entomologie ou d'Histoire naturelle des animaux articulés, 2 vol. in-18, Paris, 1829.
Histoire naturelle des animaux du littoral de la France, encore manuscrite.
D'AZ. ou AZZ. — DE AZZARA (don Félix), officier espagnol, né en 1746;
Nous a donné deux excellents ouvrages sur l'histoire naturelle du Paraguay:
Essai sur l'Histoire naturelle des Quadrupèdes du Paraguay; traduit sur le manuscrit par M. Moreau de Saint-Méry, 2 vol. in-8°. Paris, 1801; et
[page] 334
Voyages dans l'Amérique méridionale, de 1781 jusqu'en 1801; traduits par M. Walkenaer, 4 vol. in-8°. Paris, 1809. Les deux derniers volumes, traduits par M. Sonnini, contiennent l'histoire des oiseaux du Paraguay.
B.
BAJON, ancien chirurgien-major à Cayenne.
Mémoires pour servir à l'histoire de Cayenne, etc. 2 vol. in-8°, Paris, 1777. Il y a quelques détails sur des animaux de ce pays.
BARRÈRE (Pierre), professeur à Perpignan, mort en 1755.
Essai sur l'Histoire naturelle de la France équinoxiale, 1 vol. in-12. Paris, 1741.
Ornithologiœ specimen novum, 1 vol. in-4°. Perpignan, 1745.
BARTON (Benjamin-Smith), naturaliste américain, professeur à Philadelphie, mort en 1816.
Mémoire concernant la faculté de fasciner attribuée au serpent à sonnette (en anglais). Philadelphie, 1796, 1 vol. in-8°.
Faits, Observations et Conjecture sur la génération de l'opossum (en anglais). Philadelphie, 1801, broch. in-8.
Notice sur la Sirène lacertine et une autre espèce du même genre (en anglais). Philadelphie, 1808, brochure in-8°.
Mémoire sur un reptile nommé aux États-Unis Alligator, ou Hellbender (en anglais). Philadelphie, 1812, brochure in-8°. C'est la salamandre gigantesque.
BARTRAM (William).
Voyage dans les parties sud de l'Amérique Septentrionale, traduit en français par M. Benoits. Paris, 1779, 2 vol. in-8°.
BAUD. — BAUDET DE LA FACE (Marie-Jean).
Essai sur l'Entomologie du département du Puy-de-
[page] 335
Dôme. Monographie des lamelli-antennes. Clermont, 1809, 1 vol. in-8°.
BAST. — BASTER (Job), médecin de Harlem, de la Société royale de Londres, né en 1711, mort en 1775.
Opuscula subseciva, 1 vol. in-4°. divisé en deux tomes, fig. Harlem, 1764 et 1765.
BEAUV. — BEAUVOIS (Palisot de). Voyez Palisot.
BECHST. ou BECH. — BECHSTEIN (J. M.), naturaliste saxon, né en 1757.
Histoire naturelle usuelle de l'Allemagne (en allemand). Leipz. 1801–1809, 4 vol. in-8°. ne comprenant que les quadrupèdes et les oiseaux.
BELL (Th.)
Auteur de mémoires sur les reptiles, dans les trans. lin. le Zool. journ. etc.
BEL. — BELON (Pierre), médecin du Mans, né en 1517, mort en 1564, professeur au Collége de France.
Observations faites dans ses voyages en Orient, 1 vol. in-4°. 1553.
Histoire des Poissons, 1 vol. in-8°. Transv. 1551.
Histoire naturelle des étranges Poissons marins, et Description du Dauphin, etc. 1 vol. in-4°. 1551.
Histoire naturelle des Oiseaux, 1 vol. in-fol. 1551.
BENNET (E. T.) naturaliste anglais.
Auteur de Mémoires dans le Journal zoologique.
BENNETT (J. Whitchurch), naturaliste anglais.
Auteur d'une hist. nat. des Poissons de Ceylan, dont nous n'avons encore que 2 cahiers in-4°. Les pl. en sont très-belles.
BERGIUS (Pierre-Jonas), naturaliste suédois, professeur à Stockolm; mort en 1790.
Est cité pour quelques Mémoires parmi ceux de Stockholm.
[page] 336
BESEKE (Jean-Melchior-Théophile), professeur en droit à Mittau en Courlande, né en 1746.
Auteur de Matériaux pour l'Histoire des Oiseaux de Courlande (en allemand). Mittau et Leipz. 1792, in-8°.
BEUDANT (F.-S.), naturaliste et physicien, membre de l'Académie des sciences.
Cité pour ses Mémoires sur les Coquilles, dans les Annales du Muséum.
BESLER, ou MUS. BESLER. — BESLER (Michel-Robert), médecin de Nuremberg, né en 1607, mort en 1661.
Rariora Musei Besleriani. In-fol. 1716.
BLAINVILLE (Henri DUCROTAY DE), professeur adjoint à la Faculté des Sciences, membre de l'Académie des sciences.
Je cite de lui plusieurs Mémoires sur toutes les parties de la Zoologie, insérés dans les Annales du Muséum, le Bulletin des Sciences, le Journal de Physique, et ses articles sur les Mollusques, et sur les Vers, qui ont paru dans le Dictionnaire des Sciences naturelles. Le premier est imprimé à part, sous le titre de MALACOLOGIE. Paris et Strasb. in-8°. 1828. Avec un vol. de planche.
Mémoire sur les Bélemnites. Paris 1827, in-4°.
Essai d'une Monographie de la famille des Hirudinées. Paris 1827, in-8°.
BL. ou BLOCH. — BLOCH (Marc-Elieser), médecin juif à Berlin, né à Anspach en 1723, mort en 1799.
Son Ichthyologie, ou Histoire naturelle générale et particulière des Poissons, en 12 parties, in-fol. avec 432 pl., Berlin, 1785 à 1796, est loin d'être générale. Elle ne contient que les espèces qu'il avait pu se procurer, les étrangères sont presque toutes mal coloriées.
Son Systema Ichthyologiæ (voyez SCHNEIDER) réunit aussi les espèces des autres auteurs, mais sous une méthode bizarre.
Il a donné encore (en allemand): Traité sur la génération des Vers intestins. Berlin, 1782, in-4°.
[page] 337
BLUM. ou BLUMENB. — BLUMENBACH (Jean-Fréd.), professeur de médecine et d'histoire naturelle à Gottingen,
Je cite surtout son Manuel d'Histoire naturelle, dont la 8e. édition, en allemand, est de Gottingue, 1807, 1 vol. in-8°. (Il y en a une trad. franç. par M. Artaud, Metz, 1 vol. in-8°.) 1803; et ses
Figures d'Hist. nat. (Abbildungen), 10 cahiers in-8°. de 18 planches chacun. Gott. 1796–1810.
BOCCONE (Paul), moine bernardin, de Sicile, né en 1633, mort en 1704.
Nous citons ses Recherches et Observations naturelles, etc., Paris, 1671, 1 vol. in-12.
BODD. — BODDAERT (Pierre), médecin et officier municipal de Flessingue en Zéelande.
Elenchus animalium, vol. I, sistens quadrupedia. Roterdam, 1785, in-8°. La suite n'a point paru.
On a aussi de lui quatre Lettres sur autant d'animaux du cabinet de Schlosser, à la suite de celle de Schlosser même sur le lacerta amboïnensis.
BOHATSCH (Jean-Baptiste), professeur à Prague, mort en 1772.
De quibusdam Animalibus marinis; etc. 1 vol. in-4°. Dresde, 1761.
Cet ouvrage contient de bounes observations sur quelques Mollusques et Zoophytes.
BOIÉ, jeune naturaliste de Kiel, mort dans un voyage d'histoire naturelle, à Java.
Il avait préparé de grands travaux sur les reptiles.
BOJANUS (Louis-Henri), naturaliste allemand, professeur à Vilna, mort en 1828.
Auteur d'une excellente Mononographie de la tortue d'eau douce d'Europe. Vilna 1819, in-fol. et de plusieurs mémoires dans l'Isis.
[page] 338
BOISD. — BOISDUVAL (J.-A.), médecin, conservateur du cabinet de M. le comte Dejean.
Essai sur une Monographie des zygénides, 1 vol. in 8°. avec planches. Paris 1829.
Europæorum lepidopterorum index methodicus, joint au même ouvrage.
Il vient de publier les premiers cahiers d'un ouvrage sur les Lépidoptères de l'Amérique Septentrionale, et conjointement avec M. le comte Dejean, les trois premiers fascicules d'un autre, ayant pour titre: Iconographie et Histoire naturelle des Coléoptères d'Europe. 1827, in-8°.
La description (Annales de la Société linnéenne de Paris) de quelques nouvelles espèces de lépidoptères.
BOMMÉ (Léonard), médecin zélandais;
Auteur de quelques Mémoires insérés parmi ceux de la Société des Sciences de Flessingue.
BONANN. ou BON. — BONANNI, ou plutôt BUONANNI (Philippe), jésuite, professeur au Collège romain, né en 1638, mort en 1725.
Observateur assidu; nous ne citons que son ouvrage intitulé: Recreatio mentis et oculi in observatione animalium testaceorum, 1 vol. petit in-4°. Rome, 1684.
CH. BONAP. — CHARLES-LUCIEN BONAPARTE, prince de Musignano, fils du prince de Canino.
Auteur d'un excellent supplément à l'ornithologie américaine de Wilson, et de plusieurs mémoires dans les annales du lycée de New-Yorck.
BONNAT. — BONNATERRE (l'abbé), professeur d'histoire naturelle à Tulle.
Il a dirigé la gravure des planches de l'Encyclopédie méthodique, pour les animaux vertébrés, et donné un texte pour celles des Reptiles et des Poissons.
Ses figures sont généralement copiées d'autres auteurs, et pas toujours avec choix.
BONEL. — BONELLI (François), directeur du cabinet
[page] 339
d'histoire naturelle, et professeur de zoologie à Turin.
Catalogue des Oiseaux du Piémont, br. in-4°. de 1811.
Observations Entomologiques, en deux parties, imprimées dans les mémoires de l'Académie des Sciences de Turin. Elles ont pour objet le genre Carabus de Linæus, ou la tribu des carabiques.
Plusieurs autres mémoires dans ceux de l'Ac. de Turin, parmi lesquels on peut citer plus particulièrement: descrizione di sei nuovi insetti lepidopteri della Sardegna. dans le XXX vol. des dits mémoires.
BONNET (Charles), célèbre philosophe et naturaliste de Genève, né en 1720, mort en 1793.
Nous ne citons de lui que son Traité d'insectologie. Paris 1745, 2 vol. in-8°. et dans le 1er. volume de ses OEuvres, in-4°. Neufchâtel, 1769.
BONT. — BONTIUS (Jacques), médecin public, à Batavia, au commencement du 17e siècle.
Historiæ naturalis et medicæ Indiœ Orientalis, libri VI, imprimé à la suite de l'ouvrage de PISON: De Indiæ utriusque re naturali et medica.
BORLASE (Guillaume), ecclésiastique anglais, curé dans le pays de Cornouailles, né en 1696, mort en 1772.
Histoire naturelle de Cornouailles (en anglais), 1 vol. in-fol. Oxford, 1758.
BORN (Ignace, chevalier DE), naturaliste transylvain, célèbre minéralogiste, né en 1742, mort en 1791.
Nous citons ses Testacea Musei Cæsarei Vindobonensis, Vienne, 1780, 1 vol. in-fol.
BORY-SAINT-VINCENT, naturaliste de Bordeaux, qui a accompagné le capitaine Baudin jusqu'à l'Isle - de-France, et qui vient de présider la commission d'histoire naturelle en Morée.
Nous citons son Voyage aux quatre principales Iles
[page] 340
d'Afrique, où se trouvent diverses observations intéressantes de Zoologie.
Son essai d'une classification des animaux microscopiques. Paris 1826, in-8°.
Les planches des vers de l'Encyclopédie méthodique, dont il a expliqué les dernières parties.
Essai monographique sur les Oscillaires. Paris 1827, in-8°.
Et des articles, dans le Dictionnaire classique d'hist. nat. dont il est le principal directeur.
BOSC (Louis), membre de l'Académie des Sciences.
Auteur de nombreux Mémoires dans les actes de la Société d'Histoire naturelle, dans le Bulletin des Sciences, etc., et des Histoires naturelles des Vers, des Coquilles et des Crustacés, qui font suite à la petite édition de Buffon, donnée par Déterville.
BOSMAN (Guillaume), négociant hollandais du dixseptième siècle.
Voyage en Guinée, 1 vol in-8°. Utrecht, 1705. On y trouve des notes originales sur divers animaux.
BOUD. — BOUDIER (Henri-Philippe), pharmacien.
A publié dans les annales de la Société Linnéenne de Paris la description d'une espèce de lema nouvelle pour la Faune Française.
BOURGUET (Louis), professeur à Neufchâtel, né en 1678, mort en 1742.
Je cite son Traité des Pétrifications, 1 vol. in-4°. Paris, 1742.
BOWDICH, naturaliste anglais.
Auteur d'un voyage au pays des Achantes, et d'un voyage à Madère, où il y a plusieurs observ. d'hist. nat.
Mme BOWDICH, aujourd'hui Mme LEE.
Publie une histoire des Poissons d'eau douce de la Grande-Bretagne, avec de très-belles figures. Il en a paru trois cahiers. — Londres, 1828 et 29.
[page] 341
BRANDER (Gustave), naturaliste anglais, morten 1787.
Je cite ses Fossilia Hantoniensia collecta, et in museo Britannico deposita. Londres, 1766, in-4°.
BRANTZ, jeune naturaliste hollandais.
Auteur d'un Mémoire sur l'EURIOTIS, (le même rat que notre OTOMYS.)
BRÉBIS.—BRÉBISSON, membre de la Société Linnéenne du département du Calvados.
Catalogue méthodique des crustacés terrestres, fluviatiles et marins, recueillis dans le département du Calvados, in-8°.
BREHM (Chrestien-Louis), pasteur allemand.
Auteur de trois volmes in-8, de Matériaux pour l'histoire des oiseaux, en allemand. Neustadt, 1820 et 1822.
BREMSER, conservateur du cabinet impérial de Vienne.
Sur les Vers vivants dans l'homme vivant, en allemand. Vienne, 1819, in-4°. Il y en a une traduction française du docteur Grundler, avec des additions par M. de Blainville. Paris, 1824, in-8°.
BREYN. — BREYNIUS (Jean-Philippe), médecin et naturaliste de Dantzick, né en 1680, mort en 1764.
Dissert. de Polythalamiis, nova testaceorum classe. Dantz., 1732, in-4°.
Historia naturalis cocci radicum tinctorii, 1 vol. in-4°. Gedani, 1731.
BRISS. — BRISSON (Mathurin-Jacques), professeur de physique, membre de l'Académie des Sciences: dans sa jeunesse, garde du cabinet d'histoire naturelle de M. de Réaumur; né en 1723, mort en 1806.
Le Règne animal divisé en IX classes, 1 vol. in-4°. Paris, 1756, contenant seulement les Quadrupèdes et les Cétacés.
Ornithologie, 6 vol. in-4°. Paris, 1770. Ouvrage utile par l'exactitude minutieuse des descriptions. Les planches sont du même dessinateur que les planches enluminées de Buffon, et souvent faites d'après les mêmes modèles
[page] 342
BRIT. ZOOL.
Nous citons sous ce titre le volume grand in-fol., avec de belles figures, sans nom d'auteur, de la Zoologie Britannique, imprimé à Londres en 1766. Il est de Pennant, et a reparu dans sa Zoologie Britannique, en 4 vol. in-8°. Voyez PENNANT.
BROCCHI (G.), ingénieur des mines, mort en 1828 en Syrie, au service du pacha d'Égypte.
Je cite sa Conchiologia fossile subapennina, 2 vol. in-4°, Milan, 1814.
BRONGNIART (Alexandre), membre de l'Académie des Sciences, professeur à la Faculté des Sciences de Paris, et au Jardin du roi, né en 1770.
Je cite son Essai d'une classification naturelle des Reptiles. Paris, 1805, in-4°.
Ses travaux sur les Coquilles fossiles, soit dans les Annales du Muséum, soit dans notre ouvrage commun sur la Géographie physique des environs de Paris.
Et son Histoire des Crustacés fossiles, publiée avec M. Desmarets, in-4°. Paris, 1812.
BROUSS. — BROUSSONNET (Pierre-Marie-Auguste), secrétaire perpétuel de la Société d'Agriculture, membre de l'Académie des Sciences; né en 1761, mort en 1807.
Je cite son Mémoire sur les chiens de mer, Académie des Sciences, 1780.
Son Ichthyologia, dont il n'a paru qu'une décade, grand in-4°. Londres et Paris, 1782.
BROWN. JAM. — BROWNE (Patrice), médecin irlandais à la Jamaïque.
The Civil and Natural History of Jamaica, 1 vol. in-fol. Londres, 1756.
BROWN ou BR. — BROWN (Pierre), peintre anglais.
New illustrations of Zoology, 1 vol. in-4°. Lond., 1776, avec 50 planches enluminées d'animaux de diverses classes, toutes assez médiocres.
[page] 343
BRUCE (James), célèbre voyageur écossais, né en 1730, mort en 1794.
Voyage en Abyssinie et aux sources du Nil. Je cite la traduction française. Paris, 1790, 5 vol. in-4°.
BRUG. — BRUGUIÈRES (Jean-Guillaume), médecin de Montpellier, voyageur, né vers 1750, mort à Ancône à son retour de Perse, en 1799.
Je cite son Dictionnaire des Vers de l'Encyclopédie méthodique, dont il n'a paru qu'un volume. Paris, 1792, in-4°.
Et ses figures des vers, pour le même ouvrage, dont on en a 4.
BRUNNICH (Martin-Thomas), naturaliste danois, professeur à Copenhague.
Ichtyologia Massiliensis, etc., 1 vol. in-8°. Copenhague et Leipsick, 1768.
Entomologia sistens Insectorum tabulas systematicas, Copenhague, 1764, in-8°. Et plusieurs Mémoires parmi ceux de la Soc. des sc. et de la Société d'hist. naturelle de Copenhague.
BUCHANAN (le docteur François-Hamilton), écossais, médecin au Bengale, mort en 1829.
Auteur de quelques Mémoires dans les Transactions de la Société Linnéenne, et d'un Voyage au Mysore, où se trouvent plusieurs bonnes observations.
On lui doit surtout une Histoire naturelle des poissons du Gange. 1 vol. in-4°., en anglais. Edimbourg, 1822, avec un grand nombre d'excellentes figures.
BUCKLAND (Will.), professeur de Géologie à Oxford.
Auteur des Reliquiœ Diluvianæ, in-4°. Londres, 1825, et de nombreux Mémoires sur les fossiles.
BUFF. — BUFFON (Georges-Louis LECLERC, Comte DE), intendant du Jardin du Roi, trésorier de l'Académie des Sciences, né en 1707, mort en 1788.
Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roi. Je cite toujours l'édition
[page] 344
in-4°. Paris, 1749—1789, en 36 vol., dont 3 de généralités, 12 de quadrupèdes, 7 de suppléments aux généralités et aux quadrupèdes, 9 d'oiseaux, 5 de minéraux.
BUF. enl. ou enlum.
Les planches enluminées des oiseaux, publiées pour l'Histoire naturelle de Buffon, par Daubenton le jeune, au nombre de 1008, sans ordre. C'est le recueil, sans comparaison, le plus riche qui ait paru sur cette classe. La plupart de ces figures sont bonnes.
BULLET. DES SC.
Bulletin des Sciences par la Société philomatique, journal qui paraît une fois par mois, depuis 1791, et où se trouvent, en abrégé, une foule de notices précieuses pour l'Histoire naturelle.
BURSCHELL, voyageur anglais, au Cap.
C.
CARENA (Hyacinthe), professeur à Turin.
Monographie du genre Hirudo; tom. XXV des Mém. de l'Ac, Turin, 1820, in-4°.,
CARMICHAEL, officier anglais.
Cité pour un mémoire sur les poissons de Tristan d'Acunha, Trans. lin., XII.
CARUS (Charles-Gustave), professeur à Dresde.
Auteur de plusieurs ouvrages sur l'anatomie comparée. Je cite de lui un Mémoire sur la circulation des larves des insectes névroptères, en allemand. Leipsig, 1827, in-4°.
CAT. ou CATESB. — CATESBY (Marc), né en 1680, mort en 1749; voyageur dans l'Amérique septentrionale.
The natural History of Carolina, Florida and the Bahama islands, 2 vol. in-fol. et append. Lond., 1731 et 1743, avec 220 pl. coloriées.
[page] 345
CAUCHE (François), de Rouen, soldat ou matelot à Madagascar, mort en 1638;
A donné, en 1631, une Relation de Madagascar, etc. i vol. in-8°.
CAVOLINI (Philippe), médecin et naturaliste à Naples.
Memorie per servire alla Storia de' Polipi marini, in-4°. Naples, 1785.
Sulla Generazione dei Pesci e dei Granchi, 1 vol. in-4°. Naples, 1787.
CETTI (Francesco).
Storia naturale di Sardegna, 4 vol. in-12. Sassari, 1774—1777.
CHABERT, directeur de l'Ecole Vétérinaire d'Alfort.
Nous le citons pour son Traité des maladies vermineuses dans les animaux. Paris, 1782, br. in-8°.
CHAB. — CHABRIER (J.), ancien officier supérieur, correspondant de la Société d'histoire naturelle.
Une suite de mémoires sur le vol des insectes, faisant partie du Recueil de ceux du Muséum d'histoire naturelle; il en a été tiré à part un certain nombre d'exemplaires, formant un volume in-4°., et ayant pour titre: Essai sur le vol des insectes. Paris, 1823.
CHAMISSO (Adalbert de), naturaliste et littérateur distingué à Berlin, qui a fait le voyage autour du monde avec le capitaine Kotzebue.
Je cite de lui un Mémoire sur les salpa. In-4° en latin. Berlin, 1830.
CHARP. — TOUSSAINT DE CHARPENTIER.
Horæ Entomologicæ. 1 vol. in-4°, avec pl. Breslau, 1825.
CHEMN.—CHEMNITZ (Jean-Jérôme), de Magdebourg, prédicateur de la garnison à Copenhague, né en 1730;
A continué la grande Conchyliologie de Martini, et donné plusieurs Mémoires parmi ceux des Sociétés des naturalistes de Berlin, de Copenhague, dans le Naturforscher.
CHORIS (Louis), peintre russe, qui a fait le voyage
TOME III. 23
[page] 346
autour du monde, avec le capitaine Kotzebue, et a été assassiné près de la Vera-Crux, en commençant un voyage dans le Mexique.
On a de lui Voyage pittoresque autour du Monde. Paris, 1822, in-fol., et Vues et paysages des régions équinoxiales. Paris, 1826, in-fol.
CLAIRV.—CLAIRVILLE, naturaliste anglais, établi en Suisse.
Entomologie helvétique, 2 vol. in-8°, en français et en allemand, avec de très bonnes figures. Le premier vol. a paru en 1798, et le second en 1806, l'un et l'autre imprimés à Zurich.
CLARCK, médecin-vétérinaire anglais.
Une Monographie des OEstres, dans le tome troisiéme des Transactions de la Société Linnéenne.
Il en a publié une seconde édition.
CLERC (Charles), peintre suédois, élève de Linnæus.
Aranei Suecici descriptionibus et figuris illustrati, 1 vol. in-4°. Holmiæ, 1757; en suédois et en latin.
Icones Insectorum rariorum, 1 vol. in-4°. Holmini, 1759—1764. Ouvrage utile pour reconnaître les papillons décrits par Linnæus dans le cabinet de la reine Frédérique Ulrique.
CLOQUET (Jules), médecin et chirurgien de Paris.
Auteur d'une anatomie des vers intestinaux. 1824, in-4°.
CLUS. — CLUSIUS, ou L'ECLUSE (Charles), né à Arras en 1526, mort en 1609; médecin de l'empereur, et ensuite professeur à Leyde.
Exoticorum libri X, 1 vol. in-fol. Anvers, 1605.
COLLET-MEYGRET (G.-F.-H.), médecin.
Mémoire sur un ver trouvé dans le rein d'un chien (le strongylus gigas, inséré dans le journal de physique, tome LV).
FAB. COL. — COLUMNA (Fabius), médecin de Rome,
[page] 347
d'une branche bâtarde de l'illustre maison Colonne, né en 1567, mort vers 1660. Observateur exact et érudit.
De purpura, in-4°., 1616.
Aquatilium et terrestrium aliquot animalium aliarumque naturalium rerum observationes, à la suite de son Ecphrasis, ib., in-4°., 1616.
COM. ou COMMERS. — COMMERSON (Philibert), né à Dombes en 1727, mort à l'Isle-de-France en 1773, voyageur infatigable et très savant naturaliste.
Je cite ses manuscrits et ses dessins déposés à la bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle.
COOK (Jacques), célèbre navigateur, né en 1728, tué aux îles Sandwich en 1779.
Tout le monde connaît ses trois grands voyages, dont les relations ont été traduites dans toutes les langues.
COQUEBERT (Antoine - Jean), naturaliste établi à Rheims.
Illustratio iconographica Insectorum quæ in musæis Parisinis observavit. J. Chr. Fabricius, 3 décades in-4°. Paris, 1799—1804.
Il y a aussi de lui diverses notes dans le Bulletin des Sciences.
COUCH (Jonathan), naturaliste anglais.
Cité pour un Mémoire sur les poissons de Cornouailles. Trans. lin., XIV.
CRAM. — CRAMER (Pierre), marchand d'Amsterdam.
Papillons exotiques des trois parties du monde, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, en hollandais et français, 4 vol. in-4°., composant en tout 400 planches enluminées. Amsterdam, 1779—1782.
Voyez Stoll, pour le supplément.
CREUTZ. — CREUTZER (Chrétien).
Essais entomologiques; en allemand (Entomologische versuche), in-8°., avec figures coloriées. Vienne, 1799.
23*
[page] 348
CREVELT, naturaliste allemand.
Auteur d'un mémoire sur un gecko dans ceux de la Soc. des nat. de Berlin. 1809.
CURT.—CURTIS (John), naturaliste et peintre anglais.
Il a commencé la publication d'un Genera iconographique des genres d'insectes et de plantes propres à la Grande-Bretagne. Leurs caractères y sont représentés avec la plus grande fidélité.
Cet ouvrage, publié par fascicules, forme déjà trois volumes in-8°.
Il a aussi publié dans le Zoological-Journal, des Observations intéressantes sur l'elater noctilucus.
CUV. — CUVIER (George-Léopold-Chrétien-Frédéric-Dagobert), né à Montbéliard, en 1769; secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, etc.
Je cite de moi les ouvrages suivants, outre mes Mémoires insérés dans les Annales du Muséum.
MÉNAG. DU MUS.
Ménagerie du Muséum d'histoire naturelle, par MM. Lacépède, Cuvier et Geoffroy, avec des figures peintes par Maréchal, et gravées par Miger; 2 vol. pet. in-8°. Paris, 1804. Il y en a aussi une édition grand in-folio.
TAB. ÉLÉM.
Tableau élémentaire de l'Histoire naturelle des animaux, 1 vol. in-8°. Paris, an 6 (1798).
LEC. D'AN. COMP.
Leçons d'Anatomie comparée, recueillies et publiées par MM. Duméril et Duvernoy; 5 vol. in-8°. Paris, 1800 et 1805.
RECH. SUR LES OSS. FOSS.
Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes; 4 vol. in-4°. Paris, 1812. Il en a paru une 2e éd. en 5 vol. in-4° de 1821 à 1823.
MÉM. SUR LES MOLL.
Mémoires pour servir à l'histoire et à l'anatomie des Mollusques; 1 vol. in-4°. Paris, 1816.
[page] 349
CUV et VAL.
L'Histoire naturelle des poissons, que je publie avec le concours de M. Valenciennes. Il en a paru en ce moment 5 vol. in-4° et 8°. Paris et Strasbourg.
FRÉD. CUV. — CUVIER (Frédéric), inspecteur général de l'Université, membre de l'Académie des sciences, garde de la ménagerie du Muséum, né à Montbéliard en 1773.
Je cite ses Mémoires dans les Annales du Muséum, principalement ceux qui ont pour objet les dents des mammifères, recueillis en un vol. in-8°. Paris 1825. Et surtout son Histoire naturelle des mammifères, publiée avec M. Geoffroy-St.-Hilaire, in-fol. et in-4°, avec figures d'après nature.
CYRILL. — CYRILLUS ou CIRILLO (Dominique), médecin de Naples, exécuté à mort en 1796.
Entomologiæ Neap-olitanæ specimen, 1 vol. in-fol. avec planches coloriées. Neapoli, 1787.
D.
DAHL. — DAHL (Georges).
Coleoptera und Lepidoptera. Vien., 1823, 1 vol. in-8°.
DALDORF, officier danois.
On a de lui des Mémoires sur quelques poissons, insérés dans les Trans. Linnéennes et le journal de Gottingue.
DALM. — DALMAN (Jean-Guillaume), mort depuis peu à Stockholm, directeur du Musée de cette ville.
Analecta entomologica, 1 vol. in-4°., avec 4 planches. Holmiae, 1823.
Prodromus monographiæ Castniæ. 1 vol. in-4°., avec une planche. Holmiae, 1825.
Om nagra svenska arter of coccus. Mémoire, in-4°., avec planches. Stockholm, 1826.
Une Monographie des insectes de la tribu des Chalcidites, ou sa famille des Pteromalini. 1 vol. in-8°. Stockholm, 1820.
[page] 350
Une table synoptique des papillons de Suède, dans les Mémoires de l'Acad. de Stockholm. 1816.
Ephemerides Entomologicœ. 1 vol. in-8°. Holmiae, 1824.
Un Mémoire sur quelques Ichneumonides. 1 vol. in-8°. Stockholm, 1826.
Un autre, en suédois, sur les insectes, renfermés dans le Copal. 1 vol. in-8°. Stockholm, 1826.
DAL (J. Graham DALYELL), naturaliste écossais.
Observations sur divers phénomènes intéressants des planaires. Edimb., 1814, in-8°.
DAMPIER (Guillaume), célèbre marin anglais, né en 1652.
Son Voyage autour du Monde, 2 vol. in-8°. Londres, 1697 et 1699, a été traduit en français, et réimprimé plusieurs fois. Il contient quelques traits intéressants de l'histoire des animaux.
DANIELS (Samuel), peintre anglais.
African Scenerys, 1 vol. in-fol., transv.
Ouvrage magnifique, offrant plusieurs belles figures d'animaux très rares.
DAUB. — DAUBENTON (Louis-Jean-Marie), né à Montbard en 1716, mort à Paris en 1800, professeur au Muséum d'histoire naturelle et au Collége de France, membre de l'Institut.
Je cite les descriptions d'animaux dont il a enrichi l'Histoire naturelle de Buffon.
DAUD. — DAUDIN (François-Marie), mort à Paris en 1804.
Traité élémentaire et complet d'Ornithologie, dont il n'a paru que 2 vol. in-4°. (Paris, 1800), ne contenant que les oiseaux de proie et une partie des passereaux. C'est une compilation assez médiocre.
Histoire naturelle des Reptiles, 8 vol. in-8°. Paris, 1802 et 1803 ouvrage faisant suite au Buffon deSonnini.
[page] 351
Histoire naturelle des Rainettes, des Grenouilles et des Crapauds, 1 vol. in-8°., avec beaucoup de figures enluminées. Paris, 1803.
DEJ. — DEJEAN (le comte), pair de France, lieutenant-général des armées du Roi, etc.
Catalogue de la Collection des Coléoptères de M. le baron Dejean, 1 vol. in-8°., 1821.
Species général des Coléoptères, 3 vol. in-8°., 1825 — 1829. Le quatrième vient de paraître.
Histoire naturelle et Iconographie des Coléoptères d'Europe, par MM. Latreille et le baron Dejean, trois fascicules, in-8°., 1822.
Voyez BOISDUVAL.
JUSS. — DE JUSSIEU (Antoine), né à Lyon en 1686, mort en 1758, professeur de botanique au Jardin du Roi.
Je le cite pour quelques Mémoires de zoologie, imprimés parmi ceux de l'Académie des Sciences.
DEKAY, (James E.) médecin et naturaliste américain.
Auteur de Mémoires dans le Recueil du lycée de New-York.
DELAP. et BRUL. — DELAPORTE et BRULLÉ.
Notice sur un nouveau genre de la famille des Charansons, inséré dans le quatrième volume des Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
DELLE CHIAJE (Etienne), professeur à Naples.
Auteur de Mémoires sur l'Histoire des animaux sans vertèbres, du royaume de Naples en Ital., 2 vol. in-4°. Naples, 1823 et 1825.
DELUC (Jean-André), naturaliste génevois, lecteur de la Reine d'Angleterre.
Je n'ai eu occasion de citer ce célèbre géologiste, que pour son Mémoire sur les pierres judaïques, dans les Mémoires des Savants étr. de l'Académie des Scienees.
[page] 352
DESHAYES (G.-P.), naturaliste de Paris.
Anatomie et monographie du genre dentale, dans les Mém. de la description des coquilles fossiles des environs de Paris, in-4°. Paris, 1824, et ann. suiv.
DESM. — DESMARETS (Anselme-Gaétan), correspondant de l'Académie des Sciences, professeur de zoologie à l'Ecole Vétérinaire d'Alfort;
Auteur de l'Histoire naturelle des Tangaras, des Manakins, et des Todiers; 1 vol. in-fol. Paris, 1805.
D'un Traité de mammalogie, servant d'explication aux planches de mammifères de l'Encycl. méthod. Paris, 1820, in-4°.
De plusieurs articles du nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, et notamment de l'article Malacostracés.
De divers Mémoires et Notes, reproduit avec des augmentations sous le titre de Considération générale sur la classe des Crustacés, 1 vol. in-8°., avec planches. Paris, 1803.
Et de l'Histoire naturelle des crustacés fossiles, avec le concours de M. Brongniart.
DESMOULINS (Charles), vice-président de la Société Linnéenne de Bordeaux.
Essai sur les Sphérulites. Bordeaux, 1826.
DIQ. ou DIQUEM. — DICQUEMARE (l'abbé Jacques-François), naturaliste du Hâvre, né en 1733, mort en 1789.
Observateur infatigable, auteur de plusieurs Mémoires sur les Zoophytes et les Mollusques, dans les Transactions philosophiques, le Journal de Physique, etc.
DONATI (Vitalien), médecin de Padoue, voyageur pour le roi de Sardaigne, né en 1713, naufragé en revenant d'Egypte en 1763.
Histoire naturelle de la mer Adriatique (en italien-). Venise, 1750; 1 vol. in-4°. La traduction française. La Haye, 1758.
Ouvrage incomplet et superficiel.
[page] 353
DONOV. — DONOVAN (Edouard), peintre de Londres.
The Natural History of British Fishes; 5 vol. in-8°. Londres, 1820.
The Natural History of British Insects en plusieurs fascicules; in-8°.
An epitome of the Natural History of the Insects of China; 1 vol. in-4°. London, 1778.
An epitome of the Natural History of the Insects of India; in-4°. Je n'en connais que douze cahiers.
General illustration of Entomology. Part. I. An epitome of the Insects of Asia; 1 vol. in-4°. London, 1805.
DORTHÈS (Jacques-Antoine), médecin de Montpellier, né en 1759, mort en 1794.
Cité pour un Mémoire sur les Araignées maçonnes, dans le deuxième vol. des Transactions Linnéennes.
DRAPARN. ou DRAP. — DRAPARNAUD (Jacques-Philippe-Raimond), professeur à Montpellier, né en 1772, mort en 1804.
Tableau des Mollusques terrestres et fluviatiles de la France; brochure in-8°., Montpellier et Paris, 1801.
Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de la France. Paris, 1805, in-4°., avec de jolies gravures.
DRAP. — DRAPIEZ, professeur de chimie à Bruxelles.
Mémoires sur un nouveau genre d'insectes coléoptères, de la section des tétramères, et description de quelques nouvelles espèces de mammifères, d'oiseaux et d'insectes, insérées dans les Annales générales des sciences physiques.
DRUR. — DRURY, orfèvre anglais, mort depuis peu.
Illustrations of Natural History, 3 vol. in-4°., avec de très belles planches enluminées, représentant les insectes rares de son cabinet. London, 1770—1782.
DUF. — DUFOUR (Léon), médecin de Saint-Sever (Landes).
Mémoire anatomique sur une nouvelle espèce d'insecte
[page] 354
du genre Brachine; tom. 18 des Annales du Muséum d'histoire naturelle.
Des Mémoires Sur l'Anatomie des Coléoptères, sur celle des Cigales, des Cicadelles, des Labidoures ou Forficules, sur une nouvelle espèce d'Ornithomyie, sur le genre Ocyptère; imprimés dans les Annales des Sciences naturelles, deux autres Mémoires, insérés dans le Journal de physique, l'un sur l'Anatomie des Scorpions, l'autre sur celle des Scolies; les Annales générales des Sciences physiques, en offrent plusieurs autres, où il donne la description de diverses Arachnides, et de plusieurs nouvelles espèces de Coléoptères; et l'Anatomie de la Ranatre linéaire et de la Nèpe cendrée.
DUFTS.—DUFTSCHMID (Gaspard), professeur à Lintz.
Fauna Austriæ, in-8°., en allemand.
Je n'en connais que les deux premiers volumes. Le premier a paru en 1805, et le second en 1812, à Lintz et à Leipsick.
DUGEZ (Antoine), professeur à Montpellier.
Recherches sur la circulation, la respiration et la reproduction des Annelides abranches. 1828.
Sur les Espèces indigènes du genre Lacerta, Annales des Sc. nat. XVI. 1828.
DUHAM. — DUHAMEL DU MONCEAU, naturaliste, agriculteur et physicien, membre de l'Académie des Sciences, né à Paris en 1700, mort en 1782.
Je cite son Traité général des pêches. Paris, 1769, in-fol., à cause d'un grand nombre de bonnes figures de poissons.
DUM. ou DUMÉR. — DUMÉRIL (Constant;, professeur à la Faculté de Médecine et au Jardin du Roi, membre de l'Académie des Sciences, né à Amiens en 1774.
Rédacteur des deux premiers volumes de mes Leçons d' Anatomie comparée.
Zoologie analytique, 1 vol. in-8°. Paris, 1806.
[page] 355
Traité élémentaire d'Histoire naturelle, 2 vol. in-8°., 2me édition. Paris, 1807. 4e édition, 1830.
Divers Mémoires d'Anatomie comparée, entre autres un sur les Poissons cyclostomes, etc.
Les articles du Dictionnaire de Sciences naturelles relatifs aux insectes, et 1 vol. in-8°, avec planches, intitulé Considérations générales sur la classe des insectes.
DUPONCH. — DUPONCHEL (A. J.), continuateur de l'histoire naturelle des lépidoptères de France, de Godart.
Monographie du genre Érotyle, in-4°., avec planches; imprimé dans le douzième volume des Mémoires du Muséum d'histoire naturelle de Paris.
Il a continué, à commencer au sixième volume inclusivement, l'ouvrage de feu Godart, intitulé: Histoire naturelle des Lépidoptères de France. Le septième volume est presque terminé. Il a fait connaître (Annales de la Soc. Linnéenne de Paris) un nouveau genre de Coléoptères, qu'il nomme Adelostoma, et il a publié des observations sur les métamorphoses de la nymphale, petit sylvain.
DUPONT (André-Pierre), de la Société royale de Londres.
Auteur d'un Mémoire sur le Glaucus dans les Transactions philosophiques, vol. LIII.
DUTERTRE (Jean-Baptiste), moine dominicain, missionnaire aux Antilles, né en 1610.
Histoire générale des Antilles, habitées par les Français, 4 vol. in-4°. Paris, 1666—1671.
Le deuxième volume, où est l'Histoire naturelle, contient de bonnes observations.
Il y a une première édition, en 1 vol., de 1654.
DUTROCHET (N.), médecin à Château-Renaud.
Observateur exact et ingénieux, auteur de quelques Mémoires dans les Annales du Muséum, etc.
[page] 356
DUV. — DUVAU (Auguste), de la Société d'histoire naturelle de Paris.
Nouvelles Recherches sur l'Histoire naturelle des Pucerons, Mémoire lu à l'Académie des Sciences, le 25 avril 1825, et imprimé dans le Recueil des Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.
E.
EDWARDS (Georges), peintre anglais, membre et bibliothécaire de la Société royale.
Histoire naturelle des Oiseaux rares, 4 vol. in-4°.
Et Glanures d'Histoire naturelle, 3 vol. in-4°.
Ces deux ouvrages ne forment qu'un seul recueil de planches, dont les nos se suivent depuis 1 jusqu'à 362.
C'est le recueil le plus riche pour les oiseaux, après les planches enluminées de Buffon. Il y a aussi quelques animaux d'autres classes. Les figures sont belles; le texte médiocre.
EDW. — EDWARDS (Milne), conjointement avec M. Victor Audouin.
Recherches anatomiques et physiologiques sur la circulation dans les crustacés. Annales des Sciences naturelles, tom. 11.
Recherches anatomiques sur le système nerveux des crustacés. Ann. de Sc. nat., tom. 14.
De la Respiration aérienne des crustacés, et des modifications que l'appareil branchial présente dans les crabes terrestres, même recueil, tom. 15.
Mémoire sur le Nicothoe, animal singulier qui suce le sang du homard. Ib. tom. 9.
Résumé des recherches sur les animaux sans vertèbres, faites aux îles Chausay.
Description des Annelides des côtes de la France, faisant partie des Recherches, pour servir à l'Histoire naturelle du littoral de la France.
[page] 357
EDWARDS (Milne) seul.
Description de quelques crustacés nouveaux. Annales des Sciences naturelles, t. 13.
Recherches Zoologiques, pour servir à l'histoire naturelle des Lézards, même recueil, t. 16.
Monographie des crustacés amphipodes.
EGEDE (Jean), missionnaire danois en Groënland, né en 1686, mort en 1758.
Description du Groënland, 1 vol. in-8°. Copenhague et Genève, 1763.
EISENHARDT (Charles-Guillaume).
Mémoire sur les Méduses, dans ceux de l'Ac. des cur. de la nat. de Bonn; et avec ad. Chamisso, d'un Mém. sur quelques animaux de la classe des vers, ib., tom. 10, part. 2.
ELLIS (Jean), marchand de Londres.
Essai sur l'Histoire naturelle des Corallines. Londres, 1755, in-4°., en franç. A La Haye, 1756.
Natural History of many curious and uncommun Zoophytes, 1 vol. in-4°. Londres, 1786. En commun avec Solander.
ENGRAM. — ENGRAMELLE (Marie-Dominique-Joseph), moine augustin de Paris, né en 1727, mort en 1780.
Papillons d'Europe, peints par Ernest, et décrits par le révérend père Engramelle, 6 vol. petit in-fol., composés en tout de 342 planches coloriées: l'ouvrage finit au genre des noctuelles inclusivement.
Ernest était un artisan de Strasbourg, qui avait acquis de lui-même un grand talent pour peindre des papillons.
ERXL. — ERXLEBEN (Jean-Chrétien-Polycarpe), né en 1744, mort en 1777, professeur d'histoire naturelle à Gottingen.
Systema regni animalis. Classis I animalia, 1 vol. in-8°. Leipzig, 1777.
[page] 358
ESP. — ESPER (Eugène-Jean-Christophe), professeur à Erlang.
Son ouvrage sur les Lépidoptères d'Europe en allemand (Europœische Schmetterlinge), 4 volumes in-4°., dont le premier et le quatrième, divisés en deux, planches coloriées
L'ouvrage n'est pas terminé. Il a paru en outre quelques cahiers sur les phalènes proprement dites, ou les géomètres.
Son ouvrage sur les Zoophytes (die Pflanzen thiere), 4 vol. in-4°. Nuremberg, 1791 et années suivantes.
EUPHRASEN (Benoist-André), naturaliste suédois.
Auteur d'un Voyage à Saint-Barthélemy, et cité pour un Mémoire dans ceux de l'Académie de Stockholm.
EVERSMAN.
Auteur de l'appendice Zoologique, au Voyage en Bucharie du baron de MAYENDORF, avec des notes de M. LICHTENSTEIN. On en a une trad. fr. par M. Amédée JAUBERT. Paris, 1826, in-8°.
F.
FAB. — FABRICIUS (Jean-Chrétien), né en 1742, à Tundern, dans le duché de Sleswick, mort en 1807, disciple de Linnæus, professeur d'histoire naturelle et d'économie rurale à Kiel.
Auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur l'Entomologie, parmi lesquels j'ai spécialement cité:
Entomologia systematica emendata et aucta, 4 vol. in-8°., dont le premier et le troisième en deux parties. Hafniæ, 1792—1794. Il y a refondu plusieurs de ses ouvrages antérieurs, comme: Systema Entomologiæ, 1 vol. in-8°.; Species Insectorum, 2 vol. in-8°.; Mantissa Insectorum, 2 vol. in-8°.
Supplementum Entomologiæ systematicœ, 1 vol. in-8°. Hafniæ, 1798.
[page] 359
Systema Eleutheratorum, 2 vol. in-8°. Kiliæ, 1801.
Systema Rhyngotorum, 1 vol. in-8°. Brunsvigæ, 1801.
Systema Piezatorum, 1 vol. in-8°. Brunsvigæ, 1804.
Systema Antliatorum, 1 vol. in-8°. Brunsvigæ, 1805.
La mort l'a surpris lorsqu'il allait publier le Systema Glossatorum. Illiger en a donné un extrait dans son Magasin entomologique.
FAB. ou FABR. — FABRICIUS (Othon), pasteur en Groënland, puis en Norvège et en Danemarck.
Fauna Groënlandica, etc., 1 vol. in-8°. Copenhague et Leipsick, 1790, ouvrage précieux par l'extrême exactitude des descriptions; mais où les noms sont souvent mal appliqués.
Il a aussi donné quelques Mémoires parmi ceux de la Société d'Histoire naturelle de Copenhague.
FALCK (Jean-Pierre), Suédois, professeur de botanique à Pétersbourg, né en 1727; voyageur au service de Russie, de 1768 à 1773.
Il se tua à Casan en 1774. Son Voyage a été publié en allemand, 3 vol. in-4°. Pétersbourg, 1785 et 86. Les deux derniers ne contiennent que de l'Histoire naturelle.
FALL. — FALLEN (Charles-Frédéric), professeur d'histoire naturelle à Lund.
Diptera Sueciœ, in-4°., premier volume. Lundæ, 1814 1817.
FARIN. — FARINES, naturaliste habitant le département des Pyrenées Orientales.
A publié dans les Annales des Sciences naturelles (1826) des observations sur la larve du ripiphorus bimaculatus.
FAVANNE.
Auteur d'un Dictionnaire de conchyliologie, et d'une édition fort augmentée de la conchyliologie de d'Argenville.
[page] 360
FAUJ. — FAUJAS DE SAINT-FOND (B.), professeur de géologie au Muséum d'histoire naturelle.
Histoire naturelle de la montagne de Saint-Pierre de Maëstricht. Paris, 1799, 1 vol. grand in-4°.
FERMIN (Philippe), médecin à Surinam.
Histoire naturelle de la Hollande équinoxiale, 1 vol. in-8°. Amsterdam, 1765.
Description de Surinam, 2 vol. in-8°. Amst., 1769.
Deux ouvrages médiocres, et pleins de fautes de nomenclature.
FERN., ou HERN., ou HERNAND. — HERNANDES (François), médecin en chef du Mexique sous Philippe II.
Nova plantarum animalium et mineralium Mexicanorum historia, in-fol. Rome, 1651. Mélange singulier de fragments de l'auteur, de figures faites par d'autres, et de commentaires des éditeurs, qu'il faut lire avec précaution.
FÉRUSS., FER.—FÉRUSSAC (J. DAUDEBART DE), naturaliste français;
A donné une nouvelle édition, augmentée d'un Essai d'une méthode conchyliologique, écrite originairement par M. de Ferussac père, ancien militaire, broch. in-8°. Paris, 1807.
Une grande Histoire des Mollusques terrestres et fluviatiles, gr. in-fol., avec de belles planches qui n'est point encore terminée.
Et est principal rédacteur de l'important Recueil intitulé Bulletin universel des Sciences, etc.
FEUILL. ou FEUILLÉE. — FEUILLÉE (Louis), minime, compagnon et plagiaire de Plumier, né en 1660, mort en 1732.
Journal d'observations faites sur les côtes orientales de l'Amérique. Paris, 1714, 2 vol. in-4°.
Journal, etc., dans la Nouvelle-Espagne, et aux îles de l'Amérique, ib., 1725, 1 vol. in-4°.
[page] 361
FICHTEL et MOLL. — FITCHTEL (Léopold de), naturaliste de Vienne:
MOLL (Jean-Paul-Charles DE), académicien de Munich.
Auteurs d'une brochure in-4°., intitulée: Testacea microscopica aliaque minuta ex generibus argonauta et nautilus. Cum 24 tab. Vienne, 1803.
FISCH. — FISCHER DE WALDHEIM (Gotthelf), naturaliste allemand, directeur du Muséum impérial de Moscou.
Parmi ses nombreux ouvrages, nous citons:
Fragments d'Histoire naturelle (en allemand), 1 vol. in-4°. Francfort, 1801.
Anatomie des Makis (en allemand). Francfort, 1804.
Description de quelques insectes dans les Mémoires des naturalistes de Moscou, 1 vol. in-4°. Moscou, 1806.
Entomographia Imperii Russici, 2 vol. in-4°., avec de très belles planches. Moscou, 1820—1822.
Notice sur une mouche carnivore, nommée Médetère, in-4°., avec figures. Moscou, 1819.
Notice sur l'Argas de Perse. Mémoire in-4°., avec une planche. Moscou, 1823.
Lettre sur le Physodactyle, nouveau genre de Coléoptère élateroïde, in-8°. Moscou, 1824.
FITZINGER (L.-J.), médecin et naturaliste à Vienne.
Auteur d'une Nouvelle classification des reptiles d'après leurs affinités naturelles (en allemand). Vienne, 1826, in-4°.
FLEMING (John), pasteur écossais.
Auteur d'une Philosophie de la Zoologie, en anglais. Edimb., 1822, 2 vol. in-8°.
FLEURIAU DE BELLEVUE, naturaliste de la Rochelle.
Auteur de Mémoires sur des coquilles et autres mollusques, dans le Bulletin des Sciences, le Journal de Physique, etc.
FORSKAHL (Pierre), naturaliste suédois, né en 1734,
TOME III. 24
[page] 362
disciple de Linnæus, compagnon de Niébuhr dans son voyage en Orient, mort dans ce voyage en 1763.
Je cite ses Descriptiones animalium, etc., quæ in itinere Orientali observavit. Copenh., 1775, in-4°.
Et icones rerum naturalium quas in itinere Orientali depingi curavit. Copenh. 1776, in-4°.
Ouvrages posthumes, précieux par les espèces nouvelles qu'ils contiennent, quoique la nomenclature en soit peu exacte.
FORTIS (Jean-Baptiste, ou Albert), naturaliste italien, né à Vicence en 1740, mort bibliothécaire à Bologne, en 1803.
Je cite ses Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle, et principalement à l'Orictographie de l'Italie, 2 vol. in-8°. Paris, 1802.
FORST.—FORSTER (Jean-Reinhold), né à Dirchaw, en Prusse-Polonaise, en 1729, naturaliste au service d'Angleterre, pour le 2e. voyage de Cook, ensuite professeur à Halle; mort en 1798.
Nous le citons pour sa Zoologiæ indicæ rarioris spicilegium in-4°. Londres, 1790.
Son Enchiridion Historiæ naturali inserviens, in-8°. Halle, 1788, et pour les articles insérés par Bloch, Jans son Système posthume des poissons.
FOURCROY (Antoine-François DE), célèbre professeur de chimie, conseiller d'État, de l'Académie des Sciences; né en 1755, mort en 1809.
Nous n'avons occasion de citer de lui que son Entomologia Parisiensis, 2 vol. in-8°. Paris, 1785. Petit ouvrage de sa jeunesse, qui n'est qu'un abrégé de celui de Geoffroy.
FRÉD. CUV. voyez CUV.
FRÉMINV. — FRÉMINVILLE (le baron de), officier de marine, habile naturaliste.
Auteur de plusieurs articles dans le Dictionnaire classique d'hist. nat.
[page] 363
FRIES. — FRIES (Benoist-Frédéric).
Monographia Tanyporum Sueciœ. Lundiæ, 1823.
FR. ou FRISCH—FRISCH (Jean-Léonard), recteur du Gymnase de Berlin, né en 1666, mort en 1743.
Représentation de quelques oiseaux d' Allemagne et de quelques étrangers (en allemand), 2 vol. in-fol. Berlin, 1739—1763, contenant 255 planches très exactes, sans être élégantes.
Il y a aussi de lui, en allemand, une Description des insectes d' Allemagne, 1 vol. in-4°. Berlin, 1730.
FROEL. — FROELICH (Jean-Aloys), naturaliste allemand, médecin à Elwangen.
Auteur de deux Mémoires sur les vers intestinaux dans le Naturforscher.
G.
GÆRTNER (Joseph), célèbre botaniste wurtembergeois, né en 1732, mort en 1791.
Auteur de la Carpologie, a fait aussi, dans sa jeunesse, des observations zoologiques, insérées dans les Transactions philosophiques et dans les Miscell. zoolog. de Pallas.
GAILLARDOT, médecin à Lunéville, habile naturaliste.
Auteur de Mémoires sur des fossiles, dans les Ann. des Sc. Nat., etc.
GARDEN (Alexandre), écossais, médecin à Charlestown, en Caroline, né en 1730, mort en 1771.
Qui a envoyé quelques observations à Linnæus.
GAZA (Théodore DE).
Grec réfugié en Italie au 16e siècle, traducteur latin des ouvrages d'Aristote, sur les animaux.
GEB. — GEBLER (François), médecin et naturaliste russe.
Observationes Entomologicæ, mémoire, in-4°.
24*
[page] 364
DE G. — GÉER (Charles, baron de), maréchal de la cour de la reine de Suède, de l'Académie de Stockholm, né en 1720, mort en 1778.
Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes, 7 vol. in-4°., avec fig. Stockholm, 1752—1778. Excellent ouvrage, faisant suite à celui de Réaumur. Les deux premiers volumes sont rares.
M. Retzius en a donné un abrégé latin: Genera et species Insectorum, 1 vol. in-4°. Lipsiæ, 1783.
Il y en a une traduction allemande, augmentée par Gætze.
GEOF. — GEOFFROY, médecin célèbre à Paris.
Histoire abrégée des insectes, 2 vol. in-8°., avec fig. Paris, 1764.
Cet ouvrage, très élémentaire, a été réimprimé et augmenté des espèces que Fourcroy y avait ajoutées, dans l'Abrégé qu'il en avait publié. Voyez FOURCROY.
Traité sommaire des Coquilles, tant fluviatiles que terrestres, qui se trouvent aux environs de Paris, 1 vol. in-12. Paris, 1767.
Petit ouvrage remarquable par la tentative de classer les coquilles d'après leurs animaux.
GEOF. — GEOFFROY-ST.-HILAIRE (Etienne), né à Etampes en 1773, professeur au Muséum d'histoire naturelle, membre de l'Académie des Sciences.
Je cite ses nombreux Mémoires dans le Magasin Encyclopédique, les Annales du Muséum, et le grand ouvrage sur l'Égypte.
Plusieurs Mémoires sur l'organisation des Crustacés et des Insectes, imprimés dans divers recueils, tels que celui des Mém. du Musé. d'Hist. nat. Le journal complémentaire des Sciences médicales, etc., et sa Philosophie anatomique, 2 vol. Paris, 1818 et 1822.
ISID. GEOFFR. — GEOFFROY ST.-HILAIRE (Isidore), fils du précédent, aide naturaliste au Muséum d'histoire naturelle.
Auteur de plusieurs Mémoires dans les Mém. du Mus.
[page] 365
et les annales des Sciences naturelles et de la description des poissons d'Égypte, dans le grand ouv. sur l'Égypte.
GEOR. — GEORGI (Jean-Théophile), naturaliste allemand, voyageur au service de Russie en 1772, 1773 et 1774.
Son voyage est imprimé en allemand, 2 vol. in-4°. Pétersbourg, 1775.
GERMAR (Ernest-Frédéric), naturaliste allemand.
Auteur d'une Dissertatio sistens Bombycum species, etc., in-4°. Hales.
Il continue le Magasin des Insectes, d'Iliger.
GERM. — GERMAR (Etienne-François), professeur de minéralogie à Halle.
Magasin der Entomologie, 4 vol. in-8°, Halle, 1813—1821.
Insectorum species novæ, premier volume in-8°., avec figures. Halæ, 1824.
Voyez AHRENS.
GESN. — GESNER (Conrad), médecin de Zurich, né en 1516, mort en 1565.
Je cite son Histoire des Animaux, en 3 vol. in-fol., auxquels on joint un Traité des Serpents et un du Scorpion. Cet ouvrage, par ordre alphabétique, est une excellente compilation de tout ce que les Anciens avaient dit, enrichie d'observations utiles et de nombreuses figures en bois, la plupart assez bonnes.
GILLIAMS, naturaliste américain.
A donné des Mémoires sur des Reptiles et des Poissons dans ceux de l'Académie des Sc. nat. de Philadelphie.
GIOENI (Joseph), de la maison des dues d'Angio, naturaliste sicilien.
Description d'une nouvelle famille et d'un nouveau genre de testacés, etc., en italien, brochure in-8°. Naples, 1783.
C'est l'estomac de la bulla lignaria, qu'il a transformé en un animal.
[page] 366
GIORNA (Michel-Esprit), naturaliste piémontais, professeur à Turin, né en 1741, mort en 1809.
Je cite quelques-uns de ses Mémoires, insérés parmi ceux de l'Académie de Turin.
GMELIN (Samuel-Théophile) né à Tubingen en 1743, naturaliste et voyageur allemand au service de Russie, de 1768 à 1774 année où il périt en Perse.
Son Voyage a été publié en allemand, 4 vol. in-4°. Pétersbourg, 1770–1784. Il contient de bons et nombreux articles d'histoire naturelle.
G., ou GM., ou GMEL. — GMELIN (Jean-Frédéric), né à Tubingen en 1748, professeur de chimie à Gottingen, mort en 18..
Il est l'auteur de la 13e et dernière édition du Systema naturœ de Linnæus. Son travail, tout indigeste et dénué de critique et de connaissance des choses, est cependant nécessaire, comme la seule table un peu complète de ce qui a été fait jusque vers 1790.
GOD. — GODART (Jean-Baptiste), proviseur sous le régime impérial, au lycée de Bonn, mort en 1825.
A rédigé l'article Papillon de l'Encyclopédie méthodique, et a publié les cinq premiers volumes d'un ouvrage commencé en 1822, ayant pour titre: Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France. in-8°.
GOETZ, ou plutôt GOEZ. — GOEZE (Jean-Auguste-Ephraïm), pasteur à Quedlimbourg, l'un des auteurs principaux sur les vers intestinaux, né en 1731, mort en 1793.
Histoire naturelle des Vers intestinaux (en allemand), 1 vol. in-4°. Blankenbourg, 1782.
GOLDFUSS (Georges-Auguste), professeur à Bonn.
Auteur de plusieurs Mémoires, parmi ceux de l'Académie des curieux de la nature, et d'un Manuel de Zoologie, 2 vol. in-8°. Nuremberg, 1820.
[page] 367
GOUAN (Antoine), professeur à Montpellier.
Des nombreux ouvrages de ce savant naturaliste, nous n'avons occasion de citer que l'Historia Piscium, 1 vol. in-4°. Strasbourg, 1770.
Ce n'est proprement qu'une description des genres, mais faite avec beaucoup de détails, et en termes techniques, à la manière de Linnæus. Elle est précédée d'une espèce de philosophie ichthyologique.
GRAV. — GRAVENHORST (Jean-Louis-Charles), de la société Physique de Gœttingue, etc.
Coleoptera microptera Brunsvicensia, etc., 1 vol. in-8°. Brunsvigæ, 1802.
Monographia Coleopterorum micropterorum, 1 vol. in-8°. Gottingæ, 1806.
Le premier volume d'une Nosographie du genre Ichneumon, 1 vol. in-8°, avec fig., 1814.
Monographia Ichneumonum pedemontanæ regionis, faisant partie du 24e volume des Mémoires de l'Acadédes Sciences de Turin.
Une Monographie des Ichneumons aptères, 1 vol. in-8°., avec figures.
La description d'un nouveau genre Helwigia, de la même tribu et dont il a été publié un extrait dans le bulletin universel de M. le baron de Férussac.
Conspectus generum et familiarum ichneumonidum, auctoribus J. L. C. Gravenhorst et C. G. Neg ab Esenbeck, in-4°.
GRAY (J.-Ed.), naturaliste anglais, attaché au muséum britannique.
Auteur de Mémoires sur les reptiles dans les Annals of Philosophy de 1825, et le Philosophical Magazine, de 1827.
GREW (Néhemias), célèbre par ses découvertes en physiologie végétale, secrétaire de la Société royale de Londres, mort en 1711.
Je cite quelquefois son Museum regalis societatis, in-fol. Londres, 1681.
[page] 368
GRONOVIUS (Jean-Frédéric).
A donné divers Mémoires sur les Poissons dans ceux de quelques Sociétés savantes, surtout dans les Transactions philosophiques.
GRONOVIUS (Laurent-Théodore), officier municipal de Leyde, neveu du précédent, né en 1730, mort en 1777.
Museum Ichthyologicum, 1 vol. in-fol. Leyde, 1754.
Zoophylacium gronovianum, ibid., 3 cahiers faisant 1 vol. in-fol. 1765—1787.
GRUNDLER (Godefroy-Auguste), peintre et graveur à Halle.
Cité pour un Mémoire dans le Naturforscher.
GUALT. — GUALTIERI (Nicolas), médecin de Florence, auparavant professeur à Pise.
Index Testarum conchyliorum quœ adservantur in Museo R. Gualtieri. Florence, 1742, in-fol.
Les figures en sont nombreuses et exactes.
GUÉR. — GUÉRIN (François-Étienne), de la Société d'histoire naturelle de Paris.
Un Mémoire sur un insecte diptère du genre Bolitophile, imprimé dans le dixième volume des Annales des Sciences naturelles.
Un autre sur l'Eurypode, nouveau genre de crustacés, tome 16e des Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.
Un autre sur un nouveau genre, Themisto, de la même classe, tome 4e des Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris.
Iconographie du règne animal, in-4°., 1829. Il en a déjà paru cinq fascicules.
Il a rédigé divers articles de la partie des insectes de l'Encyclopédie méthodique, et il a donné l'explication des planches du même ouvrage, relatives à ces animaux.
GULDENSTEDT (Jean-Antoine), de Riga, né en 1745,
[page] 369
mort à Pétersbourg en 1781; voyageur au service de Russie, de 1768 à 1775.
Son voyage a été publié en allemand, 2 vol. in-4°. Pétersbourg, 1787—1791.
Nous citons aussi plusieurs de ses Mémoires imprimés parmi ceux de l'Académie de Pétersbourg.
GUILD. — LANSDOWN GUILDING.
Histoire naturelle du Lamia amputator. Transactions Linnéennes, tom. XIIIe,
GUNNER (Jean-Ernest), évêque de Drontheim en Norvège, né en 1718, mort en 1773.
Je cite quelques Mémoires insérés parmi ceux de la Société de Drontheim, et de celle des Sciences de Copenhague.
GYLLENH. — GYLLENHAL (Léonard), naturaliste suédois. Nous citons:
La quatrième partie du tome premier de son ouvrage intitulé: Insecta Suecica, 1 vol. in-8°. Lipsiæ, 1827.
H.
HAAN (Guill. DE), conservateur du Musée royal des Pays-Bas, à Leyde.
Monographiæ Ammoniteorum et Goniatiteorum specimen. Leyde, 1825, in-8°.
HAGENB.—HAGENBACH (Jean-Jacques), l'un des conservateurs du Musée royal de Leyde, mort en 1826.
Mormolyce novum genus, 1 vol. in-8°., avec une planche. Nurembergæ, 1825.
HAMM. — HAMMEL (Arvid-David).
Essais Entomologiques, n° 1 6, in-8°. Pétersbourg, 1821—1827.
Quelques observations sur la Blatte germanique, in-8°, St.-Pétersbourg, 1821.
[page] 370
HAMMER (Louis-Frédéric), professeur d'histoire naturelle à Strasbourg, gendre de feu Hermann.
Nous citons son Mémoire sur l'autruche d'Amérique, dans les Annales du Muséum.
HARDWICKE (Thomas), général anglais, qui a séjourné dans les Indes.
Je cite plusieurs de ses Mémoires dans les Transactions Linnéennes.
HARLAN (Richard), naturaliste américain, professeur à Philadelphie.
Auteur de Mémoires intéressants, parmi ceux du lycée de New-Yorck et de l'Ac. des Sc. nat. de Philadelphie; mais surtout d'une Fauna boreali Americana, 1 vol. in-8°. Philad., 1825, qui est l'histoire des quadrupèdes de ce pays.
HARRIS (G. P.), naturaliste anglais.
Je cite sa descript. de deux nouvelles espèces de didelphes, insérée dans les Trans. Linn., tome IX.
HARR. — HARRIS (Moyse), peintre anglais.
An exposition of english Insects, en anglais et français, 1 vol. in-4°., avec figures coloriées. Londres, 1781.
HART. — HARTMANN, peintre et graveur d'histoire naturelle, à Saint-Gall.
Auteur d'un système des coquillages terrestres et fluviatiles de la Suisse.
HASSELQUIST (Frédéric), naturaliste suédois, un des premiers élèves de Linnæus, né en 1722, mort en 1752.
Son Voyage en Orient a été publié par Linnæus en suédois, avec les descriptions des animaux et des plantes, en latin. Stockh., 17.
Il y en a une traduction française, sans les descriptions, 1 vol. in-12. Paris, 1769.
HASSELT (J.-C. Van), jeune médecin et naturaliste hollandais, ami et compagnon de Kuhl, auquel il n'a survécu que peu de mois.
[page] 371
HEGETSCH. — HEGETSCHWEILER (Jean-Jacques), naturaliste suisse.
Dissertatio Inauguralis Zootomica de insectorum genitalibus, 1 vol. in-4°. Turici, 1820.
HELW. — HELWIGG (Jean Chrétien-Louis).
Fauna Etrusca, etc. Petri Rossii, iterum edita et annotatis perpetuis aucta; 1 voi. in-8°. Helmstadii, 1755. (Voyez Iliger).
HERBST (Jean - Frédéric - Guillaume), prédicateur à Berlin, né en 1743.
Son Traité sur les Coléoptères, ayant pour titre: Natursystem aller bekanten in und auslœndischen insekten, etc., von Carl. Gustaf Jablonsky forgesetz, von J. F. W. Herbst. 10 vol. in-8°., avec un atlas de planches enluminées, pour chaque tome. Berlin, 1785, et années suivantes.
Son Traité sur les Crustacés: Versuch einer naturgeschichte der Kraben und Krebse, 3 vol. in-4°., avec 62 planches enluminées. Berlin, 1790—1803; compilation utile, entremêlée de plusieurs figures nouvelles.
Natursystem der ungeflugelten Insecten. Les genres: solpuga, tarentula et phalangium; 1 vol. in-4°., avec fig. enlum. Berlin, 1797.
Natursystem der ungeflugelten Insekten. Le genre scorpio, 1 vol. in-8°., Berlin, 1708.
Archiv der Insecten geschichte, herausgegeben, von J. Casp. Fuesly, 1 vol. in-4°., avec fig. enlum., Zurich, und Wintertkar., 1791. Cet ouvrage a été traduit en français.
Il a aussi donné une Monographie du genre papilio, de Linnæus, représentant toutes les espèces, mais que je n'ai pas citée, parce que la plupart des figures ne sont que des copies.
HERM.—HERMANN (Jean), né en 1738, mort en 1800; professeur à Strasbourg, naturaliste laborieux et érudit.
Tabula affinitatum animalium, 1 vol. in-4°. Strasbourg, 1783.
[page] 372
Observationes Zoologicœ posthumœ, 1 vol. in-4°. Strasbourg et Paris, 1804.
HERMANN (Jean-Frédéric), fils du précédent, né en 1768, mort avant son père en 1793,
A laissé un Mém. aptérologique, 1 vol. in-fol. Strasbourg, 1804.
HOEV. ou VANDER HOEV. — VANDER HOEVEN (Jean), professeur à Leyde.
Auteur d'un Manuel de Zoologie en Holland., 2 vol. in-8°, Delft., 1827. D'une Thèse de Sceleto piscium. Leyde, 1822, in-8°. D'un Mémoire sur l'ornithorhynque, etc.
HOFMANSECK (N., comte DE).
Savant naturaliste Saxon, zélé protecteur de la science, a donné différents mémoires sur des animaux du Brésil et du Portugal.
HOLTEN, naturaliste danois.
Cité pour un Mémoire inséré dans le Ve volume de la société d'Hist. nat. de Copenhague.
HOM. — HOME (sir Everard), chirurgien célèbre, conservateur du cabinet de Hunter à Londres, membre de la Société royale.
Je cite plusieurs de ses Mémoires dans les Transactions philosophiques, et son ouvrage intitulé: Lectures on comparative anatomy, 6 vol. in-4°. Londres 1814–1828.
HOPP. — HOPPE (David-Henri), apothicaire à Ratisbonne.
Enumeratio Insectorum elytratorum Indigenorum, 1 vol. in-4° avec planches color. Erlangæ, 1795, ouvrage utile pour la connaissance du genre des donacies.
HORNSTEDT, suédois, voyageur à Java.
Cité pour un Mémoire sur l'Acrocorde, parmi ceux de Stockholm, de 1787.
[page] 373
HORSF. — HORSFIELD (Thomas), naturaliste anglais.
Auteur de Recherches zoologiques à Java et dans les îles voisines. Londres, 1825, in-4° avec de belles figures.
De la première livraison, in-4°. Londres, 1828, d'un catalogue descriptif des lépidoptères du Muséum de la compagnie des Indes.
HOUTT. — HOUTTUYN (Martin).
A donné quelques Mémoires parmi ceux de l'Académie de Harlem; une traduction hollandaise développée du système de Linnæus, etc. Il est aussi le continuateur de l'Histoire des Oiseaux des Pays-Bas de Nosemann.
HUB. (Franç.) — HUBER (François), correspondant de l'Académie des Sciences à Genève.
Privé de la vue, et cependant un des observateurs qui ont montré le plus de perspicacité.
Nouvelles Observations sur les Abeilles, 2 vol. in-8° avec figures. Paris et Genève, 1814. Le second volume est de son fils.
HUB. (Pier.) — HUBER (Pierre), fils du précédent.
Recherches sur les mæurs des Fourmis indigènes, 1 vol. in-8° avec figures. Paris et Genève, 1810.
Observations sur les Bourdons, dans le tome sixième des Transactions de la société Linnéenne.
HUBN. — HÜBNER (Jacques), peintre à Augsbourg.
Son ouvrage iconographique sur les Lépidoptères d'Europe, est le plus parfait et le plus complet qu'on ait publié en ce genre. Le texte est en allemand. Il va aussi donner les Lépidoptères exotiques. Il en a déjà paru plusieurs planches; leur nombre total (format grand in-8°) s'élève à près de mille.
HUMB. — HUMBOLDT (Alexandre DE), né à Berlin en 1769, membre de l'Académie des Sciences, de l'Académie de Berlin, etc.
Je cite principalement de cet illustre et savant voyageur, les Observations de Zoologie et d'Anatomie com-
[page] 374
parée, dont nous avons déjà qnatorze livraisons grand in-4°. Paris, 1811 à 1827.
HUNTER (Jean), célèbre chirurgien écossais établi à Londres, né en 1728, mort en 1793.
Dont je cite le Traité sur les Dents, et différents Mémoires insérés dans les Transactions philosophiques.
HUZARD fils.
Auteur avec M. PELLETIER, de recherches sur le genre HIRUDO. Paris, 1825.
I.
IL., ILIG., ou ILIGER. — ILIGER (Jean-Charles-Guillaume), professeur à Berlin, mort jeune.
Nous citons de lui Prodromus systematis Mammalium et Avium, 1 vol. in-8°. Berlin, 1811. Ouvrage remarquable par la précision qu'il a cherché à donner aux genres de ces deux classes, et par l'élégance des noms qu'il leur a imposés.
Catalogue des insectes de Prusse (en allemand.) Verzeichniss der Kœfer Preussens, commencé par Théophile Kugelann, terminé par Jean Iliger; 1 vol. in-8°. Hall., 1798.
Magazin für Insectenkunde, 7 vol. in-8°. Brunsvic; 1801–1807.
Systematisches verzeichniss von den schmetterlingen der wiener gegend, 2 vol. in-8°. Brunsvic, 1801.
C'est une nouvelle édition du Catalogue systématique des Lépidoptères des environs de Vienne en Autriche. Il a continué l'édition de la Faune étrusque de Rossi, commencée par Hellwigg. Fauna etrusca, etc., tomus secundus, in-8°. Helmstadii, 1807.
ITTIOL. VERON. — ITTIOLITOLOGIA VERONESE.
Grand ouvrage sur les poissons pétrifiés du mont Bolca, où malgré sa magnificence ils ne sont ni bien rendus ni bien caractérisés.
[page] 375
J.
JACQ.—JACQUIN (Nicolas-Joseph DE), célèbre botaniste, professeur à Vienne, né à Leyde en 1727; mort en 18..
Nous citons ses Miscellanea austriaca, 2 vol. in-4°. Vienne, 1778 et 1781, où se trouvent quelques articles sur les animaux.
JACQ. — JACQUIN (Joseph-François DE), fils du précédent;
A donné des matériaux pour l'Histoire des Oiseaux, en allemand, 1 vol. in-4°, où se trouvent quelques figures d'oiseaux rares. Vienne, 1784.
JOHNS. — (J. RAWLINS JOHNSON), naturaliste anglais.
Traité de la Sangsue médicinale, en augl. Londres, 1816, in-8°, et deuxième partie, ib., 1825.
— Observations sur le genre planaire, dans les Trans. philos. Londres, 1822. Et continuées en 1825.
JOUR. D'HIST. NAT.
Nous désignons ainsi un ouvrage périodique dont il n'a paru que 2 vol. in-8°, et dont la réunion porte pour titre: Choix de Mémoires sur divers objets d'Histoire naturelle, par MM. Lamarck, Bruguières, Olivier, Haüy et Pelletier. Paris, 1792.
JOURN. DE PHYS.
Je cite ainsi les Observations sur la Physique, l'Histoire naturelle et les Arts, dont il a paru 2 vol. par an, depuis 1773 jusqu'en 1823.
D'abord sous la direction de l'abbé Rozier; ensuite sous celle de Jean-Claude de Lametherie, médecin, professeur adjoint au collége de France; enfin sous celle de M. de Blainville.
[page] 376
JURINE (Louis), professeur d'anatomie et de chirurgie à Genève.
Nouvelle méthode de classer les Hyménoptères et les Diptères, avec fig. Hyménoptères, tome 1, in-4°. Genève, 1807; ouvrage supérieurement exécuté, et indispensable pour l'étude des insectes de cet ordre.
Observations sur le Zenos vesparum, Mémoire in-4°, avec une planche, 1816.
Observations sur les ailes des Hyménoptères, Mémoire avec planches, imprimé dans le vingt-quatrième volume des Mémoires de l'Académie des sciences de Turin.
Histoire des Monocles, 1 vol. in-4°, avec planches. Gen., 1820.
Son second fils, dont on doit regretter la perte, a publié, dans le tome septième des Annales du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, un excellent Mémoire sur l'Argule foliacé. (Voyez le tome III, pages 64 et 65 de cet ouvrage.)
K.
KÆMPF. — KÆMPFER (Engilbert), médecin allemand, né à Lemgo dans le comté de la Lippe en 1651, mort en 1713, voyageur en Perse, aux Indes et au Japon.
Amœnitatum exoticarum, Fascic., V. Lemgo, 1712, in-4°,
Description du Japon, en allemand, traduite en français sous le titre d'Histoire naturelle, civile et ecclésiastique du Japon. La Haye, 1729, 2 vol. in-fol.
KAUP, naturaliste allemand.
Auteur de notes sur les reptiles dans l'Isis d'Oken.
KIRB. — KIRBY (William), Anglais, membre de la société Linnéenne, recteur de Barham dans le comté de Suffolk, etc.
Monographia Apum Angliœ, 2 vol. in-8° avec figures. Ipswich, 1802.
Il a publié, dans les Transactions de la société Lin-
[page] 377
néenne, une Monographie des apions d'Angleterre, t. IX, et celle des insectes de l'ordre des Strepsiptères, avec fig., tome XI.
Il vient de publier, conjointement avec M. Spence, une nouvelle édition de l'ouvrage ayant pour titre: An Introduction to Entomology. London, 1828, 4 vol. in-8°., avec figures.
Il a inséré dans les transactions Linnéennes et dans le Zoological journal plusieurs Mémoires sur divers insectes et dont nous avons cité les principaux.
KLÉEM. — KLÉEMANN (Chrétien-Frédéric-Charles), peintre de Nuremberg, né en 1735, et mort en 1789.
A donné un supplément à l'ouvrage de Rœsel, son beau-père, sur les insectes, qui en forme le cinquième volume. Beytræge zur natur oder insecten - geschichte, 1 vol. in-4°. Nürnberg, 1761.
KL. ou KLE. — KLEIN (Jacques-Théodore), né en 1685, mort en 1759; secrétaire du sénat de Dantzick, auteur laborieux, qui a écrit sur toutes les parties de l'Histoire naturelle, mais sans goût et sans génie.
Nous citons de lui: Summa dubiorum circa classes quadrupedum et amphibiorum Linnœi. 1743;
Quadrupedum dispositio et brevis historia naturalis. 1751;
Historiœ avium prodromus. 1750.
Stemmata avium. 1759;
Tentamen herpetologiœ. 1755;
Historiœ nat. piscium promovendœ missus V. 1740–49;
Mantissa ichtyologica. 1746;
Methodus ostracologica. 1753;
Descriptiones tubulorum marinorum. 1737;
Naturalis dispositio echinodermatum. 1734.
KLUG. — KLUG (François), docteur en médecine à Berlin.
Monographia siricum Germaniœ, atque generum illis
TOME III. 25
[page] 378
adnumeratorum, cum tabulis æneis coloratis VIII, 1 vol. in-4°. Berolini, 1803.
Plusieurs Mémoires sur divers genres ou espèces d'hyménoptères, dans le Recueil de la Société des Naturalistes de Berlin.
Une Revue critique des genres de Fabricius, dérivant de celui des apis de Linnæus, dans le Magasin Entomologique d'Illiger, 1807.
Entomologische monographien, 1 vol. in-8°, avec fig. Berlin, 1824.
Proscopia, novum genus insectorum orthopterorum, in-folio, avec deux planches.
Entomologiœ Brasilianœ specimen, et monographies en allemand.
KNOCH (Auguste-Guillaume).
Nouveaux matériaux pour la connaissance des insectes; en allemand: Neue beytraege zur insectenkunde, 1 vol. in-8°., avec fig. Leipzig, 1801.
KNORR, et WALCH, sur Knorr, etc., ou WALCH, pétrific. de Knorr.
KNORR (George-Wolgang), graveur de Nuremberg, né en 1705, mort en 1761;
WALCH (Jean-Ernest-Emanuel), professeur à Jéna;
Ont donné ensemble: Recueil des monuments des catastrophes que le globe terrestre a essuyées, contenant des pétrifications, etc., 4 vol. in-fol. Nuremberg, 1775–1778.
Je les cite pour quelques coquilles et lithophytes.
Je cite encore sous le titre: KNORR VERGN, ou KNORR. DELIC., un ouvrage du même graveur, dont il y a des éditions en plusieurs langues, intitulé, en allemand, Vergnügungen, etc.; en latin, Deliciœ, etc; et en franç., Amusements des yeux et de l'esprit, ou Collection de Coquillages, etc., en 6 vol. in-4°. Nuremb., 1760–1773.
KOEHLR. — KOEHLREUTER (Joseph-Gottlieb).
Nous citons plusieurs de ses Mémoires insérés dans les Novi Comment. acad. Petrop.
[page] 379
KRUSENSTERN, amiral russe.
Dont le Voyage autour du monde contient plusieurs observations d'histoire naturelle par M. Tilesius.
KUHL (Henri), jeune naturaliste de Hanau, né en 1797, mort à Batavia, où il faisait des recherches pour le Musée des Pays-Bas, avec un jeune hollandais, nommé Van Hasselt. Leurs récoltes étaient immenses dans toutes les classes.
On a de Kuhl, Matériaux pour la Zoologie et l'anatomie comparée, en allemand, des Monographies des Perroquets, des Petrels, des Chauve-souris d'Allemagne, etc.
L.
LAC. ou LACEP. — LACÉPÈDE (Bernard-Germain-Etienne, de la Ville, comte DE), professeur au Muséum d'hist. nat., membre de l'Académie des Sciences, etc., etc., né à Agen.
J'ai beaucoup cité ses trois ouvrages principaux, qui font suite à la grande Histoire naturelle de Buffon.
Histoire naturelle, générale et particulière des Quadrupèdes ovipares et des Serpents, 2 vol. in-4°. Paris, 1788 et 1789.
Histoire naturelle, etc., des Poissons, 5 vol. in-4°. Paris, 1798–1803.
Histoire naturelle, etc., des Cétacés, 1 vol. in-4°. Paris, 1804; et quelques Mémoires dans les Annales du Muséum.
LAET (Jean de), géographe d'Anvers au 17e siècle.
Novus Orbis, seu Descriptionis Indiœ Occidentalis, lib. XVIII. Leyde, 1633, 1 vol. in-fol.
LAICH. — LAICHARTING (Jean-Népomucène DE), professeur à Inspruck, né en 1754.
Verzeichniss der Tyroler insecten, 2 t. in-8°., avec fig. Zürich, 1781–1784.
25*
[page] 380
LAM. — LAMARCK (Jean-Baptiste DE MONNET, chevalier DE), professeur au Muséum d'hist. nat., membre de l'Académie des Sciences, né à Basentin en Picardie en 1743, mort à Paris en décembre 1829.
Parmi les nombreux ouvrages de ce célèbre naturaliste, je cite principalement: Système des Animaux sans vertèbres. Paris, 1801, 1 vol. in-8°.
Extrait du Cours de Zoologie sur les Animaux sans vertèbres, br. in-8°. Paris, 1812.
Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres, 7 vol. in-8°. Paris, de 1815 à 1822.
Et ses Mémoires sur les Coquilles, dans les Annales du Muséum.
L'auteur étant devenu aveugle pendant la rédaction de cet ouvrage, a été aidé pour les Bivalves, par M. Valenciennes, et pour les classes suivantes, par mademoiselle Lamarck sa fille ainée.
LAMARTINIÈRE.
Naturaliste français, l'un des malheureux compagnons de La Peyrouse, cité pour un Mémoire sur quelques animaux parasites, inséré dans le journal de Physique de 1787, et à la suite du Voyage de La Peyrouse.
LAMBERT, naturaliste anglais.
Auteur d'un Mémoire sur le Bos frontalis. Trans. Linn., VII.
LAMOUROUX (J. V. F.), naturaliste d'Agen, professeur à Caen.
Cité pour quelques Mémoires dans les Annales du Muséum, et pour une Histoire des Polypiers, que j'avais vue en partie manuscrite, lors de ma première édition, elle a été imprimée en 1817, 1 vol. in-8°.
Il a donné ensuite Exposition méthodique de l'ordre des Polypiers, avec les planches d'Ellis et Solander, et quelques planches nouvelles. Paris, 1821, in-4°.
Et un Dictionnaire des Zoophytes, qui fait partie de l'Encyclopédie méthodique. Paris, 1824, in-4°.
[page] 381
LANGSDORF, naturaliste allemand, qui a voyagé avec l'amiral Krusenstern, et s'est établi au Brésil.
On a de lui quelques Mémoires, et je le cite comme ayant donné des noms à divers objets qu'il a découverts.
LAPEYR. — LAPEYROUSE (Philippe PICOT, baron DE), professeur d'histoire naturelle à Toulouse.
Description de plusieurs espèces d'Orthoceratites et d'Ostracites, 1 vol. in-fol. Nuremb., 1781.
Je cite aussi quelques articles insérés dans le Dictionnaire des Oiseaux de l'Encyclopédie méthodique.
LAROCHE (DE), jeune médecin de Paris, trop tôt enlevé aux sciences.
On a de lui quelques Mémoires dans les Annales du Muséum, surtout un dans le tome XIII, sur les Poissons d'Iviça.
LASP. — LASPEYRES (Jacques-Henri), officier municipal à Berlin.
Sesiæ Europeæ iconibus et descriptionibus illustratæ, 1 vol. in-4°. Berolini, 1801.
Des Observations critiques sur le Catalogue systémamatique des Lépidoptères des environs de Vienne, insérées dans le Magasin des Insectes d'Illiger, etc.
LATH. — LATHAM (Jean), membre de la Société royale, né en 1740.
Il a surtout enrichi l'Ornithologie de belles espèces nouvelles; mais ses ouvrages sans critique veulent être lus avec précaution.
General synopsis of Birds, 3 vol. in-4°, et deux Suppléments. Lond., 1782–178:
Index Ornithologicus, 2 vol. in-4°. Lond., 1790.
LAT. — LATREILLE (Pierre-André), de l'Acad. royale des Sciences, etc., né à Brives en 1762.
Ses principaux ouvrages cités, sont:
Histoire naturelle des Salamandres, 1 vol. in-8°, avec fig. Paris, 1800.
[page] 382
Histoire naturelle des Reptiles, faisant suite à l'édition de Buffon, de Déterville, 4 vol. petit in-12, avec fig.
Précis des caractères génériques des Insectes, 1 vol. in-8°. Brives, 1796.
Genera Crustaceorum et Insectorum, 4 vol. in-8°, avec fig. Paris, 1806–1807.
Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes, faisant suite à l'édition de Buffon de Sonnini, 14 vol. in-8°, avec fig. Paris, 1802–1805.
Histoire naturelle des Fourmis, 1 vol. in-8°, avec fig. Paris, 1802.
Ses Mémoires insérés dans les Annales du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.
La partie Entomologique, à laquelle il a coopéré, dans le nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, dans l'Encyclopédie méthodique, et cette partie tout entière dans le Recueil d'Observations de Zoologie et d'Anatomie comparée, ou la deuxième partie du Voyage de MM. Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland.
Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris, in-4°.
Esquisse d'une distribution générale du règne animal, in-8°, 1824.
Familles naturelles du règne animal, 1 vol. in-8°. Paris, 1825.
Divers Mémoires généraux sur les insectes, imprimés dans le Recueil de ceux du Muséum d'Histoire naturelle.
Description des insectes, recueillis par M. Cailliaud dans son Voyage en Nubie, et faisant partie de sa relation.
La partie Entomologique de la seconde édition du nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, et divers articles du Dictionnaire classique d'Histoire naturelle, ainsi que de l'Encyclopédie méthodique, même partie.
La description (Annales de Sciences naturelles) d'un nouveau genre d'Aranéides, etc.
LAUR ou LAURENT. — LAURENTI (Joseph-Nicolas), médecin à Vienne en Autriche.
Specimen medicum exhibens synopsin Reptilium emendatam. Vienne, 1768, in-8°.
[page] 383
On dit que cette thèse est l'ouvrage de Winterl, qui depuis a été célèbre comme chimiste paradoxal.
LEACH. — LEACH (William-Elford), naturaliste anglais, docteur en médecine; l'un des conservateurs du Muséum britannique.
Une Monographie du genre Meloe, insérée dans les Transactions de la Société Linnéenne, avec figures.
Malacostraca podophthalma Britanniæ, avec de belles planches enluminées, in-4°. London, 1815 et 1816. Il en a paru huit cahiers.
A general Arrangement of the Classes crustacea, Myriapoda and Arachnides, faisant partie du tome onzième des Transactions de la Société Linnéenne. On en a donné un extrait dans le Bulletin de la Société philomatique.
On the Classification of the Natural tribe of Insects Notonectidea. Mémoire imprimé dans le douzième voldu Recueil de ceux des Transactions de la Société Linnéenne.
Descriptions of some new genera and species of animals, discovered in Africa, by T. C. Bowdich, une demi-feuille, in-4°.
Zoological Miscellany, 3 vol. in-8°. London, 1817.
On the genera and species of proboscideous insects, 1 vol. in-8°, avec fig. Edimbourg, 1817.
Appendix n° 10 a general notice of the animals taken by M. John Cranch, during the expedition to explore the source of the river Zaire, in-4°.
Plusieurs articles du Dictionnaire des Sciences naturelles relatifs aux crustacés, et des Mémoires insérés dans les Transactions Linnéennes.
LE CL. — LE CLERC, naturaliste à Laval.
Observations sur la corne du psile de Bosc, présentées à l'Académie des Sciences, en 1815, et plusieurs autres observations très intéressantes.
[page] 384
LEC. — LECOMTE, officier d'artillerie au service des Etats-Unis.
Auteur de plusieurs Mémoires sur les Quadrupèdes, les Reptiles, etc., parmi ceux de l'Académie des Sciences nat. de Philadelphie.
LEFEBV. — LEFEBVRE (Alexandre), naturaliste français.
Á publié dans les Annales de la Société Linnéenne de Paris, la description de divers insectes, inédits, recueillis par lui en Sicile, ainsi que celle de trois Lépidoptères.
LEGUAT (François), protestant bourguignon, réfugié en Hollande.
Voyages et Aventures de Fr. Leguat et de ses compagnons. Londres, 1720, 2 vol. in-12. Il y a quelques figures d'animaux de mérite très divers.
LEISLER.
Auteur d'un Supplément aux oiseaux de l'Allemagne, de Bechstein. Hanau, 1812 et 1813.
LEPEL. — LEPELLETIER DE ST. FARGEAU (Amédée), naturaliste de Paris.
Une Monographie des Chrysis des environs de Paris, Annales du Mus. d'Hist. nat. n° 58.
Un Mémoire sur les Araignées, Bulletin de la Société philom. avril, 1813, n° 67.
Monographia tenthredinetarum Synonymia extricata. Paris, 1823, 1 vol. in-8°.
Conjointement avec M. De Serville, la partie des insectes du dixième volume de l'Entomologie de l'Encyclopédie méthodique.
Il a communiqué à l'Académie des Sciences des Observations sur les accouplements de diverses espèces de Volucelles, genre de Diptères.
[page] 385
LESKE (Nathanaël-Godefroy), professeur à Leipsick, et ensuite à Marburg, né en 1752, mort en 1786.
Museum Leskeanum. Regnum animale, 1 vol. in-8°, avec figures enlum. Lipsiæ, 1789.
Je le cite aussi pour l'édition augmentée qu'il a donnée du Traité des Oursins de Klein. Leipzig, 1778, 1 vol. in-4°.
LESSON (René-Primevère), naturaliste, avec M. Garnot, de l'expédition de la Coquille, commandée par le capitaine Duperrey.
Ces deux naturalistes en ont rédigé la partie zoologique, qui n'est pas encore terminée.
On a en outre de M. Lesson, Manuel de Mammalogie. Paris, 1827, 1 vol.-in 12.
Manuel d'Ornithologie, 2 vol. in-12. Paris, 1828.
Manuel de l'Hist. des Molusques et de leurs Coquilles. 2 vol. in-12. Paris, 1829.
Il publie en ce moment, l'Histoire des Oiseaux Mouches, avec de très belles figures.
LESUEUR (Charles-Alexandre), du Havre.
L'un des dessinateurs embarqués avec Baudin, et l'un des coopérateurs les plus zélés et les plus utiles de Péron dans les recherches de Zoologie. Il a donné quelques observations zoologiques dans le Bulletin des Sciences, et le programme d'un grand ouvrage sur les Méduses, avec plusieurs échantillons des planches, et depuis plusieurs Mémoires dans ceux de l'Ac. de Sc. nat. de Philadelphie. Les Mémoires du Muséum d'Hist. nat., etc.
LEUKARD (Fred.-Sigism.)
Fragments zoologiques. Helmstadt, 1819. Les Mollusques dans le voyage de Ruppel.
LEW. — LEWINS (Jean-Guillaume).
Natural History of Lepidopterous Insects of New South Wales, 1 vol. in-4°, avec des planches coloriées. London, 1805. Il a aussi écrit sur les Oiseaux de ce pays, nat., Hist. of Birds of New-Holland.
[page] 386
LICHT. — LICHTENSTEIN (Antoine-Auguste-Henry), professeur de langues orientales à Hambourg, né en 1753.
Une Dissertation sur le genre des Mantes de Linnæus, dans le sixième volume des Transactions de la Société Linnéenne.
LICHTENSTEIN (Henri), professeur à Berlin.
Voyage au cap de Bonne-Espérance, 2 vol. in-8°. Berlin, 1811.
Et plusieurs Mémoires sur les Antilopes, les Gerboises, les Animaux de Margrave, etc.; parmi ceux de l'Académie de Berlin.
LINDROTH, naturaliste suédois.
Cité pour un Mémoire inséré dans le XIX vol. des nouv. Mém. de Stockholm.
LINK (Jean-Henri), médecin de Leipzig, né en 1674, mort en 1734.
De Stellis marinis, liber singularis, publié par Christ. Gabr. Fischer, 1 vol. in-fol. Leipsig, 1733.
L. ou LINN. — LINNÆUS (Charles), autrement, chevalier DE LINNÉ, né en 1707, mort en 1778, professeur d'histoire naturelle à Upsal, auteur de la grande réforme de la nomenclature en l'Histoire naturelle.
Je cite de lui, 1° Systema Naturœ, nommément l'édition Xe de 1757; l'édition XIIe de 1766; et surtout l'édition XIIIe donnée par Gmelin, à Leipsig, 1788, 7 vol. in-8°, pour les animaux;
2° Amænitates Academicœ, recueil de thèses, en 10 vol. in-8°, de 1749–1790;
3° Musæum Adolphi Frederici regis, 1 vol. in-fol. Stockh., 1754, avec 33 planches.
Il cite lui-même dans ses autres ouvrages un deuxième volume de celui-ci, qui est un petit in-8°.
4° Musæum Ludovicæ Ulricæ reginæ, 1 vol. in-8°. Stockholm, 1764.
5° Fauna Suecica, 1 vol. in-8°, première édition, 1746;
[page] 387
deuxième édition, 1761; troisième, par Retzius. Leipzig, 1800, ne comprenant que les vertébrés.
LINN. SOC., ou SOC. LIN., ou LINN. TRANS.
Transactions de la Société Linnéenne de Londres, 13 vol. in-4°. Londres, 1791, et années suivantes.
LISTER (Martin), naturaliste anglais, médecin de la reine Anne, mort en 1711.
Historia sive Synopsis methodica Conchyliorum, 1 vol. in-fol. Lond., de 1685 à 1693, contenant 1059 planches sur 438 feuillets.
Il y en a une réimpression avec la synonymie de Linnæus, par Guillaume HUDDESFORD. Lond., 1770.
Historia animalium Angliœ, de araneis, de cochleis tum terrestribus tum fluviatilibus, de cochleis marinis. Londres, 1678.
La partie concernant les araignées se trouve aussi dans l'His. des Insect., de Rai.
LYON. — LYONNET (Pierre), né en 1707, mort en 1789, secrétaire interprète des états-généraux.
Traité anatomique de la Chenille du saule, in-4°. La Haye, 1762, avec des planches gravées par l'auteur; ouvrage qui est à la fois le chef-d'œuvre de l'anatomie et celui de la gravure.
M.
MACL. — MACLEAY (W.-S.), de la Société Linnéenne de Londres.
Horæ entomologicæ, in-8°, tome I, en deux parties, avec planches. London, 1819 et 1821.
Annulosa Javanica, in-4°, avec planches, 1 fascio. London, 1825.
Il a aussi publié quelques Mémoires généraux sur les Insectes, mais dont nous n'avons point fait mention dans cet ouvrage.
[page] 388
MACCAR. — MACCARI (Pierre), membre associé de la Société de Médecine de Marseille, etc.
Mémoire sur le Scorpion qui se trouve sur la montagne de Cette, département de l'Hérault, etc., 1 vol. in-8°, 1810.
MACQ. — MACQUART (Jean), de la Société royale des Sciences, d'Agriculture et des Arts de Lille.
Il a publié dans le Recueil des Mémoires de cette Société, formant 4 volumes in-8°, avec planches, et imprimés à Lille (1826–1829), une suite de Mémoires sur les Insectes diptères du nord de la France, avec des planches représentant leurs ailes.
MACRI (Xavier), naturaliste napolitain.
Nouvelles observations sur l'Histoire naturelle du poumon marin des Anciens (en italien). Naples 1778, 1 vol. in-8°.
MANN. — MANNERHEIM (C.-G.), conseiller de l'empereur de Russie.
Eucnemis insectorum genus, 1 vol. in-8°, avec deux planches. Petropoli, 1823.
Observations sur le genre Megalope, tome Xe, des Mémoires de l'Académie impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, 1824.
Description de quarante nouvelles espèces de Scarabæïdes du Brésil, in-4°, avec planches.
MANTELL (Gédéon), membre du coll. de Chir. de Londres, demeurant à Lewes.
Auteur d'illustrations de la Géologie du comté de Sussex, 2 vol. in-4°. Londres, 1822 et 1827.
MARGR. ou MARCR. — MARGRAV de Liebstad (George), de Meissen en Saxe, né en 1610, voyageur au Brésil, mort en Guinée en 1644.
Historiæ rerum naturalium Brasiliæ, libri 8, in-fol. Leyde et Amsterd., 1648; ouvrage excellent pour le temps, plein de descriptions exactes et de figures reconnaissables, quoique grossières de toutes sortes d'animaux.
[page] 389
MARSH. — MARSHAM, naturaliste anglais, trésorier de la Société Linnéenne, etc.
Entomologia Britannica, sistens Insecta Britanniæ indigena, secundum methodum Linnæanam disposita, tome I. Coleoptera. Londini, 1802.
Il a publié dans le neuvième volume des Transactions de la Société Linnéenne, une Monographie du genre Notoclea (celui de Paropsis d'Olivier), avec figures.
MARTENS (Frédéric), chirurgien hambourgeois.
Voyage au Spitzberg (en allemand). Hambourg, 1675, 1 vol. in-4°.
Encore utile pour les animaux de la mer glaciale.
MARTENS (George DE), secrétaire du tribunal suprême de Wirtemberg.
Auteur d'un Voyage à Venise, 2 vol. in-8°. Ulm, 1824; où il y a un Catalogue raisonné des poissons de ce port.
MARTINI (Frédéric-Henri-Guillaume), médecin de Berlin, né en 1729, mort en 1778; a commencé le grand ouvrage conchyliologique allemand, intitulé:
Cabinet systématique de Coquilles, in-4°, 10 vol., et 1 de supplément, avec fig. enlum. Nuremberg.
Les trois premiers volumes, 1769–1777, sont de lui; le reste est de Chemnitz.
MATHIOLE (Pierre-André), de Sienne, né en 1500, mort en 1577.
Dans son Commentaire sur Dioscoride, il entre dans quelques détails sur divers animaux.
MAUD. — MAUDUIT (René-Jean-Etienne), médecin de Paris, mort en 1792.
Auteur du Dictionnaire des Oiseaux de l'Encyclopédie méthodique.
MAUPERT. — MAUPERTUIS (Pierre-Louis MOREAU DE),
[page] 390
de l'Académie des Sciences, président de celle de Berlin, etc., né en 1678, mort en 1759.
Astronome et géomètre, il a fait aussi quelques Mémoires d'Histoire naturelle.
Expériences sur les Scorpions, Mémoires de l'Acad. des Sciences de Paris, 1731.
MAURICE DE NASSAU (le prince), ou plutôt le comte Jean-Maurice DE NASSAU-SIEGEN, né en 1604, gouverneur du Brésil pour les Hollandais, de 1637 à 1644.
Il y encouragea les travaux de Margrav, et peignit luimême plusieurs figures de poissons, qui ont été gravées d'après lui dans l'Ichthyologie de Bloch. Il mourut au service de Brandebourg en 1679.
MECKEL (Jean-Frédéric), professeur à Halle.
Nous citons ses Matériaux pour l'Anatomie comparée, Leipzig, 1808, in 8. (en allemand).
Son Traité sur l'Ornithorynque, in-fol. Leipzig, 1826.
MEGERLE DE MUHLFELD (J.-C.).
Auteur d'une Classification des coquilles bivalves insérée dans le Magasin de la Société des Amis de la nature de Berlin.
MEHLIS (Edouard).
De distomate Hepatico et Lanceolato. Gotting, 1825, in-fol.
MEIG. — MEIGEN (Jean-Guillaume), naturaliste allemand.
A publié, en cette langue, un ouvrage sur les Diptères d'Europe, composant maintenant 5 vol. in-8°, accompagné de planches, représentant une espèce au moins de chaque genre, avec les détails des caractères.
M. BAUMHAUER avait publié, en 1800, un extrait du même travail, sous le titre de: Nouvelle classification des Mouches à deux ailes, in-8°. Paris, 1800.
MÉM. DE LA SOC. D'HIST. NAT.
Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris.
[page] 391
C'est un volume in-4°, publié en 1799, chez Baudouin, et qui n'a pas eu de suite.
Il y en a sous le même titre un autre recueil en 3 vol. in-4°. 1823 et années suivantes.
MERIAN (Marie-Sibille), femme Graf, Allemande, établie en Hollande, née en 1647, morte en 1717;
A laissé deux ouvrages posthumes, remarquables par la beauté des figures:
De generatione et metamorphosibus Insectorum Surinamensium, 1 vol. in-fol. La Haye, 1726.
Histoire des Insectes d'Europe, trad. en franç. par Mairet, 1 vol. in-fol. Amsterdam, 1730.
MERREM (Blaise), ne à Bremen, professeur d'Histoire naturelle à Marpurg.
Je cite de lui: Avium rariorum et minus cognitarum icones et descr., 4 cah. in-4°. Leipz., 1786.
Matériaux pour l'histoire naturelle des Reptiles (en allemand), 2 cah. in-4°. Duisbourg et Lemgo, 1790. Il n'y est parlé que de serpents.
Tentamen Systematis amphibiorum, en latin et en allemand. Marpurg, 1820, 1 vol. in-8°.
MESNARD LAGR. — MESNARD DE LA GROYE, naturaliste d'Angers, mon suppléant au Collége de France, mort en 1827.
Auteur de différents Mémoires dans les Anuales du Muséum, le Journal de Physique, etc.
MEYER et WOLF.
Taschenbuch, etc. (Almanach des Oiseaux d'Allemagne), 2 vol. in-8°. Francf. 1810. Le premier volume contient les Oiseaux de terre par M. Wolf; le second les Oiseaux d'eau, par M. Meyer. Cet ouvrage est plein de très bonnes observations.
MIG. — MIGER (Félix), naturaliste à Paris.
Mémoire sur les Larves des insectes coléoptères aquatiques. Annales du Muséum d'Hist. nat.de Paris, tom. XIV.
[page] 392
MIK. — MIKAN (Jean-Chrétien), naturaliste de Bohême.
Monographia bombyliorum Bohemiæ, in-8°, avec fig. Prague, 1796.
MILLER (J.-S.), naturaliste anglais.
Auteur d'une Histoire naturelle des Crinoides, et d'un Mém. sur les Belemnites. Bristol., 1821, in-4°. Dans les Trans. de la Soc. géologique de Londres, 2e série 2e tom., 1re partie.
MITCHILL, médecin et sénateur à New-Yorck.
Je cite surtout de lui un Mémoire sur les poissons de New-Yorck, inséré dans le premier volume des Transactions de la Société de New-Yorck. Il en a publié d'autres dans ceux de l'Ac. des Sc. nat. de Philad., et du lycée de New-York, etc.
MOEHR. — MOEHRING (Paul-Henri-Gérard), médecin à Jever.
Avium genera. Aurich, 1752, in-8°.
MOLIN — MOLINA (l'abbé Jean-Ignace), ecclésiastique chilien établi en Italie.
Essai sur l'Histoire naturelle du Chili, publiée en italien; traduite en français par Gruvel, 1 vol. in-8°. Paris, 1789. Ouvrage fait de mémoire en Italie, et fort suspect en plusieurs endroits.
MONTAG. — MONTAGU (George), naturaliste anglais.
A donné des descriptions de diverses espèces d'oiseaux, de poissons, de mollusques, de crustacés, dans les Transactions de la Société Linnéenne, et dans celles de la Société Wernérienne de Londres.
MONTÈGRE, médecin de Paris, mort aux îles.
Cité pour un Mémoire sur les Vers de terre, dans les Mémoires du Muséum.
MONTF. — MONTFORT (Denis DE), homme singulier,
[page] 393
se disant ancien naturaliste du roi de Hollande, mort de misère dans une rue à Paris, en 1820 ou 1821.
Je cite principalement sa CONCHYLIOLOGIE SYSTÉMATIQUE, espèce de Genera Conchyliorum, où les genres sont très multipliés, et représentés par des figures en bois, faites par l'auteur et aussi exactes que le comporte ce genre de gravure.
On n'en a que 2 vol. in-8°, contenant seulement les univalves. Paris, 1808 et 1810.
Il est aussi l'auteur des quatre premiers vol. in-8°, de l'Histoire naturelle des Mollusques, qui fait suite au Buffon de Sonnini. Paris, 1802, où il a inséré des figures apocryphes. Ils ne contiennent que les généralités et les céphalopodes.
MOQUIN-TANDON (Alfred), médecin de Montpellier, professeur à Marseille.
Monographie de la famille des Hirudinées. Montpellier, 1826, in-4°.
MOREAU DE JONNÈS, correspondant de l'Institut.
Cité pour plusieurs Mémoires sur les animaux des Antilles.
MORREN (C.-F.-A.), naturaliste belge.
De Lumbrici terrestris Historia naturali, nec non anatomia, Bruxelles, 1829, in-4°.
MOUFF. — MOUFFET (Thomas), naturaliste anglais, médecin de la maison de Pembrock, mort vers 1600.
Insectorum sive minimorum animalium theatrum, 1 vol. in-fol., avec 500 fig. en bois. Londini, 1634;
Publié par Théodore DE MAYERNE, Français, médecin de Jacques 1er. C'est le premier ouvrage spécial sur les insectes.
STAT. MÜLL. — MÜLLER (Philippe-Louis-Statius), professeur à Erlang, né en 1725, mort en 1776;
A donné une mauvaise traduction allemande du Système de la Nature de Linnæus; d'après la traduction hollandaise développée de HOUTTUYN, 9 vol. in-8°. Nuremb., 1773–1776, pour les animaux seulement.
TOME III. 26
[page] 394
MÜLL. — MÜLLER (Otton-Frédéric), conseiller d'État danois, l'un des plus laborieux observateurs du 18e siècle, né en 1730, mort en 1784.
Je cite de lui: Von Würmern der süssen und salzigen wassers (des Vers de l'eau douce et salée), 1 vol. in-4.
Vermium terrestrium et fluviatilium Historia, 2 vol. in-4°.
Zoologia danica, in-fol. avec fig. color. Les trois premiers cahiers. Copenh., 1788 et 89, sont de lui. Le 4e d'Abilgaard, de Vahl, etc.
Zoologiæ danicœ prodromus, 1 vol. in-8°. Havniæ, 1776.
Entomostraca seu Insecta testacea, 1 vol. in-4°, avec fig. Lipsiæ et Havniæ, 1785.
Hydrachnæ, 1 vol. in-4°, avec figures coloriées. Lipsiæ, 1781.
Animalcula infusoria, 1 vol. in-4°.
N.
NACCARI (Louis-Fortuné), bibliothécaire du séminaire de Chioggia.
Auteur d'une Ittiologia adriatica, dans le journal de Physique de Pavie, 11e déc., tome V, 1822.
NARDO (Dominique), naturaliste italien, établi à Chioggia.
A donné des additions à l'ouvrage de Naccari, journal de Phys. de Pavie, XVII.
NATTERER, naturaliste autrichien.
Auteur de plusieurs observations intéressantes sui les animaux d'Allemagne; voyageur au Brésil.
NATURF. — NATURFORSCH.
Der Naturforscher (Le Naturaliste).
C'est le titre d'un journal allemand sur l'Histoire naturelle, dont il a paru à Halle 27 cahiers, depuis 1774 jusqu'en 1793.
Il est plein d'observations importantes et de bonnes figures.
[page] 395
NAUM. — NAUMAN (J.-A. et J.-F.), père et fils.
Histoire naturelle des Oiseaux d'Allemagne, excellent ouvrage dont les figures, quoique petites, sont parfaites. La deuxième édition que nous citons principalement (Leipzig, 1820, et suiv., in-8°) n'est pas terminée.
NEES D'ESENB., voyez GRAVENHORST.
NICOLS. — NICOLSON (le Père), dominicain irlandais, missionnaire à Saint-Domingue.
Essai sur l'Histoire naturelle de Saint - Domingue, in-8°, avec figures. Paris, 1776.
NIEREMBERG (Jean-Eusèbe), jésuite, professeur à Madrid.
Historia naturalis maxime peregrina, libris XVI, distincta. Anvers, 1633, in-fol.
Compilation peu estimée.
NILSON (S. V.), conservateur du Musée de Lund.
Auteur d'une Ornithologia suecica, 2 vol. in-8°. Copenhague, 1817 et 1821.
NITZSCH (Chrétien-Louis), professeur à Halle.
Auteur de plusieurs Mémoires sur l'ostéologie des Oiseaux, et les animaux sans vertèbres, dans les Recueils de Halle, de Bonn, etc.
Spiropterœ strumosæ descr. Halle, 1829, in-4°.
Matériaux pour la connaissance des animaux infusoires ou Description des Cercaires et des Bacillaires, en allemand. Halle, 1817, in-8°.
NOSEMAN (Corneille), mort en 1786;
A donné avec le graveur Chrétien SEPP, une Histoire des Oiseaux des Pays-Bas (en hollandais). Amsterdam, 1770 et ann. suiv., in-fol., remarquable par l'élégance des figures. Les derniers cahiers sont de HOUTTUYN.
26*
[page] 396
O.
OCHSENH. — OCHSENHEIMER (Ferdinand).
Son ouvrage en allemand, sur les Lépidoptères d'Europe, in-8°, est le meilleur pour la critique et la description des espèces. Le premier volume a paru à Leipsig, en 1806. Celui qu'il va mettre au jour comprendra les noctuelles.
ODIER. — ODIER (Auguste).
Mémoire sur la composition chimique des parties cornées des insectes, inséré dans le premier volume des Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris, 1823, in-4°.
OKEN, naturaliste allemand, de Fribourg en Brisgau, établi à Jéna.
Auteur d'une Philosophie de la Nature. Jéna, 1809, 3 vol. in-8°.
D'un Traité d'Histoire naturelle, dont la Zoologie forme la troisième partie en 2 vol. in-8°. Jéna, 1816, avec un Atlas.
D'une Histoire naturelle pour les écoles, 1 vol. Jéna, 1821.
D'une Esquisse de système d'Anatomie, de Physiologie et d'Histoire naturelle. Paris, 1821, in-8°.
Et principal rédacteur du journal l'Isis, où se trouvent de nombreux et importants articles d'histoire naturelle.
OLAFSEN (Eggert), ou Erard OLAVIUS, naturaliste islandais, né en 1726, mort en 1768.
Auteur avec Biorn POVELSEN ou PAULI, premier médecin de cette île, mort en 1778, d'un Voyage en Islande, imprimé en 1772, dont je cite la traduction française, 5 vol. in-8°, et un atlas. Paris, 1802.
OLIVI (l'abbé Joseph).
Zoologia Adriatica, 1 vol. in-8°, avec figures. Bassano, 1792.
On y trouve de bonnes observations sur les Mollusques, les Crustacés.
[page] 397
OLIV. — OLIVIER (Antoine-Guillaume), membre de l'Académie des Sciences, professeur de zoologie à l'École vétérinaire d'Alfort, etc., né à Draguignan en 1756, mort en 1814.
Entomologie, ou Histoire naturelle des Insectes (Coléoptères), 5 vol. in-fol., avec planches enluminées. Paris, 1789—1808.
Encyclopédie méthodique, Insectes, depuis le tome 4e de l'Histoire naturelle, jusqu'au 8e inclusivement.
Voyage dans l'empire Ottoman, l'Egypte et la Perse, 3 vol. in-4°, avec fig. Paris, 1807.
Il s'y trouve des espèces intéressantes de plusieurs classes d'animaux.
OMALIUS DE HALLOY, gouverneur de la province de Namur, savant géologiste.
OPPEL (Michel), naturaliste bavarois, mort en 18...
On a de lui les écrits suivants: Sur la classification des Reptiles, premier Mémoire sur les Ophidiens, deuxième Mémoire sur les Batraciens, insérés dans les Annales du Muséum; et (en allemand) les Ordres, Familles et Genres des Reptiles. Munich, 1811, in-4°.
Je le cite aussi pour un Mémoire sur le Tanypus (o seau), Mém. de l'Ac. de Munich, 1812.
Il avait commencé avec MM. Tiedeman et Liboschitz, un ouvrage sur les Reptiles, avec beaucoup de figures, dont il n'a paru que les Crocodiles. Heidelberg, 1817, in-folio.
OSBECK (Pierre), élève de Linnæus, aumônier d'un vaisseau suédois qui alla à la Chine en 1750.
On a sa relation en suédois. Stockh., 1757, in-8°, et traduite en allemand par Georgi. Rostock, 1765, in-8°.
OTTO (Adolphe-Guillaume), naturaliste allemand, professeur à Breslau.
Auteur de plusieurs Mémoires dans ceux de l'Académie des Sc. de la nature et d'autres collections.
[page] 398
Conspectus animalium quorumdam, etc. Breslau, 1821.
De Sternaspide Thalassemoideo et Siphostomate diplochaito. Breslau, 1820, in-4°.
P.
PALIS. DE BEAUV. — PALISOT, baron DE BEAUVOIS (Ambroise Marie-François-Joseph), de l'Académie des Sciences, né en 1755 mort en 1820.
Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, etc., in-fol., avec planches enluminées. Paris, 1805 et suiv.
PALL. — PALLAS (Pierre-Simon), l'un des grands zoologistes de nos jours, né à Berlin en 1741, mort en 1812.
Je cite ses
GLIR.
Novæ species Quadrupedum e Glirium ordine. Erlang, 1778, in-4°, avec 39 pl. enlum.
SPIC., ou SPIC. ZOOL.
Spicilegia Zoologica, 14 cahiers in-4°. Berl., 1767–1780.
MISCELL.
Miscellanea Zoologica, 1 cahier in 4°. La Haye, 1766.
VOY.
Voyage dans plusieurs provinces de l'Empire de Russie, traduct. française, 8 vol. in-8°, et un atlas. Paris.
NORD. BEYTR.
Neue Nordische Beytrœge, etc. (Nouveaux matériaux du Nord pour la Géographie, etc.) 7 vol. in-8°. Pétersbourg et Leipzig, 1781–1796.
Zoographia Russo - Asiatica, 3 vol. in-4°, ouvrage que l'on n'a pu encore rendre public, parce que les cuivries en sont égarés. Néanmoins l'Académie de Pétersbourg a bien voulu en accorder le texte à quelques naturalistes.
Et plusieurs de ses Mémoires insérés dans ceux de l'Académie de Pétersbourg.
[page] 399
PANZ. — PANZER (George-Wolfgang-François), médecin à Nuremberg, né en 1755.
Faunæ Insectorum Germanicæ initia, ou Deutschlands Insecten, 109 fascicules in-12, composés chacun de 24 planches enluminées. A Nuremberg, 1796 et suiv.
Un des ouvrages d'Entomologie des plus utiles, par l'exactitude des figures.
Entomologischer versuch uber die Jurineschen Gattungen der Linneischen hymenoptern, 1 vol. in-12. Nurnberg, 1806.
Index Entomologicus, pars prima, Eleutherata, 1 vol. in-12. Norimbergæ, 1813.
Il a encore publié sur les Insectes plusieurs autres ouvrages, mais que je n'ai point cités.
PARK. — PARKINSON (James), naturaliste anglais.
Oustlines of Oryctology, 1 vol. in-8° avec figures.
Organic remains of a former world, 3 vol. in - 4°. Londres, 1811.
PARRA (don Antonio), naturaliste américain:
A donné en espagnol: Description de différents morceaux d'Histoire naturelle, principalement de productions marines. La Havane, 1787, in-4°.
Il y décrit et représente beaucoup de poissons et de crustacés.
PASSER. — PASSERINI (Charles).
Des observations en italien sur le cri produit par le Sphinx atropus et dont M. Duponchel a donné un extrait.
PAYKULL (Gustave), conseiller du roi de Suède, de l'Académie de Stockholm.
Fauna suecica (Insecta), 3 vol. in-8°. Upsaliæ, 1800.
Ces trois volumes ne contiennent que l'ordre des Coléoptères: ses descriptions sont complètes et soignées.
Il a aussi publié de bonnes Monographies des genres Carabus, Curculio et Staphylinus, mais qu'il a incorporées avec cet ouvrage.
Il a donné: Monographia Histeroidum, avec les figures
[page] 400
de toutes les espèces, 1 vol. in-8°. Upsaliæ, 1811. Cette Monographie est supérieure aux précédentes, et indispensable pour l'étude des insectes de ce genre.
On a de lui quelques Mémoires sur les Oiseaux.
PECK. — PECK (William), professeur de botanique à l'Université d'Harvard, aux Etats-Unis, mort en....
Un Mémoire imprimé dans le 4e vol. du journal d'agriculture de Massachusetts, relatif à une espèce de Rhynchéne qui ronge les pins.
PENN., PENNT. — PENNANT (Thomas), Gallois, né en 1726, mort en 1798, naturaliste laborieux.
Nous citons principalement de lui les ouvrages suivants:
History of Quadrupeds, 2 vol. in-4°;
British Zoology, in-fol. 1 vol;
British Zoology, in-8° et in-4°, 4 vol.;
Arctic Zool., in-4°, 2 vol.;
Indian Zool., in-4°., 1 vol.
PERNETTY (dom), moine bénédictin qui avait accompagné Bougainville aux îles Malouines; il fut ensuite bibliothécaire du roi de Prusse Frédéric II.
Voyage aux îles Malouines, 2 vol. in-8°. Paris, 1770.
On y trouve quelques bons détails d'Histoire naturelle, et des figures utiles.
PÉR. — PÉRON (François), né à Cerilly en 1775, mort en 1810, voyageur plein de zèle, enlevé trop tôt à la science, et l'un de ceux qui ont le plus enrichi le Muséum d'Histoire naturelle.
Il a rédigé le premier volume du Voyage de découvertes aux Terres Australes, en 1800–1804. Paris, 1807, 1 vol. in-4°, avec un atlas.
Et plusieurs Mémoires dans les Annales du Muséum.
PERRAULT (Claude), naturaliste, architecte du Louvre et de l'Observatoire, né en 1613. mort en 1688.
Il a rédigé, d'après les dissections de Duverney, les Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle des Animaux,
[page] 401
qui forment le tome IIIe des Mémoires de l'Académie des Sciences avant 1699.
PETAG. — PETAGNA (Vincent), Napolitain.
Specimen Insectorum ulterioris Calabriæ in-40, avec une planche. Francofurti, 1787.
Il a aussi donné des éléments d'Entomologie, en 2 vol. in-8°.
PETERSB., ou PETROP. MEM., ou COMMENT., ou NOV. COMMENT., ou ACT., ou NOV. ACT.
Ce sont les divers titres des Mémoires de l'Académie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg.
Les Commentarii vont de 1726 à 1746, 14 vol. in-4°.
Les Novi Commentarii, de 1749 à 1775, 20 vol.
Les Acta, de 1777 à 1782, 7 vol.
Les Nova Acta, de 1783 à 1802, 15 vol.
Les Mémoires, depuis 1809.
PHELSUM (Murck van), naturaliste hollandais.
Je le cite pour sa Lettre (hollandaise) à C. Noseman sur les Oursins. Roterdam, 1774, in-8°.
PHILLIP (Arthur), Allemand, gouverneur de Botanybay, pour les Anglais.
Un anonyme a donné en anglais: The Voyage of governor Phillip to Botany-bay; etc. Londres, 1789, in-4°, avec 55 planches coloriées, La partie d'Histoire naturelle est de Latham. Ou en a une traduction française sans planches, 1 vol. in-80. Paris, 1791.
PHIPS (Constantin-Jean), depuis lord MULGRAVE, né en 1746, mort en 1792.
Célèbre marin anglais, dont je cite le Voyage au Pole boréal, fait en 1773, trad. française par Desmeuniers, 1 vol. in-4°. Paris, 1775.
PLANC. — PLANCUS (Janus), ou Jean BIANCHI, médecin de Rimini, né en 1693, mort en 1775.
De Conchis minus notis, 1 vol. in-4°, avec figures.
[page] 402
Venise, 1739. La seconde édition, fort augmentée. Romæ, 1760.
PL. COL.
Planches coloriées des oiseaux, par MM. Temmink et Laugier, grand recueil in-4° et in-fol., qui fait suite aux planches enluminées des oiseaux de Buffon.
PLUMIER (Charles), minime, qui voyagea beaucoup pour Louis XIV; très grand naturaliste dans toutes les parties, mais dont plusieurs ouvrages sont restés manuscrits.
J'ai eu à citer ses Observations sur les poissons et sur les reptiles, qui sont en partie à Paris, en partie à Berlin, en manuscrit, avec beaucoup de figures, dont Bloch et M. de Lacépède ont publié une partie.
POLI, naturaliste et anatomiste napolitain.
Auteur du magnifique ouvrage: Testacea utriusque Siciliæ eorumque historia et Anatome, 2 vol. grand in-fol. Parme, 1791 et 1795. Un troisième volume a paru il y a peu de temps.
PRÉV. — PRÉVOST (Bénédict).
Mémoire sur le Chirocéphale, imprimé à la suite de l'histoire des Monocles de Jurine. Voyez cet auteur.
PREYS. — PREYSLER (Jean-Daniel.)
Werzeichniss Boehmischer Insecten, 1 vol. in-4°. Pragæ, 1790.
PR. MAX. — Le prince MAXIMILIEN DE WIED.
Son Voyage au Brésil, 2 vol. in 4° avec atlas. Francf., 1820 et 1821. Son Hist. nat. de cette contrée, dont il a paru 2 vol. in-8°. Weimar, 1826; et plusieurs cahiers in-fol. de pl. enlum., sont au nombre des ouvrages les plus riches en nouveautés de ces derniers temps.
PRUNN. — PRUNNER (Léonard DE).
Lepidoptera pedemontana, 1 vol. in 8°. Turin, 1798.
[page] 403
Q.
Q. et G.
QUOY (Jean-Réné-Constant), qui a déjà fait deux grands voyages en société avec M. GAIMARD (Joseph-Paul), son collègue.
On a d'eux la Zoologie du Voy. de l'Uranie, 1 vol. in-4°. Paris, 1824; et 1 vol. in-fol. de pl.; et ils travaillent à celle du Voy. de l'Astrolabe, dont il a paru déjà plusieurs cahiers.
R.
RAFLES (sir Stamford), général anglais, gouverneur de Sumatra, pour les Anglais, qui a beaucoup contribué à faire connaître les productions de cette île.
Je cite son Mémoite à ce sujet dans le XIIIe vol. des Transactions Linnéennes.
RAFINES. — RATINESQUE SCHMALTZ (C.-S.), naturaliste, long-temps établi eu Sicile, maintenant aux États-Unis.
Auteur de nombreux petits ouvrages, contenant des espèces, des genres et des méthodes nouvelles.
Caratteri di alcuni nuovi generi et nuove specie di animali e piante della Sicilia. Palermo, 1810, in 8°.
Indice d'ittiologia Siciliana. Palermo, 1810, in-80.
Principes fondamentaux de sémiologie. Palerme, 1814.
Analyse de l'Univers, ou Tableau de la nature. Palerme, 1815, in-8°.
Ichthyologia ohiensis or natural history of the fishes inhabiting the River Ohio, etc., Lexington. Kentuky, 1820, in-8°.
RAI (Jean), théologien anglais, né en 1628, mort en 1707, le premier véritable méthodiste pour le règne animal, guide principal de Linnæus dans cette partie.
Synopsis methodica animalium, quadrupedum et serpentum. Lond., 1683, in-8°.
[page] 404
Synopsis methodica avium et piscium. Lond., 1713, in-8°.
Historia Insectorum. Lond., 1710, in-4°.
RAMDOHR (Charles-Auguste), naturaliste allemand.
Auteur d'un Traité sur les organes digestifs des Insectes en Allem. Halle, 1811, in-4°; et de matériaux pour l'histoire de quelques Monocles allemands, ib., 1805, in-4°.
RANG (Sander), officier au corps royal de la marine, habile naturaliste.
Manuel de l'Hist. nat. des Mollusques et de leurs coquilles. Paris, 1829, in-12. Établissement de la famille des béroïdes dans le tome IV des Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. Histoire naturelle des aplysies, Paris, 1828, grand in-4°.
RANZANI (l'abbé Camille), professeur d'histoire naturelle à Bologne, primicier de la cathédrale.
Auteur d'Éléments de Zoologie eu Italien, Bol., 1819; et ann. suiv., dont il a déjà paru 13 volumes in-8°; consacrés aux Quadrupèdes et aux oiseaux; et de Mémoires d'histoire naturelle, aussi en ital. Bol., 1820, in-4°.
RAPP (Guill.), professeur à Tubingue.
Sur les Polypes en général et les Actinies en particulier. Weimar, 1829, in-4°.
RÉAUM. — RÉAUMUR (Réné-Antoine FERCHAULT DE), de l'Académie des Sciences, né en 1683, mort en 1757, a travaillé sur toutes les parties des sciences.
Nous citons principalement ses Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes, dont il a paru 6 vol. in-4°, avec fig. Paris, 1734–1742; ouvrage admirable par le nombre et la beauté des observations. Le 7e volume est resté ma nuscrit; les autres n'ont pas été commencés.
RED. — REDI (François), d'Arezzo, médecin et littérateur célèbre, né en 1626, mort en 1698.
Experimenta circa generationem Insectorum, 3 vol. in-12, avec fig. Amstelodami, 1671, 1686, 1712.
[page] 405
REICH. — REICHENBACH (Henri-Théophile-Louis).
Monographia Pselaphorum, 1 petit vol. in-8°, avec fig. Lipsiæ, 1816.
REINWARDT, naturaliste allemand, professeur à Leyde, qui a voyagé dans l'Archipel des Indes, et y a fait de belles collections.
RENARD (Louis), éditeur d'un recueil de figures de poissons et autres animaux marins, faites aux Indes par des peintres du pays, et qui, sous une apparence barbare, présentent des espèces intéressantes et vraies.
1 vol. in-fol. Amsterd., 1754.
RENIERI, naturaliste italien, professeur à Padoue.
RETS. — RETSIUS, naturaliste suédois, professeur à Lund, en Scanie.
Auteur d'une édition fort augmentée du Fauna Suecica de Lin., de plusieurs thèses, etc.
RICHARDS. — RICHARDSON (John), chirurgien du premier voyage du capitaine Franklin.
Auteur de l'appendice zoologique qui y est joint. Londres, 1823, in-4°.
RISS. — RISSO (A.), naturaliste à Nice, observateur zélé.
Ichtyologie de Nice, etc., 1 vol. in-8°. Paris, 1810; ouvrage précieux par un assez grand nombre d'espèces nouvelles.
Histoire naturelle des Crustacés des environs de Nice, 1 vol. in-8°, avec fig. Paris, 1816.
Ces deux ouvrages ont reparu, augmentés dans son Histoire naturelle de l'Europe mérid., 5 vol. in-8°. Paris, 1826.
Il a publié dans le journal de Physique la description de quelques nouvelles espèces de crustacés.
ROBIN. — ROBINEAU DESVOIDY, médecin à St.-Sauveur, département de l'Yonne.
Recherches sur l'organisation vertébrale des Crustacés,
[page] 406
des Arachnides et des Insectes, 1 vol. in-8°. Paris, 1828. Essai sur la tribu des Culicides, imprimés dans le second volume des Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
Un grand travail sur les Diptères de la tribu des Muscides, qu'il nomme Myodaires, imprimés dans les Mém. des savants étangers de l'Académie des Sc.
Des observations sur l'organe olfactif des crustacés et sur l'usage des balanciers des insectes de l'ordre des Diptères.
ROCHEFORT (N.), ministre protestant en Hollande.
Histoire naturelle et morale des Antilles de l'Amérique.
La première édition est anonyme, et de Rotterdam, 1658. L'auteur y copie, pour l'Histoire naturelle, la première édition de Dutertre, de 1654.
ROEM. — ROEMER (Jean-Charles).
Genera Insèctorum Linnæi et Fabricii, Ionibus illustrata, 1 vol. in-4°. Vitoduri Helvetiorum, 1789.
Ce n'est qu'une édition de l'ouvrage de Sulzer sur le même objet, avec quelques nouvelles planches.
ROES. — ROESEL DE ROSENHOF (Auguste-Jean), peintre de Nuremberg, né en 1705, mort en 1759, l'undes plus ingénieux observateurs et des plus habiles dessinateurs d'histoire naturelle.
Historia naturalis ranarum nostratium, 1 vol. in-fol. Nüremb., 1758.
Insecten-belustigungen (Amusements sur les insectes) 4 vol. in-4°, avec de très belles planches coloriées. Nuremberg, 1746 et années suiv. (Voy. Kléemann.)
ROG. — ROGER, naturaliste de Bordeaux.
Un Mémoire ayant pour titre: Instructions à l'usage des personnes qui voudraient s'occuper à recueillir des insectes, pour les cabinets d'Histoire naturelle, in-8°. Bordeaux.
ROISSY (Félix de), naturaliste de Paris.
A terminé par les 5 et 6e vol. in-8°, l'Histoire des Mol-
[page] 407
lusques, commencée par Denys de Montfort pour le Buffon de Sonnini.
RONDEL. — RONDELET (Guillaume), né en 1507, mort en 1566, professeur de médecine à Montpellier.
Libri de piscibus, 1 vol. in-fol. Lyon, 1554; ouvrage encore utile par ses nombreuses figures en bois, très reconnaissables.
ROSS. — ROSSI (Pierre), naturaliste italien, professeur à Pise, mort et 18.
Fauna Etrusca, sistens Insecta quæ in provinciis Florentinâ et Pisanâ præsertim collegit Petrus Rossius, etc., 2 vol. in-4° avec planches enlum. Liburui, 1790.
Mantissa Insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas, a Petro Rossio, etc., 2 vol. in-4°, avec fig. enlum. Pisis, 1792–1794.
ROUX (Polydore), conservateur du Musée d'histoire naturelle de Marseille.
Ornithologie provençale, in-4° avec de belles figures lithographiées.
Crustacés de la Méditerranée et de son littoral, in-4°, avec pl., trois prem. fascicules. Marseille, 1827–1828.
ROXBURGH, médecin anglais, au Bengale.
Je le cite pour son mém. sur le Dauphin du Gange.
RUDOLPHI (Charles-Asmund), naturaliste et anatomiste allemand, professeur à Gripsvald, et à présent à Berlin.
Je le cite principalement pour son ouvrage classique sur les vers intestinaux, intitulé: Entozoa seu Vermium intestinalium Historia naturalis, 2 vol. in-80. Amsterd., 1808.
RUMPH (George-Everard), négocîant allemand, né à Hanau en 1637, intendant à Amboine pour les Hollandais, mort en 1706.
Cabinet d'Amboine, en hollandais. Amsterd., 1705, 1 vol. in-fol.
[page] 408
Thesaurus imaginum, etc. La Haye, 1739, 1 vol. in-fol., avec les mêmes planches et un texte plus abrégé.
RUPPEL (Edouard), naturaliste de Francfort.
Auteur d'un voyage en Nubie, dont il a paru déjà plusieurs cahiers (Francf., 1826, gr. in-4°), avec de très belles planches lithographiées et enluminées, représentant des espèces nouvelles de plusieurs classes.
RUSSEL (Patrice), autrefois médecin au Bengale.
A donné en anglais, deux ouvrages capitaux avec de belles fig: Les Serpents de la côte de Coromandel, 1 vol. in-fol., avec un supplément. Lond., 17...
Desc. et figures de deux cents poissons de la côte de Coromandel, 2 vol. in-fol. Lond., 1803.
RUYSCH (Henri), fils du célèbre anatomiste, mort avant son père.
A donné, sous le nom de Theatrum Animalium, 2 vol. in-fol. Amsterd., 1718, une édition de Johnston, à laquelle il a ajouté une copie des mêmes dessins de poissons, dont se sont servis Renard et Valentin.
S.
SABINE, naturaliste anglais.
Auteur de l'appendice au premier voyage du capitaine Parry, et de plusieurs Mémoires dans les Transactions de la Soc. Linn.
SAGE (Balthazar-George), chimiste de l'Académie des Sciences, mort en 1824.
Nous le citons pour un Mémoire sur les Bélemnites, dans le Journal de Physique.
SAHLB. — SAHLBERG (C.-R.)
Dissertatio Entomologica insecta fennica enumerans. Præs. C.-R. Sahlberg. Aboæ, 1817–1823, in-8°.
Periculi Entomographici, 1 vol. in-8°, avec planches. Aboæ, 1823.
[page] 409
SALERNE, médecin à Orléans.
A donné une traduction du Synopsis avium de Rai, sous ce titre: l'Histoire naturelle éclaircie dans une de ses principales parties, L'ORNITHOLOGIE, etc. Paris, 1767, grand in-4°.
Les figures sont du même dessinateur que celles de Brisson, et des planches enluminées de Buffon, et souvent d'après les mêmes individus.
SALT, consul anglais en Égypte.
A donné un Voyage en Abyssinie, où sont quelques observations d'Hist. nat.
SALV. — SALVIANI (Hippolyte), de Citta di Castello, médecin à Rome, né en 1513, mort en 1572.
Aquatilium animalium Historiœ, 1 vol. in-fol. Romæ, 1554, avec de bonnes figures en taille-douce de beaucoup de poissons.
SAV. ou SAVIGN. — SAVIGNY (Jules-César), membre de l'Académie des sciences.
Je cite de lui: Histoire naturelle et mythologique de l'Ibis, 1 vol. in-8°. Paris, 1805.
Mémoires sur les oiseaux de l'Égypte, dans le grand ouvrage sur l'Égypte.
Mémoires sur les animaux sans vertèbres, première partie, premier fascic., in-8°. Paris, 1816.
Système de Annélides inséré dans le grand ouvrage sur l'Egypte, ainsi que son Tableau systématique des Ascidies.
SAVI. — SAVI (Paul), jeune naturaliste Toscan, professeur à Pise.
Auteur de plusieurs bonnes observations sur les animaux de ce pays, dans le Giornale dei letterati.
A publié, en italien, deux Mémoires sur une espèce de Jule, et qui viennent d'être réimprimés avec d'autres, du même savant, dans un ouvrage intitulé: Memorie Scientifiche di paolo Savi, decade prima con sette tavole. Pisa, 1828, 1 vol. in-8°.
TOME III. 27
[page] 410
SAY, naturaliste français, établi aux États-Unis.
Auteur de plusieurs Mémoires, parmi ceux de Philadelphie et de New-York.
SCHAEFF. — SCHAEFFER (Jacques-Chrétien), pasteur à Ratisbonne, né en 1718, mort en 1799.
Elementa Entomologica, 1 vol. in-4°, avec fig. color. Ratisbonne, 1769.
Icones Insectorum circà Ratisbonam indigenorum, 3 vol. in-4°. Ratisbonne, 1769.
Apus pisciformis, insecti aquatici species noviter detecta, in-4°, avec figures. Ratisbonne, 1757.
Ce crustacé est le Cancer stagnalis de Linnæus. Voyez Branchipe.
Et quelques autres sur divers insectes, réunies en un volume in-4°: Abhandlungen von Insecten. Regensburg, 1764–1779.
SCHELLENB. — SCHELLENBERG (Jean-Rod.), peintre et graveur de Zurich.
Cimicum in Helvetiœ aquis et terris degens genus, 1 vol. in-8°, avec fig. Turici, 1800.
Genres des mouches diptères, 1 vol. in-8, en français et allemand, avec figures coloriées. Zurich, 1803.
Le texte est de deux anonymes.
SCHEUCHZ. ou SCH. — SCHEUCHZER (Jean-Jacques), médecin de Zurich.
Physique sacrée, quatre volumes in-fol. Amsterdam, 1732.
Ce livre intéresse l'Histoire naturelle par beaucoup de gravures de serpents que l'auteur y a insérées.
SCHINTZ (H.-R.), secrétaire de la Société d'histoire naturelle de Zurich, traducteur allemand du règne animal.
Auteur d'une Histoire des nids et des œufs des oiseaux.
[page] 411
SCHLOSSER, médecin à Amsterdam.
Cité pour quelques Mémoires sur les Poissons, publiés avec Boddaert, ou dans les Trans. phil.
SCHN. — SCHNEIDER (Jean-Gottlob), célèbre belléniste, et naturaliste, professeur à Francfort-sur-l'Oder, à présent à Breslau.
Je cite de lui:
Amphibiorum physiologiæ specim. I. et II. Zullichow, 1797, 2 cahiers in-4°.
Historiæ amphibiorum naturalis et litterariæ, Fascic. I. et II., in 8°. Jena, 1799 et 1801.
Histoire naturelle générale des Tortues (en allemand), in-8°, 1 vol. Leipzig, 1783.
Je cite aussi généralement sous son nom, l'édition qu'il a donnée du Systema Ichthyologiæ de Bloch, 2 vol. in-8°, avec 110 fig. Berlin, 1801.
SCHOEPF (Jean-David), médecin d'Anspach, né en 1752.
Historia testudinum iconibus illustrata. Erlang, 1792 et suiv., in-4°, fig. enl.
SCHONEFELD (Etienne de), médecin de Hambourg.
Ichtyologia, etc., ducatuum Slesvigi et Holsatiœ. Hamb., 1624, in-4°.
SCHON. — SCHOENHERR (Charles-Jean), suédois.
Synonymia Insectorum, 2 vol. in-8°, avec fig. Steckh., 1806–1808, le 3e Skag., 1817.
Curculionidum dispositio methodica, 1 vol. in-8°. Leipz. 1826.
SCHRANK. — SCHRANK (François-de-Paule), naturaliste bavarois, professeur à Ingolstadt, né en 1747.
Enumeratio Insectorum Austriæ indigenorum, 1 vol. in-8°, avec fig. Augustæ Vindelicorum, 1781.
Fauna Boica, 6 vol. in-8°. Nuremberg et Ingolstatd, 1798 et suiv.
27.
[page] 412
SCHREB. — SCHREBER (Jean-Chrétien-Daniel DE), professeur à Erlang, né en 1739.
Nous citons principalement son Histoire des Mammifères, in-4°, avec fig. enlum. Erlang, 1775 et ann. suiv. En allemand.
Il existe aussi des exemplaires français des premières parties.
Le plus grand nombre des figures est copié de Buffon, et enluminé d'après les descriptions; néanmoins il y en a aussi plusieurs de bonnes et d'originales.
SCHREIB. — SCHREIBERS (Charles de), directeur du cabinet impérial d'histoire naturelle à Vienne.
Les descriptions, en anglais, de plusieurs espèces de Coléoptères inédites ou peu connues, avec leurs figures, insérées dans le sixième volume des Transactions de la Société Linnéenue.
Un Mémoire sur le Proteus, dans les Transactions philosophiques.
SCHROET. — SCHROETER (Jean-Samuel), surintendant luthérien à Buttstedt, dans le duché de Weimar, né en 1735. Auteur de nombreux ouvrages sur la conchyliologie.
Nous citons son Histoire des Coquilles fluviatiles (en allemand), in-4°. Halle, 1979.
SCHWEIGGER (A.-F.), natural. prussien, assassiné par son guide pendant un voyage dans l'intérieur de la Sicile.
A donné dans les archives de Kœnigsberg en 1812, un Prodromus monographiæ Cheloniorum, où il décrit surtout les espèces nouvelles de notre Musée de Paris.
Des Observations faites pendant ses voyages, où il traite des Coraux et de l'Ambre jaune. Berlin, 1819, in-4°.
Un Manuel des animaux invertébrés et inarticulés, en allemand, 1 vol. in-8°. Leipsig, 1820.
SCILLA (Augustin), peintre sicilien.
La Vana speculatione disingannata dal senso, 1 vol. petit in-4°. Naples, 1670.
[page] 413
Première comparaison exacte des fossiles avec leurs analogues naturels.
Il y en a une traduction latine, grand in-4°. Rome, 1752.
SCOP. — SCOPOLI (Jean-Antoine), professeur de botanique et de chimie à Pavie, né en 1723, mort en 1788.
Entomologia Carniolica, 1 vol. in-8°. Vindebonæ, 1763.
Deliciœ Florœ et Faunœ insubricœ, 4 vol. in-fol. avec figures. Ticini, 1786–1788.
Introductio ad Historiam naturalem, 1 vol. in-8°. Praæ, 1777.
Anni Historicc-Naturales, au nombre de cinq. Lipsiæ, 1768 1772, réunis en 1 vol. in-8°.
Il a aussi donné des planches faisant suite à son Entomologia Carniolica, mais qui sont peu connues.
SCORESBY, marin anglais, qui a découvert de nouveau le Groënland oriental.
Et donné une Relation des régions arctiques, etc., en angl., 1 vol. Londres, 1819, où se trouvent beau coup d'observations précieuses sur les Cétacés.
SEB. — SEBA (Albert), pharmacien d'Amsterdam, né en 1665, mort en 1736.
Célèbre par son Locupletissimi rerum naturalium The sauri accurata descriptio, 4 vol. grand in-fol. Amsterd., 1734–1765.
Ouvrage que j'ai cité souvent, parce qu'il est enrichi d'un grand nombre de belles planches; mais dont le texte ne jouit d'aucune autorité, parce qu'il est écrit sans jugement et sans critique.
SELBY (Prideaux-John).
Auteur des Illustrations de l'ornithologie Britannique. Edimb., 1825, in-8°, avec un très grand atlas, le plus ma gnifique ouvrage d'ornithologie qui existe.
Et de divers mémoires dans le Journal Zoologique, etc.
[page] 414
SENGUERD. — SENGUERDIUS (Wolferd).
Tractatus physicus de Tarentula, 1 vol. in-12. Lugduni Batavorum, 1668.
SERRES (Marcel de), professeur de minéralogie à la Faculté des Sciences de Montpellier.
Plusieurs Mémoires sur l'Anatomie des Insectes, dans les Annales du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.
Mémoire sur les yeux composés et les yeux lisses des insectes, etc., 1 vol. in-8°, avec fig. Montpellier, 1813.
SERV. — SERVILLE, l'un des collaborateurs pour la partie en tomologique de la faune française, et de l'encyclopédie méthodique.
Il a aussi publié le dernier fascicule de l'ouvrage de feu Palisot de Beauvois, sur les insectes recueillis par lui en Afrique et en Amérique; ainsi que des extraits de divers ouvrages sur les insectes, dans le bulletin universel de M. le baron de Ferussac.
SHAW (Thomas), théologien d'Oxford, voyageur en Afrique et au Levant.
Son ouvrage, publié en anglais, à Oxfort, en 1738, in-fol., a été traduit en français en 2 vol. in-4°, sous ce titre: Voyage dans plusieurs parties de la Barbarie et du Levant, etc. La Haye, 1743.
SH. ou SHAW. — SHAW (George), aide-bibliothécaire du Muséum britannique, mort en 1815, compilateur et descripteur laborieux.
Naturalists miscellany, in-80. Londres, 1789 et années suivantes; nombreux recueil de figures enluminées, en grande partie copiées, mais dont il y en a aussi plusieurs d'originales.
General Zoology. Londres, 1800, et années suiv., plusieurs vol. in-8°, avec des figures, la plupart copiées.
Zoology of New-Holland. Lond., 1794 et ann. suiv., quclques cahiers in-8°. L'ouvrage est resté incomplet.
[page] 415
SLOANE (Hans), né en 1660, mort en 1753, président de la Société royale.
Voyage to the Islands Madera, Barbados, Nieves, St.-Christophers and Jamaica, 2 vol. in-fol. Lond., 1707, 1727, avec 274 planches médiocres ou mauvaises.
SMEATH. — SMEATHMAN (Henri).
Son Histoire des Termites, publiés dans le 71e volume de Transactions philosophiques, a été traduite en français par M. Rigaud, docteur en médecine de la Société de Montpellier, et insérée dans le deuxième volume de la traduction française du Voy. de Sparrman.
SMITH (Hamilton), officier anglais, très savant naturaliste.
Auteur d'une grande partie des additions de la trad. anglaise de mon Règne animal, et surtout du Synopsis mammalium, qui en termine le 3e volume.
SOC. DES NAT. DE BERL., ou NAT. DE BERL., ou BERL. NAT.
Ses Mémoires ont paru successivement sous quatre titres différents, en allemand:
1° Beschæftigungen (Occupations), 4 vol. in-8°, 1775–1779;
2° Schriften (Écrits), 11 vol. in-8°, 1780–1794, dont les 5 derniers ont aussi le titre de Beobachtungen und Entdeckungen (Observations et découvertes);
3° Neue Schriften (Nouveaux écrits), vol. in-4°, 1795–17
4° Magazin, etc. (Magasin pour les nouvelles découvertes en Histoire naturelle), 1 cahier par trimestre, depuis 1807.
SOLD. — SOLDANI (Ambroise), général des Camaldules, ensuite professeur à Sienne.
A donné des ouvrages sur les Coquilles microscopiques, soit fossiles, soit vivantes.
Saggio orittografico ovvero osservationi sopra le terre nautilitiche, etc. Sienne, 1780, 1 vol. in-4°.
[page] 416
Et Testaceographia ac Zoophytographia parva et microscopica, 3 vol. petit in-fol. Sienne, 1789–1798.
SONNERAT, né à Lyon, mort à Paris en 1814, collecteur infatigable.
Premier Voyage. Voyage à la Nouvelle-Guinée, 1 vol. in-4°, avec 120 planches. Paris, 1776.
Deuxième Voyage. Voyage aux Indes orientales et à la Chine, depuis 1774 jusqu'en 1781. Paris, 1782, 2 vol. in-4°, avec 140 planches.
SONNINI de Manoncourt (C. S.), ingénieur, né en Lorraine, mort en Valachie en 1814.
Je cite son Voyage dans la Haute et Basse-Égypte, 3 vol. in-8°. Paris, 1799, avec un atlas de 40 planches;
Et quelquefois son édition de Buffon. Paris, Dufart, 1798, etc., in-8°.
SOWERB. — SOWERBY (James), et SOWERBY (George-Brettingham), son fils, naturalistes et artistes anglais.
The genera of recent and fossil shels, in-8°, trente liv.
Fossil conchology.
Et divers Mémoires dans le Zoological journal.
SPALL. — SPALLANZANI (Lazare), célèbre observateur, professeur à Reggio, à Modène et enfin à Pavie. Né en 1729, mort en 1799.
De ses nombreux ouvrages, nous n'avons eu à citer que ses Opuscoli di Fisica animale e vegetabile, 1776.
Ils sont traduits en français par Sennebier, 3 vol. in-8°. Genève, 1787.
SPARM. — SPARMANN (André), né en 1748. Elève de Linnæus, voyageur au Cap et en Chine, puis professeur à Upsal.
VOY.
Voyage au Cap de Bonne-Espérance, trad. française, 3 vol. in-8°. Paris, 1787.
[page] 417
MUS. CARLS.
Museum Carlsonianum, 4 cahiers petit in-fol. Stockh., 1786 et années suivantes.
Figures d'oiseaux, où quelques variétés sont érigées en espèces.
SPENC. — SPENCE (William), naturaliste anglais.
Une Monographie des Cholèves (genre de Coléoptères) qui se trouvent en Angleterre, insérée dans les Transactions de la Société Linnéenne.
SPENGLER (Laurent), garde du cabinet du roi de Danemarck, né en 1720.
Cité pour quelques Mémoires dans le Naturforscher, etc.
SPIN. — SPINOLA (Maximilien), noble génois, savant naturaliste.
Insectorum Liguriœ species novæ aut rariores, 2 tomes in-4°, avec figures. Genuæ, 1806–1808.
Un Mémoire sur les poissons de Ligurie; un sur la Cératine albilabre, et l'essai d'une nouvelle classification générale des Diplolépaires, dans les Ann. du Muséum d'Hist. nat.
SPIX (Jean), naturaliste bavarois, académicien de Munich.
Cité pour ses Mémoires dans les Annales du Muséum.
Et pour les grands ouvrages sur la Zoologie du Brésil, où il a fait un voyage avec M. de Martius, par ordre du Roi de Bavière, ce voyage très productif a donné:
Hist. nat. des esp. nouv. de singes et de chauve-souris, 1 vol. gr. in-fol. lat. et fr. Munich 1823.
Espèces nouv. d'ois., 1 vol. gr. in-4° avec 109 pl. col. en lat. Munich 1824.
Espèces nouv. de tortues et de grenouilles, en lat. gr. in-4°, Munich. 1824.
Espèces nouv. de lézards, en lat. gr. in-4°, Munich 1825.
Hist. nat. des esp. nouv. de serpents, décrite d'après les notes du voyageur, par Jean Wagler, lat. et fr. gr. in-4°, Munich 1824.
Espèces et genres choisis de poissons, décrits par L. Agassiz, grand in-4°. Munich, 1829.
[page] 418
SLABBER (Martin), naturaliste hollandais.
Amusements naturels contenant des observations microscopiques, etc., en hollandais, 1 vol. in-4°. Harlem, 1778.
Il y a aussi des Mémoires de lui parmi ceux de l'Académie de Harlem.
STEV. — STEVEN (Chrétien), directeur du jardin impérial de botanique d'Odessa.
Description de quelques insectes du Caucase et de la Russie méridionale, Mémoire in-4°, imprimé dans le recueil de ceux de la Société impériale des naturalistes de Moscou, tome 11.
STOKH. (Mém. de).
Mémoires de l'Académie des Sciences de Suède. Il en paraît, depuis 1739, chaque année, un vol. in-8°, en quatre trimestres, en suédois; les quarante premiers vont jusqu'en 1779. Depuis 1780, ils paraissent sous le titre de Nouveaux Mémoires, etc.
STOLL, — STOLL (Caspar), médecin hollandais.
Supplément à l'ouvrage intitulé: Les Papillons exotiques des trois parties du monde, 1 vol. in-4°. Amsterd., 1790 et suiv., hollandais et français.
Représentation exactement coloriée d'après nature, des spectres, des mantes, des sauterelles, etc., huit cahiers in-4°. Amsterdam, 1787 et suiv., hollandais et français.
Représentation exactement coloriée d'après nature des cigales et des punaises, 12 cahiers in-4°. Amsterdam, 1780 et suiv., hollandais et français.
STORR (Théophile-Conrad-Chrétien), professeur à Tubingen.
Sa thèse Prodromus methodi mammalium. Tub., 1780, réimprimée dans le Delectus opusculorum ad sc. nat. spect. de Ludwig, 1 vol. in-8°. Leipzig, 1790, tome I, pag. 37, nous a été fort utile.
[page] 419
STRAUS. — STRAUS DURCKHEIM (Hercule).
Considérations générales sur l'anatomie comparée des animaux aarticulés, uxquelles on a joint l'anatomie descriptive du Hanneton, 1 vol. in-4°, avec planches. Paris, 1828.
Le seul ouvrage qui puisse être comparé à celui de Lyonnet, sur la chenille du bois de saule.
Il a lu à l'Académie des Sciences, un Mémoire sur le système tégumentaire et musculaire de l'Araignée aviculaire (Mygale de Le Blond, Latr.).
STROEM (Jean), pasteur en Norvège, né en 1726.
A donné plusieurs Mémoires parmi ceux de Drontheim, de Copenhague, etc.
Et une description du district de Sondmer.
STURM. — STURM (Jacques), naturaliste et peintre allemand.
J'ai cité de lui l'ouvrage suivant: Deutschland Fauna, 2 vol. in-8°, avec d'excellentes figures. Nuremberg, 1807.
SULZ. — SULZER (Jean-Henri).
Les caractères des Insectes (en allemand) Die kennzei clen der Insecten, avec fig., 1 vol. in-4°. Zurich, 1761.
SURRIR. — SURRIRAY, médecin au Havre.
Des observations sur le fœtus d'une espèce de Calige, dans le tome troisième des Annales générales des Sciences physiques.
SWAINS. — SWAINSON, naturaliste anglais.
Auteur de plusieurs Mémoires sur les oiseaux dans les Trans. Lin., le journ. Zool. et d'un Recueil intitulé: Zoological illustrations, qui fait suite au Zool. miscellany de Leach, et au naturalists miscellany de Shaw.
Il a fait avec M. Horsfield un Mémoire sur les Oiseaux de la Nouvelle-Hollande, Transactions linnéennes. XV.
[page] 420
SWAMMERDAM (Jean), médecin hollandais, né à Amsterdam, en 1637, mort en 1680.
Auteur principal sur l'anatomie des insectes, dans son Biblia Naturæ, 2 vol. in-folio, en latin et en hollandais. Leyde, 1737 et 38.
Il y en a un extrait français, qui fait le 5e vol. de la collection académique, partie étrangère.
SWED. — SWEDER (Nicolas-Samuel), naturaliste suédois.
Cité pour un Mémoire parmi ceux de Stockholm, 1784.
T.
TEMM. et souvent T. — TEMMINK (C. J.), ci-devant directeur de la Société des Sciences d'Harlem, et propriétaire d'un riche cabinet de zoologie; aujourd'hui directeur du Musée royal d'histoire naturelle des Pays-Bas à Leyde.
Histoire naturelle générale des Pigeons et des Gallinacées, 3 vol. in-8°. Amsterdam et Paris, 1813–1815.
La partie des pigeons a aussi paru in-fol. avec de belles planches en couleur, par madame Knip.
Manuel d'Ornithologie, ou Tableau systématique des oiseaux qui se trouvent en Europe, 1 vol. in-8°. Amsterd. et Paris, 1815.
Monographies de Mammalogie. Paris, 1827, in-4°.
Et surtout Planches coloriées des oiseaux, in-4°. et in-folio, faisant suite aux planches enluminées de Buffon.
Cet ouvrage est publié en commun avec M. MEIFFREN DE LAUGIER, baron de CHARTROUSE, Maire d'Arles.
THIENEM. — THIENEMAN, professeur et conservateur du cabinet de Dresde.
Auteur de remarques sur les animaux du Nord, et principalement sur les Phoques, en allemand, in-8°. 1824, avec atlas in-4°, transv.
[page] 421
THIER. —THIERY DE MENONVILLE (Nicolas-Joseph), médecin français, qui alla au Mexique enlever la cochenille.
Traite de la culture du Nopal et de l'éducation de la Cochenille, 2 vol. in-8° avec fig. Paris, 1787.
THOMAS (P.), médecin de Montpellier.
Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle des Sangsues, brochure in-8°. Paris, 1806.
THOMPSON (John W.), chirurg. dans l'armée anglaise.
Memoire sur le Pentacrinus Europæus. Cork, 1827, in-4°.
THOMPS. — THOMPSON (William), médecin anglais, établi à Naples.
Auteur d'un Mémoire sur un hipppurite qu'il appelle Cornucopia.
THUNBERG (Charles-Pierre), élève de Linnæus, voyageur au Cap et au Japon, professeur à Upsal, né en 1743.
Je le cite pour plusieurs Mémoires parmi ceux de l'Académie de Stockholm.
TIEDEMAN (Frédéric), professeur à Heidelberg.
Anatomie de l'holothurie, de l'astérie et de l'oursin. Landshut, 1805, in-fol., l'une des plus belles monographies d'animaux sans vertèbres.
TILESIUS (W. G.), naturaliste allemand, voyageur autour du monde.
A donné quelques Mémoires à l'Académie de Pétersbourg, des notices de plusieurs animaux nouveaux, dans le Voyage du capitaine Krusenstern; et auparavant, en allemand, un Annuaire d'histoire naturelle. Leipzig, 1802, in-12.
TRANS. LIN.
Les Mémoires de la Société linnéenne de Londres. Londres, in-4°, depuis 1791, il y en a déjà 15 volumes pleins des observations les plus intéressantes.
[page] 422
TREITS. — TREITSCHKE (Frédéric), naturaliste allemand.
Il continue l'ouvrage d'Ochsenheimer sur les lépidoptères d'Europe. Le dernier volume (1829) contient les pyralides.
TREMBLEY (Abraham), de Genève, né en 1710, mort en 1784; immortel par la découverte de la reproduction du polype.
Mémoires pour servir à l'Histoire des Polypes d'eau douce, à bras en forme de cornes. Leyde, 1744, in-4°, avec 15 planches.
TREUTL. — TREUTLER (Frédéric-Auguste), médecin allemand.
Auteur d'une thèse: Observationes pathologico-anatomicæ, auctarium ad helminthologiam humani corporis, continentes. Leipsig, 1793, in-4°.
TRÉVIR. — TRÉVIRANUS (G. R.), TRÉVIRANUS, professeur à Brême.
Sur l'organisation interne des arachnides, en allemand. Nüremberg, 1812, 1 vol. in-4°, avec figures.
TUCKEY (J. K.), capitaine de marine anglais.
Relation d'une expédition pour reconnaître le Zaïre, traduit en français, 2 vol. in-8°, avec atlas, in-4°. Paris, 1818.
V.
VAHL (Martin), danois, botaniste célèbre.
A donné aussi quelques Mémoires de zoologie, parmi ceux de la société d'Histoire naturelle de Copenhague.
VAILLT. — LE VAILLT. — LEVAILLANT (François), né à Surinam, d'un père français, voyageur et collecteur célèbre.
1er VOY.
Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le cap de Bonne-Espérance, 2 vol. in-8. Paris, 1790.
[page] 423
2e VOY.
Second Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, etc., 3 vol. in-8. Paris, 1795.
AFR.
Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique. Il en a paru 5 vol. in-4°. Paris, 1799 et années suiv.
PERR.
Histoire naturelle des Perroquets, 2 vol. in-4° et in-fol. Paris, 1801.
OIS. DE PAR.
Hist. nat. des oiseaux de Paradis, et des rolliers, suivie de celle des toucans et des barbus, 2 vol. grand in-fol. Paris, 1806.
Hist. nat. des Promerops et des Guêpiers. Paris, 1807. Id.
VALENCIENNES (A.), aide naturaliste au Muséum d'histoire naturelle, mon collaborateur pour la grande histoire des poissons.
Auteur de plusieurs Mémoires, dans ceux du Muséum, des Annales des Sc. nat., et dans le recueil d'observations de zoologie, de M. de Humboldt.
VALENTYN (François), pasteur à Amboine.
A donné en hol landais: l'Inde orientale, ancienne et nouvelle, 5 vol. in-fol. Dordrecht et Amsterdam, 1724—1726.
Le troisième volume contient beaucoup de détails sur l'Hist. nat. d'Amboine. Les figures des poissons y sont les mêmes que dans Renard.
VALL. — VALLOT, professeur à Dijon.
A envoyé à l'Académie royale des Sciences un Mémoire sur quelques espèces de diptères, du genre cecidomye, et a publié dans les Annales des sciences naturelles (tom. 13e), des observations sur les habitudes de l'anthribe marbre, mais qui avaient été faites en Suède par Dalman.
VANDELLI, naturaliste italien, directeur du cabinet de Lisbonne.
Auteur de quelques Mémoires sur les poissons de la ri-
[page] 424
vière des Amazones, parmi ceux de l'Académie de Lisbonne.
VANDER LIND. — VANDER LINDEN (P. L.), médecin, professeur d'histoire naturelle à Bruxelles.
A publié, en latin, dans deux Mémoires in-4°, la description des libellulines du territoire de Bologne en Italie, et ensuite dans un vol. in-8, celle de toutes les espèces de la même famille, propres à l'Europe.
On a aussi de lui des observations sur les hyménoptères d'Europe, de la famille des fouisseurs.
Le premier cahier d'un ouvrage intitulé: Essai sur les insectes de Java et des îles voisines; une notice sur une empreinte d'insecte, renfermée dans un calcaire schisteux de Solenhofen en Bavière. Ces trois derniers Mémoires font partie des Annales générales des sciences physiques. Bruxelles, 1819 et ann. suiv.
VAUCHER (Jean-Pierre), pasteur et professeur à Genève.
Auteur d'une Histoire des conferves d'eau douce, 1 vol. in-4°. Genève, 1803; et de quelques observations sur les zoophytes, dans le Bulletin des Sciences.
VIEILL. — VIEILLOT (L. P.), naturaliste de Paris. Mort en 1828.
Histoire naturelle des plus beaux oiseaux chanteurs de la zone torride, 1 vol. in-fol. Paris, 1805.
Histoire naturelle des oiseaux de l'Amérique septentrionale, dont il n'a paru que 2 vol. in-fol. Paris, 1807.
Il a aussi continué l'Histoire des oiseaux dorés d'Audebert, et a donné une Analyse d'une nouvelle Ornithologie élémentaire, broch. in-8. Paris, 1816.
On a encore de M. Vieillot: Galerie des oiseaux, in-4°. que je cite ainsi, Vieill. Gal. Ila concouru à l'édition des oiseaux du Buffon, imprimé par Dufart, et au nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, imprimé par Déterville.
[page] 425
VIGORS, naturaliste anglais, principal rédacteur du zoological journal.
Auteur de plusieurs Mémoires dans les Trans. linn., etc.
VILL. — VILLERS (Charles DE), naturaliste de Lyon.
C. Linnæi Entomologia, 4 vol. in-8, avec d'assez bonnes figures. Lugduni, 1789.
Compilation qui a été utile dans le temps où elle a paru, et à laquelle l'auteur a ajouté la description de plusieurs insectes propres aux départements méridionaux de la France.
VILL. — VILLIERS (Adrien-Prudent DE).
A publié dans les Annales de la société linnéenne de Paris (nov. 1826), une notice sur trois lépidoptères inédits ou peu connus du midi de la France, avec u ne planche représentant ces insectes. Il y rectifie aussi la description qu'on avait donné du Bombyx Milhauseri.
VIQ D'AZ. — VIQ D'AZYR (Félix), né à Valogne en 1748, mort à Paris en 1794; membre de l'Ac. des Sc. secrétaire perpétuel de la Société royale de médecine.
Je cite son Système anatomique, qui fait partie de l'Encyclopédie méthodique, et dont il n'a paru que le deuxième volume, contenant les quadrumanes et les rongeurs, 1 vol. in-4°. Paris, 1799.
VIREY (J.-J.), docteur en médecine, l'un des rédacteurs du journal de pharmacie et des Sciences accessoires.
Où il a publié (avril 1810) une Histoire naturelle des Végétaux et des insectes qui les produisent, ainsi que des recherches sur l'insecte de la gomme-laque.
VIV. — VIVIANI (Dominique), professeur d'histoire naturelle et de botanique à Gênes.
Phosphorescentia maris quatuordecim lucescentiumanimalculorum novis speciebus illustrata, 1 vol. in-4°. Genuæ, 1805.
VOSMAER (Arnold), naturaliste hollandais, mort en 1799, garde du cabinet et de la ménagerie du stadtouder.
A donné en français et en hollandais, à compter de
TOME III. 28
[page] 426
1767, un assez grand nombre de feuilles contenant des Monographies et des figures enluminées de divers animaux.
VOY. DE DUPERREY. Zool.
La partie zoologique du Voyage de la Coquille, commandée par M. DUPERREY. La rédaction de cette partie est de MM. LESSON et GARNOT.
VOY. DE FREYC., ou ZOOL. DE FREYC.
La partie zoologique du voyage de l'Uranie, commandée par M. de FREYCINET. Cette partie est rédigée par MM. QUOY et GAIMARD.
W.
WAGLER (Jean), naturaliste allemand.
Auteur de fragments ornithologiques, sous le titre de Systema avium, et rédacteur dans la Zool. du Brésil, par MM. Spix et Martius, de l'histoire des serpents, et de Mémoires sur les poissons, dans l'Isis.
WALBAUM (Jean-Jules), médec. de Lubeck, né en 1724.
Outre son édition d'Artedi, a donné une Chelon ographia ou Description de quelques tortues, en allemand. Lubeck et Leipzig, 1782, 1 vol. in-4°;
Et quelques Mém. parmi ceux des naturalistes de Berlin.
WALCH (Jean-Ernest-Emmanuel), professeur à Jena, né en 1725, mort en 1778.
Auteur du texte des monuments du déluge de Knorr. Voy. Knorr.
WALCK. — WALCKENAER (Charles-Athanase), membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Faune Parisienne, 2 vol. in-8. Paris, 1802.
Tableau des Aranéides, 1 vol. in-8, avec figures, 1805.
Histoire des Aranéides, par fascicules, à la manière de ceux de Panzer sur les insectes d'Allemagne. Il n'en a paru que cinq.
Aranéides de France, ouvrage faisant partie de celui intitulé la Faune Française, publié par MM. de Blainville, Desmaret, Viellot, etc.
Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle des Abeilles solitaires. Paris, 1817, 1 vol. in-8.
[page] 427
WEB. — WEBER (Frédéric), naturaliste allemand, professeur à Kiel.
Observationes Entomologicæ, 1 vol. in-8. Kiel, 1801.
WHITE, BOT. B. ou WHITE. Voy. WHITE (Jean), chirurgien de l'établissement anglais de Botany-Bay.
Je cite son Journal of a Voyage to new Southwales, 1 vol. in-4°. Londres, 1790, avec 65 planches, dont la partie zoologique, enrichie de belles figures, paraît avoir été rédigée par Jean Hunter, le célèbre anatomiste. Il y en a une trad. franç. Paris, 1795, 1 vol. in-8, où l'on a ajouté des notes inutiles, et supprimé l'histoire nat. et les pl.
WIEDEM.—WIEDEMANN (C.-R.-G.), professeur à Kiel.
Diptera exotica, 1 vol. in-8, pars prima, avec figures. Kiliæ, 1821.
Analecta entomologica. Kiliæ, 1824, in-4°, avec pl.
WILL. ou WILLUG. — WILLUGHBY DE ERESBY (François), né en 1635, mort en 1672, gentilhomme anglais, très zélé pour l'histoire naturelle.
Ray a publié, d'après ses papiers posthumes, Ornithologiœ, lib. III. Lond. 1676, 1 vol. in-fol.;
Traduit avec des additions, par Salerne, 1 vol. in-4°. Paris, 1767.
Historia Piscium, lib. IV. Oxford, 1685, 2 vol. in-fol.
Les planches de ces deux ouvrages sont en grande partie copiées d'autres auteurs.
WILSON, naturaliste américain, né en 1766, mort en 1813.
Auteur d'une Crnithologie américaine, en 9 volumes grand in-4°. Philadelphie, 1808 à 1814.
Une nouvelle édition en 3 vol in-4° a paru en 1828.
WOLFF (Jean-Frédéric), médecin allemand.
Icones cimicum descriptionibus illustratæ, 4 fascicules, in-4°. Erlangæ, 1804.
WOLFF, auteur, avec MEYER, de l'Almanach des oiseaux d'Allemagne.
WORM, ou MUS. WORM. — WORMIUS (Olaus) ou WORM,
28*
[page] 428
professeur à Copenhague, né en 1588, mort en 1654.
Museum Wormianum, 1 vol. in-fol. Leyde, 1650.
Y.
YARRELL, naturaliste anglais.
Auteur de divers Mémoires dans le Journal zoologique de Londres, etc.
Z.
ZED ou ZEDER. — ZEDER (Jean-George-Henri), naturaliste allemand.
A donné (en allemand), un premier suppl. à l'Hist. nat. des vers intestinaux de Goese, 1 vol. in-4°. Leipzig, 1800.
Et une introduction à l'Hist. nat. des vers intestin aux, 1 vol. in-8. Bamberg, 1803.
ZETTERST. — ZETTERSTED (Jean-Guillaume), naturaliste suédois.
Orthoptera sueciœ, 1 vol. in-8. Lundæ 1821.
Il vient de publier la première partie d'un autre ouvrage ayant pour titre: Fauna Laponica, 1 vol. in-8. Hammone, 1828.
ZOOL. JOURN. Journal zoologique.
Publié à Londres par M. VIGORS, secondé de plusieurs autres naturalistes, MM. TH. BELL; E. T. BENNETT; J. E. BICHENO; W. J. BRODERIP; J. G. CHILDREN; Gen. Th. HARDWICKE; T. HORSFIELD; W. KIRBY; SOWERBY père et fils et W. YARREL.
Nous en avons seize numéros, de 18 à 1829.
ZORGDRAGER, hollandais.
Auteur d'un Traité sur la pêche de la baleine.
FIN DE LA TABLE ALPHABÉTHIQUE DES AUTEURS CITÉS.
Ajoutez à la lettre B:
BASTEROT (B. de), avocat.
Je cite de lui un Mémoire géologique sur les environs de Bordeaux. Paris, 1825, in-80.
[page 429]
EXPLICATION DES PLANCHES.
NE pouvant donner beaucoup de planches, on a chois i de préférence des espèces non encore bien représentées, ou des parties anatomiques nécessaires à l'intelligence des termes techniques employés dans l'ouvrage.
Les quadrupèdes de la PLANCHE Ire sont suffisamment décrits dans le texte aux endroits cités.
La PLANCHE II a pour objet de faire connaître l'ostéologie de la tête de deux mammifères anomaux, savoir:
1, 2, 3, L'Aye-aye (Cheiromys. C.) qui, à des dents de rongeurs unit une tête fort semblable à celle des quadrumanes, principalement pour ce qui regarde l'arcade zygomatique, l'orbite, etc.
4, 5, 6. Le Phascolome qui, à des dents aussi de rongeurs, unit une tête analogue à celle des carnassiers, et tenant évidemment de fort près à celle des phalangers.
Les oiseaux des PLANCHES III et IV sont suffisamment décrits ou indiqués dans le texte aux endroits cités.
Les PLANCHES V, VI et VII représentent quelques nouvelles espèces de reptiles sauriens, suffisamment indiquées dans les endroits cités au bas.
PLANCHE VIII. Ostéologie de la tête de quelques serpents anomaux.
Fig. 1, 2, 3. Tête de Cécilie en-dessus, de profil et en dessous. Elle est tellement anomale, que nous ne pouvons en donner l'explication qu'avec beaucoup de doute.
a.a. Intermaxillaires et nasaux réunis.
b.b. Maxillaires recouvrant l'orbite et percés d'un petit trou pour l'œil.
c. Frontal unique.
[page] 430
d.d. Frontaux antérieurs.
e.e. Pariétaux.
f.f. Occipital supérieur.
g.g. Frontaux postérieurs?
h.h. Mastoïdiens et caisses réunis.
Fig. 4, 5, 6. Tête d'Amphisbène, en dessus, de profil et en dessous.
a. Frontal propre, unique.
b.b. Frontaux antérieurs.
c.c. Nasaux.
d.d. Maxillaires.
e.e. Pariétal unique.
f.f. Occipital unique.
g.g. Caisses.
h. Intermaxillaire unique.
i.i. Ptérygoïdiens internes.
k. Sphénoïde.
l.l. Palatins.
m.m. Rochers?
Fig. 7, 8, 9. Tête d'Ophisaure, en dessus, en dessous et de profil. C'est une vraie tête de Saurien.
a Frontal.
b. Pariétal.
c.c. Frontaux antérieurs.
d.d. Frontaux postérieurs.
e.e. Jugaux.
f.f. Maxillaires.
g. Intermaxillaire unique.
h.h. Nasaux.
i.i. Temporaux.
k.k. Mastoïdiens.
l.l. Caisses.
m. Occipital supérieur.
n. Occipital inférieur.
o. Sphénoïde.
p.p. Prérygoïdiens internes.
q.q. Transverses.
r.r. Palatins.
[page] 431
PLANCHE IX, fig. 1, 2, 3. Tête du grand Python de l'île de Java, pour servir d'exemple de l'ostéologie de la tête d'un serpent ordinaire non venimeux.
Fig. 1, en dessous. Fig. 2, en dessus, Fig. 3, de profil.
a.a. Frontaux proprement dits.
b.b. Frontaux antérieurs.
c.c. Frontaux postérieurs.
d.d. Surorbitaires.
f. Pariétal unique.
g.g. Mastoïdiens.
h. Occipital supérieur.
i.i. Rochers.
k.k. Caisses.
l.l. Transverses.
m.m. Ptérygoïdiens internes.
n.n. Palatins.
o. Sphénoïde unique.
p. Vomer unique.
q. Intermaxillaire unique.
r.r. Maxillaires.
s.s. Cornets inférieurs.
t.t. Nasaux.
u. Occipital inférieur.
v.v. Etrier de l'oreille.
w.w. Articulaire de la mâchoire inférieure.
x. Dentaire de la mâchoire inférieure.
z. Petite portion du sur-angulaire.
Il s'y trouve encore deux autres os à la face interne, que l'on n'a pas pu exprimer dans ces figures.
Fig. 4, 5, 6. Tête d'un serpent à sonnette, pour servir d'exemple de l'ostéologie de la tête d'un serpent ordinaire venimeux.
Les lettres y désignent les mêmes os que dans les figures du python, et il est aisé par là de saisir les différences de proportions, principalement celles des maxillaires et des ptérygoïdiens.
[page] 432
PLANCHE X. Tête de morue, pour expliquer l'ostéologie de la tête des poissons.
Fig. 1, le crâne en dessus. Fig. 2, le crâne en dessous. Fig. 3, la tête entière de profil.
a.a.a. Frontal proprement dit, unique.
b.b. Frontaux antérieurs.
c.c. Frontaux postérieurs.
d.d. Pariétaux.
e. Interpariétal unique.
é. Sa crête.
f.f. Occipitaux supérieurs.
g.g. Occipitaux latéraux.
h.h. Mastoïdiens.
i. Occipital inférieur.
k. Ethmoïde.
l. Vomer.
m. Sphénoïde.
n.n. Rochers.
o.o. Os représentant les grandes ailes sphénoïdales.
p.p. Os représentant les petites ailes.
q. Intermaxillaires.
r. Maxillaire.
s. Nasal.
t. Cornet inférieur?
u.u. Sous-orbitaires.
v.v. Temporal.
w. Caisse.
x. Transverses.
y. Ptérygoïdien interne.
z. Jugal.
α Préopercule.
β Opercule.
γ Subopercule.
δ Interopercule.
ε Postmandibulaire.
ζ Mandibulaire.
Os hyoïde portant les rayons branchiaux.
La PLANCHE XI représente des espèces nouvelles, mais de genres connus.
[page] 433
Fig. 1. Diodon antennatus, C. ainsi nommé de plusieurs filaments charnus qu'il porte sur le devant de la tête, en a, a, a, ainsi que dans quelques autres parties du corps, qui sont indépendants de ses épines. Sa couleur est un gris roussâtre avec des taches d'un roux foncé, disposé symétriquement.
2. Balistes geographicus. Péron. Ainsi nommé des taches de son corps. Il appartient à la première division de mes monacanthes.
3. Balistes penicibligerus. Péron. Ainsi nommé des tentacules branchus qui hérissent son corps. Il appartient à la troisième division de mes monacanthes.
PLANCHE XII. On a laissé ici quelques espèces de poissons qui formaient à l'époque de la première édition de nouveaux genres ou sous-genres.
Fig. 1. Myletes macropomus. Cuv. L'une de ces trois espèces de Raiis d'Amérique, que j'annonce tome II, p. 311, note 3. Celui-ci se distingue par la grandeur de ses opercules.
2. Hydrocin du Brésil, indiqué p. 312, note 3. Sous le nom d'hydrocyon brevidens. Son caractère spécifique est d'être rayé longitudinalement de noirâtre.
3. Pristigastre. Sous-genre de la famille des Clupes, t. II, p. 321. Cette espèce est tout argentée.
4. Vastrès géant. Très grande espèce du Brésil (t. II, p. 327), remarquable par ses écailles osseuses et la briéveté de sa queue.
PLANCHE XIII. Nous donnons ici les figures de deux Sternoptix, dont la première espèce, Sternoptix diaphana, n'était connue que par une mauvaise figure d'Herman; la deuxième est nouvelle, et a été découverte près des Açores par M. Olfers.
Le Gymnarchus Senegalensis est une espèce nouvelle d'un genre récemment découvert dans le Nil par M. Rifaud.
PLANCHE XIV.
Fig. 1. Notarche. Nouveau genre de gastéropodes tectibranches.
[page] 434
2. Pleurobranchus luniceps. Nouvelle espèce du geure pleurobranche. En a. est la verge; b.b. les tentacules; c. l'anus; d.d. le pied qui déborde le corps de toute part. Cette figure n'est pas gravée au miroir.
3. Animal d'Anomie. a. portion du muscle qui se joint à la troisième valve; b. le pied; c. portion du muscle qui joint les deux grandes valves; d.d. manteau; e.e. coquille.
4. Le Sigaret, avec son manteau charnu enveloppant et cachant sa coquille.
5. Animal de la Tridacne. a. trousseau fibreux analogue aux fils de la moule, et qui attache la tridacne aux rochers b. ouverture pour l'introduction de l'eau; c. ouverture répondant à l'anus; d. muscle transverse.
6. Esquisse rapetissée du beau Polyclinum diazona, découvert par M. de la Roche, et reconnu par M. Savigny pour appartenir aux ascidies composées.
PLANCHE XV.
Fig. 1, 2. Espèce très singulière de Floriceps, trouvée dans le foie du diodon mola. Elle est enveloppée dans un sac membraneux, fig. 1, qui paraît tenir à son corps d'une manière quelconque, et jouir de contractions volontaires.
Fig. 2, représente ce sac ouvert, et l'animal détaché.
Fig. 3, le Chondracanthe de la Roche, et fig. 4, un autre de ces parasites voisins des calyges, que l'on a pris pour des lernées, et qui est du grondin; fig. 5, brachielle du Thon.
Les autres figures sont suffisamment expliquées.
La fig. 9 montre des filaments sortant de son anus. Ses nombreux tentacules sortiraient de l'ouverture opposée.
PLANCHE XVI.
1. Grapse porte-pinceau, de grandeur naturelle., t. IV, p. 52.
2. Remipède tortue, de grandeur naturelle. Ce sous-genre est mentionné page 75. Jaunâtre, un peu rugueuse; cinq dents au bord antérieur. Voyez Latreille, Gener. Crust. et Insect., tome I, p. 45.
3. Pagure a large queue, réduit de moitié. Espèce de la division du pagure voleur, pagurus latro du genre birgus du docteur Léach, cité p. 76, beaucoup plus petit, rou-
[page] 435
geâtre; les deux pieds postérieurs très distincts, bifides, à leur extrémité, ainsi que les deux précédents; antennes mitoyennes aussi longues ou même plus longues que les latérales; d'ailleurs semblables au pagure voleur. — Des Indes orientales.
PLANCHE XVII.
1. Goliath (Inca, Lepell. et Serv.) barbicorne, mâle, de grandeur naturelle. Dessus du corps d'un brun rougeâtre foncé, mat, avec une teinte de bronze, et pointillé de gris; le dessus et les pieds d'un vert bronzé; extrémité antérieure de la tête divisée profondément en deux cornes élevées, comprimées, triangulaires, garnies au côté intérieur d'un duvet jaunâtre. — Du Brésil. Envoyé au Muséum d'Histoire naturelle par M. Alexandre Mac-Leay, secrétaire de la Société Linnéenne.
Ce sous-genre est mentionné tom. IV, pag. 572.
2. Bupreste écussonné, B, de grandeur naturelle; bronzé eu dessus, d'un vert doré en dessous; corselet ayant près de chaque angle postérieur une impression, avec une tache d'un rouge cuivreux; élytres ayant des lignes élevées, en formes de nervures, et cinq dents au bord extérieur. Il ne diffère que par ce dernier caractère du B. scutellaris de Fabricius, qui se trouve à l'Isle-de- France, de même que le précédent, et d'où ils ont été rapporté par M. Cattoire.
3. Lucane serricorne, mâle, de grandeur naturelle; noir luisant; tête large; mandibules presque une fois plus longues qu'elle, terminées en pinces dentelés, écartées entre elles, à leur base, en manière de cercle. — De Madagascar.
4. Cétoine à deux cornes, mâle, de grandeur naturelle; ovale, un peu rétrécie postérieurement, d'un noir luisant, avec les élytres, leur base et l'extrémité opposée exceptés, rouges; tête divisée eu deux longues cornes, avancées, comprimés et pointues. — Rapporté de Timor par Péron et Lesueur.
5. Hispe bordé, de grandeur naturelle; jaunâtre en dessous, d'un noir bleuâtre en dessus, avec la tête, les côtés du corselet, le bord extérieur des élytres, leur suture, et une
[page] 436
ligne transverse près de leur milieu, rougeâtres. — Du Brésil. Cette espèce est du genre alurnus, dans le système de Fabricius.
6. Hélée perforée, de grandeur naturelle; corps très noir, luisant; corselet ayant en devant une ouverture pour laisser passer la tête; les deux lobes de l'échancrure croisés l'un sur l'autre; disque des élytres ayant des poils, disposés en lignes longitudinales. — Rapporté de l'île des Kanguroos par Péron et Lesueur.
7. Brente à queue, de grandeur naturelle; d'un brun noirâtre; longeur de la tête avec la trompe, égalant la moitié de celle du corps; élytres ayant des taches roussâtres, disposées en une ligne, brusquement rétrécies à leur extrémité, et prolongées en forme de queue linéaire; cuisses simples.
De l'Ile-de-France par M. Cattoire. Olivier ayant décrit sous un nom spécifique presque identique (en queue) une espèce très analogue à la précédente par la manière dont se terminent les élytres, mais qui en est distincte et propre à l'Amérique Méridione, nous appellerons avec M. le comte Dejean le brente représenté ici, APPENDICULÉ (appendiculatus)
PLANCHE XVIII.
1. Panagée à quatres taches (P. quadrimaculé. Oliv. Encycl. méth.), de grandeur naturelle; noir; une ontaille de chaque côté du corselet; élytres à stries pointillées, avec deux taches d'un jaune fauve sur chaque. — Du port Jackson.
2. Pambore alternant. Lat. Encycl. méth., de grandeur naturelle; noir; côté du corselet d'un bleu violet; élytres d'un bronzé foncé, sillonnées; sillons coupés par des incisions taansverses, avec une rangée de petits grains. — Port Jackson. Péron et Lesueur.
3. Taupin double-croix, de grandeur naturelle; noir, avec le dessus du corselet et des élytres rouges; milieu du corselet noir, avec deux sillons et une côte au milieu; élytres striées, avec une bande le long de la suture, une autre transverse près de leur milieu, et une troisième à leur extremité, noir; antennes pectinées. — De Madagascar.
[page] 437
4. Onite jaunâtre, mâle, de grandeur naturelle, jaunâtre, avec une teinte bronzée sur le corselet et sur la tête; une ligne élevée, transverse, à la partie antérieure et supérieure de la tête; une autre, anguleuse, interrompue au milieu, en arrière de la précédente; élytres striées, avec un pli au bord extérieur; cuisses postérieures unidentées. — Du port Jackson. Péron et Lesueur.
5. Cétoine à deux cornes, femelle, de grandeur naturelle; semblable au mâle représenté sur la planche précédente; mais le chaperon est simplement échancré.
6. Lebic à côte, de grandeur naturelle; corps entièremeut noir, luisant, ponctué; élytres ayant de petites côtes. — Du port Jackson. Cette espèce forme le genre helluo de M. Bonelli, cité, tom. IV, page 373.
7. Lamie veinée, de grandeur naturelle; corps mélangé de brun, de noirâtre et de jaunâtre; garni de duvet, ainsi que les trois premiers articles des antennes; élytres d'un gris jaunâtre, avec des taches noirâtres, inégales, éparses, corselet sans épines, antennes de longeur moyenne. — Du Bengale. M. Cattoire.
PLANCHE XIX.
1. Pneumore scutellaire, de grandeur naturelle. Femelle aptère, d'un vert pâle, avec des taches blanches et plus grandes sur le thorax, et d'autres jaunâtres sur l'abdomen; les unes et les autres disposées en séries longitudinales et bordées de rouge; trois de chaque côté de la carène dorsale, formant de petites bandes obliques, bords du thorax dentelés. Du Muséum d'Histoire naturelle, et apporté du cap de Bonne-Espérance, par Lalande.
2. Nemestrine longirostre, de grandeur naturelle. Cette espèce a été décrite par M. Wiedemann, sous le même nom spécifique (longirostris). Elle est noirâtre et garnie d'un duvet jaunâtre, avec plusieurs petites taches d'un gris de perle sur le thorax et l'abdomen; cette dernière partie du corps est entre-coupée, transversalement de bandes noirâtres et rousseâtres; les taches y sont placées sur les premières; les côtés offrent des faisceaux de poils noirs. Les ailes sont noirâtres, avec de petites taches, et le limbe postérieur trans-
[page] 438
parent. La trompe est trois à quatre fois plus longue que le corps. Les pattes sont roussâtres. — Du cap de Bonne-Espérance.
3. Corée (sous - genre Syromeste), Phyllomorphe, de grandeur naturelle. Espèce voisine du Coreus paradoxus de Fabricius; mais un peu moins velue et proportion nellement plus courte et plus large, avec l'abdomen presque carré; ses bords latéraux offrent en devant trois dentelures et deux lobes en arrière; le bord postérieur a, de chaque côté une petite incision. Le corps est un peu relevé sur ses bords en manière de nacelle, grisâtre, un peu transparent et un peu veiné; ses bords et le premier article des antennes sont hérissés de petites épines. — Du Sénégal, où elle a été recueillie par M. Dumolin, commissaire de la marine, et envoyée à M. Guérin, qui l'a donnée au Muséum d'Histoire naturelle.
4. Synagre spiniventre, de grandeur naturelle. Femelle noire, avec les ailes d'un bleu violet, et l'extrémité postérieure de l'abdomen couleur de souci; son second anneau est armé en dessous de deux épines assez fortes. — Du même pays, et donné aussi à cet établissement par le même naturaliste.
5. Abdomen de cet insecte vu en dessous.
6. Fourmilion clavicorne, de grandeur naturelle. Corps blanchâtre, avec des points noirs sur le thorox. Antennes terminées en un petit bouton arrondi; de petites taches noires, dont les unes presque en forme de pointes, et les autres, particulièrement celles du bord interne, formant de petites lignes sur les ailes supérieures; d'autres lignes de la même couleur, et dont l'une bifides postérieurement à l'extrémité des inférieurs; une tache plus grande et presque arrondie, pareillement noire dans leur milieu. — Du Sénégal encore, et donné aussi au Muséum par le même naturaliste.
PLANCHE XX (1).
1. Smérinthe Dumolin, de grandeur naturelle. Ailes
(1) Les Lépidoptères représentés sur cette planche, nous ont été communiqués par M. Boisduval, l'un des naturalistes actuels, qui connaît le mieux cet ordre d'insectes. Il a bien voulu y joindre les descriptions suivantes.
[page] 439
dentées d'un gris brunâtre obscur; les supérieures avec deux ou trois petites lignes sinuées, d'un gris blanchâtre, peu prononcées, et une large bande d'un brun olivâtre, n'atteignant pas la base marquée d'un gros point blanc et d'une tache trilobée également blanche; l'extrémité de ces mêmes ailes avec une bande brunâtre plus pâle et fortement dentée. Dessous des quatre ailes plus pâle que le dessus, ayant sur le milieu près de la côte de chacune, une large tache noire.
Corselet d'un gris foncé avec le milieu d'un brun olivâtre, ainsi que l'origine de l'abdomen, antennes blanches, plus faible dans la femelle que dans le mâle.
Chenille à tête triangulaire comme celle de tous les smerinthes, annelée de noir et de rouge, avec des points noirâtres sur tout le corps, Elle vit au Sénégal, sur le Baobab, où M. Dumolin en a découvert deux individus.
De la collection de M. le comte Dejean.
2. Castnie Hübner, de grandeur naturelle. Ailes supérieures brunes, avec deux bandes obliques blanches et presque maculaires au-delà du milieu des ailes. Ailes postérieures noirâtres avec la côte et la base rougeâtre, et deux rangées de gros points vers l'extrémité, dont la postérieure marginale est d'un rouge minium et l'autre blanche. Dessous des quatre ailes offrant le même dessin que le dessus, mais presque entièrement rougeâtre excepté le milieu des inférieures, et le côté externe de la bande terminale des premières qui sont noires.
Abdomen du même ton que les ailes.
Amérique méridionale. De la collection de M. le comte Dejean.
3. Ægocère Boisduval, de grandeur naturelle. C'est la troisième espèce du genre que l'on connaisse. Ailes supérieures d'un brun vineux, avec trois bandes blanches: l'une longeant tout le bord interne, l'autre très courte, partant de la côte, et enfin la dernière partant aussi de la côte pour descendre obliquement près du bord externe:
[page] 440
ces mêmes ailes offrent en outre sur leur fond, quatre taches métalliques d'un gris violâtre. Ailes postérieures jaunes avec une lunule, et l'extrémité d'un brun clair. Corselet blanc avec les épaulettes d'un brun veineux. Abdomen jaune avec une série de points noirs sur le dos. Antennes plus grêles que dans l'Ægocera venulia. De la côte occidentale d'Afrique. Collection de Boisduval.
4. Coronis d'Urville, de grandeur naturelle. Dessus des premières ailes d'un brun olivâtre, ayant près de la base et vers le milieu une bande oblique dentée en scie, blanchâtre; celle de la base plus ou moins violâtre, celle du milieu un peu lavée d'olivâtre sur son côté interne qui, seul, est denté; l'extrémité offre près de la frange une double ligne grisâtre, dont la plus externe denticulée: ailes postérieures se terminant par une queue médiocre, un peu spatulée et offrant sur le milieu une bande d'un bleu violet vif, très large près de la côte et finissant en pointe près de l'angle anal. Dessous des quatre, d'un brun olivâtre pâle, avec une bande blanche sur le milieu de chacune, et l'extrémité d'un gris jaunâtre. Cayenne, de la collection de M. Boisduval.
FIN DE L'EXPLICATION DES PLANCHES.
[page 441]
TABLE ALPHABÉTIQUE
DE L'OUVRAGE.
Nota. Le chiffre romain indique le volume, et le chiffre arabe la page.
A.
Abeilles, V, 342.
Ablette, II, 276.
Abranches, III, 209.
Abranchus (note), II, 118.
Abramès, II, 274.
Abstraction, I, 42.
Acænites (Acænitas), V, 288.
Acalèphes (Acalephæ), III, 274.
Acalèphes simples, III, 275.
Acalèphes hydrostatiques, III, 284.
Acamarchis, III, 302.
Acanthées (Acanthéa), V, 200.
Acanthocéphales, III, 260.
Acanthocères (Acanthocerus), IV, 546.
Acanthomères (Acanthomera), V, 16 et 482.
Acanthonix (Acanthonix), IV, 58.
Acanthopes (Acanthopus), V, 38 et 356.
Acanthoptères (Acanthoptera, V, 114.
Acanthoptérigiens, II, 131, 158 et 171.
Acanthoscèles (Acanthocelis), IV, 383.
Acanthuros (Acanthurus), II, 223.
Acarde, III, 119.
Acarne, II, 183.
Acarus, IV, 283 et 286.
Acastes, III, 178.
Accipitres, I, 313.
Acéphales, III, 115.
Acéphales sans coquilles, III, 162.
Acéphalophores (note), III, 115 et 170.
Acères, III, 62.
Acérina, II, 144.
Acétabules (Acetabulum), III, 308.
Achées (Achaeus), IV, 64.
Acheus, I, 224.
Achias (Achias), V, 517.
Achires (Achirus), II, 343.
Acinopes (Acinopus), IV, 389.
Acipenser, II, 378.
Aclysies (Aclysia), IV, 290.
Acmea, III, 83.
Acoétes, III, 207.
Acontias, II, 70.
Acrochordes, II, 85.
Acrydium, V, 185.
Actéons, III, 84.
TOME III. 29
[page] 442
Actinaires (note), III, 321.
Actinies (Actinia), III, 291.
Actinocrinites, III, 230.
Acrocine (Acrocinus), V, 123.
Acupalpes (Acupalpus), IV, 391.
Adèles (Adela), V, 423.
Adelie (Adelium), V, 58.
Adélocères (Adelocera), IV, 451.
Adelosines (note), III, 25.
Adelostomes (Adelostoma), V, 10.
Adéones (Adeona), III, 317.
Aedes (Aedes), V, 439.
Aega (Aega), IV, 134.
Ægagre, I, 275.
Aegialies (Aegialia), IV, 540.
Aegocères (Aegocera), V, 392.
Aegothèles (add.), I, 583.
Aegypius (add.), I, 582.
Æsales (Æsalus), IV, 577.
Aeshnes (Aeshnes), V, 239.
Aethra (Aethra), IV, 67.
Agacephales (Agacephala), IV, 549.
Agames (Agama), II, 35.
Agamis, I, 506.
Aganide (note), III, 18.
Agaons (Agaon), V, 297.
Agaricines, III, 315.
Agaristes (Agarista), V, 389.
Agatines (Agatina), III, 45.
Agathis (Agathis), V, 288.
Agathistegues (note), III, 25.
Agelaius (note), I, 418.
Ageneioses, II, 295.
Aggrégés, III, 167.
Aglaophenies, III, 301.
Aglaures, III, 201.
Aglosses (Aglossa), V, 418.
Agnoste (Agnostus), IV, 204.
Agones (Agonum), IV, 402.
Agonus, II, 163.
Agoutis, I, 221.
Agres (Agra), IV, 376.
Agrions (Agrion), V, 240.
Agriopes, II, 168.
Agyrtes (Agyrtes), IV, 501.
Ahætula, II, 82
Aï, I, 225.
Aigles, I, 324.
Aigles-Autours, I, 329.
Aigles-Pêcheurs, I, 326.
Aiguillats, II, 391.
Ailurus, I, 138.
Akera, III, 62.
Akis (Akis), V, 10.
Alabès, II, 354.
Alactaga, I, 209.
Alauda, I, 399.
Albatrosses, I, 554.
Albiones, III, 216.
Albumine, I, 24.
Albunées (Albunea), IV, 74.
Alca, I, 548.
Alcedo, I, 443.
Alcinoes, III, 282.
Alciopes, III, 202.
Alcyons (Alcyonium), III, 320.
Alecto, III, 228 et 303.
Alectors, I, 469.
Alene (note), III, 101.
Aleochares (Aleochara), IV, 440 et 441.
Alèpes (note), III, 177.
Alepocephales, II, 283.
Aleyrodes (Aleyrodes), V, 228.
Algazel, I, 271.
Algyres (Algyra), II, 31
Alicorti, II, 198.
Alimes (Alima), IV, 110.
[page] 443
Allecules (Allecula), V, 42.
Alligator, II, 22.
Alomyes (Alomya), V, 287.
Aloses (Alosa), II, 319.
Alouatte, I, 99.
Alouettes, I, 399.
Alouettes de mer, I, 526.
Alpées (Alpaeus), IV, 415.
Alphées (Alpheus), IV, 96.
Alucites (Alucita), V, 420.
Alurnes (Alurnus), V, 142.
Alutères, II, 374.
Alveolines (note), III, 25.
Alydes (Alydas), V, 197.
Atye (Atya), IV, 93.
Alysies (Alysia), V, 290.
Alyson (Alyson), V, 331.
Amande de mer, III, 63.
Amarygmes (Amarygmus), V, 36.
Amathie (Amathia), V, 547.
Amatia, III, 301.
Ambasses, II, 137.
Ambassis, II, 137.
Amblytères, IV, 556.
Ambrettes, III, 44.
Ameiva, II, 28.
Amerhine (Amerhinus), V, 85.
Amies (Amia), II, 327.
Ammobates, V, 352.
Ammocètes (Ammocetus), II, 406.
Ammodites, II, 360.
Ammonites, III, 20.
Amnios, I, 64.
Ampelis, I, 361.
Amphacanthus, II, 223.
Amphibies, I, 166.
Amphibulimes (note), III, 44.
Amphicomes (Amphicoma), IV, 566.
Amphictènes (note), III, 194.
Amphidesmes (note), III, 153.
Amphinomes (Amphinome), III, 198.
Amphipeplea (note), III, 48.
Amphipodes (Amphipoda), IV, 114.
Amphiprions, II, 179.
Amphiroés, III, 306.
Amphisbènes (Amphisbæna), II, 72.
Amphisiles, II, 269.
Amphistegines (note), III, 25.
Amphistoma, III, 263.
Amphitrites (Amphitrite), III, 194.
Amphiuma, II, 118.
Ampithoès (Ampithoès), IV, 121.
Ampulex (Ampulex), V, 324.
Ampullaires (Ampullaria), III, 81.
Anabas, II, 226.
Anabates (Anabates), I, 429.
Anableps (Anableps), II, 279.
Anacanthes, II, 400.
Anadiomène, III, 308.
Anampsès, II, 259.
Ananchites, III, 236.
Anarrhiques (Anarrhichas), II, 240
Anas, I, 565.
Anaspes (Anaspis), V, 57.
Anastomus, I, 515.
Anatifes (Anatifa), III, 175.
Anatines, III, 155.
Ancées (Anceus), IV, 125.
Anchois, II, 322.
Anchomènes (Anchomenus), IV, 403.
Anchorelles, III, 257.
Ancillaires (Ancillaria), III, 98.
Ancilorhynques (Ancilorhyncus), V, 456.
Ancylodon, II, 173
29*
[page] 444
Ancyloscèles (Ancyloscelis), V, 355.
Ane, I, 253.
Anchone (Anchonus), V, 88.
Anelastes (Anelastes), IV, 459.
Anges, II, 394.
Anguille (Muræna), II, 348.
Anguinaires (Anguinaria), III, 300.
Anguis, II, 68.
Angulite (note), III, 18.
Anhinga, I, 564.
Anilius (note), II, 76.
Animaux articulés, I, 50.
Animaux à bourse, I, 68.
Animaux mollusques, I, 50.
Animaux rayonnés, I, 51.
Anis, I, 459.
Anisonyx (Anisonyx), IV, 568.
Anisoplies (Anisoplia), IV, 563.
Anisoscèles (Anisoscelis), V, 197.
Annélides, III, 182 et suiv.
Anobium, IV, 483.
Anodontes (Anodontes), III, 137.
Anœma, I, 220.
Anolis (Anolius), II, 48.
Anomalines (note), III, 23.
Anomies (Anomia), III, 126.
Anopheles (Anopheles), V, 439.
Anoplognathes (Anoplognathus), IV, 556.
Anoplotherium, I, 246.
Anostomes (Anostomus), II, 309.
Anoties (Anotia), V, 217.
Anser, I, 567.
Antennarius, II, 251.
Antennulaires, III, 301.
Antéons (Anteon), V, 300.
Anthosome (Anthosoma), IV, 198.
Anthias, II, 140.
Anthies (Anthia), IV, 367.
Anthidies (Anthidium), V, 350.
Antipathes (Antipathes), III, 309.
Anthipnes (Anthipna), IV, 567.
Anthocephalus (note), III, 271.
Anthomyies (Anthomyia), V, 519.
Anthophila, V, 341.
Anthophores (Anthophora), V, 355.
Anthrax, V, 465.
Anthrènes (Anthrenus), IV, 511.
Anthribe (Anthribus), V, 72.
Anthures (Anthura), IV, 138.
Anthus, I, 391.
Antilope, I, 266 et 582.
Aoura, I, 317.
Apanistiques (Apanisticus), IV, 448.
Apars, I, 228.
Apatomyze (Apatomyza), V, 463.
Aphis, V, 226.
Aphidiens (Aphidii), V, 224.
Aphidiphages (Aphidiphagi), V, 160.
Aphodies (Aphodius), IV, 539.
Aphrites (Aphritis), V, 496.
Aphrodites (Aphrodita), III, 206.
Apiocrinites, III, 230.
Apis, V, 342.
Apistes, II, 167.
Aplysies (Aplysia), III, 60.
Apogonies (Apogonia), IV, 557.
Apogons (Apogon), II, 136.
Apolles, III, 104.
Apores (Aporus), V, 322.
Aporobranches (note), III, 26.
Apotomes (Apo
Aprons, II, 135.
Apseudis (Apseudis), IV, 124.
Aptenodytes, I. 550
[page] 445
Aptines (Aptinus), IV, 388.
Apus (Apus), IV, 179.
Aquila, I, 324.
Aracari, I, 460.
Arachnides, III, 184 et IV, 206.
Arachnotères, I, 434.
Arades (Aradus), V, 201.
Araignée (Aranca), IV, 235.
Aranéides (Araneides), IV, 213.
Aras, I, 461.
Arcacées (note), III, 132.
Arches (Arca), III, 132.
Archers, II, 195.
Arcopages (Arcopagus), V, 165.
Arctomys, I, 196.
Arctures (Arcturus), IV, 139.
Ardea, I, 510.
Arenaria, I, 526.
Arénicoles (Arenicola), III, 197.
Areodes (Areodes), IV, 561.
Argali, I, 277.
Argas (Argas), IV, 288.
Argentines (Argentina), II, 308.
Argonautes (Argonauta), III, 12.
Argule (Argulus), IV, 190,
Argus ou Luen, I, 478.
Argyseyores, II, 210.
Argyrites (Argyrites), V, 518.
Argyronete (Argyroneta), IV, 242.
Aricies, III, 204.
Arondes, III, 131.
Arremou (note), I, 408.
Arrosoirs, III, 161.
Artemies (Artemia), IV, 173.
Artères, I, 35.
Articulines (note), III, 25.
Articerès (Articerus), V, 166.
Arvicola, I, 205.
Armadilles (Armadillo), IV, 144
Asaphes (Asaphus), IV, 205.
Aselles (Asellus), IV, 140.
Asèmes, III, 178.
Ascagne, I, 93.
Ascalabotes, II, 50.
Ascalaphes (Ascalaphus), V, 249.
Ascarides (Ascaris), III, 250.
Ascidies (Ascidia), III, 165.
Ascies (Ascia), V, 497.
Ascomys, I, 211.
Asides (Asida), V, 19.
Asiles (Asilus), V, 456.
Asindule (Asindulum), V, 448.
Asiraques (Asiraca), V, 217.
Aspergillum, III, 161.
Aspidiphores (Aspidiphorus), IV, 508.
Aspidogaster, III, 266.
Aspidophores, II, 163.
Aspistes (Aspistes), V, 453.
Asprédes (Aspredo), II, 299.
Aspro, II, 135.
Astacus, IV, 88.
Astates (Astata), V, 327.
Astartés, III, 150.
Astemme (Astemma), V, 199.
Astéries (Asterias), III, 225.
Astomes, III, 279.
Astrapées (Astrapaeus), IV, 433.
Astrapia (note), I, 371.
Astrées, III, 314.
Astrodermus, II, 216.
Astur, I, 331.
Atélécycles (Atelecyclus), IV, 38.
Atèles, I, 100.
Ateuchus (Ateuchus), IV, 532.
Athalies (Athalia), V, 275.
Athanas (Athanas), IV, 99.
Athéricères (Athericera), V., 488.
[page] 446
Athérines (Atherina), II, 234.
Atherix (Atherix), V, 468.
Atherures, I, 215.
Athyrée (Athyreus), IV, 544.
Atlantes (Atlanta), III, 68.
Atomes (Atoma), IV, 291.
Atractocere (Atractocerus), IV, 485.
Attagènes (Attagenus), IV, 510.
Attelabes (Attelabus), V, 73.
Attes (Atta), V, 313.
Atychies (Atychia), V, 394.
Atyles (Atylus), IV, 120.
Atypes (Atypus), IV, 233.
Auchenia, I, 258.
Auchénies (Auchenia), V, 138.
Aulaques (Aulacus), V, 281.
Aulopes (Aulopus), II, 315.
Aulostomes, II, 268.
Aurelies (note), III, 277.
Auricules (Auricula), III, 49.
Auroch, I, 279.
Autonomées (Autonomea), IV, 96.
Autours, I, 331.
Autruches, I, 495.
Auxides (Auxis), II, 198.
Averanos, I, 364.
Avicula, III, 131.
Avocettes, I, 533.
Axies (Axius), IV, 87.
Axine (note), III, 265.
Axines (Axina), IV, 477.
Axinures, II, 225.
Axolots, II, 119.
Aye-Aye, I, 195.
B.
Babiroussa, I, 244.
Baccha (Baccha), V, 494.
Bacha, I, 337.
Bachype (Bachypus), V, 83.
Badister (Badister), IV, 405.
Bagous (Bagous), V, 83.
Bagres, II, 292.
Balaena, I, 295.
Balanine (Balaninus), V, 84.
Balanus, III, 177.
Balbusards, I, 327.
Baleines, I, 295.
Balénoptères, I, 297.
Balistes (Balistes), II, 37.
Barbacous, I, 455.
Barbaresque, I, 193.
Barbeaux (Barbus), II, 272.
Barbicans, I, 457.
Barbiers, II, 140.
Barbue, II, 341.
Barbus, I, 456.
Barges, I, 524.
Baridie (Baridius), V, 85.
Barillets, III, 43.
Bariphonus (note), I, 443.
Barita, I, 353.
Bars, II, 133.
Banchus (Banchus), V, 287.
Banxring (note), I, 126.
Basilics (Basilicus), II, 46.
Bathiergus, I, 211.
Batholithes, III, 120.
Batraciens, II, 101.
Batracoïdes (Batrachus), II, 253.
Baudroyes, II, 250.
Bdelles, III, 214.
Bdelles (Bdella), IV, 286.
Bécard, II, 303.
Bécardes, I, 354.
Bécasse, I, 518.
[page] 447
Bécasseau, I, 531.
Bec-croisé, I, 414.
Bec-en-ciseaux, I, 560.
Bec-fin, I, 382.
Bec-ouvert, I, 515.
Belzébuth, I, 101.
Belemnitea, III, 19.
Bellerophes, III, 14.
Belette, I, 143.
Belone, II, 284.
Belostomes (Belostoma), V, 206.
Beluga, I, 291.
Belytes (Belyta), V, 301.
Bembex (Bembex), V, 325.
Bembidions (Bembidion), IV, 418.
Benturongs, I, 138.
Bérenices (note), III, 304.
Bergeronnettes, I, 391.
Beris (Beris), V, 483.
Bernaches, I, 568.
Béroé (Beroe), III, 280.
Beroses (Berosus), IV, 524.
Beryx, II, 151.
Béthiles, I, 355.
Bethyles (Bethylus), V, 300.
Bethylus, I, 355.
Bibions (Bibio), V, 453.
Biblis (Biblis), V, 381.
Bichirs, II, 329.
Bicuirassés (Bipeltata), IV, 110.
Bigenerines (note), III, 25.
Bihoreaux, I, 512.
Biloculines (note), III, 25.
Bimanes, II, 66.
Bipèdes (Bipes), II, 65.
Biphores, III, 163.
Birgus (Birgus), IV, 76.
Biset, I, 490.
Bison, I, 280.
Bittaques (Bittacus), V, 246.
Bitomes (Bitoma), V, 97.
Blac, I, 334.
Blaireaux, I, 140.
Blaps (Blaps), V, 15.
Blapstine (Blapstinus), V, 21.
Blattes (Blatta), V, 174.
Blanquette, II, 318.
Blenies ou Baveuses, II, 236.
Blennius, II, 236.
Blepharis, II, 209.
Blepsias, II, 167.
Blongios, I, 511.
Boa (Boa), II, 77.
Bocydies (Bocydium), V, 219.
Bœufs, I, 278.
Bogueravel, II, 183.
Bogues, II, 185.
Bolbocères (Bolbocera), IV, 545.
Bolitophiles (Bolitophila), V, 448.
Bottenies (note) III, 166.
Bombilles (Bombillus), V, 461.
Bombinator, II, III.
Bombus, V, 357.
Bombycilla, I, 363.
Bonasia (note), I, 481.
Bondrées, I, 335.
Bonellies (Bonellia), III, 243.
Bongares, II, 96.
Bonicou, II, 199.
Bonnet chinois, I, 95.
Boops, II, 185.
Bopyres (Bopyrus), IV, 132.
Borées (Boreus), V, 247.
Borlasia (note), III, 259.
Boros (Boros), V, 24.
Bos, I, 278.
Bostriches (Bostrichus), V, 344.
Botrhops, II, 88.
Botrylles (Botryllus), III, 168.
[page] 448
Bothryocéphales (Bothryocephalus), III, 270.
Botys (Botys), V, 417.
Boubies, I, 563.
Boucliers, IV, 495.
Boulereau, II, 243.
Bouquetin, I, 276.
Bourdons, V, 357.
Bousiers, IV, 538.
Bouvreuils, I, 414.
Brachélytres, IV, 431.
Brachielles, III, 257.
Brachines (Brachinus), IV, 369.
Brachions (Brachionus), III, 325.
Brachiures, I, 104.
Brachycéphalus (note), II, 112.
Brachycères (Brachycerus), V, 76.
Brachylophes, II, 40.
Brachyopes (Brachyopa), V, 498.
Brachyptères, I, 544.
Brachypus (note), II, 66.
Brachytèles, I, 101.
Bracons (Bracon), V, 289.
Bradypus, I, 223.
Brama, II, 194.
Branchellion, III, 216.
Branchie, I, 36.
Branchiopodes (Branchiopoda), IV, 149.
Branchipes (Branchipus), IV, 174.
Brassolides (Brassolis), V, 383.
Brèmes, II, 274.
Brentes (Brentus), V, 75.
Brèves, I, 373.
Breviceps, II, 112.
Brevipennes, I, 494.
Brissoïdes, III, 237.
Brochets, II, 282.
Brosmes (Brosmius), II, 334.
Brotules (Brotula), II, 335.
Bruants, I, 403.
Bruches (Bruchus), V, 71.
Bryaxis (Bryaxis), V, 165.
Bubale, I, 269.
Bubo, I, 343.
Bubreste (Bubrestis), IV, 445.
Bucardes, III, 144.
Buccinoïdes, III, 91.
Buccins (Buccinum), III, 97.
Bucco, I, 456.
Bucentes (Bucentes), V, 506.
Buceros, I, 445.
Buffle, I, 280.
Bufo, II, 109.
Bullées, III, 63.
Bulimes terrestres, III, 42.
Bulimines (notes), III, 24.
Bulimus, III, 42.
Buphaga, I, 416.
Bura, II, 223.
Bursaires, III, 326.
Bursatelles, III, 62.
Busiris, III, 56.
Busards, I, 337.
Buses, I, 336.
Buteo, I, 336.
Butirins (Butirinus), II, 324.
Butors, I, 512.
Byrrhe (Byrrhus), IV, 512.
Byssomies, III, 156.
Bythines (Bythynus), V, 165.
Bytures (Byturus), IV, 506.
[page] 449
C.
Caama, I, 269.
Cabassou, I, 229.
Cabiais, I, 219.
Cabochons, III, 87.
Cacatoes, I, 464.
Cachalots, I, 293.
Cachichames, I, 227.
Cadrans, III, 75.
Caesio, II, 187.
Cailles, I, 485.
Cailleu-Tassarts, II, 320.
Caïmans, II, 22.
Calamita, II, 107.
Calandre, I, 400.
Calandre (Calandra), V, 87.
Calaos, I, 445.
Calappes (Calappa), IV, 66.
Calathes (Calathus), IV, 401.
Calcar (Calcar), III, 73 et V, 25.
Calcarines (notes), III, 24.
Calceoles, III, 120.
Calèpes (Calepus), V, 142.
Calidris, I, 525.
Caliges (Caligus), IV, 195.
Calleïdes (Calleida), IV, 377.
Callianasses (Callianassa), IV, 87.
Callianires, III, 282.
Callianyres, III, 301.
Callicères (Callicera), V, 496.
Callichromes (Callichroma), V, 113.
Callichtes (Callichtys), II, 298.
Callidies (Callidium), V, 117.
Callimorphes (Callimorpha), V, 406.
Calliodons, II, 266.
Callionymes (Callionymus), II, 247.
Callirhipis (Callirhipis), IV, 459.
Callirhoé (note), III, 276.
Callistes (Callistus), IV, 403.
Callitriche, I, 91.
Callobates (Callobata), V, 530.
Callomyies (Callomyia), V, 473.
Callorinques (Callorhynchus), II, 382.
Calmars, III, 14.
Calocéphales, I, 167
Calopes (Calopus), V, 48.
Calosomes (Calossoma) IV, 413.
Calotes, II, 38.
Calpes, III, 289.
Calybés, I, 354.
Calymènes (Calymene) IV, 205.
Calyptomènes, I, 393.
Calyptorhynchus (note), I, 464.
Calyptrées (Calyptraea), III, 88.
Camacées, III, 141.
Caméléons (Camaeleo), II, 58.
Camelopardalis, I 265.
Camelus, I, 256.
Camérines, III, 22.
Cames, III, 143.
Campagnols, I, 205.
Campanulaires, III, 300.
Campilodon, II, 205.
Camposie (Camposia), IV, 60.
Campsies (Campsia), V, 37.
Camptocères (Camptocerus), V, 91.
Camptorhynques, V, 86.
Campyles (Campylus), IV, 456.
[page] 450
Campylomyzes (Campylomyza), V, 450.
Campylopterus (add.). I, 583.
Canards, I, 565.
Cancellaires (Cancellaria), III, 97.
Cancer, IV, 30.
Cancroma, I, 509.
Canis, I, 149.
Canna, I, 272.
Cantharides (Cantharis), III, 74 et V, 67.
Canthères (Cantharus), II, 185.
Cantrope (note), III, 18.
Caouane, II, 14.
Caparo, I, 101.
Capillaria, III, 249.
Capitaines, 2, 257.
Capito (note), I, 457.
Capra, I, 275.
Caprella, IV, 128.
Capricorne, V, 110.
Caprimulgus, I, 397.
Capromys, I, 200.
Capros, II, 211.
Capsala (note), III, 265.
Capses (Capsa), III, 151.
Capses (Capsus), V, 199.
Capuloides, III, 86.
Capulus, III, 87.
Carabe (Carabus), IV, 365 et 411.
Caracal, I, 164.
Caracara, I, 328.
Caractères, I, 9.
Carangues, II, 208.
Caranx (Caranx), II, 207.
Caranxomores, II, 216.
Carapes (Carapus), II, 357.
Carbo, I, 562.
Carcharias, II, 387.
Carcinoïdes, IV, 151.
Cardiacés, III, 144.
Cardinales, V, 54.
Cardisomes (Cardisoma), IV, 50.
Cardites, III, 139.
Cardium, III, 144.
Carduelis, I, 409.
Carenums (Carenum), IV, 381.
Caret, II, 13.
Cariama, I, 505.
Carinaires, III, 68.
Caris (Caris), IV, 290.
Carnassiers, I, 110 et IV, 355.
Carnivora, IV, 355.
Carnivores, I, 132.
Carouges, I, 418.
Carreau, II, 271.
Caryocatactes, I, 423.
Caryophyllaeus, III, 263.
Cassicus, I, 416.
Cassidaires, III, 101.
Cassidulines (note), III, 23.
Cassis, III, 100.
Casmarhynchos, I, 364.
Casnonies (Casnonia), IV, 371.
Casoars, I, 496.
Casques, III, 100.
Casse-Noix, I, 423.
Cassicans, I, 353.
Cassides (Cassida), V, 143.
Cassidules, III, 235.
Cassiques, I, 416.
Castagnoles, II, 194.
Castalies (Castalia), III, 139.
Castnies (Castnia), V, 389.
Castors (Castor), I, 212.
Casuarius, I, 496.
Cataphractus, II, 298.
Catarrhactes, I, 551.
[page] 451
Catascope (Catascopus), IV, 398.
Catastomes (Catastomus), II, 275.
Catharistes, I, 316.
Calhartes, I, 316.
Catroptophorus (note), I, 531.
Caudisona (note), II, 88.
Causes finales, I, 5
Caurale, I, 508.
Cayopollin, I, 177.
Cayou, I, 101.
Cavia, I, 220.
Cavitaires, III, 247.
Cavolines (Cavolina), III, 55.
Ceblepyris, I, 363.
Cebrion (Cebrio), IV, 457.
Cebus, I, 102.
Cecidomyie (Cecidomyia), V, 443.
Cécilies (Caecilia), II, 98.
Cecrops (Cecrops), IV, 199.
Cellépores (Cellépora), III, 304.
Cellulaires (Cellularia), III, 302.
Cellulosité, I, 21.
Célonites (Célonites), V, 333
Célyphes (Celyphus), V, 535.
Cenchris (note), II, 79.
Centenes, I, 125.
Centorhynques, V, 86.
Centrarchus (Centrarchus), II, 147.
Centrina, II, 392.
Centrines (Centrinus), V, 86.
Centris (Centris), V, 356.
Centrisques (Centriscus), II, 268.
Centrogaster, II, 223.
Centrolophes, II, 216.
Centronotes (Centronotus), II, 202.
Centronotus, II, 239.
Centropomes (Centropomes), II, 134.
Centropristes (Centropristis), II, 145.
Centropus, I, 454.
Centrotes (Centrotus), V, 219.
Cephalacanthes, II, 162.
Cephalies (Cephalia), V, 532.
Cephalopodes, III, 8.
Cephalocères (Cephlocera), V, 480.
Céphaloptères, I, 361.
Cephaloptères (Cephaloptera), II, 401.
Cephalotes, I, 114.
Céphalotes (Cephalotes), IV, 398.
Cephalus, III, 369.
Cephus, I, 548 et V, 277.
Cepola, II, 221.
Cerambyx, V, 110.
Céramie (Ceramius), V, 335.
Cerapes (Cerapus), IV, 122.
Ceraptère (Cerapterus), V, 93.
Ceraspis (Ceraspis), IV, 561.
Ceraste, II, 91.
Ceratine (Ceratina), V, 347.
Cératophris, II, 106.
Ceratophthalmes, IV, 172.
Ceratophye, (Ceratophya), V, 496.
Ceratophytes, III, 309.
Ceratopogons (Ceratopogon), V, 442.
Ceraturgues (Ceraturgus), V, 457.
Cerbères (Cerberus), II, 81.
Cercaires (Cercaria), III, 326.
Cercopes (Cercophis), V, 221.
Cercopithecus, I, 91.
Cérébratules, III, 260.
Cereopsis, I, 569.
Cerfs, I, 260.
Ceries (Ceria), V, 495.
Cerithes (Cerithium), III, 101.
Cerniers, II, 145.
[page] 452
Cerocomes (Cerocoma), V, 62.
Ceropales (Ceropales), V, 320.
Cérophyte (Cerophytum), IV, 453.
Ceroplates (Ceroplateus), V, 451.
Cerpules Cymospires (note), III, 191.
Cerques (Cercus), IV, 506.
Certhia, I, 430.
Certhilauna (add.), I, 583.
Cervus, I, 260.
Cérylons (Cerylon), V, 96.
Ceste (Cestum), III, 282.
Cestoides, III, 273.
Cestracions, II, 391.
Cétacés, I, 281.
Cétoines, IV, 574.
Ceyx, I, 444.
Chabots, II, 162.
Chacal, I, 151.
Chaetodons, II, 188.
Chaetoptère (Chaetopterus), III, 208.
Chaïa, I
Chalceus, II, 311.
Chalcides (Chalcides), II, 66.
Chalcis (Chalcis), V, 294.
Chalybaeus, I, 354
Chama, III, 141.
Chamaesaura (note), II, 64.
Chameaux, I, 256.
Chameck, I, 100
Chamois, I, 274.
Champses (note), II, 21.
Changeants, V, 37.
Charaçins (Characinus), II, 308.
Charadrius, I, 499.
Charançons, V, 77.
Charax (note), II, 181.
Charbonnière, I, 401.
Chasmés (Chasme), IV, 567.
Chasmodies (Chasmodia), IV, 553.
Chasmoptères (Chasmopterus), IV, 467.
Chats, I, 160.
Chat-cervier, I, 164.
Chats-Huants, I, 342.
Chatoessus, II, 320.
Chauna, I, 536.
Chauliodes (Chauliodus), II, 284.
Chauve-Souris, I, 112.
Chamaepelia (add.), I, 584.
Cheilodactyles, II, 177.
Cheilodiptères, II, 137.
Chersine (note), II, 9.
Cheiromys, I, 195.
Cheiroptères, I, 111.
Chelidra (note), II, 12.
Chelifer, IV, 275.
Chelmons, II, 190.
Chelonaires (Chelonarium), IV, 452.
Chelones (Chelonus), V, 290.
Chelonia, V, 406.
Cheloniens, II, 5.
Chelonura (note), II, 12.
Chelostomes (Chelostoma), V, 348.
Chennies (Chennium), V, 164.
Chenondopores (note), III, 321.
Chersydres (Chersydrus), II, 98.
Chevaliers, I, 529 et II, 175.
Chevaux, I, 251.
Chevèches, I, 344.
Chèvres, I, 275.
Chevreuil, I, 264.
Chevrolles, IV, 128.
Chevrolains, I, 258.
Cheylètes (Cheyletus), IV, 285.
[page] 453
Chiens, I, 149.
Chilognathes (Chilognatha), IV, 329.
Chilopodes (Chilopoda), IV, 335.
Chimaera, III, 132.
Chimères (Chimaera), II, 381.
Chimpansé, I, 89.
Chinchilla, I, 222.
Chionées (Chionea), V, 447.
Chionès, I, 541.
Chipeau, I, 576.
Chirocentres (Chirocentrus) II, 325.
Chirocères (Chirocera), V, 295.
Chironectes, II, 251.
Chironèmes (Chironemus), II, 146.
Chironomes (Chironomus), V, 441.
Chirons (Chiron), IV, 541.
Chiroscèles (Chiroscelis), V, 24.
Chirotes, II, 66.
Chirus, II, 249.
Chiton, III, 114.
Chlaenies (Claenius), IV, 403.
Chlamydes (Chlamys), V, 146.
Chlamyphores, I, 229.
Chloes (Chloeia), III, 198.
Chocard, I, 379.
Choleves (Choleva), IV, 503.
Cholepus, I, 225.
Chondracantes (Chondracantus), III, 258.
Chondropterigiens, II, 376.
Chondrosepia, III, 16.
Chondrus, III, 44.
Choragus (Choragus), V, 147.
Chorion, I, 64.
Chouette, I, 341.
Chouettes à aigrettes, I, 344.
Choucaris, I, 355.
Choucas, I, 421.
Chromis, II, 263.
Chryptonix, I, 480.
Chrysis (Chrysis), V, 303.
Chrysochlores, I, 129.
Chrysodons (note), III, 195.
Chrysomèles (Chrysomela), V, 147.
Chrysophores (Chrysophora), IV, 552.
Chrysophris, II, 181.
Chrysops (Chrysops), V, 477.
Chrysotoses, II, 211.
Chrysotoxes (Chrysotoxum), V, 495.
Chuva, I, 101.
Chylizes (Chyliza), V, 525.
Chyromyzes (Chiromyza), V, 480.
Cicadaires (Cicadaria), V, 210.
Cicadelles (Cicadella), V, 218.
Ciccus (Ciccus), V, 221.
Cicindèles (Cicindela), IV, 359.
Cidaris, III, 232.
Cigales, V, 210,
Cignes (Cycnus), I, 566.
Cigognes (Ciconia), I, 513.
Cimex, V, 190.
Cincinnurus (note), I, 427.
Cineles, I, 375.
Cinclus, I, 375.
Cineres, III, 177.
Cinetus, V, 301.
Cingle, II, 135.
Cini, I, 411.
Cinnyris, I, 433.
Ciones (Cionus), V, 84.
Circaetes (Circaetus), I, 327.
Circelles (Circellium), IV, 535.
Circus, I, 337.
Cirolanes (Cirolana), IV, 135.
Cirrhatules, III, 205.
[page] 454
Cirrhibarbes, II, 239.
Cirrhines, II, 274.
Cirrhites (Cirrhites), II, 146.
Cis (Cis), V, 94.
Cissopis (note), I, 355.
Cistèles (Cistela), V, 41.
Cistènes (note). III, 195.
Cistogastres (Cistogaster), V, 511.
Cistuda (note), II, 12.
Citharines (Citharinus), II, 313.
Civettes, I, 154.
Cixies (Cixius), V, 216.
Cladies (Cladius), V, 275.
Cladobates, I, 125.
Cladocères, IV, 151.
Clairons (Clerus), IV, 476.
Clangula (note), I, 571.
Classe, I, 8.
Clavagelles (Clavagella), III, 161.
Clavatules, III, 105.
Clavelles (Clavella), III, 258.
Clavellines (note), III, 166.
Clavicornes, IV, 487.
Clavigères (Clavigere), V, 166.
Clavipalpes, V, 155.
Clavulines (note), III, 24.
Clausilia, III, 44.
Cleodores (Cleodora), III, 29.
Cleonymes (Cleonymus), V, 298.
Clepsines, III, 216.
Cleptes (Cleptes), V, 305.
Cleptiques (Clepticus), II, 261.
Climènes, III, 212.
Clinus, II, 238.
Clio (Clione), III, 26.
Clitellio (note), III, 211.
Clivines. (Clivina), IV, 385.
Cloportes (Oniscus), IV, 131.
Clotho (Clotho), IV, 236.
Clubiones (Clubiona), IV, 241.
Clypeastres, III, 236.
Clythres (Clythra), V, 145.
Cnodalons (Cnodalon), V, 37.
Coaïta, I, 101.
Coatis, I, 139.
Cobayes, I, 220.
Cobitis, II, 277.
Cobra (note), II, 90.
Coccothraustes, I, 413.
Coccinelles (Coccinella), V, 161.
Coccus, V, 229.
Cochenilles V, 229.
Cochevis, I, 400.
Cochlohydre (note), III, 44.
Cochons, I, 243.
Cochons d'Inde, I, 220.
Cocorly, I, 527.
Coelioxydes (Coelixys), V, 351.
Coelogenys, I, 221.
Coendous, I, 216.
Coenomyies (Coenomyia), V, 482.
Coenosies (Coenosia), V, 519,
Coenures (Coenurus), III, 272.
Coereba (note), I, 432.
Cœurs, I, 35.
Coffres, II, 375.
Cogrus (note), II, 351.
Colaris, I, 425.
Colaspes (Colaspis), V, 148.
Coléoptères (Coleoptera), IV, 352.
Coliades (Colias), V, 378.
Colibris, I, 435.
Colius, I, 486.
Colious, I, 415.
Colliures (Colliures), IV, 364.
Colius, I, 415.
Colobiques (Colobicus), IV, 504.
Colombars, I, 492.
[page] 455
Colpodes (Colpodes), IV, 399.
Coluber, II, 80
Columba, I, 488.
Colymbètes (Colymbetes), IV, 426.
Columbi-Gallines, I, 489.
Colydies (Colydium), V, 98.
Colymbus, I, 544.
Comatules, III, 228.
Combattans, I, 527.
Comephores, II, 248.
Conchacées (note), III, 144.
Concholepas, III, 100.
Condor, I, 316.
Condylures, I, 131 et IV, 153.
Cones (Conus), III, 91.
Conies, III, 178.
Conilires (Conilira), IV, 134.
Conirostres, I, 399.
Conocephale (note), V, 184.
Conops (Conops), V, 504.
Conopalpes (Conopalpus), V, 45.
Conovulus, III, 50.
Conulus, III, 234.
Conurus, I, 462.
Cophias (note), II, 66, 88.
Copris, IV, 538.
Coprobies (Coprobius), IV, 535.
Coprophiles (Coprophilus), IV, 439.
Coptodères (Coptodera), IV, 379.
Coqs, I, 476.
Coqs de roche, I, 392.
Coque ou sourdon, III, 145.
Coracias, I, 424, 438.
Coracina (note), I, 365.
Corail (Coralium), III, 311.
Corail noir, III, 309.
Coralle (note), II, 79.
Corallines (Corallina), III, 305.
Corbeaux, I, 420.
Corbeilles (Corbis), III, 147.
Corbicalao (add.), I, 583.
Corbs, II, 173.
Corbules (Corbula), III, 152.
Cordistes (Cordistes), IV, 375.
Cordon bleu, I, 362.
Cordyles (Cordylus), II, 32; V, 451.
Corées (Coreus), V, 196.
Coricus, II, 260.
Corèthres (Corethra), V, 441.
Corines (Corine), III, 295.
Corindo (note), II, 14.
Corinne, I, 267.
Coriocelles (Coriocella), III, 90.
Corises (Corixa), V, 208.
Cormorans, I, 562.
Corneille, I, 421.
Cornulaires, III, 300.
Coronis (Coronis), IV, 109; V, 389.
Corophies (Corophium), IV, 123.
Corps organisés, I, 13.
Corrialiophages, III, 140.
Corsac, I, 152.
Corticus (Corticus), V, 24.
Corvina, II, 173.
Corvus, I, 420.
Corydonie (note), I, 454.
Coryphenes (Coryphaena), II, 215.
Corystes (Coristes), IV, 53.
Corythaix, I, 467.
Corythus, I, 415.
Cosson (Cossonus), V, 89.
Cossus (Cossus), V, 398.
Cossyphes (Cossyphus), V, 32.
Cotingas, I, 361.
Cottus, II, 162.
[page] 456
Coturnix, I, 485.
Couagga, I, 253.
Couas, I, 454.
Coucals, I, 454.
Coucous, I, 452.
Coudous, I, 272.
Cougouar, I, 163.
Couï, II, 10.
Couïa, I, 214.
Couleuvres, II, 80.
Coupeurs d'eau, I, 560.
Coure-vite, I, 504.
Coureurs, V, 170.
Courlan, I, 508.
Courlis, I, 521.
Courols, I, 455.
Couroucous, I, 458.
Courtillères, V, 181.
Cousins, V, 436.
Crabe, IV, 30.
Crabier, I, 176, I, 511.
Crabrons (Crabro), V, 329.
Cracticus (note), I, 353.
Crambus (Crambus), V, 420.
Crangons (Crangon), IV, 34.
Cranies (Crania), III, 173, III, 119.
Crapauds, I, 109.
Craspedocephales (note), II, 89.
Crassatelles, III, 140.
Cravant, I, 569.
Craves, I, 438.
Crax, I, 469.
Creadion (add.), I, 583.
Cremastocheiles, IV, 572.
Crenatules (Crenatula), III, 129.
Crenilabres, II, 259.
Crépidules (Crepidula), III, 87.
Crépusculaires, V, 387.
Creseis, III, 29.
Cresserelle, I, 322.
Cressine, III, 150.
Creusies, III, 179.
Crevettes, IV, 115.
Cricetus, I, 204.
Criocère (Crioceris), V, 135.
Criquets, V, 185.
Crisies, III, 302.
Cristatelle (Cristatella), III, 296.
Cristellaires (note), III, 23.
Crocises (Crocisa), V, 353.
Crocodiles (Crocodilus), II, 17.
Crocodilurus (note), II, 27.
Croo, I, 94.
Crossarchus, I, 158.
Crotales (Crotalus), II, 87.
Crotalophorus (note), II, 88.
Crotophaga, I, 459.
Crustacés (Crustacea), III, 183; IV, 7.
Crypsirina (note), I, 424.
Cryptes (Cryptus), V, 286.
Cryptiques (Crypticus), V, 22.
Cryptobranchus (note), II, 118.
Cryptocephalus, V, 144.
Cryptopes (Cryptopus), IV, 100.
Chryptophages (Cryptophagus), IV, 507.
Cryptorhynque (Cryptorhynchus), V, 87.
Cryptostomes (Cryptostoma), IV, 453.
Cryptostomes (Cryptostoma), III, 90.
Crypturus, I, 487.
Ctenes (Ctenus), IV, 258.
Cteniceres (Ctenicera), IV, 454.
Clénistes (Clénistes), V, 165.
Cténodactyles (Ctenodaclyta), IV, 376.
Ctenodes (Ctenodes), V, 112.
[page] 457
Cténophores (Ctenophora), V. 444.
Cténostomes (Ctenostoma), IV, 363.
Cucujes (Cucujus), V, 101.
Cucullans (Cucullanus), III, 250.
Cuculle, V, 58.
Cuculus, I, 452.
Culex, V, 436.
Cultrirostres, I, 505.
Cupes (Cupes), IV, 487.
Cupulites, III, 287.
Curimates, II, 309.
Curruca, I, 384.
Cursoria, V, 170.
Cursorius, I, 504.
Cuviéries, III, 29; III, 239.
Cyame (Cyamus), IV, 127.
Cyanées (Cyanaea), III, 277.
Cyathocrinites, III, 230.
Cybium, II, 199.
Cyclades, I, 146.
Cychles (Cycla), II, 263.
Cychrus (Cychrus), IV, 409.
Cyclides (Cyclidium), III, 326.
Cycliques (Cyclica), V, 139.
Cyclobranches, III, 36; III, 113.
Cyclocéphales (Cyclocephala), IV, 552.
Cyclocotyles, III, 265.
Cyclolithes, III, 313.
Cyclome (Cyclomus), V, 77.
Cyclopes (Cyclopes), IV, 154.
Cycloptères (Cyclopterus), II, 345.
Cyclostomes, II, 402.
Cyclostomes (Cyclostoma), III, 78;
Cylas (Cylas), V, 76.
Cylidres (Cylidrus), IV, 476.
Cymbulies, III, 27.
Cymindis (Cymindis), IV, 377.
Cymodocées (Cymodocea), IV, 138.
Cymopolies, III, 306.
Cymothoés (Cymothoa), IV, 133.
Cynanthus (add.), I, 583.
Cynips (Cynips), V, 291.
Cynocéphales, I, 97.
Cynthies (note), III, 166; IV, 406.
Cyphomyies (Cyphomyia), V, 483.
Cypraea, III, 92.
Cypricardes, III, 140.
Cyprines (Cyprina), III, 146.
Cyprinodons, II, 281.
Cyprins, II, 270.
Cypris (Cypris), IV, 159.
Cypselus, I, 394.
Cyrènes (Cyrena), III, 146.
Cyrtes (Cyrtus), V, 461.
Cyrtodaire, III, 155.
Cythérées (Cythere), IV, 158.
Cytherina, IV, 158.
Cysticerques (Cysticercus), III, 271.
Cystingia (note), III, 167.
D.
Dacelo (note), I, 444.
Dacnis, I, 418.
Dactylocères (Dactylocera), IV, 117.
Dactylopore, III, 320.
Dactyloptères, II, 161.
Daedelion, I, 301.
Dacne, IV, 507.
Dagysa, III, 163.
Dails, III, 158.
Daim, I, 262.
TOME III. 30
[page] 458
Damans, I, 248.
Damier, I, 553.
Dancé, IV, 507.
Daphnées (Daphnia), IV, 164.
Dapses (Dapsa), V, 159.
Daptes (Daptus), IV, 389.
Darnis (Darnis), V, 219.
Dascilles (Dascillus), IV, 461.
Dascylles (Dascyllus), II, 179.
Dasycères (Dasycerus), V, 99.
Dasyornis (add.), I, 583.
Dasypogons (Dasypogon), V, 457.
Dasyprocta, I, 221.
Dasypus, I, 226.
Dasytes (Dasytes), IV, 473.
Dasyurus, I, 179.
Dasyures, I, 179.
Dasyus (Dasyus), IV, 562.
Dauphins, I, 287.
Dauphìnules, III, 76.
Daurades, II, 181.
Dauw, I, 253.
Decapodes (Decapoda), IV, 16.
Decapodes brachyures, IV, 28.
Decapodes macroures, IV, 70.
Delphax (Delphax), V, 218.
Delphinaptères, I, 290.
Delphinorhynques, I, 288.
Delphinus, I, 287.
Demetrias (Demetrias), IV, 377.
Demi-becs, II, 285.
Démocères (Democerus), V, 129.
Demoiselles, V, 236.
Dendritines (note), III, 23.
Dendrocolaptes, I, 431.
Dendrocopus (note), I, 431.
Dendrodoa (note), III, 167.
Dendroïdes (Dendroida), V, 54.
Dendrophages (Dendrophagus), V, 102.
Dendrophis, II, 82.
Dendroplex (add.), I, 583.
Dentales (Dentalium), III, 196.
Dentalines (note), III, 24.
Dentés (Dentex), II, 184.
Dentirostres, I, 348.
Derbes (Derbes), V, 218.
Derbio, II, 204.
Dermestes (Dermestes), IV, 508.
Dermochelis (note), II, 14.
Derostomes, III, 268.
Desmans, I, 128.
Détrille, IV, 33.
Dexamines (Dexamine), IV, 121.
Dexies (Dexia), V, 515.
Diacopes (Diacope), II, 142.
Diadêmes (Diadema), III, 179.
Diagrammes (Diagramma), II, 176.
Dialythes (Dialyta), V, 524.
Dianchores, III, 125.
Diapères (Diaperis), V, 28.
Diapriès (Diapria), V, 301.
Dibolies (Dibolia), V, 155.
Dibothryorhynques, III, 270.
Dicaeles (Dicaelus), IV, 405.
Dicæum, I, 433.
Dicées, I, 433.
Dicerates, III, 143.
Dicheles, IV, 568.
Dichelestion (Dichelestium), IV, 199.
Dicholophus, I, 505.
Dichotomaire (note), III, 308.
Dicotyles, I, 245.
Dicranies (Dicrania), IV, 564.
Dicranoures (Dicranoura), V, 407.
Dicrurus (note), I, 365.
Didelphis, I, 175.
Dictyopteres (Dictyoptera), IV, 464.
[page] 459
Digitigrades, I, 142.
Dilatias (note), II, 392.
Dilophes (Dilophus), V, 452.
Dimorphines (note), III, 25.
Dindons, I, 475.
Dinemoures (Dinemoura), IV, 197.
Dinètes (Dinetus), V, 327.
Dinops, I, 115.
Dioctries (Dioctria), V, 457.
Diodesmes (Diodesma), V, 97.
Diodons (Diodon), II, 367.
Diomedea, I, 554.
Dionix (Dionix), V, 164.
Diopsis (Diopsis), V, 531.
Diphucephales (Diphucephala), IV, 562.
Diphyes (Diphyes), III, 288.
Diphyllides, III, 57.
Diplectron (note), I, 474.
Diploptères, V, 332.
Diploprions, II, 136.
Dipsas, II, 82.
Diptères, IV, 325; V, 428.
Dipterodon, II, 194.
Diplostoma, I, 212.
Dircée (Dircea), V, 43.
Dircées (Dircaea), V, 44.
Discines (note), III, 119.
Discoboles, II, 344.
Distichopores, III, 316.
Distisocheres (Distichocera), V, 121.
Distoma, III, 263.
Ditomes (Ditomus), IV, 387.
Diurnes (Diurna), V, 373.
Dixes (Dixa), V, 446.
Dolabelles (Dolabella), III, 61.
Dolichonyx (add.), I, 583.
Dolichopes (Dolichopus), V, 470.
Doliques (Dolichus), IV, 402
Dolium, III, 99.
Dololium, III, 282.
Dolomèdes (Dolomedes), IV, 258.
Donaces (Donax), III, 145.
Donacies (Donacia), V, 135.
Donzelles, II, 358.
Doras, II, 295.
Dorcacéres (Dorcacerus), V, 111.
Dorcatomes (Dorcatoma), IV, 483.
Dorées, II, 211.
Dorippes (Dorippe), IV, 68.
Doris (Doris), III, 51.
Dormeur, II, 246.
Dormilles, II, 277.
Dorsch, II, 332.
Dorsibranches, III, 187.
Dorsuaire (note), II, 194.
Doryles (Dorylus), V, 314.
Doryphores (Doryphora), V, 149.
Doryphorus, II, 34.
Douc, I, 93.
Doules, II, 147.
Douroucouli, I, 104.
Douves, III, 262.
Dragonnes, II, 27.
Dragonneaux, III, 217.
Dragons (Draco), II, 42.
Drapetis (Drapetis), V, 460.
Drasses (Drassus), IV, 238.
Drenne, I, 369.
Driles (Drilus), IV, 468.
Drill, I, 99.
Dromaius (note), I, 497.
Dromes (Dromas), I, 516.
Dromies (Dromia), IV, 68, 377.
Drongos, I, 365.
Dryines (Dryinus), V, 300.
Dryinus, II, 82.
Drymeies (Drymeia), V, 519.
Dryomyzes (Dryomyza), V, 527.
30*
[page] 460
Dryophis, II, 83.
Dryophthore (Dryopthorus), V, 89.
Dryops (Dryops), IV, 516.
Dryptes (Drypta), IV, 374.
Duberria (note), II, 83.
Dues, I, 343.
Dugongs, I, 284.
Dules, II, 147.
Duiker-bock, I, 270.
Durbecs, I, 415.
Dseren, I, 267,
Dyctiles (Dyctilus), V, 48.
Dynamènes, III, 301; IV, 138.
Dynomène (Dynomene), IV, 69.
Dyschiries (Dyschirius), IV, 386.
Dysdères (Dysdera), IV, 234.
Dysporus, I, 563.
Dytisques (Dytiscus), IV, 422.
Dzigguetai, I, 252.
E.
Eburnes (Eburna), III, 98.
Ecailles, V, 406.
Echasses, I, 532.
Echassiers, I, 493.
Echelettes, I, 431.
Echeneis (Echeneis), II, 347.
Echelus (note), II, 348.
Echenilleurs, I, 363.
Echidna, I, 235.
Echidnés, I, 235.
Echimys, I, 199.
Echinanthus, III, 236.
Echinococcus (note), III, 273.
Echinocyamus, III, 237.
Echinodermes, III, 223.
Echinodermes sans pieds, III, 241.
Echinomyies (Echinomyia), V, 510.
Echinonés, III, 234.
Echinorinques (Echinorhynchus), III, 261.
Echinostome (note), III, 264.
Echinus, III, 230.
Echis, II, 95.
Echiures, III, 244.
Eciton (Eeiton), V, 313.
Ecphimotes, II, 47.
Ecorcheur, I, 350.
Ecrevisses, IV, 88.
Ectopistes (add.), I, 584.
Ecureuils, I, 192.
Edentés, I, 223.
Edolius, I, 365.
Effrayes, I, 342.
Egéone (note). III, 22.
Egrefin, II, 331.
Eiders, I, 572.
Elacates, II, 203.
Elan, I, 261.
Elaphres (Elaphrus), IV, 416.
Elaps (Elaps), II, 94.
Elaterides, IV, 448.
Electres, III, 303.
Eledone (Eledona), V, 31.
Elédons, III, 12.
Elenophore (Elenophorus), V, 10.
Eleotris, II, 246.
Eléphans, I, 238.
Eléphas, I, 238.
Elephastomes (Elephastomus), IV, 545.
Ellipostomes (note), III, 79.
Elmis (Elmis), IV, 517.
[page] 461
Elodes (Elodes), IV, 462.
Elopes (Elops), II, 324.
Elophores (Elophorus), IV, 520.
Elops, II, 261.
Elserines (note), III, 304.
Emarginules (Emarginula), III, 112.
Emberiza, I, 403.
Emberizoïdes (note), I, 405.
Emérillon, I, 321.
Emissoles, II, 389.
Emou (note), I, 497.
Empis (Empis), V, 459.
Emydosauriens (note), II, 19.
Emys, II, 10.
Encelades (Enceladus), IV, 380.
Enchelides (Enchelis), III, 326.
Encouberts, I, 228.
Encrines (Encrinus), III, 229.
Encrinites, III, 230.
Encyrtes (Encyrtus), V, 299.
Endomyques (Endomychus), V, 160.
Enfermés, III, 153.
Engoulevents, I, 397.
Engraulis, II, 322.
Engystoma, II, 112.
Enhydres (note), II, 85.
Enoplies, IV, 480.
Enoploses (Enoplosus), II, 136.
Entelle, I, 94.
Enterions, III, 210.
Entomostomes (note), III, 97.
Entomostracés (Entomostraca), IV, 145.
Entomozoaires apodes (note), III, 188.
Entomozaires chétopodes (note), III, 188.
Entomozaires apodes onchocéphalés (note), III, 255.
Entonnoirs, III, 74.
Entozoa, III, 245.
Entozoa nematoidea, III, 247.
Eolides (Eolidia), III, 55.
Epaulard, I, 289.
Epeiche, I, 449.
Epeires (Epeira), IV, 247.
Epéoles (Epeolus), V, 352.
Eperonnier, I, 474.
Eperons, III, 73.
Epervier, I, 333.
Ephémères (Ephemera), V, 241.
Ephippies (Ephippia), V, 485.
Ephippus ou Cavaliers, II, 191.
Ephire (note), III, 278.
Ephydres (Ephydra), V, 521.
Epibulus, II, 260.
Epicharis (Epicharis), V, 356.
Epidelles (note), III, 217.
Epimachus, I, 439.
Epimaques, I, 439.
Epinochette, II, 170.
Epinoches, II, 169.
Episines (Episinus), IV, 244.
Epitrages (Epitragus), V, 36.
Epomis (Epomis), IV, 404.
Eponges, III, 321.
Eques, II, 175.
Equilles, II, 360.
Equorées, III, 276.
Equula, II, 212.
Equus, I, 251.
Erebes (Erebeus), V, 409.
Erèses (Eresus), IV, 263.
Eretisons, I, 216.
Erichthes (Erichthus), IV, 110.
Erinaceus, I, 124.
Eriodon (Eriodon), IV, 233.
Erioptères (Erioptera), V, 445.
Eriphies (Eriphia), IV, 41 et V, 520.
[page] 462
Eristales (Eristalis), V, 492.
Erix, II, 79.
Erodies (Erodius), V, 8.
Erotyles (Erotylus), V, 156.
Erpetons, II, 80.
Erpobdelles (note), III, 214.
Erycine (Erycina), V, 384.
Erycines (note), III, 153.
Eryons (Eryon), IV, 88.
Erythrees (Erythræus), IV, 284.
Erythrins (Erythrinus), II, 326.
Escarbots, IV, 492.
Escargots, III, 40.
Eschares (Eschara), III, 316.
Esoces (Esox), II, 281.
Espadons, II, 200.
Espèce, I, 16.
Esturgeons, II, 378.
Etalions (Etalion), V, 220.
Etelis, II, 135.
Eteone (note), III, 200.
Ethéries (Etheria), III, 130.
Etmopterus (note), II, 392.
Etoiles de mer, III, 225.
Etourneaux, I, 419.
Êtres vivants, I, 11.
Êtres animés, I, 18.
Êtres inanimés, I, 18.
Eubries (Eubria), IV, 462.
Eucharis (Eucharis), V, 296.
Euchrées (Euchraeus), V, 304.
Eucnemis (Eucnemis), IV, 451.
Eucratées, III, 303.
Eudynamys (add.), I, 584.
Eudytes, I, 546.
Euglosses (Euglossa), V, 356.
Eulabes, I, 377.
Eulalia (note), III, 202.
Eulimenes (Eulimene), IV, 178.
Eulopes (Eulopa), V, 222.
Eulophes (Eulophus), V, 299.
Eumèles (note), III, 39.
Eumenies (Eumenia), V, 383.
Eumènes (Eumènes), V, 336.
Eumerphes (Eumerphus), V, 159.
Eumolpe, III, 207.
Eumolpes (Eumolpus), V, 147.
Eunicées, III, 310.
Eunices, III, 199.
Eunomia (note), III, 202.
Euparie (note), IV, 539.
Eupelix (Eupelix), V, 222.
Eupelmes (Eupelmus), V, 298.
Euphones ou Tangaras-bouvreuils, I, 366.
Euphrosines, III, 199.
Euplocames (Euplocamus), V, 420.
Eupodes (Eupoda), V, 132.
Euprosopes (Euprosopus), IV, 361.
Eurhines (Eurhinus), V, 74.
Eurinorhynchus, I, 528.
Eurinorinque, I, 528.
Eurybies, III, 29.
Eurybies (Eurybia), V, 383.
Eurychores (Eurychora), V, 10.
Eurydices (Eurydices), IV, 135.
Eurylaimes, I, 393.
Euryope (Euryope), V, 147.
Eurypes (Eurypus), IV, 477.
Eurypyga, I, 508.
Eurysterne (Eurysternus), IV, 535.
Eurystomus (note), I, 425.
Eurytomes (Eurytoma), V, 297.
Eustrophes (Eustrophus), V, 44.
Euthycères (Euthycera), V, 529.
Evaesthètes (Evaesthetus), IV, 437.
Evagores (note), III, 276.
Evaniales, V, 280.
[page] 463
Evanies (Evania), V, 280.
Evomphales (Evomphalus), III, 75.
Exatome (Exatona), V, 446.
Exocets (Exocetus), II, 286.
Exochnata, IV, 70.
Explanaires, III, 314.
Eylais (Eylais), IV, 289.
F.
Fabricie (note), III, 193.
Fabulaires (note), III, 25.
Fahaca, II, 368.
Faisans, I, 476.
Falcinelles, I, 527.
Falco, I, 319.
Falconelles, I, 356.
Falcunculus, I, 356.
Farlouses, I, 391.
Fasciola, III, 262.
Faucheurs, IV, 281.
Faucons, I, 319.
Faux Scorpions, IV, 273.
Fauvettes, I, 384.
Felis, I, 160.
Fera, II, 307.
Fer crenelé, I, 117.
Fericostomes (Fericostoma), V, 253.
Feronies (Feronia), IV, 393.
Fibres, I, 22.
Fibulaires, III, 237.
Ficedula, I, 383.
Fierasfers, II, 359.
Figites (Figites), V, 293.
Figulus (note), I, 432.
Filaires (Filaria), III, 248.
Fileuses, IV, 213.
Filistates (Filistata), IV, 234.
Filous, II, 260.
Fimbria, III, 147.
Firoles (Firola), III, 69.
Fissirostres, I, 394.
Fissurelles (Fissurella), III, 112.
Fistulanes (Fistulana), III, 160.
Fistulaires (Fistularia), II, 267.
Flabellaires, III, 307.
Flabellines, III, 55.
Flammants, I, 542.
Flet, II, 339.
Flétans, II, 340.
Floriceps, III, 270.
Fluide nourricier, I, 23.
Flustres (Flustra), III, 303.
Fœne (Fœnus), V, 280.
Fondules (Fondulus), II, 280.
Forficula, V, 171.
Fossores, V, 316.
Fouette-Queue, II, 34.
Fouine, I, 145.
Fouisseurs, V, 316.
Foulques, I, 540.
Fourmilliers, I, 231, 372.
Fourmillions, V 248.
Fourmis (Formica), V, 307.
Fournier, I, 432.
Fous, I, 563.
Francolins, I, 484.
Fratercula, I, 548.
Freux, I, 421.
Frégattes, I, 563.
Fregilus, I, 438.
Friganes, V, 259.
Fringilla, I, 406.
Frippière, III, 74.
Friquet, I, 408.
[page] 464
Frondiculaires (note), III, 24.
Fulgores (Fulgora), V, 215.
Fulica, I, 539.
Fuligula (note), I, 570.
Funarius (note), I, 432.
Fungicoles, V, 159.
Furet, I, 143.
Furculaires (Furcularia), III, 324.
Fuseaux (Fusus), III, 105.
G.
Gades (Gadus), II, 330.
Gadinia (note), III, 89.
Gadoïdes, II, 330.
Galago, I, 109.
Galathées (Galathæa), III, 147.
Galathées (Galathea), IV, 83.
Galaxaures, III, 307.
Galaxies (Galaxies), II, 282.
Galba (Galba), IV, 451.
Galbula, I, 447.
Galeae, III, 236.
Galeodes (Galeodes), IV, 273.
Galeolaires (note), III, 191.
Galeopithèques, I, 122.
Galeotes, II, 38.
Galerites (Galerita), III, 234; IV, 375.
Galeruque (Galeruca), V, 152.
Galeus, II, 389.
Galgules (Galgulus), I, 424; V, 205.
Galleries (Galleria), V, 419.
Gallicoles (Gallicolae), V, 290.
Gallinacés (Gallinae), I, 468.
Gallinsectes (Gallinsecta), V, 228.
Gallinula, I, 539.
Gallus, I, 476.
Gals, II, 210.
Gamases (Gamasus), IV, 284.
Gamba, I, 176.
Gammarus, IV, 115.
Ganga, I, 483.
Gardon, II, 275.
Garrots, I, 571.
Garrulus, I, 422.
Gasteropelecus, II, 309.
Gasteropodes, III, 30.
Gasterosteus, II, 169.
Gastre, II, 170.
Gastrobranches, II, 406.
Gastrochènes (Gastrochæna), III, 160.
Gastroplax, III, 65.
Gastroptères (Gastropteron), III, 65.
Gauzou-Poucou, I, 264.
Gavials, II, 19.
Gazelle, I, 267.
Geais, I, 422.
Gébies (Gebia), IV, 86.
Gecarcins (Gecarcinus), IV, 50.
Geckos, II, 50.
Gelasimes (Gelasimus), IV, 45.
Gélatine, I, 22.
Gempyles, II, 200.
Génération, I, 15.
Genetta, I, 155.
Genettes, I, 155.
Geniates, IV, 557.
Genre, I, 8.
Geobdelle (note), III, 215.
Geocorises (Geocorisæ), V, 190.
Geomys, I, 211.
Geomyzes (Geomyza), V, 525.
[page] 465
Georisses (Georissus), IV, 518.
Georychus, I, 207.
Geosaurus (note), II, 50.
Geotrupes, IV, 543.
Gerbille (Gerbillus), I, 203.
Gerboa, I, 209.
Gerboises, I, 208; I, 581.
Gerfaults, I, 323.
Germe, I, 15.
Germons, II, 198.
Géroflés, III, 263.
Gerons (Geron), V, 464.
Gerres, II, 188.
Gerris (Gerris), V, 204.
Gervilies, III, 129.
Giaroles ou Perdrix de mer, I, 541.
Gibbar, I, 298.
Gibbies (Gibbium), IV, 482.
Gibbon, I, 90.
Gibèle, II, 271.
Girafe, I, 265.
Girelles, II, 257.
Glandes, I, 37.
Glands de mer, III, 177.
Glaphyres (Glaphyrus), IV, 566.
Glareola, I, 541.
Globaire (Globaria), IV, 521.
Globicornes (Globicornis), IV, 511.
Globigérines (note), III, 24.
Glomeris (Glomeris), IV, 333.
Glossobdelle (note), III, 216.
Glossophages, I, 117.
Glossophores, III, 216.
Glaucopis, I, 424.
Glaucus (Glaucus), III, 54.
Gloutons, I, 140.
Glycères, III, 203.
Glycymères (Glycymeris), III, 155.
Glyphisodons, II, 180.
Gnathabolus, II, 321.
Gnathées (Gnathium), V, 68.
Gnathophylles (Gnathophyllum), IV, 96.
Gnou, I, 274.
Gobe-Mouches, I, 356.
Gobiesoces, II, 345.
Gobous (Gobius), II, 241.
Goelands, I, 555.
Gomphoses, II, 261.
Gones, III, 326.
Gonies (Gonia), V, 511.
Gonnelles, II, 239.
Gonocephales, II, 39.
Gonodactyles (Gonodactylus), IV, 109.
Gonolepte, IV, 281.
Gonoplaces (Gonoplax), IV, 43.
Gonorhinques (Gonorhynchus), II, 277.
Gonopes (Gonopus), V, 17.
Gonypes (Gonypus), V, 458.
Gouazoupita, I, 265.
Gordius, III, 217.
Goregonus, II, 306.
Gorettes, II, 175.
Gorfous, I, 551.
Gorge-Bleue, I, 384.
Gorge-Noire, I, 384.
Gorgones (Gorgonia), III, 310.
Gorgonocéphales, III, 228.
Gorytes (Gorytes), V, 329.
Goujons (Gobio), II, 273.
Goulins, I, 381.
Gonrami, II, 228.
Gracula, I, 377.
Grallae, I, 493.
Grallaria (note), I, 374.
Grammistes (Grammistes), II, 134.
[page] 466
Grands-Voiliers, I, 552.
Graucalus, I, 355.
Gremilles, II, 144.
Grenailles III, 44
Grenouilles, II, 102.
Graphiptères (Graphipterus), IV, 367.
Grapses (Grapsus), IV, 51.
Grèbes, I, 545.
Grébifoulques, I, 546.
Grenadiers, II, 336.
Gribouri, V, 144.
Griffons, I, 318.
Grillons, V, 181.
Grimme, I, 270.
Grimpereaux, I, 430.
Grimpeurs, I, 446.
Gristes, II, 145.
Grisets, II, 390.
Grison, I, 141.
Grive, I, 369.
Gros-Bec, I, 413.
Growlers, II, 145.
Grues (Grus), I, 506.
Grylo-Talpa, V, 181.
Gryllus, V, 180.
Gryphées (Gryphæa), III, 122.
Guans ou Yacours, I, 471.
Guazouti, I, 264.
Guenon, I, 91.
Guêpes, V, 334.
Guêpes-Ichneumons, V, 316
Guépiaires, V, 334.
Guêpiers, I, 441.
Guevei, I, 270.
Guignard, I, 501.
Guignette, I, 531.
Guillemots, I, 547.
Gulo, I, 140.
Gyall, I, 280.
Gymnarchus, II, 357.
Gymnétres (Gymnetrus), II, 119.
Gymnocephales, I, 361.
Gymnodactyles, II, 58.
Gymnodères, I, 365.
Gymnodontes, II, 365.
Gymnogaster, II, 218.
Gymnolepe (note), III, 177.
Gymnopleures (Gymnopleurus), IV, 534.
Gymnops, I, 381.
Gymnosomos (Gymnosomia), V, 511.
Gymnotes (Gymnotus), II, 355.
Gymnura, I, 579.
Gymnura (add.), I, 579.
Gypaetos, I, 318.
Gyps (add.), I, 582.
Gyrins (Gyrinus), IV, 428.
Gyroïdines (note), III, 24.
H.
Haematopotes (Haematopota), V, 477.
Haematopus, I, 503.
Haemocharis, III, 215.
Haemonies (Haemonia), V, 136.
Haemopis, III, 214.
Haemulon, II, 175.
Haeruca, III, 262.
Haje, II, 93.
Haliaetus, I, 326,
Halicore, I, 284.
Halieus, I, 562.
[page] 467
Halimes (Halimus), IV, 60.
Haliotides, III, 111.
Haliples (Haliplus), IV, 428.
Halithées, III, 206.
Hallomènes (Hallomenus), V, 44.
Halodroma, I, 554.
Halymèdes, III, 307.
Halyotis, III, 111.
Hamsters, I, 204.
Hanneton, IV, 558.
Hapale, I, 104.
Harengs (Clupea), II, 317.
Harfang, I, 345.
Harles, I, 577.
Harpa, III, 99.
Harpales (Harpalus), IV, 390.
Harpaye, I, 338.
Harpes, III, 99.
Harpies (Harpia), I, 329.
Heaumes, III, 101.
Hectocotyles, III, 265.
Hégétre (Hegeter), V, 9.
Helamys, I, 209.
Helcons (Helcon), V, 289.
Hélées (Helaeus), V, 32.
Heleomyze (Heleomyza), V, 526.
Heliasses, II, 180.
Hélicines (Helicina), III, 82.
Helico-Limax, III, 42.
Helicostégues (note), III, 25.
Heliornis, I, 546.
Helix, III, 40.
Hellwigies (Hellwigia), V, 287.
Helophiles (Helophilus), V, 492.
Helops (Helops), V, 36.
Helores (Helorus), V, 301.
Helostomes, II, 227.
Helotes, II, 148.
Hemachate, II, 93.
Hémérobes (Hemerobius), V, 250.
Hémérodromées (Hemerodromia), V, 460.
Hemicyclostomes (note), III, 85.
Hemidactyles, II, 54.
Hémilepidotes (Hemilepidotus), II, 165.
Hemipodius, I, 486.
Hémiptères (Hemiptera), IV, 324; V, 189.
Hémirhipes (Emirhipus), IV, 454.
Hemi-Ramphus, II, 285.
Hémitriptères (Hemitripterus), II, 164.
Heniochus ou Cochers, II, 191.
Heorotaires, I, 433.
Hepates (Hepatus), IV, 39.
Hepiales (Hepialus), V, 397.
Heptatrèmes, II, 405.
Heptranchias (note), II, 390.
Heriades (Heriades), V, 348.
Hérissons, I, 124.
Hérissons de mer, III, 230.
Hermelles (note), III, 194.
Hermeties (Hermetia), V, 481.
Hermine, I, 143.
Herminie (Herminia), V, 415.
Hermione (note), III, 207.
Hermites (Hermites), IV, 76.
Hérons, I, 510.
Herpethothères (note), I, 333.
Hésiones, III, 204.
Hesperies (Hesperia), V, 386.
Hétérobranches (Heterobranchus), II, 296.
Hétérocères (Heterocerus), IV, 515.
Heterodon, II, 81.
Heterogynes (Heterogyna), V, 306.
Heteromères, V, 1.
Heteromys (note), I, 199.
Hétéropodes, III, 35, 66.
[page] 468
Heteroscèles (Heteroscelus), V, 18.
Héterostégynes (note), III, 25.
Heterotarses (Heterotarsus), V, 26.
Hétérotomes (Heterotoma), V, 199.
Hexacotyle (note), III, 264.
Hexanchus (note), II, 390.
Hexathirédie (note), III, 264.
Hexatomes (Hexatoma), V, 478.
Hexodons (Hexodon), IV, 551.
Hians, I, 515.
Hiatelles (Hiatella), III, 157.
Hiboux, I, 340.
Hierax (add.), I, 582.
Hierofalco, I, 323.
Hiéroglyphes, I, 43.
Hygrobies (Hygrobia), IV, 426.
Hilobates, I, 190.
Himantopes, III, 325.
Himantopus, I, 532.
Hinnites, III, 124.
Hippalines (note), III, 321.
Hippes (Hippa), IV, 74.
Hippobosques (Hippobosca), V, 543.
Hippocampes (Hippocampus), II, 363.
Hippodes (Hippodus), III, 142.
Hippocrènes (Hippocrenes), III, 108.
Hippoglossns, II, 340.
Hippolytes (Hippolyte), IV, 96.
Hipponoès, III, 199.
Hipponyces (Hipponix), III, 87.
Hippopodes (Hippopus), III, 287.
Hippopotamus, I, 242.
Hippurites, III, 120.
Hirmoneures (Hirmoneura), V, 466.
Hirondelles, I, 394.
Hirondelles de mer, I, 558.
Hirudo, III, 212.
Hirundo, I, 394.
Hispe (Hispa), V, 141.
Hister, IV, 492.
Humantins, II, 392.
Hoazin, I, 472.
Hobereau, I, 321.
Hoccos, I, 469.
Hochequeue, I, 390.
Hocheur, I, 93.
Holacanthes, II, 192.
Holètres (Holetra), IV, 279.
Holhyménies (Holhymenia), V, 197.
Holocentrums, II, 150.
Hololepte (Hololepta), IV, 492.
Holoptiles (Holoptilus), V, 202.
Holostoma, III, 264.
Holothuries (Holothuria), III, 238.
Homalopsis (note), II, 83.
Homalura, V, 536.
Homme, I, 67.
Homoles (Homola), IV, 67.
Homoptères (Homoptera), V, 209.
Hoplies (Hoplia), IV, 564.
Horie (Horia), V, 60.
Houlettes, III, 124.
Houppifères, I, 479.
Houtias, I, 200.
Houting, II, 307.
Huche, II, 203.
Huitres, III, 120.
Huitriers, I, 503.
Huppes, I, 438.
Hurleur, I, 99.
Hurons (Huro), II, 135.
Hurria, II, 82.
Hyaena, I, 159.
Hyales (Hyalea), III, 28.
Hyas (Hyas), IV, 61.
Hybos (Hybos), V, 459.
[page] 469
Hybosores (Hybosorus), IV, 546.
Hyclée (Hycleus), V, 63.
Hydatides, III, 271.
Hydatiques (Hydaticus), V, 86.
Hydnophores, III, 315.
Hydra, III, 294.
Hydrachnes (Hydrachne), IV, 289.
Hydraenes (Hydraena), IV, 520.
Hydraspis (add.), II, 11.
Hydres (Hydrus), II, 97.
Hydrobata (note), I, 375.
Hydrobates (note), I, 570.
Hydrobie (Hydrobius), IV, 524.
Hydrocampes (Hydrocampe), V, 418.
Hydrocanthares (Hydrocanthari), 420.
Hydrochoerus, I, 219.
Hydrochus (Hydrochus), IV, 520.
Hydrocorises (Hydrocorisae), V, 205.
Hydrocyns (Hydrocyon), II, 312.
Hydromètra (Hydrometre), V, 204.
Hydromys, I, 199.
Hydrophiles (Hydrophilus), IV, 519.
Hydrophis, II, 97.
Hydropores (Hydroporus), IV, 427.
Hyènes, I, 159.
Hylecoetes (Hylecoetus), IV, 486,
Hylées (Hylaeus), V, 342.
Hylesines (Hylesinus), V, 91.
Hylotomes (Hylotoma), V, 273.
Hymènocères (Hymenocera), IV, 95.
Hymenopteres, IV, 324; V, 263.
Hymenosomes (Hymenosoma), IV, 63.
Hyodons, II, 326.
Hyperies (Hyperia), IV, 117.
Hyperoodons, I, 291.
Hypobdelle (note), III, 214.
Hypochton, II, 119.
Hypogeons, III, 211.
Hypophlées (Hypophlaeus), V, 30.
Hypostomes (note), III, 262; II, 301.
Hypsiprymnus, I, 185.
Hypudoeus Variegatus, I, 203.
Hypules (Hypulus), V, 45.
Hyrax, I, 248.
Hyries (Hyria), III, 139.
Hystrix, I, 214.
I.
Ibalies (Ibalia), V, 293.
Ibis (Ibis), I, 519.
Ichneumons (Ichneumon), V, 282.
Ichneumonides, V, 281.
Ichtyodelle (note), III, 215.
Ichthyophiles (Ichthyophilus), IV, 133.
Ichthyosarcolites (note), III, 21.
Ichthyosaurus (note), II, 67.
Ieterus, I, 417.
Ictides, I, 138.
Idée, I, 41.
Idée générale, I, 41.
Idies (Idia), V, 517.
Idotées (Idotea), IV, 139.
Idya, III, 281.
Iguaniens, II, 32.
Iguanodon (note), II, 50.
Ilithyes (Ilithya), V, 422.
Ilysia (note), II, 76.
[page] 470
Image, I, 41.
Imagination, I, 42.
Impooko, I, 172.
Inachus (Inachus), IV, 63.
Indicateurs, I, 455.
Indris, I, 108.
Inférobranches, III, 35.
Inflammation, I, 29.
Infusoires, III, 322.
Infusoires homogènes, III, 325.
Inocérames, III, 129.
Insectes (Insecta), IV, 291.
Insectivores, I, 123.
Instinct, I, 44.
Intelligence, I, 41.
Intestinaux, III, 245.
Intestinaux cavitaires, III, 247.
Iutestinaux parenchymateux, III, 247.
Ione (Ione), IV, 118.
Ips (Ips), IV, 505.
Isis (Isis), III, 311.
Isocardes (Isocardia), III, 143.
Isodon-Pilorides (add.), I, 581.
Isopodes (Isopoda), IV, 129.
Issus (Issus), V, 217.
Istiophorus, II, 202.
Istiures (Istiurus), II, 41.
Ixodes (Ixodes), IV, 287.
J.
Jabirus, I, 514.
Jacamars, I, 447.
Jacanas, I, 534.
Jacapa (note), I, 368.
Jacchus, I, 105.
Jack, I, 280.
Jaera (Jaera), IV, 141.
Jaguar, I, 161.
Jaguarondi, I, 165.
Jakie, II, 105.
Jambonneaux, III, 131.
Janies, III, 306.
Janires, III, 282.
Janthines (Janthina), III, 84.
Jaseurs, I, 363.
Jasses (Jassa), IV, 122.
Jasses (Jassus), V, 223.
Jatrobdella (note), III, 213.
Jean-le-Blanc, I, 328.
Joel, II, 235.
Johnius, II, 173.
Joppes (Joppa), V, 287.
Jules (Julus), IV, 333.
Julis, II, 257.
Jumenta, I, 69.
Juscle. II, 186.
K.
Kahau, I, 94.
Kamichi, I, 536.
Kanguroos, I, 186.
Kerodon, I, 220.
Kérones, III, 325.
Kevei, I, 267.
Kinkajous, I, 139.
Kinosternon (note), II, 12.
Kleistagnatha, IV, 28.
Klip-Springer, I, 270.
Koala, I, 188.
Kurtes (Kurtus), II, 214.
Kyphose (note), II, 194.
[page] 471
L.
Labbes, I, 557.
Labeons (Labeo), II, 275.
Labrax, II, 133, 249.
Labres (Labrus), II, 254.
Labydes (Labydus), V, 314.
Lacertiens, II, 24.
Lachesis (note), II, 90.
Lachnolaimus, II, 257.
Laemodipodes (Laemodipoda), IV, 126.
Laenes (Laena), V, 39.
Lafoée (note), III, 303.
Lagomys, I, 218.
Lagopedes, I, 482.
Lagotrix, I, 101.
Lagries (Lagria), V, 52.
Lamantins ou Manates, I, 283.
Lamas, I, 258.
Lamellicornes, IV, 526.
Lamellirostres, I, 565.
Lamie (Lamia), V, 123.
Lamies (Lamna), II, 388.
Lampornis (add.), I, 583.
Lamproies, II, 403.
Lamprimes (Lamprima), IV, 577.
Lampris, II, 211.
Lamprosomes (Lamprosoma), V, 146.
Lampyres (Lampyris), IV, 463.
Langage, I, 42.
Langaha, II, 95.
Langoustes, IV, 80.
Langrayen ou Pies-grièches-hirondelles, I, 353.
Languries (Languria), V, 157.
Lanio (note), I, 351.
Laniogères (Laniogerus), III, 55.
Lanites, III, 82.
Lanius, I, 349.
Laphries (Laphria), V, 456.
Lapin, I, 217.
Larres (Larra), V, 326.
Larus, I, 555.
Lasies (Lasius), V, 463.
Lasiocampe (Lasiocampa), V, 401.
Lasioptères (Lasioptera), V, 445.
Lates, II, 133.
Lathires, III, 105.
Latridies (Latridius), V, 99.
Lathrobies (Lathrobium), IV, 435.
Lauxanies (Lauxania), V, 535.
Lavandières, I, 390.
Lavarets, II, 306.
Lavignons, III, 153.
Lebias, II, 280.
Lebies (Lebia), IV, 378.
Lédres (Ledra), V, 220.
Leias (Leia), V, 449.
Leiches, II, 392.
Leiodes (Leiodes), V, 30.
Leiolepis, II, 37.
Leisura (add.), I, 582.
Lemmings (Lemming), I, 207.
Leodice (note), III, 199.
Léopard, I, 162.
Lepadogaster, II, 344.
Lepas, III, 174.
Lepidoleprus, II, 336.
Lepidopes (Lepidopus), II, 217.
Lepidoptères, IV, 324 et V, 366.
Lepisacanthes, II, 169.
Lepisiès (Lepisia), IV, 563.
Lepismenes (Lepismene), IV, 340.
Lepismes (Lepisma), IV, 340.
[page] 472
Lépisostées (Lepisosteus), II, 328.
Lepitrix (Lepitrix), IV, 568.
Leposoma, II, 38.
Leptes (Leptus), V, 290.
Leptis (Leptis), V, 468.
Leptoceres (Leptocera), V, 121.
Leptocephales (Leptocephalus), II, 358.
Leptocorises (Leptocorisa), V, 197.
Leptopes (Leptopus), IV, 62 et V, 203.
Leptopodies (Leptopodia), IV, 64.
Leptosomus (note), I, 455.
Leptotrachèles (Leptotrachelus), IV, 371.
Leptures (Leptura), V, 128.
Lepturus, II, 218.
Lernacanthe (note), III, 258.
Lernanthrope (note), III, 258.
Lerneentome (note), III, 258.
Lerneocères (note), III, 256.
Lerneomyzes (note), III, 257.
Lerneopène (note), III, 257.
Lernées (Lernaea), III, 255.
Lerot, I, 198.
Lestèves (Lesteva), IV, 439.
Lestris, I, 557.
Lethrinus, II, 184.
Lethrus (Lethrus), IV, 542.
Leucophres, III, 325.
Leucopsis (Leucopsis), V, 296.
Leucosies (Leucosia), IV, 53.
Leucothoés (Leucothoé), IV, 122.
Leucothyrées (Leucothyreus), IV, 557.
Lézards, II, 30.
Liagores (note), III, 299 et III, 307.
Libelles (Libellula), V, 236.
Libinies (Libinia), IV, 61.
Libythées (Libithea), V, 381.
Lichanotus, I, 108.
Liches (Lichia), II, 203.
Licines (Licinus), IV, 405.
Licophre (note), III, 21.
Lièvres (Lepus), I, 216.
Ligies (Ligia), IV, 142.
Ligules (Ligula), III, 273.
Ligules (note), III, 153.
Limacelle (note), III, 39.
Limaces (Limax), III, 37.
Limacines, III, 28.
Limande, II, 339.
Limes (Lima), III, 123.
Limicula (note), I, 524.
Limnadies (Limnadia), IV, 172.
Limnatis (note), III, 214.
Limnebie (Limnebius), IV, 524.
Limnées (Limnæus), III, 48.
Limnichus (Limnichus), IV, 510.
Limnobies (Limnobia), V, 445.
Limnochares (Limnochares), IV, 290.
Limnorées (note), III, 321 et IV, 135.
Limosa, I, 524.
Limules (Limulus), IV, 184.
Lippiste (note), III, 76.
Lineus (note), III, 259.
Lingue, II, 333.
Linguatules, III, 254.
Lingules (Lingula), III, 170.
Lingulines (note), III, 24.
Linottes et Chardonnerets, I, 409.
Linyphies (Linyphia), IV, 245.
Lion, I, 161.
Liparis (Liparis), II, 346.
Liponyx (note), I, 480.
[page] 473
Lipurus, I, 188.
Lispes (Lispe), V, 518.
Lisse, II, 84.
Lisses (Lissa), V, 525.
Lissomes (Lyssomus), IV, 452.
Lissonotes (Lissonotus), V, 111.
Lithobies (Lithobius), IV, 338.
Lithodermes, III, 242.
Lithodes (Lithodes), IV, 64.
Lithodomes (Lithodomus), III, 136.
Lithophiles (Lithophilus), V, 161.
Lithophytes, III, 311.
Lithosies (Lithosia), V, 407.
Lithotrie (note), III, 177.
Lithurges (Lithurgus), V, 350.
Litorne, I, 369.
Littorines, III, 80.
Lixes (Lixus), V, 82.
Lobipèdes (Lobipes), I, 532.
Lobotes, II, 176.
Loches, II, 277.
Locusta, V, 183.
Loddes, II, 305.
Loris, I, 108 et I, 197.
Loligo, III, 14.
Loligopsis, III, 14.
Lombrics (Lumbricus), III, 209.
Lombrinères, III, 204.
Lomechuses (Lomechusa), IV, 441.
Lonchères, I, 199.
Lonchoptères (Lonchoptera), V, 526.
Longicornes, V, 102.
Longipennes, I, 552.
Longirostres, I, 518.
Longitarses (Longitarsus), V, 155.
Lophiodon, I, 250.
Lophius, II, 250.
Lophobranches, II, 361.
Lophonocères (Lophonocerus), V, 112.
Lophophores (Lophophorus), I, 474.
Lophorina (note), I, 428.
Lophosies (Lophosia), V, 512.
Lophotes, II, 222.
Lophura, II, 41.
Lophyrus (note), II, 38. Lophyres (note), I, 489 et V, 276.
Loricaires (Loricaria), II, 300.
Loricata (note), II, 19.
Loricère (Loricera), IV, 407.
Loricules, III, 303.
Loriots (les vrais), I, 380.
Loripèdes (Loripes), III, 148.
Lottes (Lota), II, 333.
Loup, I, 150.
Loutres, I, 147.
Loxia, I, 414.
Loxocères (Loxocera), V, 524.
Lucanes (Lucanus), IV, 576.
Lucene (note), III, 44.
Lucernaires (Lucernaria), III, 293.
Lucines (Lucina), III, 149.
Lucio-Perca, II, 138.
Lumme, I, 547.
Lumps, II, 346.
Lunulites, III, 320.
Lutra, I, 147.
Lutraires (Lutraria), III, 154.
Luvarus, II, 214.
Lycée, II, 121.
Lycoris, III, 201.
Lycoses (Lycosa), IV, 259.
Lyctes (Lyctus), V, 97.
Lycus (Lycus), IV, 464.
Lygées (Lygæus), V, 198.
Lymacodes (Lymacodes), V, 405.
Lymexylon (Lymexylon), IV, 485.
Lyncée (Lynceus), IV, 171.
Lynx, I, 163.
TOME III. 31
[page] 474
Lyres, I, 381.
Lyriocéphales, II, 40.
Lyrops (Lyrops), V, 326.
Lysidices, III, 200.
Lysmates (Lysmata), IV, 98.
Lystres (Lystra), V, 216.
Lystroniques (Lystronichus), V, 41.
M.
Mabouia (note), II 62.
Macaques, I, 94.
Macareux, I, 548.
Machetes, I, 527.
Machiles (Machilis), IV, 341.
Machles (Machla), V, 18.
Machoirans, II, 292.
Macraspis (Macraspis), IV, 553.
Macreuses, I, 570.
Macrocères (Macrocera), V, 449.
Macrocheles (Macrocheles), IV, 282.
Macrodactyles, I, 533.
Macrodactyles (Macrodactylus), IV, 562.
Macrognathes, II, 205.
Macronyques (Macronychus), IV, 517.
Macropezes (Macropeza), V, 446.
Macrophthalmes (Macrophtalmus), IV, 44.
Macropodes, II, 227.
Macropus, I, 186.
Macroramphus (note), I, 523.
Macrorhines, I, 169.
Mactres (Mactra), III, 152.
Macrourus, II, 336.
Madrépores (Madrepora), III, 312.
Maekistocères (Mækistocera), V, 446.
Mæna, II, 186.
Mænura, I, 381.
Maera (Maera), IV, 121.
Magas (note), III, 173.
Magiles (Magilus), III, 109.
Magnifique, I, 427.
Magots, I, 96.
Maïa (Maia), IV, 59.
Maigres, II, 172.
Maillots, III, 43.
Maimon, I, 96.
Mainates, I, 377.
Makaira, II, 202.
Makis, I, 106.
Malacanthes (Malacanthus), II, 264.
Malachies (Malachius), IV, 473.
Malacodermes (Malacodermi), IV, 444.
Malacoptérigiens, II, 348.
Malacostracés (Malacostraca), IV, 16, 411.
Malapterures, II, 298.
Malarmat, II, 161.
Malbrouc, I, 92.
Malcoas, II, 456.
Malentozaires (note), III, 174.
Malleus, III, 128.
Mallotes (Mallota), V, 492.
Malthées (Malthe), II, 252.
Malthines (Malthinus), IV, 472.
Mallotus, II, 305.
Manakius (les vrais), I, 393.
Manatus, I, 283.
[page] 475
Manchots, I, 550.
Mandrills, I, 98.
Mangabey à collier, I, 91.
Mangabey sans collier, I, 91.
Mangoustes, I, 157.
Mangues, I, 158.
Manorhines, I, 379.
Manteaux, III, 122.
Mantes (Mantis), V, 175.
Manticores (Manticora), IV, 360.
Mantispes (Mantispa), V, 253.
Manucode, I, 427.
Maquereaux, II, 197.
Marbrés, II, 46.
Marène, II, 307.
Marginelles (Marginella), III, 96.
Marginulines (note), III, 24.
Marikina, I, 106.
Marimonda, I, 101.
Marmose, I, 177.
Marmottes, I, 195.
Marouette, I, 538.
Marsouins, I, 289.
Marsupiaux, I, 172.
Marteaux, II, 393; III, 128.
Martes, I, 142.
Martinets, I, 394.
Martins, I, 377.
Martins-Pêcheurs, I, 443.
Masaris (Masaris), V, 333.
Mastacembles (Mastacembelus), II, 205.
Mastige (Mastigus), IV, 489.
Mastodon, I, 240.
Mastodontes, I, 240.
Matamata, II, 15.
Matière médullaire, I, 22.
Matrice, I, 39.
Matutes (Matuta), IV, 31.
Mauhèches, I, 525.
Mauves, I, 555.
Mauvis, I, 370.
Meandrines, III, 314.
Médéterus (Medeterus), V, 472.
Meduses (Medusa), III, 275.
Mégacephales (Megacephala), IV, 360.
Megachiles (Megachile), V, 348.
Mégadères (Megaderus), V, 111.
Megadermes, I, 118.
Megalodontes (Magalodontes), V, 276.
Megalopes (Megalops), II, 323.
Megalopes (Megalopus), IV, 85, V, 133.
Megalosaurus (note), II, 50.
Megalotis, I, 150.
Megalurus (add.), I, 583.
Megapodes, I, 537.
Megapodius, I, 537.
Megascelis (Megascelis), V, 138.
Megatomes (Megatoma), IV, 509.
Mélampes, III, 50.
Mélandryes (Melandrya), V, 45.
Melanies (Melania), III, 82.
Melanophore (Melaphora), V, 514.
Melanopsides (Melanopsis), III, 83.
Melasis (Melasis), IV, 448.
Melasomes (Melasoma), V, 2.
Méleagris, I, 475.
Melectes (Melecta), V, 353.
Melet, II, 318.
Mélicerte (note), III, 276.
Meliphaga (note), I, 375.
Mélitées (note), III, 276.
Mélites, III, 312.
Melithreptus, I, 433.
Melitturges (Melitturga), V, 355.
31*
[page] 476
Mellifères, V, 341.
Mellines (Mellinus), V, 330.
Membraces (Membracis), V, 219.
Membrane, I, 22.
Mémoire, I, 41.
Meloé (Meloe), V, 61.
Méloe propres (Méloe), V, 64.
Mélolontha, IV, 558.
Mélophages (Mélophagus), V, 544.
Melyra (Melyris), IV, 472.
Mendoles, II, 186.
Ménès, II, 212.
Menides, II, 186.
Menobranchus, II, 119.
Menopoma, II, 118.
Mephites, I, 146.
Mergus, I, 577.
Meries (Meria), V, 318.
Meriones, I, 203.
Merions, I, 204.
Merlans, II, 332.
Merles, I, 368.
Merles d'eau, I, 375.
Merluches, II, 333.
Merodons (Merodon), V, 497.
Merops, I, 441.
Merous, II, 140.
Meryx (Meryx), V, 99.
Mesanges, I, 401.
Mesoprions (Mesoprion), II, 143.
Messager ou Secrétaire, I, 338.
Métamorphose, I, 38.
Méthode, I, 8.
Melites (Melita), IV, 120.
Meunier, II, 274.
Micippes (Micippe), IV, 59.
Mico, I, 106.
Microdactylus, I, 505.
Microgastres (Microgaster), V, 289.
Micrommates (Micrommata), IV, 251.
Micropèples (Micropeplus), IV, 440.
Microptera, IV, 431.
Microptères, II, 178.
Microstomes (Microstoma), II, 283.
Micrures, II, 94.
Mictyres (Mictyris), IV, 47.
Migranes, IV, 66.
Mikiri, I, 100.
Milandres, II, 389.
Milans, I, 334.
Milésies (Milesia), V, 498.
Millepores (Millepora), III, 316.
Millioles (note), III, 25.
Millouinan, I, 573.
Millouins, I, 572.
Miltogrammes (Miltogramma), V, 511.
Milvus, I, 334.
Miniades (Minyas), III, 241.
Mink, I, 144.
Miris (Miris), V, 199.
Miscophes (Miscophus), V, 327.
Misgurn, II, 278.
Misolampes (Misolampus), V, 16.
Mites, IV, 283.
Mithrax (Mithrax), IV, 57.
Mitou, I, 469.
Mitres (Mitra), III, 96.
Mixodes, II, 238.
Mochon, II, 235.
Mococo, I, 107.
Mocos, I, 220.
Modioles (Modiolus, III, 136.
Moi, I, 27.
Moineaux, I, 406.
Moles, II, 368.
Molinesia, II, 281.
[page] 477
Molobres (Molobrus), V, 450.
Molosses, I, 115.
Molpadies (Molpadia), III, 241.
Moluris (Moluris), V, 14.
Mollusques, III, 1.
Mollusques brachiopodes, III, 170.
Mollusques cirrhopodes, III, 174.
Mormyres (Mormyrus), II, 288.
Monacanthes, II, 373.
Monades (Monas), III, 327.
Monarcha (add.), I, 583.
Monasa (note), I, 455.
Mone, I, 92.
Mongous, I, 107.
Monitors, II, 24.
Monoceros, II, 224.
Monodontes (Monodon), III, 80.
Monocheles, IV, 565.
Monocentris, II, 169.
Monochires (Monochir), II, 343.
Monocles (Monoculus), IV, 150.
Monodon, I, 292.
Monophores, III, 70.
Monopleurobranches (note), III, 58.
Monoptères, II, 353.
Monotome (Monotoma), V, 95.
Monotrèmes, I, 233.
Monticulaires, III, 315.
Mopsées, III, 312.
Moqueur, I, 370.
Mordelles (Mordella), V, 55.
Morillon, I, 573.
Morio, III, 101.
Morions (Morio), IV, 386.
Morme, II, 184.
Mormon, I, 548.
Mormoops, I, 120.
Mormolyces (Mormolyce), IV, 400.
Morphnus, I, 329.
Morphos (Morpho), V, 382.
Morses, I, 170.
Morues, II, 331.
Moschus, I, 258.
Mosille (Mosillus), V, 535.
Motacilla, I, 382.
Motelles (Motella), II, 334.
Motmots, I, 442.
Motteux, I, 382.
Moucheroles, I, 357.
Mouches, V, 509.
Mouches-Scorpions, V, 245.
Mouettes, I, 555.
Mouflon, I, 277.
Moule commune, III, 136.
Moules propres, III, 135.
Mouffettes, I, 146.
Mourines, II, 400.
Moustac, I, 92.
Moustaches, I, 403.
Moutons, I, 276.
Mucronines (note), III, 24.
Mulcions (Mulcion), IV, 100.
Mulètes, III, 138.
Mulions (Mulio), V, 466.
Mulles (Mullus), II, 156.
Muraenoïdes, II, 239.
Murex, III, 102.
Muricées, III, 311.
Mursies (Mursia), IV, 39.
Muges, II, 230.
Mus, I, 195.
Musaraignes, I, 126.
Musaraigne d'eau, I, 127.
Musc, I, 258.
Musca, V, 509.
Muscade, III, 64.
Muscardin, I, 198.
[page] 478
Muscicapa, I, 356.
Muscipeta, I, 357.
Musophages (Musophaga), I, 467.
Mustela, I, 142.
Mustèle, II, 334.
Mustelus, II, 389.
Mutilles (Mutilla), V, 314.
Myas (Myas), IV, 397.
Mycetes, I, 99.
Mycetobies (Mycetobia), V, 450.
Mycétochares (Mycetochares), V, 42.
Mycétophages, V, 98.
Mycetophiles (Mycetophila), V, 449.
Myctère (Mycterus), V, 49.
Mycteria, I, 514.
Mydas (Mydas), V, 480.
Myes (Mya), III, 154.
Mygale, I, 128.
Mygale (Mygale), IV, 227.
Myiagra (add.), I, 582.
Mylabres (Mylabris), V, 63.
Myliobatis, II, 400.
Myodites (Myodites), V, 56.
Myodoques (Myodocha), V, 199.
Myopes (Myopa), V, 506.
Myopotamus, I, 214.
Myorhines (Myorhinus), V, 84.
Myothera, I, 372.
Myoxus, I, 197.
Myre, II, 350.
Myrianes (note), III, 208.
Myriapodes (Myriapoda), IV, 326.
Myripristis, II, 150.
Myrmécie (Myrmecia), IV, 261.
Myrmecophaga, I, 231.
Myrmécophiles (Myrmécophila), V, 183.
Myrmeleon, V, 248.
Myrmothera (note), I, 372.
Myrines (Myrina), V, 385.
Mysis (Mysis), IV, 100.
Mysomela (add.), I, 583.
Mystus, II, 292.
Mytilacés, III, 135.
Mytilus, III, 135.
Myxines, II, 405.
Myzines (Myzines), V, 318.
N.
Nagos, I, 270.
Naia, II, 93.
Naïdes (Naïs), III, 211.
Naïsa (note), III, 299.
Nanguer, I, 268.
Narvals, I, 292.
Nasique, I, 94.
Nasons (Naseus), II, 224.
Nasses (Nassa), III, 98.
Nasua, I, 139.
Natices (Natica), III, 85.
Nauclerus (add.), I, 582.
Naucores (Naucoris), V, 206.
Naucrates, II, 202.
Naupredies (Naupredia), IV, 128.
Nautiles (Nautilus), III, 17.
Navicelles, III, 88.
Nebalies (Nebalia), IV, 153.
Nebries (Nebria), IV, 415.
Necrobies (Necrobia), IV, 479.
Necrophores (Necrophorus), IV, 496.
[page] 479
Nectarinia, I, 432.
Nectopodes (note), III, 66.
Nécydale (Necydalis), V, 119.
Neïdes (Neides), V, 198.
Nelocires (Nleocira), IV, 135.
Nematodes (Nematodes), IV, 454.
Nematoïdea, III, 247.
Nematopodes (note), III, 174.
Nemerte (Nemertes), III, 259.
Nemestrines (Nemestrina), V, 467.
Nemocères (Nemocera), V, 435.
Nemosomes (Nemosoma), V, 95.
Nemognathes (Nemognathus), V, 68.
Nemoptères (Nemoptera), V, 246.
Nemotèles (Nemotelus), V, 486.
Nemoures (Nemoura), V, 258.
Neomeris (note), III, 299.
Neops (note), I, 429.
Népes (Nepa), V, 205.
Nephelis, III, 214.
Nephrotomes (Nephrotoma), V, 444.
Nephthys, III, 203.
Néréides (Nereis), III, 201.
Nereiphylles, III, 202.
Nerinée (note), III, 102.
Nérites (Nerita), III, 85.
Néritines, III, 86.
Nesea, III, 306.
Nésées (Naesa), IV, 137.
Neuroptera, V, 233.
Nevroptères, IV, 324 et V, 233.
Nez, II, 276.
Nicothoes (Nicothoe), IV, 201.
Nilions (Nilio), V, 33.
Niphons, II, 136.
Nitèles (Nitela), V, 328.
Nitidules (Nitidula), IV, 503.
Nitschia (note), III, 265.
Nocthores, I, 104.
Noctilions (Noctilio), I, 116.
Noctua, I, 344.
Noctuelles (Noctua), V, 409.
Noctule, I, 121.
Nocturnes (Nocturna), V, 395.
Noddis, I, 559.
Nodosaires (note), III, 24.
Nomades (Nomada), V, 352.
Nomeus, II, 206.
Nompareilles, III, 44.
Nonionines (note), III, 23.
Nonnette, I, 402.
Noreck (add.), I, 580.
Nosodendres (Nosodendron), IV, 512.
Notacanthes, II, 205.
Notacanthes (Notacantha), V, 478.
Notarches (Notarchus), III, 62.
Notères (Noterus), IV, 427.
Nothus (Nothus), V, 47.
Notidanus, II, 390.
Notiophiles (Notiophilus), IV, 418.
Notiphiles (Notiphila), V, 521.
Notistium, II, 202.
Notodontes (Notodonta), V, 404.
Notonectes (Notonecta), V, 208.
Notoptères (Notopterus), II, 321.
Notoxe (Notoxus), V, 58.
Nucifraga (note), I, 423.
Nucleobranches (note), III, 66.
Nucléolites, III, 234.
Nucules, III, 134.
Nudibranches, III, 35.
Numenius, I, 521.
Numida, I, 475.
Nummulites, III, 22.
Nutrition, I, 24.
[page] 480
Nyctées (Nycteus), IV, 462.
Nyctélies (Nyctelia), V, 8.
Nyctères (Nycteris), I, 119.
Nycteribies (Nycteribia), V, 545.
Nycticées, I, 122.
Nyctinomes, I, 115.
Nylgau, I, 274.
Nymphales (Nymphalis), V, 381.
Nymphons (Nymphon), IV, 278.
Nyssons (Nysson), V, 327.
O.
Obélies (note), III, 277.
Oblades (Oblada), II, 185.
Obrie (Obrium), V, 119.
Océanies (note), III, 277.
Ocelot, I, 164.
Ochodées (Ochodæus), IV, 544.
Ochtères (Ochtera), V, 520.
Ochthebies (Ochthebius), IV, 520.
Ochthosies, III, 179.
Octopus, III, 11.
Oculines, III, 313.
Ocydromies (Ocydromia), V, 459.
Ocypètes (Ocypète), IV, 291.
Ocypodes (Ocypode), IV, 46.
Ocyptères (Ocyptera), V, 512.
Ocyroés, III, 282.
Ocypterus, I, 353.
Ocythoé (note), III, 13.
Odacanthes (Odacantha), IV, 372.
Odax, II, 266.
Odontognathes, II, 321.
Odontomaques (Odontomachus), V, 313.
Odontomyies (Odontomyia), V, 485.
OEcophore (OEcophora), V, 422.
OEdalées (OEdalea), V, 458.
OEdémère (OEdemera), V, 47.
OEdicnèmes (OEdicnemus), I, 500.
OEdionyques (OEdionychis), V, 154.
OEnanthe (note), I, 382.
OEnas (OEnas), V, 64.
OEstres (OEstrus), V, 500.
Ogygies (Ogygia), IV, 205.
Oidemia (note), 570.
Oies, I, 567.
Oiseaux, I, 301.
Oiseaux de proie, I, 313.
Oiseaux de proie nocturnes, I, 339.
Oiseaux de Paradis, I, 426.
Oiseaux mouches, I, 436.
Oiseaux de rivage, I, 493.
Oligodon, II, 83.
Oliste (Olistus), II, 209.
Olives (Oliva), III, 94.
Omalies (Omalium), IV, 439.
Omalises (Omalisus), IV, 465.
Ombellulaires, III, 319.
Ombre, II, 305.
Ombrelles, III, 65.
Ombrettes, I, 515.
Ombrines, II, 174.
Ometis (Ometis), IV, 554.
Ommaties (Ommatius), V, 458.
Omophrons (Omophron), IV, 416.
Onagga, I, 253.
Once (note), I, 163.
Onchidies (Onchidium), III, 46.
Onchidores, III, 52.
Ondatras, I, 205.
Oniscodes (Oniscoda), IV, 140.
Oniticelles (Oniticellus), IV, 536.
Onitis (Onitis), IV, 537.
[page] 481
Onthophages (Onthophagus), IV, 536.
Onychoteuthis, III, 15.
Onykia, III, 15.
Oodes (Oodes), IV, 403.
Opâtres (Opatrum), V, 22.
Operculines (note), III, 24.
Ophélies, III, 205.
Ophicéphales (Ophicephalus), II, 229.
Ophidium, II, 358.
Ophie (note), I, 432.
Ophiocéphales, III, 259.
Ophiognathus, II, 355.
Ophions (Ophion), V, 286.
Ophiostomes, III, 250.
Ophisaures (Ophisaurus), II, 69.
Ophisures (Ophisurus), II, 350.
Ophiures, III, 228.
Ophrones (Ophronus), IV, 391.
Ophryesses (Ophryessa), II, 46.
Opiles (Opilo), IV, 478.
Opistognathes, II, 240.
Opistolophus (note), I, 536.
Oplocéphales, II, 95.
Oplurus, II, 47.
Orangs, I, 87.
Orang-outang, I, 87.
Orbicules (Orbicula), III, 173.
Orbiculines (notes), III, 25.
Orbulites, 3, 320.
Orchestes (Orchestes), V, 85.
Orchesties (Orchestia), IV, 119.
Orcynus, II, 198.
Ordre, I, 8.
Oreillards, I, 121.
Oreosome (Oreosoma), II, 171.
Orfe, II, 276.
Orfraie, I, 326.
Orgasme, I, 29.
Orgyies (Orgyia), V, 405.
Oribates (Oribata), IV, 285.
Oricou, I, 315.
Oriolus, I, 380.
Oristhocomus, I, 472.
Orithyies (Orithyia), IV, 32.
Ormiers, III, 111.
Ornithomyies (Ornithomyia); V, 543.
Ornithorinques, I, 235.
Ornithorhynchus, I, 235.
Orobitis (Orobitis), V, 86.
Orphées, II, 284.
Orsodacnes (Orsodacna), V, 134.
Ortalida, I, 472.
Ortalides (Ortalis), V, 533.
Orthagoriscus, II, 369.
Orthocères (Orthocerus), V, 24.
Orthocérines (notes), III, 24.
Orthonyx, I, 374.
Orthoptères, IV, 323.
Orthoptères (Orthoptera), V, 167.
Orthorhynchus, I, 436.
Orties de mer, III, 274.
Orties de mer fixes, III, 290.
Ortochætes (Ortochætes), V, 88.
Ortochiles (Ortochile), V, 471.
Ortolan, I, 404.
Ortygis, I, 486.
Orvets, II, 69.
Oryctères, I, 211.
Oryctéropes (Orycteropus), I, 230.
Oryctès (Oryctes), IV, 548.
Orysses (Oryssus), V, 278.
Oscabrelles (note), III, 115.
Oscabrions, III, 114.
Oscine (Oscinis), V, 528.
Osorius (Osorius), IV, 438.
[page] 482
Osphromènes (Osphromenus), II, 228.
Osteoglosses (Osteoglossum), II, 328.
Ostracés, III, 119.
Ostracion, II, 375.
Ostracite, III, 119.
Ostracodes, IV, 151.
Ostrea, III, 120.
Otilophes, II, 112.
Otiocères (Otiocerus), V, 216.
Otion, III, 177.
Otis, I, 498.
Otites (Otites), V, 529.
Otolicnus, I, 109.
Otolithes (Otolithus), II, 172.
Otomys, I, 208 et 581.
Otus, I, 340.
Oublie, III, 64.
Ouette, I, 362.
Ouistitis, I, 104.
Ourax, I, 470.
Ours, I, 135.
Oursins, III, 230.
Outardes, I, 498.
Ovaire, I, 39.
Oviductus, I, 39.
Ovis, I. 276.
Ovules (Ovula), III, 93.
Ovulites, III, 320.
Oxées (Oxæa), V, 353.
Oxures (Oxura), V, 16.
Oxybèles (Oxybelus), V, 328.
Oxycères (Oxycera), V, 485.
Oxycheiles (Oxycheila), IV, 360.
Oxygnathes (Oxygnahus), IV, 384,
Oxyopes (Oxyopes), IV, 258.
Oxypores (Oxyporus), IV, 433.
Oxyrhynchus, II, 112.
Oxyrinques, I, 418.
Oxystomes (Oxystomus), IV, 385.
Oxystomes (note), III, 84.
Oxytèles (Oxytelus), IV, 438.
Oxyura (note), I, 574.
Oxyures (Oxyuris), III, 250.
Oxyures (Oxyuri), V, 299.
Ozènes (Ozæna), IV, 386.
P.
Pacas, I, 221.
Pachycephala (add.), I, 582.
Pachycnèmes (Pachycnemus), IV, 568.
Pachydermes, I, 69. 236.
Pachylides (Pachylis), V, 197.
Pachypes (Pachypus), IV, 555.
Pachyptila, I, 554.
Pachystomes (Pachystomus), V, 481.
Pachytes, III, 125.
Paecilopodes (Paecilopoda), IV, 183.
Pagels, II, 183.
Pagres, II, 182.
Pagures (Pagurus), IV, 76.
Paille-en-queue, I, 564.
Palaeornis (note), I, 462.
Palaeotherium, I, 249.
Palamedea, I, 536.
Palares (Palarus), V, 326.
Palée, II, 308.
Palémons (Palaemon), IV, 97.
Palinurus, IV, 80.
[page] 483
Pallettes, I, 517.
Palliobranches (note), III, 170.
Palmipèdes, I, 543.
Palmiste, I, 193.
Palmyres (Palmyre), III, 205.
Palpicornes, IV, 518.
Palpimane (Palpimanus), IV, 263.
Paludines (Paludina), III, 79.
Pambores (Pamborus), IV, 409.
Pamphilies (Pamphilius), V, 276.
Panagées (Panageus), IV, 407.
Panda, I, 138 et 580.
Pandales (Pandalus), IV, 97.
Pandares (Pandarus), IV, 197.
Pandion, I, 327.
Pandores, III, 156.
Pangolins, I, 232.
Panopes (Panopea), III, 156.
Panorpes (Panorpa), V, 245.
Panthère, I, 162.
Panurges (Panurgus), V, 346.
Paons (Pavo), I, 473.
Paphies, III, 140.
Papillons (Papilio), V, 374.
Papion, I, 97.
Paracephalophores (note), III, 26.
Paracephalophores-Dioïques (note), III, 70.
Paracephalophores hermaphrodites (note), III, 110.
Paracephalophores monoïques (note) III, 50.
Paradisœa, I, 426.
Paradoxides, IV, 205.
Paradoxure, I, 156.
Paradoxurus, I, 156.
Paralepis, II, 156.
Paramèces, III, 326.
Parandre (Parandra), V, 106.
Parasites, IV, 323.
Pardalotes, I, 356.
Pardalotus, I, 356.
Parent, I, 15.
Paresseux, I, 223.
Parmacelles (Parmacella), III, 40.
Parmophorus, III, 113.
Parnopes (Parnopes), V, 304.
Parole, I, 42.
Paropside (Paropsis), V, 149.
Parotia (note), I, 427.
Parra, I, 534.
Parraquas, I, 472.
Parthenope (Parthenope), IV, 56.
Parus, I, 401.
Pasimaque (Pasimachus), IV, 382.
Pasiphaé (Pasiphaea), IV, 99.
Pasites (Pasites), V, 352.
Passales (Passalus), IV, 580.
Passandres (Passandra), V, 101.
Passereaux, I, 347.
Passerina (note), I, 409.
Passerita, II, 82.
Pastenagues, II, 399.
Pasteurs, II, 206.
Patas, I, 91.
Patelles (Patella), III, 114.
Patrobes (Patrobus), IV, 408.
Patte-d'oie, II, 108.
Paussus (Paussus), V, 93.
Pauxi, I, 470.
Pavois, III, 113.
Pavonaires, III, 319.
Pavonie (Pavonia), V, 382.
Pavonines (note), III, 24.
Paxillommes (Paxylloma), V, 281.
Pecari, I, 245.
Pecora, I, 254.
[page] 484
Pecten, III, 122.
Pectinaires (note) III, 194.
Pectinibranches, III, 36.
Pectunculus, III, 133.
Pédères (Pæderus), IV, 436.
Pedetes, I, 209.
Pedicies (Pedicia), V, 444.
Pedicellaires (Pedicellaria), III, 297.
Pédicellés, III, 224.
Pediculus, IV, 344.
Pedines (Pedinus), V, 19.
Pedipalpes (Pedipalpi), IV, 265.
Pedum, III, 124.
Pégases (Pegasus), II, 363.
Pegasies (note), III, 276.
Peignes, III, 122.
Peintades, I, 475.
Pekan (note), I, 146.
Pélages, I, 169.
Pelagies, III, 276.
Pelamides, II, 97.
Pelates, II, 148.
Pélécanoïdes, I, 554.
Pelecanus, I, 561.
Pelecies (Pelecium), IV, 406.
Pélécines (Pelecinus), V, 281.
Pélerines, III, 122.
Pélerins, II, 390.
Pélicans, I, 561.
Pelidna, I, 526.
Pelocère (Pelocera), V, 499.
Pélocophores (Pelocophorus), IV, 475.
Pelocotomes (Pelocotoma), V, 56.
Pelors, II, 168.
Peloris, III, 121.
Peloronta, III, 85.
Peltastes (Peltastes), V, 288.
Pempherides (Pempheris), II, 95.
Pemphredons (Pemphredon), V, 330.
Penées (Penæus), IV, 92.
Pénélope, I, 471.
Pénéroples (note), III, 23.
Pénicilles, III, 306.
Pennatules (Pennatula), III, 317.
Pennelles (Pennella), III, 256.
Pentacrinites, III, 230.
Pentalasmis, III, 175.
Pentapodes, II, 184.
Pentapomes (Pentapoma), V, 193.
Pentastoma, III, 254.
Penthimies (Penthimia), V, 223.
Penthétries (Penthetria), V, 452.
Peprilus, II, 213.
Pepsis (Pepsis), V, 320.
Perameles, I, 180.
Perce-Oreilles, V, 171.
Perches (Perca), II, 132.
Percis (Percis), II, 153.
Percnoptères, I, 317.
Percoïdes, II, 131.
Percophis, II, 153.
Perdix, I, 484.
Perdrix, I, 484.
Péricerès (Pericera), IV, 58.
Périlampes (Perilampus), V, 298.
Périophtalmes (Periophtalmus), II, 245.
Peristera (add.), I, 584.
Peristedion, II, 161.
Perle (Perla), V, 258.
Pernes (Perna), III, 128.
Pernis, I, 335.
Peronia (note), III, 39.
Perroquets, I, 461.
Perruches, I, 462.
Perruches ingambes I, 466.
[page] 485
Perygophorus, V, 275.
Pétauristes, V, 136.
Pétoncles, III, 133.
Pétrels, I, 552.
Pétricoles (Petricola), III, 152.
Petrodroma (note), I, 431.
Petromyzon, II, 403.
Pezoporus, I 466.
Phædons (Phœdon), V, 151.
Phænicophæus (note), I, 456.
Phaëton, I, 564.
Phætornis (add.), I, 583.
Phalacres (Phalacrus), V, 157.
Phalacrocorax, I, 562.
Phalænæ tortrices, V, 411.
Phalangers, I, 181.
Phalangiens (Phalangita), IV, 279.
Phalangista, II, 163.
Phalaropes (Phalaropus), I, 528.
Phalenes (Phalæna), V, 395.
Phallusies (note), III, 166.
Phanées (Phanaeus), IV, 537.
Phanies (Phania), V, 514.
Pharyngiens, II, 225.
Phacochoeres, I, 244.
Phascolomes, I, 188.
Phascogales, I, 178.
Phascolarctos, I, 188.
Phascolomys, I, 188.
Phasianelles (Phasianella), III, 81.
Phasianus, I, 476.
Phasies (Phasia), V, 512.
Phasmes (Phasma), V, 179.
Phène, I, 318.
Pheruses (Pherusa), IV, 121.
Phibalures, I, 366.
Philanthes (Philanthus), V, 331.
Philedon, I, 375; I, 435 (note.)
Philerèmes (Phileremus), V, 352.
Phileopsis, III, 87.
Phileures (Phileurus), IV, 550.
Philodromes (Philodromus), IV, 254.
Philomyque (note), III, 39.
Philoscies (Philoscia), IV, 143.
Phisaloptères, III, 253.
Phlæa (Phlæa), V, 195.
Phloïotribes (Phloïotribus), V, 92.
Phoca, I, 166.
Phocœna, I, 289.
Phœnicocère (Phœnicocerus) V, 113.
Phoenicopterus, I, 542.
Pholades (Pholas), III, 158.
Pholcus (Pholcus), IV, 244.
Pholidotes (Pholidotus), IV, 578.
Phoques, I, 166.
Phores (Phora), 5, 537.
Phrenotrix (note), I, 424.
Phronimes (Phronima), IV, 116.
Phrosine (Phrosine), IV, 117.
Phryganea, V, 259.
Phrynes (Phrynus), IV, 266.
Phrynocephalus (note), II, 40.
Phthiries (Phthiria), V, 463.
Phycis (Phycis), II, 335; V, 420.
Phyllidies (Phyllidia), III, 57.
Phyllies (Phyllium), V, 179.
Phylline (note), III, 265.
Phylliroès, III, 70.
Phyllocaris (Phyllocaris), V, 148.
Phyllocère (Phyllocerus), IV, 456.
Phyllodoces, III, 202.
Phyllopes, IV, 171.
Phyllosome (Phyllosoma), IV, 111.
Phyllostomes, I, 116.
Phyllures, II, 58.
Physale (note), III, 240.
[page] 486
Physalies (Physalia), III, 285.
Physcs (Physa), III, 48.
Physeter, I, 293.
Physignathes, II, 41.
Physique générale, I, 2.
Physique ou science naturelle, I, 2.
Physique particulière, I, 3.
Physodactyles (Physodactylus), IV, 458.
Physsophores (Physsophora), III, 286.
Phyzeliæ (note), III, 194.
Piabuques, II, 310.
Pica, I, 422.
Picarels, II, 187.
Pics (Picus), I, 448.
Picucules, I, 431.
Pierides (Pieris), V, 377.
Pies-Grièches, I, 349.
Piette, I, 578.
Pigeons, I, 448.
Pilchard, 2, 318.
Pileoles (Pileolus), III, 88.
Pilet, I, 575.
Pilotes, II, 202.
Pilumnes (Pilumnus), IV, 41.
Pimelies (Pimelia), V, 5.
Pimeleptères (Pimelepterus), II, 193.
Pimelodes, II, 292.
Pimples (Pimpla), V, 285.
Pinceaux de mer, III, 189.
Pinces, IV, 275.
Pinche, I, 105.
Pinçons, I, 409.
Pingouins, I, 548.
Pinna, III, 131.
Pinnothères (Pinnothères), IV, 48
Pinophiles (Pinophilus), IV, 435.
Pinguipes, II, 153.
Pipa, II, 112.
Pipi, I, 391.
Pipistrelle, I, 121.
Pipizes (Pipiza), V, 498.
Pipra, I, 392
Pipuncule (Pipunculus), V, 473.
Pique-Bœufs, I, 416.
Pirènes, III, 83.
Pirimèle (Pirimela), IV, 38.
Piscicoles (note), III, 215.
Pisons (Pison), V, 328.
Pit-Pits, I, 418.
Pithecia, I, 103.
Pithecus, I, 87.
Pitta (note), I, 373.
Pitylus, I, 413.
Placenta, I, 64.
Placobranches (Placobranchus), III, 56.
Plactoles (Plactolus), IV. 64.
Placunes (Placuna), III, 126.
Plagiostomes, II, 383; III, 124.
Plagusies (Plagusia), IV; 51.
Planaires (Planaria), III, 266.
Planiceps (Planiceps), V, 321.
Planipennes, V, 224.
Planorbes (Planorbis), III, 47.
Planorbulines (note), III, 24.
Plantigrades, I, 134.
Planulaires (note), III, 24.
Planulins (note), III, 24.
Platalea, I, 517.
Platax, II, 193.
Platessa, II, 338.
Platures, II, 94.
Platycercus (note), I, 463.
Platycères (Platycerus), IV, 579.
Platycrinites, III, 230.
Platydactyles, II, 52.
Platygastres (Platygaster), V, 302.
[page] 487
Platygenie (Platygenia), IV, 571.
Platynes (Platynus), IV, 402.
Platypes (Platypus), V, 92.
Platypèzes (Platypeza), V, 473.
Platyptères, II, 248.
Platypterix (Platypterix), V, 407.
Platypus, I, 235; (note), 570.
Platyrhynques, I, 358.
Platyscèle (Platyscelus), V, 21.
Platycéphales (Platycephalus), II, 165.
Platyrhinques (note), I, 445.
Platystes (Platistacus), II, 299.
Platystomes (Platystoma), V, 534.
Platyures (Platyura), V, 450.
Plecotus, I, 121.
Plectognathes, II, 364.
Plectris (Plectris), IV, 563.
Plectropomes (Plectropoma), II, 142.
Plectrophores (note), III, 39.
Pléiones (Pleione), III, 199.
Plésiops, II, 264.
Plesiosaurus (note), II, 68
Pleurobranchoea (Pleurobranchidium), III, 59.
Pleurobranches (Pleurobranchus), III, 58.
Pleuronectes (Pleuronectes), II, 337.
Pleurotomaires, III, 76.
Pleurotomes, III, 105.
Plexaures, III, 310.
Plicatules, III, 127.
Plicipennes, V, 259.
Plies, II, 338.
Plocamocères, III, 52.
Ploceus, I, 406.
Plochiones (Piochionus), IV, 378.
Ploières (Ploiaria), V, 203.
Plongeons, I, 544.
Plongeurs, I, 544.
Plotoses, II, 297.
Plotus, I, 564.
Plumulaires, III, 301.
Pluvianus (note), I, 502.
Pluviers, I, 499.
Plyctolophus (note), I, 464.
Pneumodermes (Pneumodermon), III, 27.
Pneumores (Pneumora), V, 185.
Pneustoïdea (note), II, 40.
Pocillopores, III, 314.
Podarges (Podargus), I, 398.
Podiceps, I, 545.
Podies (Podium), V, 324.
Podoa, I, 546.
Podocères (Podocerus), IV, 122.
Podonties (Podentia), V, 148.
Podophthalmes (Podophthalmus), IV, 33.
Podopsides, III, 125.
Podures (Podura); IV, 342.
Podurelles (Podurellæ), IV, 342.
Poecilies (Poecilia), II, 280.
Peociloptère (Poeciloptera), V, 217.
Pogones (Pogonus), IV, 392.
Pogonias, I, 457; II, 174.
Pogonophores (Pogonophorus), IV, 414.
Poissons, II, 122.
Polatouches, I, 194.
Pole, II, 339.
Polipiers nageurs, III, 317.
Polistes, V, 337.
Polistiques (Polisticus), IV, 373.
Pollicipes, III, 176
Pollyxènes (Pollyxenus), IV, 335.
Polochion (note), I, 375.
[page] 488
Polochres (Polochrum), V, 319.
Polophilus (note), I, 454.
Polyacanthes (Polyacanthus), II, 227.
Polybies (Polybius), IV, 31.
Polybranches (note), III, 50.
Policères (Polycera), III, 52.
Polychrus, II, 46.
Polyclinum, III, 169.
Polydème (Polydesmus), IV, 334.
Polydores (note), III, 189.
Polymorphines (note), III, 25.
Polynèmes (Polynemus), II, 154.
Polynoé, III, 207.
Polyodons, II, 380.
Polyodontes (note), III, 132; III, 208.
Polyommates (Polyommatus), V, 385.
Polypes, III, 12, 289.
Polypes à bras, III, 294.
Polypes à cellules, III, 302.
Polypes charnus, III, 290.
Polypes corticaux, III, 309.
Polypes gélatineux, III, 294.
Polypes à Polipiers, III, 297.
Polypes à tuyaux, III, 298.
Polyphèmes (Polyphemus), IV, 163.
Polyphyses (Polyphysa), III, 308.
Polyplaxiphores (note), III, 115.
Polyplectrum (note), I, 474.
Polyprion, II, 145.
Polypterus, II, 329.
Polystoma, III, 264.
Polystomelles (note), III, 23.
Pomacanthes, II, 192.
Pomacentres, II, 179.
Pomatomes (Pomatomus), II, 137.
Pomotis (Pomotis), II, 147.
Pompadour, I, 362.
Pompiles (Pompilus), V, 320.
Ponères (Ponera), V, 313.
Pongo, I, 88, 579.
Pontobdella (note), III, 216.
Pontonies (Pontonia), IV, 96
Popilies (Popilia), IV, 563.
Porcelaines, III, 92
Porcellanes (Porcellana), IV, 84.
Porcellious (Porcellio), IV, 143.
Porc-Epics, I, 214.
Porites, III, 314.
Porphyrio, I, 539.
Porppyrops (Porphyrops), V, 472.
Porpites (Porpita), III, 283.
Porte-Bec, V, 69.
Porte-Crête, II, 41.
Porte-Ecuelle, II, 344.
Porte-Plumet, III, 79.
Porte-Scie, V, 268.
Portunes (Portunus), IV, 33.
Potamides, III, 102.
Potamophiles (Potamophilus), IV, 516.
Poteriocrinites, III, 230.
Potoroos, I, 185.
Potto, I, 139.
Pou (Pediculus), IV, 344.
Pouce-Pieds, III, 176.
Pouillot, I, 389.
Poules d'ean, I, 539.
Poulpes, III, 11.
Poumon, I, 36.
Pourpres, III, 99.
Pranizes (Praniza), IV, 125.
Prasocures (Prasocuris), V, 151.
Premnades (Premnas), II, 179.
Pressirostres, I, 498.
Prêtre ou Abusseau, II, 235.
Priacanthes (Priacanthus), II, 147.
Priapules, III, 242.
[page] 489
Primnoa, III, 311.
Priocères (Priocera), IV, 477.
Priodons, II, 225.
Priodontes, I, 229.
Priones (Prionus), V, 107.
Prionites, I, 442.
Prionodermes (Prionoderma), III, 255.
Prionotes, II, 160.
Prions, I, 554.
Prionures, II, 224.
Pristigastres (Pristigaster), II, 321.
Pristipomes (Pristipoma), II, 176.
Pristis, II, 394.
Proboscidiens, I, 237.
Procellaria, I, 552.
Procerus (Procerus), IV, 411.
Processes (Processa), IV, 95.
Procnias, I, 364.
Procris (Procris), V, 394.
Proctotrupes (Proctotrupes), V, 301.
Procustes (Procustes), IV, 411.
Prognathes (Prognatha), IV, 439.
Promerops, I, 439.
Pronées (Pronæus), V, 323.
Proscopies (Proscopia), V, 185.
Prostomes, III, 267.
Prostomis (Prostomis), V, 100.
Protées (Proteus), II, 119; III, 326.
Proteines (Proteinus), IV, 440.
Proto (note), III, 211.
Protonopsis (note), II, 118.
Proxichiles (Proxichilus), IV, 278.
Proyer, I, 404.
Prudence, I, 42.
Psammétiques (Psammetichus), V, 12.
Psammobies (Psammobia), III, 158.
Psammodies (Psammodius), IV, 539.
Psammœchus, V, 135.
Psammosaurus (note), II, 26.
Psammothées (Psammothea), III, 15S.
Psares (Psarus), V, 495.
Psaris, I, 354.
Pselophiens (Pselaphii), V, 163.
Psens (Psen), V, 331.
Psettus, II, 193.
Pseudo-ameva (note), II, 30.
Pseudobdella (note), III, 214.
Pseudo-boa, II, 79.
Pseudopus, II, 69.
Pseudo-scorpiones, IV, 273.
Pseudostoma, I, 211.
Psilomyies (Psilomyia), V, 525.
Psittacus, I, 461.
Psoa (Psoa), V, 94.
Psophia, I, 506.
Psoques (Psocus), V, 257.
Psyché (Psyche), V, 406.
Psychés, III, 29.
Psychodes (Psychoda), V, 442.
Psylles (Psylla), V, 224.
Psylliodes (Psylliodes), V, 154.
Pteraclis, II, 216.
Pterocères (Pterocera), III, 107.
Pterocles, I, 483.
Pterodactyle, II, 43.
Pteroglossus, I, 460.
Pterois, II, 167.
Pteromales (Pteromalus), V, 298.
Pteromys, I, 194.
TOME III. 32
[page] 490
Pterophores (Pterophorus), V, 424.
Pteropleura (note), II, 54.
Pteropodes, III, 26.
Pteropus, I, 113.
Pterotrachea, III, 67.
Pterygoceres (Pterygocera), IV, 124.
Pterygophores, V, 275.
Pterygopodes (Pterygopoda), IV, 197.
Ptilinopus (note), I, 492.
Ptilins (Ptilinus), IV, 483.
Ptilodactiles (Ptilodactilus), IV, 461, et V, 483.
Ptilonorhynchus (note), I, 355.
Ptines (Ptinus), IV, 481.
Ptychoptères (Ptychoptera), V, 445.
Ptychozoon (note), II, 54.
Ptyodactyles, II, 56.
Pucerons, V, 226.
Puces (Pulex), IV, 350.
Puffins (Puffinus), I, 553.
Pulmonaires (Pulmonaria), IV, 211.
Pulmonés, III, 34.
Pulmonés aquatiques, III, 46.
Pulmonés operculés (note), III, 78
Pulvinites, III, 130.
Punaises, V, 190.
Punaises d'eau, V, 205.
Pupa, III, 43.
Pupipares (Pupipara), V, 538.
Pupivores (Pupivora), V, 279.
Purpura, III, 99.
Putois, I, 143.
Pycnogonides (Pycnogonides), IV, 276.
Pycnogonons (Pycnogonum), IV, 278.
Pygodactile (note), II, 65.
Pyloridées (note), III, 135.
Pyrales (Pyralis), V, 412.
Pyramidelles, III, 84.
Pyranga, I, 367.
Pyrgo, III, 30.
Pyrgomes, III, 178.
Pyrochres (Pyrochroa), V, 54.
Pyrosomes (Pyrosoma), III, 168
Pyrrhocorax, I, 379.
Pyrrhula, I, 414.
Pythe (Pytho), V, 40.
Pythons, II, 80.
Q.
Quadrumanes, I, 67,
Quatre-œil, I, 176.
Quatre raies, II, 84.
Quetz paleo, II, 47.
Queues rudes, II, 34.
Quinqueloculines (note), III, 25.
Quojas-morou (note), I, 89.
R.
Race caucasique, I, 80.
Race éthiopique, I, 80.
Race mongolique, I, 80.
Racemides, III, 287.
Radiolites, III, 119.
Raies (Raia), II, 395.
[page] 491
Rainettes, II, 107.
Rales, I, 538.
Rallus, I, 538.
Ramado, II, 232.
Ramphastos, I, 460.
Ramphe (Ramphus), V, 85.
Ramphomyies (Ramphomyia), V, 460.
Rana, II, 102.
Ranatres (Ranatra), V, 207.
Ranelles (Ranella), III, 104.
Raniceps, II, 336.
Ranines (Ranina), IV, 69.
Raphidies (Raphidia), V, 253.
Raphium (Raphium), V, 472.
Rascasses, II, 165.
Rasoir, II, 277.
Rasons, II, 262.
Rate, I, 56.
Ratels, I, 142.
Rat d'eau, I, 206.
Ratons, I, 137.
Rats, I, 195.
Rats-Taupes, I, 210.
Recurvirostra, I, 533.
Reduves (Reduvius), V, 202.
Reebock, I, 269.
Regulus, I, 389.
Reins, I, 56.
Rembes (Rembus), IV, 404.
Rémipèdes (Remipes), IV, 75.
Remiz, I, 403.
Renards, I, 151.
Renilles (Renilla), III, 319.
Reophage (note), III, 24.
Reproduction, I, 15.
Reptiles, Il, 1.
Requins, II, 387.
Rétépores (Retepora), III, 316.
Rhabdites (note), III, 21.
Rhagies (Rhagium), V, 130.
Rhamnusies (Rhamnuisium), V, 130.
Rhamphocèles (note), I, 368.
Rhamphocène (note), I, 374.
Rhenne, I, 261.
Rhesus, I, 96.
Rhina, II, 396.
Rhinchobdelles (Rhinchobdella) II, 204.
Rhinelles, II, 112.
Rhines (Rhina), V, 88.
Rhingies (Rhingia), V, 499.
Rhinobates (Rhinobatus), II, 395.
Rhinocéros, I, 247.
Rhinolophes (Rhinolophus), I, 118.
Rhinopirus (note), II, 80.
Rhinopomes, I, 109.
Rhinosime (Rhinosimus), V, 50.
Rhinotrague (Rhinotragus), V, 119.
Rhinoties (Rhinocia), V, 74.
Rhipiceres (Rhipicera), IV, 460.
Rhipidies (Rhipidia), V, 445.
Rhipipterès (Rhipiptera), IV, 325, et V, 424.
Rhisotrogues (Rhisotrogus), IV, 561.
Rhizophyzes (Rhizophyza), III, 287.
Rhizostomes (Rhizostoma), III, 278.
Rhodocrinites, III, 230.
Rhombilles, IV, 43.
Rhombus, II, 340.
Rhynchaenes (Rhychaenus), V, 83.
Rhynchapsis (note), I, 574.
Rhynchées (Rynchæa), I, 525.
32*
[page] 492
Rhynchène (propre), V, 84.
Rhynchobothrium, III, 271.
Rhynchoprion, IV, 288.
Rhynchops, I, 560.
Rhyphes (Rhyphus), V, 448.
Rhysodes (Rhysodes), IV, 487.
Rhyssonotes (Rhyssonotus), IV, 578.
Rhyzophages (Rhysophagus), V, 96.
Richards, IV, 446.
Ricins (Ricinus), IV, 344.
Rimulines de (note), III, 24.
Ripiphores (Ripiphorus), V, 55.
Rissoaires (Rissoa), III, 83.
Ritbock (note), I, 270.
Rizæna, I, 158.
Robulines (note), III, 23.
Rochers, III, 102.
Rocinèles (Rocinela), IV, 134.
Roitelets ou Figuiers, I, 389.
Rolles, I, 425
Rolliers, I, 424.
Rolowai, I, 92.
Rongeurs, I, 68.
Ropalomères (Ropalomera), V, 520.
Rophites (Rophites), V, 346.
Rorqual, I, 298.
Rosalines (note), III, 24.
Rosse, II, 275.
Rossignol, I, 384.
Rotalies (note), III, 22.
Rotalite (note), III, 22.
Rotella, III, 73.
Rotengles, II, 276.
Rotifères, III, 323.
Rouge-gorge, I, 384.
Rouge-queue, I, 384.
Rouget, II, 157.
Rouleaux, II, 76.
Roulettes, III, 73.
Roussettes, I, 113 et 579.
Roussettes, II, 386.
Roux, I, 163.
Rubans, II, 221.
Rubiettes, I, 383.
Ruminans, I, 68 et 254.
Rupicola, I, 392.
Rutèles (Rutela), IV, 553.
Rynchophores (Rynchophora), V, 69.
Rypticus, II, 144.
Rytina, I, 284.
S.
Sabellæ Astartæ (note), III, 192.
Sabellae Spirographes (note), III, 193.
Sabellaires (note), III, 194.
Sabelles (note), III, 192.
Sabots, III, 75.
Saccopharynx, II. 355.
Sagres (Sagra), V, 133.
Sagouin, I, 103.
Saïga, I, 268.
Saïmiris, I, 103.
Sajou, I, 102.
Saki, I, 103.
Sula, I, 563.
Salamandres (Salamandra), II, 113.
Salangane, I, 396.
Salanx, II, 284.
[page] 493
Salarias, II, 238.
Saldes (Salda), V, 198.
Salmlet, II, 305.
Salpa (note), III, 163; III, 240.
Saltatoria, V, 179.
Saltigrades, IV, 261.
Saltiques (Salticus), IV, 264.
Saluth, II, 291.
Samalia (note), I, 426.
Sang, I, 22.
Sandalus (Sandalus), IV, 460.
Sanderlings, I, 526.
Sandres, II, 138.
Sanglier, I, 243.
Sangsues, III, 212.
Sanguinolaires (Sanguinolaria), III, 158.
Sanguisuga, III, 213.
Sapajous, I, 99.
Saperdes (Saperda), V, 126.
Saphylins (Saphylinus), IV, 431.
Sapromyzes (Sapromyza), V, 527.
Sapyges (Sapyga), V, 319.
Sarcelles, I, 577.
Sarcinules, III, 315.
Sarcophages (Sarcophaga), V, 516.
Sardes (Sarda), II, 199.
Sargues (Sargus), II, 181; V, 487.
Sarigues, I, 175.
Saropodes (Saropoda), V, 355.
Sarruba (note), II, 57.
Saturnie (Saturnia), V, 399.
Satyres (Satyrus), V, 383.
Savacous, I, 509.
Savary, II, 247.
Savonniers, II, 144.
Saumons (Salmo), II, 302.
Saue, II, 185.
Sauriens, II, 16.
Saurophis, II, 66.
Saurothera (note), I, 454.
Saurus (Saurus), II, 313.
Sauterelles, V, 180.
Sauteurs, V, 179.
Sauvegardes, II, 28.
Saxicaves (note), III, 162.
Saxicola, I, 382.
Scalaires (Sacalaria), III, 77.
Scalops, I, 132
Scaphidie (Scaphidium), IV, 502.
Scalpellum (note), III, 176.
Scaphinotes (Scaphinotus), IV, 410.
Scaphures (note), V, 184.
Scarabes, III, 49.
Scarabées (Scarabæus), IV, 530.
Scares (Scarus), II, 264.
Scarites (Scarites), IV, 383.
Scatophages (Scatophaga), V, 524.
Scatopses (Scathopse), V, 452.
Scaures (Scaurus), V, 12.
Scelions (Scelion), V, 302.
Scelotes (note), II, 65.
Scheltopusick, II, 69.
Schermaus, I, 206.
Schillécs, II, 291.
Scienes (Sciæna), II, 171.
Scienoïdes, II, 171 et suiv.
Scinques (Scincus), II, 61.
Scirpéaires, III, 319.
Sciurus, I, 192.
Sclerostomes, III, 254.
Scolepèdes (note), III, 204.
Scoletome (note), III, 204.
Scolex (Scolex), III, 273.
Scolies (Scolia), V, 317.
[page] 494
Scolopax, I, 518.
Scolopendres, IV, 335.
Scolople (note), III, 204.
Scolopsides (Scolopsides), II, 178.
Scolytes (Scolytus), V, 91.
Scombres, II, 196.
Scopèles (Scopelus), II, 314.
Scorpènes (Scorpena), II, 165.
Scorpions (Scorpio), IV, 267.
Scorpions aquatiques, V, 205.
Scops, I, 346.
Scopus, I, 515.
Scotines (Scotinus), V, 18.
Scotobies (Scotobius), V, 12.
Scutellerès (Scutellera), V, 193.
Scutelles, III, 235.
Scutibranches, III, 36, III, 110.
Scutigeres (Scutigera), IV, 337.
Scydmènes (Scydmænus), IV, 489.
Scyllares (Scyllarus), IV, 79.
Scyllées (Scyllæa), III, 54.
Scyllium, II, 386.
Scymnus, II, 392.
Scytates, II, 79, II, 95.
Scyres (Scyris), II, 209.
Scythrops, I, 456.
Scytodes (Scytodes), IV, 242.
Sebastes (Sebastes), II, 166.
Sécrétions, I, 24.
Sécurifera, V, 268.
Sédentaires (note), III, 189.
Ségestries (Segestria), IV, 240.
Seiches, III, 11.
Selache, II, 390.
Selaciens, II, 383.
Semblides (Semblis), V, 252.
Semnopithèques, I, 93.
Senelopes (Senelops), IV, 253.
Sépedons (Sepedon), V, 529.
Sepia, III, 11.
Sépidies (Sepidum), V, 13.
Sépioles, III, 15.
Sepiotheutes, III, 16.
Seps (Seps), II, 63.
Sepsis (Sepsis), V, 532.
Septaires, III, 88.
Serapties (Seraptia), V, 58.
Sérées (note), III, 321.
Serialaires, III, 301.
Sérialopores, III, 314.
Séricaires (Sericaria), V, 404.
Sericomyies (Sericomyia), V, 492.
Serioles (Seriola), II, 205.
Seriques (Serica), IV, 562.
Seroles (Serolis), IV, 132.
Serotine, I, 121.
Serpens nus, II, 98.
Serpentarius ou Gypogeranus, I, 338.
Serpes, II, 309.
Serpules (Serpula), III, 190.
Serpulées (note), III, 189.
Serra-Salmes, II, 310.
Serrans (Serranus), II, 139.
Serricornes (Serricornes), IV, 442.
Serropalpes (Serropalpus), V, 45.
Sertulaires (Sertularia), III, 300.
Serval, I, 165.
Seserinus, II, 214.
Sesies (Sesia), V, 392.
Shals, II, 294.
Siagones (Siagona), IV, 380.
Siamang, I, 90.
Sibynes (Síbynes), V, 84.
Sicus (Sicus), V, 460.
Sidjans, II, 223.
Siffleur, I, 576.
Sifilet, I, 427.
[page] 495
Sigalphes (Sigalphus), V, 290.
Siganus, II, 223.
Sigarets (Sigaretus), III, 90.
Signes, I, 42.
Silicaires (Siliquaria), III, 209.
Silis (Silis), IV, 471.
Sillago, II, 149.
Silpha, IV, 495.
Silure (Silurus), II, 290.
Silvains (Silvanus), V, 100.
Silvie (Silvius), V, 477.
Simia, I, 86.
Simulies (Simulium), V, 452.
Singes, I, 86.
Sinodendres (Sinodendron), IV, 576.
Siphonaires (Siphonaria), III, 89.
Siphonostomes (note), III, 102.
Siphonostomes (Siphonostoma) IV, 189.
Siponcles (Siponclus), III, 242.
Sirènes (Siren), II, 120.
Sirex (Sirex), V, 278.
Sirli, I, 401.
Sirons (Siro), IV, 282.
Siserin, I, 410.
Sisyphes (Sisyphus), IV, 534.
Sitanes (Sitana), II, 43.
Sitaris (Sitaris), V, 68.
Sitta, I, 428.
Sittasomus (add.), I, 583.
Sittelles, vulg. Torchepots, I, 428.
Sittines, I, 429.
Slepetz, I, 210.
Smarides (Smaridia), IV, 287.
Smaris, II, 187.
Smérinthes (Smerinthus), V, 391.
Smynthures (Smynturus), IV, 343.
Solarium, III, 75.
Soldanies (note), III, 24.
Solecurte (note), III, 158.
Solémyes, III, 155.
Solénostomes, II, 363.
Solens (Solen), III, 157.
Soles (Solea), II, 343.
Solipèdes, I, 251.
Somniosus (note), II, 393.
Sons, I, 42.
Sorcière, II, 353.
Sorex, I, 126.
Souchets, I, 574.
Soui-Mangas, I, 433.
Soulcie, I, 413.
Souslik, I, 197.
Sourdon, III, 145.
Souris, I, 201.
Spalangies (Spalangia), V, 299.
Spalax, I, 210.
Sparasions (Sparasion), V, 302.
Sparedres (Sparedrus), V, 48.
Spares, II, 181.
Sparoides, II, 180.
Spatangues (Spatangus), III, 237.
Spatularia, II, 380.
Spatules, I, 517.
Spécifiques, I, 29.
Spectre (Spectrum), V, 178.
Sperchés (Spercheus), IV, 521.
Spermagra (add.), I, 582.
Sperme, I, 39.
Sphærocères (Sphærocera), V, 523.
Sphærodères (Sphœroderus), IV, 410.
Sphærotes (Spærotus), V, 38.
Sphagebranches (Sphagebranchus), II, 353.
Sphécomyies (Sphecomyia), V, 495.
[page] 496
Sphecothère (note), I, 355.
Sphégines (Sphegina), V, 497.
Sphénisques (Spheniscus), I, 551, V, 37.
Sphéridies (Sphæridium), IV, 525.
Spheriodactyles, II, 57.
Spherites (Sphærites), IV, 495.
Spheroïdines (note), III, 25.
Spheromes (Sphæroma), IV, 137.
Spherulites, III, 120.
Sphex (Sphex), V, 317, V, 320.
Sphinx (Sphinx), V, 388.
Sphodres (Sphodrus), IV, 400.
Sphyrènes (Shyræna), II, 156.
Sphyrious, III, 257.
Sphyrna, II, 393.
Spinax, II, 291.
Spio (note), III, 189; III, 203.
Spiramelles (note), III, 192.
Spiratelle (note), III, 28.
Spirifères (Spirifera), III, 172.
Spirlin, II, 276.
Spirobranches (Spirobranchus), II 229.
Spirolines (note), III, 23.
Spiroloculines (note), III, 25.
Spiroptères, III, 253.
Spirules (Spirula), III, 17.
Spondyles (Spondylis), V, 106.
Spondyles (Spondylus), III, 127.
Spongia, III, 321.
Springbock, I, 268.
Syma (add.), I, 584.
Squales (Squalus), II, 385.
Squammipennes, II, 188.
Squatarola, I, 502.
Squilles (Squilla), IV, 108.
Stephylins, propres, IV, 434.
Stelides (Stelis), V, 351.
Stellères, I, 284.
Stellions (Stellio), II, 32.
Stemmatopes, I, 169.
Stenelytres (Stenelytra), V, 33.
Steneosaurus (note), II, 20.
Sténépteryx, V, 544.
Stenocionops (Stenocionops), IV, 59.
Stenodactyles, II, 58.
Stènodères (Stenoderus), V, 130.
Stenolophes (Stenolophus), IV, 391.
Stenopes (Stenopus), IV, 93.
Stenoptère (Stenopterus), V, 120.
Stenorhynques (Stenorhynchus), IV, 64.
Stenosomes (Stenosoma), IV, 139.
Stenostona, II, 73.
Stenostomes (Stenostoma), V, 49.
Stenotracheles (Stenotrachelus) V, 40.
Stéphanes (Stéphanus), V, 285.
Stephanomies (Stephanomia), III, 288.
Stercoraires, I, 557.
Sterna, I, 558.
Sternaspis, III, 245.
Sternoptix, II, 315.
Sternoxes (Sternoxi), IV, 444.
Stéropes (Steropes), V, 58.
Stilbe (Stilbum), V, 304.
Stomapodes (Stomapoda), IV, 16, IV, 101.
Stomates (Stomatia), III, 111.
Stomias, II, 283.
Stomis (Stomis), IV, 398.
Stomoxes (Stomoxis), V, 506.
Stratiomes (Stratiomys), V, 484.
Strebles (Strebla), V, 544.
[page] 497
Strepsilas, I, 529.
Strigées (Strigea), III, 263.
Strigocephales (note), III, 173.
Strix, I, 340.
Strobiliphaga (note), I, 415.
Stromatés (Stromateus), II, 212.
Strombes (Strombus), III, 107.
Strongles (Strongylus), III, 252.
Strongylies (Strongylium), V, 40.
Strophostome (note), III, 41.
Sturnus, I, 419.
Sturoniens, II, 378.
Stygides (Stygides), V, 465.
Stygies (Stygia), V, 398.
Stylaria (note), III, 211.
Stylephores (Stylephorus), II, 220.
Stylines, III, 315.
Stymes (Stymus), V, 330.
Sublets, II, 260.
Subulicornes, V, 235.
Succinea, III, 44; IV, 349; II, 402.
Suceurs (Cyclostomes), II, 402.
Suceurs (Suctoria), IV, 323, 349.
Sucriers, I, 432.
Sudis, II, 327.
Suricates, I, 158.
Surmulet, II, 157.
Surmulot, I, 201.
Sybistromes (Sybistroma), V, 471.
Syderolines (note), III, 23.
Sygalions III, 207.
Syllis, III, 203.
Sylvia, I, 383.
Synagres (Synagris), V, 335.
Synallaxes (Synallaxis), I, 430.
Synancées (Synancea), II, 169.
Synaphes (Synapha), V, 450.
Synbranches (Synbranchus), II, 354.
Synchites (Synchita), V, 95.
Syndactyles, I, 441.
Syndeses (Syndesus), IV, 580.
Synetheres, I, 216.
Syngnathes (Syngnathus), II, 362.
Synodontis, II, 294.
Synodus (Synodus), IV, 135.
Syntomides (Syntomis), V, 394.
Syphostoma, III, 196.
Syrnium, I, 342.
Syrphe (Syrphus), V, 491.
Syrrhaptes, I, 487.
Système des vaisseaux, I, 55.
Systis (Systis), V, 200.
Systropes (Systropus), V, 505.
Systrophes (Systrophe), V, 345.
T.
Tabaniens (Tabanides), V, 474.
Tabanus, V, 474.
Tachines (Tachina), V, 515.
Tachines (Tachinus), IV, 441.
Tachydromes (Tachydromus), I, 504; II, 31.
Tachyglosus, I, 235.
Tachyphonus (note), I, 367.
Tachypores (Tachyporus), IV, 442.
Tadornes, I, 575.
Taenia (Taenia), III, 268.
Taenioïdes, II, 217.
Tagnicati, I, 245.
Taguan, I, 194.
Taïra, I, 141.
Talapoin, I, 92.
Talèves ou Poules sultanes, I, 539.
[page] 498
Talitres (Talitrus), IV, 119.
Talpa, I, 130.
Tamandua, I, 232.
Tamanoir, I, 231.
Tamarin, I, 106.
Tamatias (Tamatia), I, 458.
Tambours, II, 174.
Tamnophiles (Tamnophilus), V, 83.
Tanagra, I, 366.
Tanches, II, 273.
Tanegies (Tanegia), V, 12.
Tangaras, I, 366.
Tantales (Tantalus), I, 516.
Tanypes (Tanypus), V, 442.
Tanystomes (Tanistoma), V, 454.
Taons, V, 474.
Tapayes, II, 37.
Taphiens, I, 119.
Taphosous, I, 119.
Taphries (Taphria), IV, 401.
Tapirs, I, 250, I, 581.
Tapissières, IV, 236.
Tarayaxin, II, 37.
Tardigrades, I, 223.
Tarentule (Tarantula), IV, 265.
Tarets, III, 159.
Targeur, II, 341.
Tarier, I, 382.
Tarières, III, 94.
Tarin, I, 411.
Tarsiers, I, 109.
Tartarin, I, 98.
Tassade (note), III, 44.
Tanisiptera (note), I, 444.
Tassards, II, 199.
Tatous, I, 226.
Tauprouge (note), I, 129.
Taupes, I, 130; I, 580.
Tain, IV, 449.
Taxicornes, V, 26.
Tchicarra, I, 273.
Tchincou, I, 94.
Tectaires, III, 73.
Tectibranches, III, 58; III, 35.
Tefflus (Tefflus), IV, 410.
Teignes, V, 421.
Teius (note), II, 27.
Télagon, I, 147.
Téléas (Teleas), V, 302.
Teleosaurus (note), II, 20.
Téléphores (Telephorus), IV, 470.
Telesto (note), III, 299.
Tellines (Tellina), III, 147.
Telyphones (Telyphonus), IV, 266.
Temia, I, 424.
Temnodons, II, 206.
Tendrac, I, 125.
Tenebrion (Tenebrio), V, 22.
Tengyres (Tengyra), V, 318.
Tenioïdes, III, 268.
Tenrees, I, 125.
Tentaculaires, III, 271.
Tenthredes (Tenthredo), V, 269.
Tenuirostres, I, 428.
Tentyries (Tentyria), V, 9.
Téphrites, V, 534.
Terebelles (Terebella), III, 193.
Terebellum, III, 94.
Terebra, III, 101.
Térébratules (Terebratula), III, 171.
Térédines (Teredina), III, 161.
Teredo, III, 159.
Tergipes, III, 56.
Termites (Termita), V, 254.
Terrapène (note), II, 12.
Tersines (Tersina), I, 363.
Tèssarops (Tessarops), IV, 263.
[page] 499
Tesseratomes (Tesseratoma), V, 195.
Testacelles (Testacella), III, 39.
Testicules, I, 39.
Testudo, II, 8.
Tetanocères (Tetanocera), V, 529.
Tétanops (Tetanops), V, 533.
Tetragnathes (Tetragnatha), IV, 247.
Tétragonoptères (Tetragonopterus), II, 310.
Tetragonodères (Tetragonoderus), IV, 393.
Tetragonurus, II, 233.
Tetragule (note), III, 255.
Tetralasmis, III, 177.
Tetraptures (Tetrapturus), II, 201.
Tetraonix (Tetraonyx), V, 66.
Tetrarinques (Tetrarhynchus), III, 271.
Tétras (Tetrao), I, 480.
Tetratomes (Tetratoma), V, 31.
Tetrodons (Tetraodon), II, 368.
Tettigones (Tettigonia), V, 223.
Textulaires (note), III, 25.
Thaïs (Thais), V, 377.
Thalassèmes (Thalassema), III, 244.
Thalassianthes, III, 293.
Thalassine (Thalassina), IV, 86.
Thalia, III, 163.
Thanasimes (Thanasimus), IV, 478.
Thecadactyles, II, 55.
Thécidées (Thecidea), III, 173.
Thelethuses (note), III, 197.
Thelphuses (Thelphusa), IV, 43.
Thephritis, V, 534.
Therapons, II, 148.
Therates (Therates), IV, 364.
Thérèves (Thereva), V, 468.
Theridions (Theridions), IV, 243.
Théthyes (Thethya), III, 321.
Théthys (Thethys), III, 53.
Theutyes, II, 222.
Thies (Thia), IV, 38.
Thimalia (note), I, 373.
Thinnus, II, 197.
Thiroptera, I, 116.
Thoea, III, 302.
Thons, II, 197.
Thoracantes (Thoracantha), V, 297.
Thrips (Trips), V, 226.
Thrisses (Thryssa), II, 323.
Throsque (Throscus), IV, 452.
Thylacines, I, 178.
Thymales (Thymalus), IV, 504.
Thymallus, II, 306.
Thynnes (Thynnus), V, 319.
Thyréophores (Thyreophora), V, 522.
Thyrides (Thyris), V, 392.
Thyrsites, II, 200.
Thysanoures (Thysanoura), IV, 339.
Tibianes, III, 299.
Tichodroma, I, 431.
Tigre, I, 161.
Tilles (Tillus), IV, 476.
Timarches (Timarcha), V, 150.
Timia, V, 536.
Timoriennes, III, 69.
Tinca, II, 273.
Tinamous (Tinamus), I, 487.
Tinea, V, 421.
Tingis (Tingis), V, 201.
Tiphies (Tiphia), V, 318.
Tipules propres (Tipula), V, 444.
Tipulus (Tipula), V, 440.
Tisiphone (note), II, 89.
Tisserins, I, 406.
[page] 500
Tityra (note), I, 354.
Tmesisternes (Tmesisternus), V, 121.
Todiers, I, 445.
Todiramphes (add.), I, 584.
Todus, I, 445.
Tomiques (Tomicus), V. 92.
Tomogères (note), III, 41.
Tones, III, 99.
Toque, I, 95.
Torcols, I, 452.
Tordeuses, V, 411.
Tornatelles, III, 84.
Torquatrix (note), II, 76.
Torpilles (Torpedo), II, 396.
Torticelle (note), I, 487.
Tortrix, II, 76.
Tortues, II, 8 et suiv.
Totanus, I, 529.
Totipalmes, I, 560.
Touan, I, 177.
Toucans, I, 460.
Toucnam-Courvi, I, 406.
Touilles, II, 388.
Toupies, III, 73.
Touracos, I, 467.
Tourne-Pierres, I, 529.
Tourterelles, I, 490.
Toxiques (Toxicum), V, 24.
Toxophores (Toxophora), V, 462.
Toxotes, II, 195.
Tracheennes (Tracheariæ), IV, 271.
Trachées, I, 36.
Trachelides, V, 51.
Trachichtes (Trachichtys), II, 151.
Trachinotes, II, 204.
Trachinus, II, 152.
Trachydères, V, 112.
Trachynotes (Trachynotus), V, 14.
Trachyscèles (Trachyscelis), V, 30.
Tragocères (Tragocerus), V, 121.
Tragopan (Tragopan), I, 479.
Tragopes (Tragopa), V, 219.
Trapellus, II, 37.
Trapésies (Trapesia), IV, 41.
Traquets, I, 382.
Trechus (Trechus), IV, 420.
Tremadotes, III, 262.
Treron (note), I, 492.
Triacanthes, II, 374.
Trichechus, I, 170.
Trichies (Trichius), IV, 570.
Trichiures (Trichiurus), II, 218.
Trichocephales (Trichocephalus), III, 249.
Trichocères (Trichocera), V, 446.
Trichodes, III, 325.
Trichodons, II, 149; II, 370.
Trichoglossus (note), I, 463.
Trichognathes (Trichognatha), IV, 374.
Trichopodes, II, 228.
Trichocerques, III, 324.
Trichostomes, III, 249.
Tricondyles (Tricondyla), IV, 365.
Trichonotes (Trichonotus), II, 248.
Tricuspidaires (Tricuspidaria), III, 270.
Tridacnes, III, 141.
Tridactyles (Tridactylus), V, 182; 1, 486.
Trigles (Trigla), II, 158.
Trigonies, III, 134.
Trigonocephales, II, 88.
Trilobites (Trilobites), IV, 202.
Triloculines (note), III, 25.
Trimeresures, II, 95.
Tringa, I, 525.
Trionix, II, 15.
[page] 501
Triphylles (Triphillus), V, 98.
Triplax (Triplax), V, 157.
Tristome (Tristoma), III, 265.
Triptère (note), III, 29.
Triton, II, 116; III, 174.
Tritonies (Tritonia), III, 52.
Trixes (Trixa), V, 511.
Trocheties, III, 215.
Trochilus, I, 435.
Trochoïdes, III, 72.
Trochus, III, 73.
Troglodytes (Troglodites), I, 390.
Trogodermes (Trogoderma), IV, 511.
Trogosites (Trogosita), V, 100.
Trogon, I, 458.
Trogules (Trogulus), IV, 282.
Trombidions (Trombidium), IV, 284.
Tromises (Tromisas), IV, 255.
Troncatulines (note), III, 24.
Tropidolepis, II, 38.
Tropidosaurus, II, 38.
Troupiales, I, 417.
Trox (Trox), IV, 547.
Truite de mer, II, 303.
Truxales (Truxalis), V, 186.
Trygon, II, 399.
Trypoxilons (Tripoxilon), V, 329.
Tubicènes (Tubicenus), V, 74.
Tubicolaires (Tubicolaria), III, 324.
Tubicoles, III, 187.
Tubifex (note), III, 212.
Tubipores (Tubipora, III, 298.
Tubiteles, IV, 236.
Tubulaires, III, 259.
Tubulaires (Tubularia), III, 299.
Tubulibranches, III, 108.
Tubulipores (Tubulipora), III, 305.
Tuniciers (note), III, 162.
Tupinambis, II, 24.
Turbinelles (Turbinella), III, 106.
Turbinolies, III, 313.
Turbinolopses, III, 313.
Turbots, II, 340; III, 75.
Turdus, I, 368.
Turnix, I, 486.
Turritelles (Turritella), III, 77.
Tylode (Tylode), V, 87.
Tylos (Tylos), IV, 141.
Typhis (Typhis), IV, 124.
Typhlops (Typhlops), II, 73.
Tyrannula (add.), I, 582.
Tyrans (Tyrannus), I, 356.
Tyrsé. II, 15.
U.
Ucas (Uca), IV, 49.
Uléïotes (Uleiota), V, 102.
Ulobores (Uloborus), IV, 246.
Uloceres (Ulocerus), V, 75.
Ultimes (note), III, 94.
Ulula, I, 342.
Umbrina, II, 174.
Unau, I, 225.
Unibranchaperture, II, 354.
Unicuirassés, IV, 107.
Unio, III, 138.
Unipeltata, IV, 107.
Upeneus, II, 157.
Upis (Upis), V, 25.
Upupa, I, 438.
Uranies (Urania), V, 387.
Uranoscopes (Uranoscopus), II, 153.
[page] 502
Urceolaires, III, 325.
Uria, I, 547.
Urine, I, 38.
Uromastix, II, 34.
Uropodes (Uropoda), IV, 286.
Ursons, I, 216.
Ursus, I, 135.
Urubitinga, I, 330.
Urubu, I, 317.
Usies (Usia), V, 463.
Uterus, I, 39.
Uvigerines (note), III, 24.
V.
Vaginales (Vaginalis), I, 541.
Vaginicoles, III, 324.
Vaginules (Vaginulus), III, 39.
Vaginulines (note), III, 24.
Vaisseaux, I, 22.
Valvées (Valvata), III, 78.
Valvulines (note), III, 24.
Vanellus, I, 502.
Vanesses (Vanessa), V, 380.
Vandoise, II, 275.
Vanga, I, 353.
Vampire, I, 117.
Vanneaux, I, 502.
Vappons (Vappo), V, 487.
Varanus (note), II, 26.
Vari, I, 107.
Variétés, I, 16.
Varioles, II, 133.
Vastrès, II, 327.
Vautourin, I, 316.
Vautours, I, 314.
Veine porte I, 56.
Vélates, III, 86.
Vélelles (Velella), III, 284.
Vélies (Velia), V, 204.
Vemme, II, 307.
Venturon, I, 411.
Venus (Venus), III, 149.
Verdier, I, 413.
Vérétilles (Veretillum) III, 319.
Verge, I, 39.
Vermets (Vermetus), III, 108.
Vermilies, III, 109.
Veron, II, 276.
Veronicelle (note), III, 39.
Vers à sang rouge, III, 182.
Vertébralines (note), III, 23.
Vertébrés, I, 48.
Vertébrés ovipares, I, 299.
Vervet, I, 92.
Vespertilio, I, 112.
Vespertillons, I, 120.
Vesperus (Vesperus), V, 129.
Vespa, V, 334.
Vessie, I, 56.
Veuves, I, 412.
Vibrions (Vibrio), III, 326.
Vidua, I, 412.
Vieille, II, 256.
Vigogne, I, 258.
Vinago, I, 492.
Vipères (Vipera), II, 90.
Viperine, II, 84.
Viréons (note), I, 351.
Virgulaires, III, 318.
Virgalincs (note), III, 25.
Vernes, I, 35.
Viscache, I, 222.
Vitrines (Vitrina), III, 42.
Vives, II, 152.
Viverra, I, 154.
Voiliers, II, 202.
Volonté, I, 42.
[page] 503
Volucelles (Volucella), V, 491.
Volutes (Voluta), III, 94.
Volvaires (Volvaria), III, 95.
Volvoces (Volvox), III, 327.
Vomer, II, 209.
Vorticelles (Vorticella), III, 296.
Vouroudrious, I, 455.
Vrillettes, IV, 483.
Vulselles (Vulsella), III, 128.
Vultur, I, 314.
Vulve, I, 39.
Vulvulines (note), III, 25.
X.
Xanthornus, I, 418.
Xenopeltis, II, 81.
Xestomyzes (Xestomyza), V. 463.
Xilophages (Xilophagi), V, 89.
Xilophiles (Xilophilus), V, 73.
Xiphias, II, 200.
Xiphorhynchus (add.), I, 583.
Xiphosoma (note), II, 79.
Xiphydries (Xiphydria), V, 277.
Xirichthys, II, 262.
Xistères (note), II, 194.
Xorides (Xorides), V, 285.
Xyèles (Xyela), V, 277.
Xylocopes (Xylocopa), V, 346.
Xylophages (Xylophagus), V, 481.
Xyphosures (Xyphosura), IV, 184.
Xystes (Xysta), V, 514.
Xytelines (Xytelinus), IV, 483.
Y.
Yarké, I, 103.
Ynambus, I, 487.
Yponomeutes (Yponomeuta), V, 422.
Yunx, I, 452.
Z.
Zabres (Zabrus), IV, 392.
Zèbre, I, 253.
Zélimes (Zelima), V, 376.
Zelus (Zelus), V, 203.
Zemni, I, 210.
Zenik (note), I, 158.
Zerda, I, 153.
Zeus, II, 210.
Zeuzères (Zeuzera), V, 399
Zibeth, I, 155.
Zirophores (Zyrophorus), IV, 438.
Zizel, I, 197.
Zoanthes (Zoanthus), III, 293.
Zoarcès, II, 240.
Zoés (Zoca), IV, 152.
Zocor, I, 207.
Zodions (Zodion), V, 506.
Zonitis (Zonitis), V, 67.
[page] 504
Zophoses (Zophosis), V, 8.
Zoophytes, III, 218.
Zosterops (note), I, 388.
Zuphies (Zuphium), IV, 237.
Zuzares (Zuzara), IV, 137.
Zygaena, II, 393.
Zygènes (Zygaena), V. 393.
Zygies (Zygia), IV, 474.
Zygnis (note), II, 64.
Zygops (Zygops), V, 86.
FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DE L'OUVRAGÉ.
[page break]

[page break]
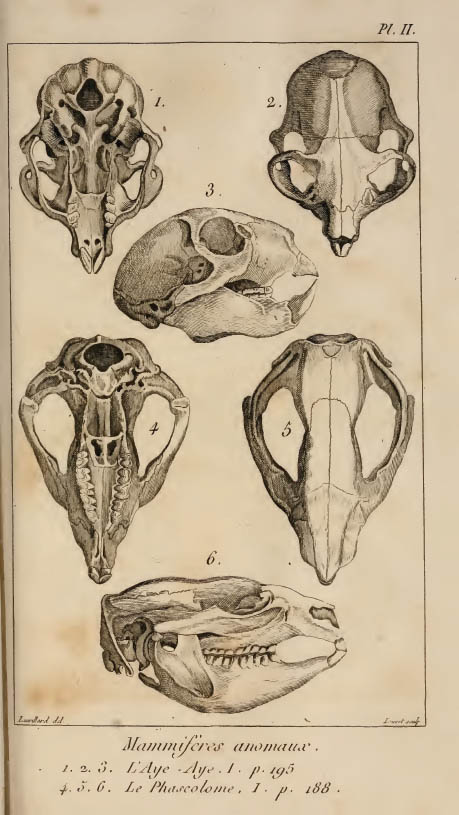
[page break]
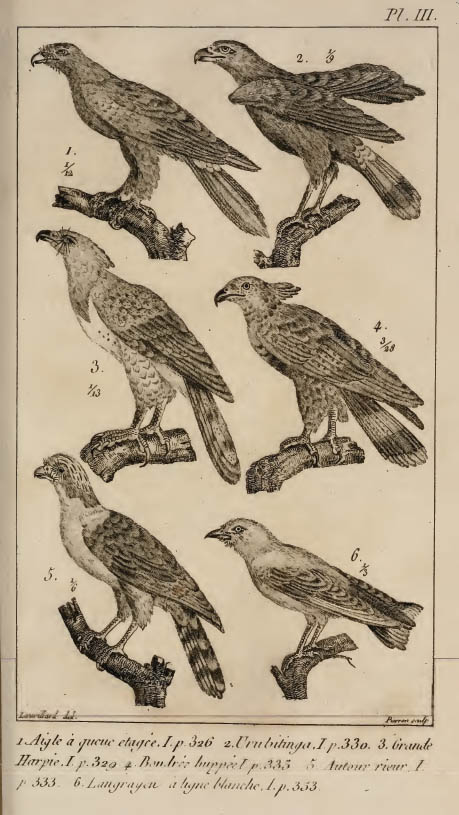
[page break]
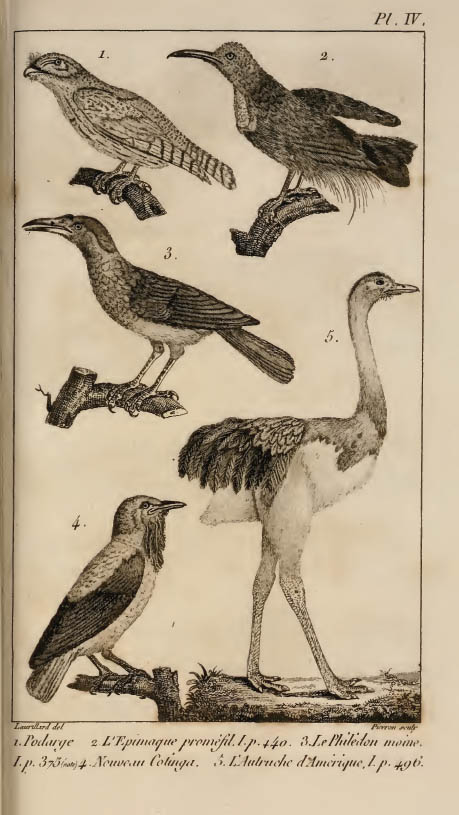
[page break]

[page break]
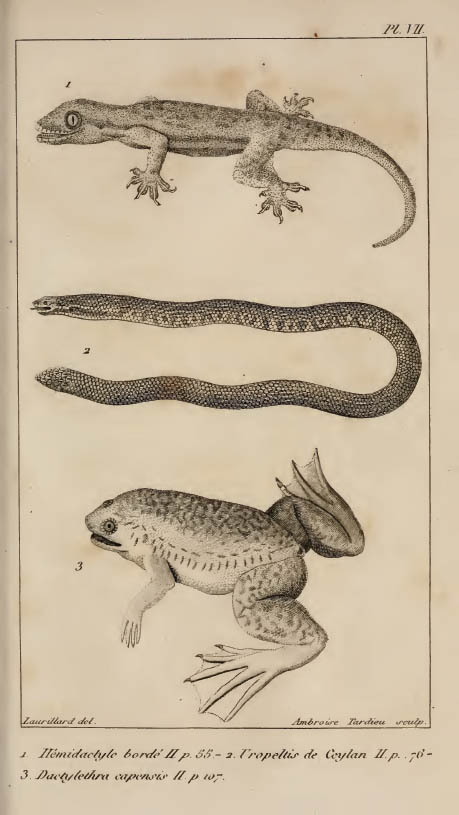
[page break]

[page break]

[page break]
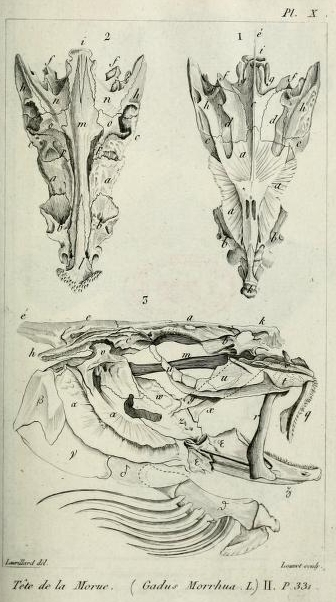
[page break]
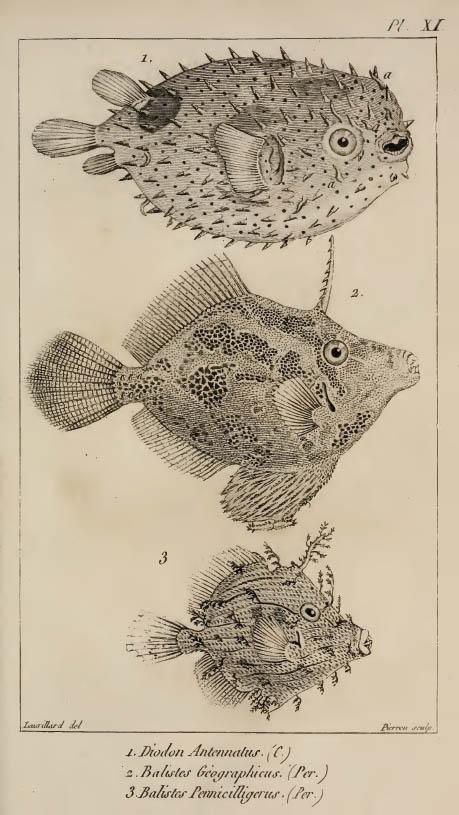
[page break]
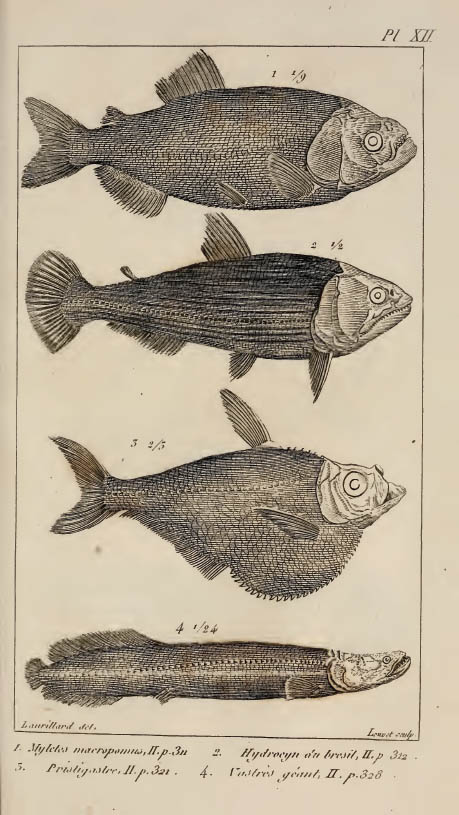
[page break]

[page break]

[page break]

[page break]
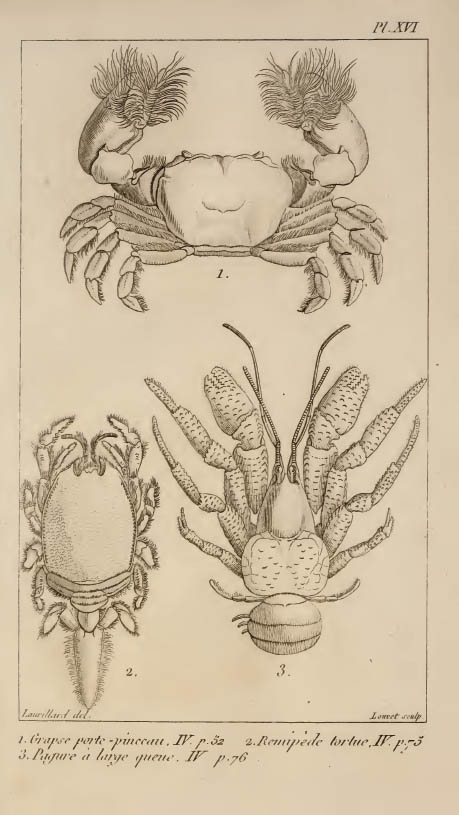
[page break]

[page break]
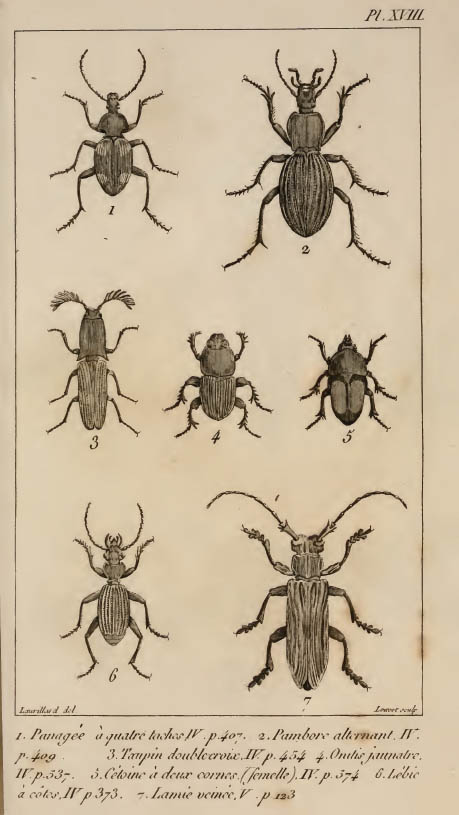
[page break]
